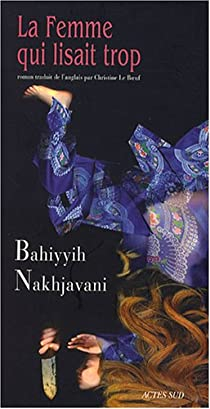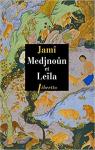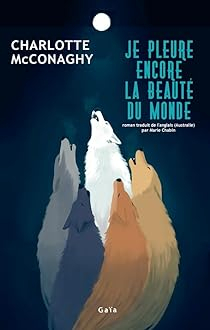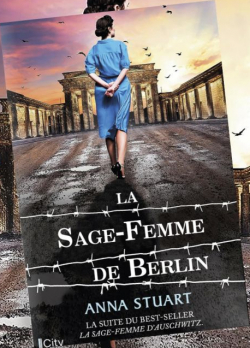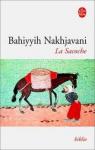Bahiyyih Nakhjavani
Christine Le Boeuf (Traducteur)/5 36 notes
Christine Le Boeuf (Traducteur)/5 36 notes
Résumé :
Téhéran, seconde moitié du XIXe siècle: la cour du sha fourmille d'intrigues de palais, complots et autres tentatives d'assassinat, sous le regard cruel de la mère du souverain... Ce très ancien royaume va se trouver ébranlé par l'irruption d'une poétesse fort lettrée dont les vers et les propos semblent agir sur quiconque en prend connaissance comme de puissants catalyseurs d'énergies subversives- voire hérétiques.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La femme qui lisait tropVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (12)
Voir plus
Ajouter une critique
"La femme qui lisait trop" raconte l'histoire d'une poétesse, hérétique, qui vécut dans l'Iran du 19e siècle. On la trouve sous différents noms dont Tahirih (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fatemeh).
Femme + cultivée + maîtrise des textes saints + débat = aucune chance de survie dans cet Iran du 19e (dans celui du 21e, pas mieux, elle est d'ailleurs ignorée dans son pays natal). Emprisonnée puis tuée....
Le livre est bien écrit (jolies tournures), l'héroïne est passionnante. Malheureusement, l'auteure a choisi de raconter son histoire de façon inutilement alambiquée, mettant au final son héroïne beaucoup trop au second plan....
.
Le livre se découpe en 4 parties, racontées par 4 narratrices différentes (la mère du Shah, l'épouse du maire de Téhéran, la soeur du Shah, la fille de la poétesse). Chacune de ces parties suit deux fils narratifs différents situés à deux temporalités différentes.... et franchement on s'y perd... 8 temporalités qui s'entrecroisent et se mêlent, et impossible si telle scène a lieu avant telle autre....
Au final on passe beaucoup de temps dans les arcanes du pouvoir du Shah, mais, à mon goût, pas assez auprès de cette femme si cultivée, si érudite.... dont la philosophie est passée trop sous silence (la religion Ba'hai).
Une pointe de regret....
Femme + cultivée + maîtrise des textes saints + débat = aucune chance de survie dans cet Iran du 19e (dans celui du 21e, pas mieux, elle est d'ailleurs ignorée dans son pays natal). Emprisonnée puis tuée....
Le livre est bien écrit (jolies tournures), l'héroïne est passionnante. Malheureusement, l'auteure a choisi de raconter son histoire de façon inutilement alambiquée, mettant au final son héroïne beaucoup trop au second plan....
.
Le livre se découpe en 4 parties, racontées par 4 narratrices différentes (la mère du Shah, l'épouse du maire de Téhéran, la soeur du Shah, la fille de la poétesse). Chacune de ces parties suit deux fils narratifs différents situés à deux temporalités différentes.... et franchement on s'y perd... 8 temporalités qui s'entrecroisent et se mêlent, et impossible si telle scène a lieu avant telle autre....
Au final on passe beaucoup de temps dans les arcanes du pouvoir du Shah, mais, à mon goût, pas assez auprès de cette femme si cultivée, si érudite.... dont la philosophie est passée trop sous silence (la religion Ba'hai).
Une pointe de regret....
Un beau roman inoubliable une fois la lecture achevée. Je ne dirais pas, toutefois, qu'il soit facile d'accès, l'autrice ayant choisi une narration chronologiquement déstructurée obligeant le lecteur à patiemment reconstituer un puzzle de dizaines de fragments.
Tahirih Qurratu'l-Ayn fut une poétesse persane du XIXème siècle qui eut l'audace de divorcer de son mari, mollah, et d'étudier et discourir à visage découvert avec d'autres érudits, tous hommes. Arrêtée et emprisonnée à Téhéran pendant trois ans, elle fut assassinée sur ordre du shah, ou de sa mère, régente tyrannique tapie dans le harem royal telle une araignée au fond de son trou.
Si la structure du roman peut surprendre et représenter une contrainte, la qualité de la langue et la grandeur du style compensent cet inconfort. Par la voix de quatre femmes de statut différent (mère, épouse, soeur, fille), l'histoire de Tahirih Qurratu'l-Ayn nous parvient tel un écho très contemporain, n'en finissant pas d'interroger sur la place de la femme dans l'Islam mais aussi, plus globalement, dans les sociétés.
Le choix même des quatre voix correspond aux quatre situations reconnues à la femme et en dehors desquelles elle n'est rien aux yeux des hommes, n'ayant acquis aucune légitimité puisque n'ayant aucun rôle qui lui soit profitable à lui.
"La femme qui lisait trop" m'a glacée par la violence omniprésente des moeurs et de la politique iraniennes. J'ai beaucoup appris sur les arcanes du pouvoir et sur le fonctionnement occulte de l'anderoun (le harem). le roman est très coloré, bruyant, bruissant, parfumé, visuel.
Cette lecture fut un dépaysement total, une source instructive, édifiante autant qu'effrayante, sur l'histoire, la sociologie, les mentalités, la philosophie et la religion d'un pays qui nie encore aujourd'hui les libertés fondamentales de millions d'individus.
Challenge PLUMES FEMININES 2023
Challenge MULTI-DEFIS 2023
Tahirih Qurratu'l-Ayn fut une poétesse persane du XIXème siècle qui eut l'audace de divorcer de son mari, mollah, et d'étudier et discourir à visage découvert avec d'autres érudits, tous hommes. Arrêtée et emprisonnée à Téhéran pendant trois ans, elle fut assassinée sur ordre du shah, ou de sa mère, régente tyrannique tapie dans le harem royal telle une araignée au fond de son trou.
Si la structure du roman peut surprendre et représenter une contrainte, la qualité de la langue et la grandeur du style compensent cet inconfort. Par la voix de quatre femmes de statut différent (mère, épouse, soeur, fille), l'histoire de Tahirih Qurratu'l-Ayn nous parvient tel un écho très contemporain, n'en finissant pas d'interroger sur la place de la femme dans l'Islam mais aussi, plus globalement, dans les sociétés.
Le choix même des quatre voix correspond aux quatre situations reconnues à la femme et en dehors desquelles elle n'est rien aux yeux des hommes, n'ayant acquis aucune légitimité puisque n'ayant aucun rôle qui lui soit profitable à lui.
"La femme qui lisait trop" m'a glacée par la violence omniprésente des moeurs et de la politique iraniennes. J'ai beaucoup appris sur les arcanes du pouvoir et sur le fonctionnement occulte de l'anderoun (le harem). le roman est très coloré, bruyant, bruissant, parfumé, visuel.
Cette lecture fut un dépaysement total, une source instructive, édifiante autant qu'effrayante, sur l'histoire, la sociologie, les mentalités, la philosophie et la religion d'un pays qui nie encore aujourd'hui les libertés fondamentales de millions d'individus.
Challenge PLUMES FEMININES 2023
Challenge MULTI-DEFIS 2023
The Woman Who Read Too Much
Traduction : Christine le Boeuf
"La Femme qui lisait trop", au titre à la fois provocateur et ironique, est de ces livres qui, une fois qu'on en a tourné la dernière page, laissent leur lecteur sur les plus hauts sommets de l'imagination, respirant un air si pur qu'on ne se résoud à s'en détourner qu'avec les plus vifs regrets.
Il est dédié à la mémoire de la poétesse persane Tahirih Qurratu'l-Ayn, dont le corps ne fut jamais retrouvé après son assassinat dans l'un des grands jardins situés au nord de Téhéran, durant ce que l'on appela "l'Eté des Massacres", ordonné par la mère du Shah, Mahd-i-Olya, en l'an de grâce 1852.
Fille d'un mollah chiite respecté, la jeune Tahirih fut autorisée par son père, qui l'adorait, à étudier autant que les garçons de la famille. D'une intelligence exceptionnelle, elle dépassa bientôt ses frères et ses cousins, s'attirant par là la haine de son oncle, Muhammad Taqi Baraghani. Bien des années plus tard, elle sera accusée, par le fils de celui-ci (qui était devenu entretemps son mari et dont elle avait divorcé), d'avoir assassiné son oncle et beau-père. Pourtant, un homme se dénoncera volontairement, affirmant qu'il avait assassiné le mollah parce que celui-ci avait manqué de respect à un autre dignitaire religieux, considéré comme un saint homme.
Pendant quelques années, Tahirih, connue également sous le nom de la Poétesse de Qazvîn, fuira de ville en ville, se cachant certes mais souvent invitée à prêcher car, en dépit du machisme de la religion islamique, cette femme, qui avait rejeté le voile et embrassé la Foi babie, finissait toujours par s'attirer le respect de tous. Cette nouvelle doctrine, qui plaidait pour l'amélioration du statut des femmes et des pauvres ainsi que pour l'éducation pour toutes et tous, avait été lancée, dans les années 1840, par un jeune marchand, Siyyid Ali Muhammad, qui avait pris le nom de "Bâb" qui, dans la langue arabe, signifie "Porte" ou "Ouverture."
Pour les mollahs chiites traditionnels - les plus nombreux, on s'en doute - le Bâb et ses partisans, qui voulaient s'attaquer à une tradition au demeurant pré-islamique, n'étaient que des hérétiques. La Poétesse de Qazvîn était donc tout à la fois une femme, une divorcée, une hérétique, et en plus, elle s'était mis en tête d'enseigner lecture et écriture aux femmes. Dans la Perse du XIXème siècle, et bien que, apparemment, le Shah lui-même, fasciné autant par sa beauté que par son intelligence, l'eût protégée aussi longtemps qu'il le put, Tahirih était, par cela même, promise à une mort tragique.
Sa vie et l'Histoire de son pays sont dépeintes ici par des points de vue strictement féminins. le roman est en effet partagé en quatre "livres" : celui de la Mère, où Bahiyyih Nakhjavani expose le point de vue de la mère du Shah, femme de tête et de pouvoir, qui hait la Poétesse uniquement parce qu'elle risque, en fait, de lui voler sa puissance ; celui de l'Epouse, consacré aux rapports qui se tissent peu à peu entre l'épouse du maire de Téhéran, chez qui la Poétesse fut retenue quelque temps prisonnière, et Tahirih ; celui de la Soeur, où l'on fait un peu mieux connaissance avec la soeur du Shah, personnage extrêmement émouvant ; et enfin, le livre de la Fille, placé sous le patronnage de la fille de Tahirih - et de toutes ses autres "filles", ces femmes du monde entier qui ont lutté et luttent encore pour que leurs droits soient enfin reconnus.
L'une des forces de "La Femme Qui Lisait Trop", c'est que, malgré tout ce qui peut les séparer d'elle, toutes ces femmes finissent par se révéler extrêmement proches de la Poétesse de Qazvîn. Avec douceur mais fermeté, l'ombre de Tahirih Qurratu'l-Ayn, sur qui nous savons si peu de choses mais dont on ne peut que sentir l'incontestable charisme tout au long de ces pages, parvient à créer un sentiment d'extraordinaire solidarité. Féminine, évidemment mais sans le souci de revanche des féministes bon-teint.
Qui mieux est, Bahiyyih Nakhjavani part d'une situation précise, la condition de la Femme en terre d'islam, pour dépasser celle-ci et étendre son propos à l'Humanité tout entière. On ne s'en rend pleinement compte que lorsqu'on a terminé le roman - c'est peut-être d'ailleurs pour cette raison qu'on en demeure le coeur si haut - mais l'effet obtenu est impossible à raconter. Il faut le vivre pour le comprendre.
Tout cela en outre magnifiquement écrit, dans une langue à la fois poétique, souple et d'une grande richesse, avec un souffle unique et une saisissante humanité. L'un des plus grands livres que j'ai jamais lus - un livre que méritait amplement celle qui l'inspira et qui aima tant les mots. ;o)
Traduction : Christine le Boeuf
"La Femme qui lisait trop", au titre à la fois provocateur et ironique, est de ces livres qui, une fois qu'on en a tourné la dernière page, laissent leur lecteur sur les plus hauts sommets de l'imagination, respirant un air si pur qu'on ne se résoud à s'en détourner qu'avec les plus vifs regrets.
Il est dédié à la mémoire de la poétesse persane Tahirih Qurratu'l-Ayn, dont le corps ne fut jamais retrouvé après son assassinat dans l'un des grands jardins situés au nord de Téhéran, durant ce que l'on appela "l'Eté des Massacres", ordonné par la mère du Shah, Mahd-i-Olya, en l'an de grâce 1852.
Fille d'un mollah chiite respecté, la jeune Tahirih fut autorisée par son père, qui l'adorait, à étudier autant que les garçons de la famille. D'une intelligence exceptionnelle, elle dépassa bientôt ses frères et ses cousins, s'attirant par là la haine de son oncle, Muhammad Taqi Baraghani. Bien des années plus tard, elle sera accusée, par le fils de celui-ci (qui était devenu entretemps son mari et dont elle avait divorcé), d'avoir assassiné son oncle et beau-père. Pourtant, un homme se dénoncera volontairement, affirmant qu'il avait assassiné le mollah parce que celui-ci avait manqué de respect à un autre dignitaire religieux, considéré comme un saint homme.
Pendant quelques années, Tahirih, connue également sous le nom de la Poétesse de Qazvîn, fuira de ville en ville, se cachant certes mais souvent invitée à prêcher car, en dépit du machisme de la religion islamique, cette femme, qui avait rejeté le voile et embrassé la Foi babie, finissait toujours par s'attirer le respect de tous. Cette nouvelle doctrine, qui plaidait pour l'amélioration du statut des femmes et des pauvres ainsi que pour l'éducation pour toutes et tous, avait été lancée, dans les années 1840, par un jeune marchand, Siyyid Ali Muhammad, qui avait pris le nom de "Bâb" qui, dans la langue arabe, signifie "Porte" ou "Ouverture."
Pour les mollahs chiites traditionnels - les plus nombreux, on s'en doute - le Bâb et ses partisans, qui voulaient s'attaquer à une tradition au demeurant pré-islamique, n'étaient que des hérétiques. La Poétesse de Qazvîn était donc tout à la fois une femme, une divorcée, une hérétique, et en plus, elle s'était mis en tête d'enseigner lecture et écriture aux femmes. Dans la Perse du XIXème siècle, et bien que, apparemment, le Shah lui-même, fasciné autant par sa beauté que par son intelligence, l'eût protégée aussi longtemps qu'il le put, Tahirih était, par cela même, promise à une mort tragique.
Sa vie et l'Histoire de son pays sont dépeintes ici par des points de vue strictement féminins. le roman est en effet partagé en quatre "livres" : celui de la Mère, où Bahiyyih Nakhjavani expose le point de vue de la mère du Shah, femme de tête et de pouvoir, qui hait la Poétesse uniquement parce qu'elle risque, en fait, de lui voler sa puissance ; celui de l'Epouse, consacré aux rapports qui se tissent peu à peu entre l'épouse du maire de Téhéran, chez qui la Poétesse fut retenue quelque temps prisonnière, et Tahirih ; celui de la Soeur, où l'on fait un peu mieux connaissance avec la soeur du Shah, personnage extrêmement émouvant ; et enfin, le livre de la Fille, placé sous le patronnage de la fille de Tahirih - et de toutes ses autres "filles", ces femmes du monde entier qui ont lutté et luttent encore pour que leurs droits soient enfin reconnus.
L'une des forces de "La Femme Qui Lisait Trop", c'est que, malgré tout ce qui peut les séparer d'elle, toutes ces femmes finissent par se révéler extrêmement proches de la Poétesse de Qazvîn. Avec douceur mais fermeté, l'ombre de Tahirih Qurratu'l-Ayn, sur qui nous savons si peu de choses mais dont on ne peut que sentir l'incontestable charisme tout au long de ces pages, parvient à créer un sentiment d'extraordinaire solidarité. Féminine, évidemment mais sans le souci de revanche des féministes bon-teint.
Qui mieux est, Bahiyyih Nakhjavani part d'une situation précise, la condition de la Femme en terre d'islam, pour dépasser celle-ci et étendre son propos à l'Humanité tout entière. On ne s'en rend pleinement compte que lorsqu'on a terminé le roman - c'est peut-être d'ailleurs pour cette raison qu'on en demeure le coeur si haut - mais l'effet obtenu est impossible à raconter. Il faut le vivre pour le comprendre.
Tout cela en outre magnifiquement écrit, dans une langue à la fois poétique, souple et d'une grande richesse, avec un souffle unique et une saisissante humanité. L'un des plus grands livres que j'ai jamais lus - un livre que méritait amplement celle qui l'inspira et qui aima tant les mots. ;o)
Un livre qui nous plonge dans l'actualité et que je ne peux que chaudement vous recommander.
Un hommage à la poétesse Tahirih Qurratu'l-Ayn , première femme féministe de l'histoire de Perse voulant généraliser entre autres, l'alphabétisation féminine à travers le portrait de 4 femmes :
-Le livre de la mère : Son Altesse royale Mahd-i-Oldya , mère du Shah Nasir-ed-Din tenant les rênes de l'empire de Perse. On y lit toutes les intrigues politiques liées à la cour, assassinat, la peur et la haine que suscite la poétesse qui s'expose aux yeux du monde sans voile ,en femme libre , mais qui a conquis par son esprit et son aura de grandes cités , comme Bagdad et les montagnes d'Irak . Une rhétoricienne de talent s'élève contre les dogmes religieux et le pouvoir du royaume.
Le livre de l'épouse : épouse du maire de Téhéran, Mahmud Khan-i-Kalantar, chef suprême de la police qui écroue la poétesse entre ses murs, sa demeure étant la prison dans laquelle les hurlements dus aux tortures ne sont pas légendes. La captive étant considérée comme un djinn par cette épouse ne laisse pas le harem insensible et démontre que toutes sont conscientes de leur vie dans laquelle elles jouent « le jeu »d'être une épouse assujettie. Pourtant il suffit de peu pour que ces femmes se rallient à la cause de «l'hérétique ».
Le livre de la soeur : soeur du shah et épouse du grand vizir Amir Kabir. Partisane de la poétesse.
Le livre de la fille : une partie concernant la poétesse Tahirih Qurratu'l-Ayn et sa fille.
L'ordre chronologique des événements commence à voir le jour au travers du livre de la soeur, en effet, Nakhjavani opte pour la narration déstructurée, ce qui nous sollicite à nous centraliser afin de ne pas se perdre dans les sinuosités des lignes, chaque chapitre correspond à une pièce de puzzle à assembler au récit. (ce qui m'a valu quelques retours en arrière)
« Nous définissons aujourd'hui le voile comme un emblème d'identité culturelle, de foi religieuse. Elle n'y voyait que préjugés, littéralisme et uniformité. Nous en avons fait un symbole politique, un argument dans la négociation de la liberté d'expression, un symbole politique. Elle le rejetait précisément parce qu'il représentait l'oppression. Si l'Islam contemporain est déchiré par l'écart grandissant entre modérés et extrémistes, par le conflit entre chiites et sunnites, et si l'anarchie au Moyen Orient et la montée partout dans le monde du fondamentalisme et de la terreur qui en sont les conséquences ont commencé à menacer la texture même de nos démocraties, il peut être opportun pour le public occidental de redécouvrir l'histoire de cette Perse du XIXème siècle » B.N
Au-delà d'un hommage, Bahhiyih Nakhjavani soulève le voile et nous mène au travers de ses yeux dans ce royaume où l'anderoun ne ressemble pas au conte des mille et une nuits, Téhéran n'exalte pas ses effluves d'épices et de fleurs, mais la puanteur des famines et des maladies, les jardins paradisiaques sont les lieux de tortures et le vin coulant à flots n'est autre que le sang du peuple.
C'est un voyage au coeur de la Perse, sous une identité dévoilée au travers d'un joyau qui n'est pas des moindres: la liberté d'expression parée de superbes allégories, que Bahhiyih Nakhjavani signe ce bijou littéraire mettant en avant la condition féminine, la religion et les enjeux politiques.
Remarquable.
"Je suis la rivière de vin rouge
Dans la bouche de la vie et de la mort.
Le dit écarlate de mes paroles
Passe goutte à goutte dans ton souffle.
Je suis la rivière jaune
Qui nourrit et sustente la jeune intelligence
Mes pages safran offrent l'espoir à l'espèce humaine.
Je suis la rivière des mots verts comme le miel, pleins de vie.
Je tiens dans mes bras qui m'inspire et me fait confiance,
Les saisons et leur combat.
Je suis la rivière d'eau blanche
Par laquelle le coeur est lavé de la rouille.
Mes paroles d'unité ont soif de boire la poussière."
J'ai bien failli ne pas ouvrir ce livre que j'ai découvert par hasard à la médiathèque.
Dès les premières lignes je me suis demandée où l'histoire menait. La construction en quatre parties m'intriguait. Mère, épouse, soeur, fille, une polyphonie de voix féminines raconte l'incroyable destin de Tahirih, poétesse iranienne du XIXe siècle.
Un roman très politique sur l'Iran du XIXe, les intrigues d'état, le pouvoir des religieux, les pressions sociales et protocolaires. Mais ce qui m'a fait aller jusqu'au bout ce sont les différents points de vue féminins. La vision de femmes écrasées par le domination masculine. Leur ténacité, leur besoin de liberté. Ce roman historique raconte des faits plus que jamais d'actualité sur la condition féminine face aux hommes, face aux dogmes. La liberté se gagne au prix des vies. Sans arrêt remise en question, la liberté n'est pas innée, elle s'acquiert au prix d'une lutte constante.
Dès les premières lignes je me suis demandée où l'histoire menait. La construction en quatre parties m'intriguait. Mère, épouse, soeur, fille, une polyphonie de voix féminines raconte l'incroyable destin de Tahirih, poétesse iranienne du XIXe siècle.
Un roman très politique sur l'Iran du XIXe, les intrigues d'état, le pouvoir des religieux, les pressions sociales et protocolaires. Mais ce qui m'a fait aller jusqu'au bout ce sont les différents points de vue féminins. La vision de femmes écrasées par le domination masculine. Leur ténacité, leur besoin de liberté. Ce roman historique raconte des faits plus que jamais d'actualité sur la condition féminine face aux hommes, face aux dogmes. La liberté se gagne au prix des vies. Sans arrêt remise en question, la liberté n'est pas innée, elle s'acquiert au prix d'une lutte constante.
Citations et extraits (21)
Voir plus
Ajouter une citation
L'aîné de ses cousins lui en avait toujours voulu. Fils premier-né du patriarche, il trouvait particulièrement humiliant d'être surpassé par une fille. Depuis qu'on les avait fiancés, tout enfants, il lui avait envié sa supériorité et son intelligence naturelles ; il s'était irrité de ce qu'il appelait sa prétention. Elle était intolérablement sûre d'elle. Il se sentait piqué, non seulement parce qu'elle avait toujours raison, mais aussi parce qu'elle le savait. Pire encore, elle savait l'exprimer. Il aurait pu lui pardonner si elle s'était montrée plus hésitante, moins assurée. Une fille était censée pouvoir parler, mais pas s'exprimer clairement ; elle avait le droit d'être bavarde, mais pas éloquente. Il ne supportait pas, non seulement qu'elle fascinât tout le monde, mais encore qu'elle lût autant et écrivît aussi bien. Ses rancœurs envers elle s'accumulèrent ; elles s'assemblèrent, enflèrent ; sa jalousie bourgeonna et finit par porter fruit dans la brutale intimité de la chambre conjugale.
C'est son père que l'on blâma d'abord : il avait éduqué sa fille comme un garçon, là était le problème. C'était assez grave, déjà, de l'avoir laissée apprendre à lire et à écrire dès son âge le plus tendre, mais lui permettre de s'asseoir avec ses frères et ses cousins, l'autoriser à étudier avec eux la philosophie et la jurisprudence, ce l'était trop. Il n 'aurait jamais dû la traiter comme leur égale, vanter sa mémoire, applaudir à ses commentaires. Il n'aurait jamais dû l'encourager à discuter de la nature de l'âme ou des limites temporelles de la justice. Elle n'avait aucun droit d'interrompre des débats théologiques, même cachée derrière un rideau. C'était passer toute pudeur, toute raison. En quoi la résurrection était-elle l'affaire d'une femme ? p 306
Selon la coutume, la loi du talion n'était généralement applicable aux femmes qu'en cas d'adultère. De meurtre. On pouvait impunément abattre des femmes innocentes mais on était autorisé officiellement que pour infidélité. Ou assassinat délibéré. Selon la coutume, bien que la violence fut pratique courante à l'encontre du sexe féminin, il fallait qu'une femme soit coupable de pauvreté pour qu'on l'accuse de meurtre ou d'adultère : il était rare qu'on jette du haut d'une tour ou qu'on lapide une femme riche ou une dame de haut rang. La seule autre façon de mériter une mort légitime était l'apostasie. Mais il eût fallu qu'une femme hérétique reste réfractaire à la réforme avant qu'on put la déclarer coupable de ce péché; il eût fallu que son influence en ait entraîné d'autres dans ses voies erronnées avant qu'on pût la condamner pour un tel crime. Et seul un tribunal religieux pouvait se prononcer en cette matière.
L'épouse du maire niait que l'on torturât dans ses caves. Bien qu'elle fût extrêmement contrariée d'avoir des prisonniers chez elle et protestât avec force contre les plaintes et gamissements provenant des ses sous-sols, elle ne désirait pas savoir exactement ce qui s'y passait, en ce premier hiver où la poétesse de Qazvîn fut confiée à la garde de son mari. Elle était bien conscient du fait qu'une douzaine d'hommes de bonne famille avaient également été capturés dans le cadre des purges du grand vizir mais, malgré les craquements, les claquements de fouet et les bruits sourds montant d'en bas, elle préférait de pas trop penser à leur sort. C'était terriblement désagréable. C'était aussi fichtrement ennuyeux car les caves servaient de refuge contre la chaleur durant la saison d'été et elle, pour sa part, avait bien l'intention de savourer ses pastèques dans la fraîcheur, là dessous, à quelques mois de là. p 129
Quand un mariage était fidèle, il donnait naissance à la poésie, conclut-elle. Sinon, il devenait lettre morte d'un jour à l'autre.
Video de Bahiyyih Nakhjavani (1)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : littérature iranienneVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Bahiyyih Nakhjavani (5)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3169 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3169 lecteurs ont répondu