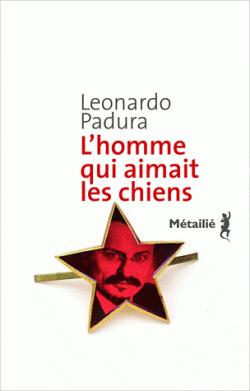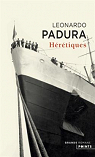« Ce qui compte c'est le rêve, pas l'homme. »
« L'homme qui aimait les chiens » est un livre historique et politique captivant centré sur l'histoire d'un des assassinats politiques les plus révélateurs du XXème siècle.
Captivant, parce qu'il démêle les dessous de l'assassinat de Trotski dans le contexte très tendu des relations internationales de l'entre-deux-guerres et de la montée des totalitarismes profitant de la crise économique, politique et sociale.
Captivant également parce que Leonardo Padura entrelace la grande et la petite Histoire pour n'en faire qu'une. En effet, son personnage principal, Iván Cárdenas Maturell, écrivain cubain soumis à la dictature de Castro et vétérinaire à La Havane, rencontre durant l'été 77 un vieil homme étrange et solitaire qui se promène sur la plage avec deux magnifiques lévriers barzoïs.
Après plusieurs rencontres fortuites, l'homme va peu à peu se confier sur les événements qui ont conduit au meurtre de Léon Trotski. L'homme semble connaître intimement l'assassin de l'opposant en exil, grande figure de la révolution russe de 1917.
*
L'histoire s'articule autour du destin de trois personnages que L Histoire va lier de manière tragique à travers le temps et l'espace. Un autre point commun qui les relie est leur amour pour les chiens et en particulier les lévriers Barzoïs.
Leonardo Padura entrelace leurs vies en trois brins narratifs qui se superposent à travers plusieurs époques. Par le biais de l'écrivain cubain, les voix du passé forment progressivement une tresse historique complexe autour de la lutte de pouvoir qui a opposé Staline à Trotski. L'Europe y apparaît comme un vaste échiquier où les dirigeants attaquent et contre-attaquent, conspirent et manipulent, s'allient ou éliminent leurs adversaires.
*
Le premier fil est ancré à Cuba comme tous les romans de Leonardo Padura. Il est celui du narrateur du roman, personnage fictif dont j'ai déjà parlé précédemment. S'il peut paraître à première vue moins intéressant, je le trouve au contraire essentiel à plus d'un titre.
Tout d'abord, il est celui qui accole présent et passé, semblant attester qu'avec le passage du temps, les crimes d'hier s'effacent des mémoires collectives mais sans que personne n'en tire la moindre leçon. C'est comme si l'indicible et l'horreur se répétaient inlassablement, impunément.
Ensuite, Iván, en tant qu'écrivain, joue à mon sens le rôle de passeur, de témoin : en effet, la littérature joue un rôle précieux en témoignant d'une époque, en participant à la transmission d'une mémoire historique qui s'efface peu à peu.
De plus, cette partie de l'histoire est plus narrative et moins exigeante, ce qui apporte une respiration appréciable pour le lecteur. Pour autant elle est loin d'être négligeable car Leonardo Padura en profite pour aborder les conséquences de l'assassinat de Trostki à Cuba sous l'ère Castro. Elle nous immerge dans la réalité cubaine. Il évoque ainsi l'homosexualité, la censure littéraire, la pauvreté, le manque de nourriture et de libertés, l'exil, …
Grâce à ce fil ancré dans le présent, l'auteur nous entraîne dans le passé et reconstitue avec beaucoup de talent les vies de Trotski et de Ramon Mercader.
Le côté historique, richement documenté et superbement écrit, est vraiment très réussi : l'auteur est parvenu à rendre le récit passionnant et très instructif.
*
Le second fil développé par l'auteur est donc celui de Liev Davidovich Bronstein, dit Trotski. Déporté aux confins de la Russie orientale, dans les steppes du Kirghizstan, il sera par la suite expulsé de l'Union soviétique avec une partie de sa famille et trouvera finalement refuge au Mexique.
L'ombre menaçante de Staline accompagnera son exil, planant silencieusement au-dessus d'eux près à fondre au moment le plus opportun. Staline, qui tel un chef d'orchestre, impulse sa vision d'un monde centré sur sa personne, qui discrédite inlassablement son infatigable ennemi Trotski, élimine ses adversaires réels ou potentiels, rejetant sur eux ses échecs tout en consolidant par ailleurs sa position dominante dans les jeux de pouvoir.
« … l'histoire ne supporte pas de témoins »
J'ai eu de la compassion pour cet homme seul face à ses tristes années d'exil, ses erreurs passées, l'attente de la mort alors que son entourage est peu à peu décimé ; pour sa femme et ses enfants qui seront tous exécutés sur ordre de Staline. Certains moments de sa vie sont particulièrement touchants, la disparition de ses enfants, son attachement à son lévrier barzoï, sa foi inébranlable.
« L.D. est seul. Nous marchons dans le petit jardin de Coyoacán, et nous sommes entourés de fantômes aux fronts troués… Quand il travaille, je l'entends parfois lancer un soupir et se parler à lui-même à haute voix : ‘Quelle fatigue… je n'en peux plus !' »
« … il devait savoir que, le moment venu, ni l'acier, ni les pierres, ni les gardes ne pourraient le sauver, parce qu'il avait déjà été condamné par l'histoire. »
L'auteur rend bien compte de son statut à la fois de victime mais aussi de bourreau, d'où mes sentiments ambivalents, car il ne faut pas oublier que Trotski fut une des figures de la révolution russe de 1917 ; qu'empli de sa mission révolutionnaire, il fut le principal organisateur de l'Armée rouge et de la répression contre les opposants au régime communiste, n'hésitant pas à institutionnaliser la terreur, à exécuter sans pitié ses adversaires.
*
Parallèlement au difficile parcours du leader révolutionnaire russe, l'auteur retrace dans un troisième et dernier fil, la trajectoire suivie par le meurtrier de Trotski, Ramón Mercader.
Ainsi, on plonge dans la guerre civile espagnole des années 30. Milicien communiste espagnol, on suit son parcours depuis son enfance tout en s'intéressant aux grandes puissances qui attisent les tensions dans le pays et tirent les ficelles du conflit entre républicains et nationalistes dirigés par général Franco.
On lit aussi la manière dont il va être recruté comme combattant de l'idéal soviétique pour devenir par la suite le bras meurtrier de Staline. Véritable caméléon, il adoptera de nombreuses identités pour se rapprocher lentement de sa cible, entrer dans son cercle intime, gagner sa confiance et au final, l'exécuter.
Même si le lecteur connaît par avance fa fin tragique de Trotski, j'ai aimé la tension qu'imprimait l'auteur plus la date fatidique du 21 août 1940 se rapprochait.
*
Les personnages, principaux comme secondaires, sont particulièrement intrigants, fascinants, retors, monstrueux.
Je vous laisse découvrir comment Ramón Mercader a été manipulé, comment sa foi, ses convictions politiques, son besoin de reconnaissance ont été utilisés pour le modeler et en faire une marionnette fière de participer à cette mission d'envergure. Là encore, l'auteur a su montrer comment cet homme s'est retrouvé dans un engrenage meurtrier dont il n'a pu s'échapper et qui a fait de lui à la fois un sauveur, un bourreau et une victime.
« On lui avait tout pris, son nom, son passé, sa volonté, sa dignité. Et finalement pour quoi ? Depuis l'instant où il avait répondu « oui » … Ramón a vécu dans une prison qui l'a poursuivi jusqu'au jour de sa mort. »
*
Même si l'auteur a parfois fait appel à la fiction, surtout en ce qui concerne la vie de Ramón Mercader pour laquelle ne subsistent que peu de documents historiques, il y a en revanche, une justesse et une profondeur dans l'écriture qui m'a plu.
C'est un récit troublant, empreint de nostalgie, hanté par la mort et la peur, nourri de vérités et de mensonges, de combats et de trahisons, de foi aveugle et de sacrifices, d'idéologies et d'arbitraire, de réussites et d'échecs, de rêves et de désillusions, de haine et de peur.
*
L'auteur explore les thèmes de l'histoire du XXème siècle et les crimes des régimes totalitaires, de l'utopie politique jusqu'à la dictature légitimée, de la justification d'actes de barbarie sous couvert de créer un monde plus juste, de l'engagement politique jusqu'à l'endoctrinement, de la solitude et de la peur, de l'amitié et de la trahison, de l'exil et du déracinement.
Il évoque également le lien entre le pouvoir et l'art, thème déjà évoqué il y a peu à propos d'Hitler qui n'hésitait pas, lui non plus, à légitimer son pouvoir et son influence en faisant de l'art un instrument de propagande et d'oppression.
« L'art est une arme de la révolution.. »
*
Pour finir, « L'homme qui aimait les chiens » est un récit superbement écrit, très bien documenté, qui mêle fiction et réalité historique.
Jamais fastidieux ni soporifique, ce récit m'a emportée dans les méandres de l'Histoire. Leonardo Padura est un auteur cubain pour lequel j'ai envie d'approfondir ses textes et ses thématiques.
*****
Cette lecture est le fruit d'une envie de découvrir cet auteur en lecture partagée. Je vous remercie tous pour ces échanges et ces regards entrecroisés qui permettent d'avoir un regard plus profond et nuancé sur les oeuvres.
*****
« L'homme qui aimait les chiens » est un livre historique et politique captivant centré sur l'histoire d'un des assassinats politiques les plus révélateurs du XXème siècle.
Captivant, parce qu'il démêle les dessous de l'assassinat de Trotski dans le contexte très tendu des relations internationales de l'entre-deux-guerres et de la montée des totalitarismes profitant de la crise économique, politique et sociale.
Captivant également parce que Leonardo Padura entrelace la grande et la petite Histoire pour n'en faire qu'une. En effet, son personnage principal, Iván Cárdenas Maturell, écrivain cubain soumis à la dictature de Castro et vétérinaire à La Havane, rencontre durant l'été 77 un vieil homme étrange et solitaire qui se promène sur la plage avec deux magnifiques lévriers barzoïs.
Après plusieurs rencontres fortuites, l'homme va peu à peu se confier sur les événements qui ont conduit au meurtre de Léon Trotski. L'homme semble connaître intimement l'assassin de l'opposant en exil, grande figure de la révolution russe de 1917.
*
L'histoire s'articule autour du destin de trois personnages que L Histoire va lier de manière tragique à travers le temps et l'espace. Un autre point commun qui les relie est leur amour pour les chiens et en particulier les lévriers Barzoïs.
Leonardo Padura entrelace leurs vies en trois brins narratifs qui se superposent à travers plusieurs époques. Par le biais de l'écrivain cubain, les voix du passé forment progressivement une tresse historique complexe autour de la lutte de pouvoir qui a opposé Staline à Trotski. L'Europe y apparaît comme un vaste échiquier où les dirigeants attaquent et contre-attaquent, conspirent et manipulent, s'allient ou éliminent leurs adversaires.
*
Le premier fil est ancré à Cuba comme tous les romans de Leonardo Padura. Il est celui du narrateur du roman, personnage fictif dont j'ai déjà parlé précédemment. S'il peut paraître à première vue moins intéressant, je le trouve au contraire essentiel à plus d'un titre.
Tout d'abord, il est celui qui accole présent et passé, semblant attester qu'avec le passage du temps, les crimes d'hier s'effacent des mémoires collectives mais sans que personne n'en tire la moindre leçon. C'est comme si l'indicible et l'horreur se répétaient inlassablement, impunément.
Ensuite, Iván, en tant qu'écrivain, joue à mon sens le rôle de passeur, de témoin : en effet, la littérature joue un rôle précieux en témoignant d'une époque, en participant à la transmission d'une mémoire historique qui s'efface peu à peu.
De plus, cette partie de l'histoire est plus narrative et moins exigeante, ce qui apporte une respiration appréciable pour le lecteur. Pour autant elle est loin d'être négligeable car Leonardo Padura en profite pour aborder les conséquences de l'assassinat de Trostki à Cuba sous l'ère Castro. Elle nous immerge dans la réalité cubaine. Il évoque ainsi l'homosexualité, la censure littéraire, la pauvreté, le manque de nourriture et de libertés, l'exil, …
Grâce à ce fil ancré dans le présent, l'auteur nous entraîne dans le passé et reconstitue avec beaucoup de talent les vies de Trotski et de Ramon Mercader.
Le côté historique, richement documenté et superbement écrit, est vraiment très réussi : l'auteur est parvenu à rendre le récit passionnant et très instructif.
*
Le second fil développé par l'auteur est donc celui de Liev Davidovich Bronstein, dit Trotski. Déporté aux confins de la Russie orientale, dans les steppes du Kirghizstan, il sera par la suite expulsé de l'Union soviétique avec une partie de sa famille et trouvera finalement refuge au Mexique.
L'ombre menaçante de Staline accompagnera son exil, planant silencieusement au-dessus d'eux près à fondre au moment le plus opportun. Staline, qui tel un chef d'orchestre, impulse sa vision d'un monde centré sur sa personne, qui discrédite inlassablement son infatigable ennemi Trotski, élimine ses adversaires réels ou potentiels, rejetant sur eux ses échecs tout en consolidant par ailleurs sa position dominante dans les jeux de pouvoir.
« … l'histoire ne supporte pas de témoins »
J'ai eu de la compassion pour cet homme seul face à ses tristes années d'exil, ses erreurs passées, l'attente de la mort alors que son entourage est peu à peu décimé ; pour sa femme et ses enfants qui seront tous exécutés sur ordre de Staline. Certains moments de sa vie sont particulièrement touchants, la disparition de ses enfants, son attachement à son lévrier barzoï, sa foi inébranlable.
« L.D. est seul. Nous marchons dans le petit jardin de Coyoacán, et nous sommes entourés de fantômes aux fronts troués… Quand il travaille, je l'entends parfois lancer un soupir et se parler à lui-même à haute voix : ‘Quelle fatigue… je n'en peux plus !' »
« … il devait savoir que, le moment venu, ni l'acier, ni les pierres, ni les gardes ne pourraient le sauver, parce qu'il avait déjà été condamné par l'histoire. »
L'auteur rend bien compte de son statut à la fois de victime mais aussi de bourreau, d'où mes sentiments ambivalents, car il ne faut pas oublier que Trotski fut une des figures de la révolution russe de 1917 ; qu'empli de sa mission révolutionnaire, il fut le principal organisateur de l'Armée rouge et de la répression contre les opposants au régime communiste, n'hésitant pas à institutionnaliser la terreur, à exécuter sans pitié ses adversaires.
*
Parallèlement au difficile parcours du leader révolutionnaire russe, l'auteur retrace dans un troisième et dernier fil, la trajectoire suivie par le meurtrier de Trotski, Ramón Mercader.
Ainsi, on plonge dans la guerre civile espagnole des années 30. Milicien communiste espagnol, on suit son parcours depuis son enfance tout en s'intéressant aux grandes puissances qui attisent les tensions dans le pays et tirent les ficelles du conflit entre républicains et nationalistes dirigés par général Franco.
On lit aussi la manière dont il va être recruté comme combattant de l'idéal soviétique pour devenir par la suite le bras meurtrier de Staline. Véritable caméléon, il adoptera de nombreuses identités pour se rapprocher lentement de sa cible, entrer dans son cercle intime, gagner sa confiance et au final, l'exécuter.
Même si le lecteur connaît par avance fa fin tragique de Trotski, j'ai aimé la tension qu'imprimait l'auteur plus la date fatidique du 21 août 1940 se rapprochait.
*
Les personnages, principaux comme secondaires, sont particulièrement intrigants, fascinants, retors, monstrueux.
Je vous laisse découvrir comment Ramón Mercader a été manipulé, comment sa foi, ses convictions politiques, son besoin de reconnaissance ont été utilisés pour le modeler et en faire une marionnette fière de participer à cette mission d'envergure. Là encore, l'auteur a su montrer comment cet homme s'est retrouvé dans un engrenage meurtrier dont il n'a pu s'échapper et qui a fait de lui à la fois un sauveur, un bourreau et une victime.
« On lui avait tout pris, son nom, son passé, sa volonté, sa dignité. Et finalement pour quoi ? Depuis l'instant où il avait répondu « oui » … Ramón a vécu dans une prison qui l'a poursuivi jusqu'au jour de sa mort. »
*
Même si l'auteur a parfois fait appel à la fiction, surtout en ce qui concerne la vie de Ramón Mercader pour laquelle ne subsistent que peu de documents historiques, il y a en revanche, une justesse et une profondeur dans l'écriture qui m'a plu.
C'est un récit troublant, empreint de nostalgie, hanté par la mort et la peur, nourri de vérités et de mensonges, de combats et de trahisons, de foi aveugle et de sacrifices, d'idéologies et d'arbitraire, de réussites et d'échecs, de rêves et de désillusions, de haine et de peur.
*
L'auteur explore les thèmes de l'histoire du XXème siècle et les crimes des régimes totalitaires, de l'utopie politique jusqu'à la dictature légitimée, de la justification d'actes de barbarie sous couvert de créer un monde plus juste, de l'engagement politique jusqu'à l'endoctrinement, de la solitude et de la peur, de l'amitié et de la trahison, de l'exil et du déracinement.
Il évoque également le lien entre le pouvoir et l'art, thème déjà évoqué il y a peu à propos d'Hitler qui n'hésitait pas, lui non plus, à légitimer son pouvoir et son influence en faisant de l'art un instrument de propagande et d'oppression.
« L'art est une arme de la révolution.. »
*
Pour finir, « L'homme qui aimait les chiens » est un récit superbement écrit, très bien documenté, qui mêle fiction et réalité historique.
Jamais fastidieux ni soporifique, ce récit m'a emportée dans les méandres de l'Histoire. Leonardo Padura est un auteur cubain pour lequel j'ai envie d'approfondir ses textes et ses thématiques.
*****
Cette lecture est le fruit d'une envie de découvrir cet auteur en lecture partagée. Je vous remercie tous pour ces échanges et ces regards entrecroisés qui permettent d'avoir un regard plus profond et nuancé sur les oeuvres.
*****
Il y a quelques semaines , j'ai lu la biographie de Trotsky par Robert Service , j'ai aimé mais sans plus , et puis , je lis ' L'homme qui aimait les chiens ' , un livre fascinant qui est certes une biographie romancée mais tellement bien écrite , il y a des détails pertinents et surtout un réel talent , on apprends pleins de choses mais de façon passionnante .
Il y a même un détail que j'avais noté chez Robert Service , il dit que Georges Simenon est Français , tandis que Léonardo Padura lui rend bien sa nationalité de belge .
Nous voilà parti dans un voyage dans le temps et l'espace , en effet , nous sommes en Espagne pendant la tragique guerre civile , puis en URSS tout le long du règne du Tsar rouge , c'est-à-dire Staline , puis dans Cuba aux prises avec les restrictions encore augmentées par la fin ' du grand frère '.
J'ai découvert qu'à Cuba être homosexuel était un délit , je ne savais pas que la censure était si importante .
J'ai appris beaucoup sur les années de la guerre civile en Espagne , et surtout sur cette pieuvre monstrueuse qu'était le communisme Stalinien , sur toutes ces personnes sacrifiées au nom de l'idéal . Et puis que reste -t-il quand cet idéal s'effondre , que de vies gâchées pour rien .
Par un procédé original ; l'auteur ose un parallèle entre Trotsky et son meurtrier Ramon Mercadès , tous deux seront poursuivis toute leur vie , et seront apatrides .
Avec les portraits de Caridad et d' Africa , on touche à la passion destructrice qui anime ces passionnées d'une cause , elles renoncent à tous , même à leurs enfants .
Mais aussi , je garde en tête la plage cubaine avec les deux Barzoïs .
Un auteur qui me donne envie de le découvrir un peu plus .
Il y a même un détail que j'avais noté chez Robert Service , il dit que Georges Simenon est Français , tandis que Léonardo Padura lui rend bien sa nationalité de belge .
Nous voilà parti dans un voyage dans le temps et l'espace , en effet , nous sommes en Espagne pendant la tragique guerre civile , puis en URSS tout le long du règne du Tsar rouge , c'est-à-dire Staline , puis dans Cuba aux prises avec les restrictions encore augmentées par la fin ' du grand frère '.
J'ai découvert qu'à Cuba être homosexuel était un délit , je ne savais pas que la censure était si importante .
J'ai appris beaucoup sur les années de la guerre civile en Espagne , et surtout sur cette pieuvre monstrueuse qu'était le communisme Stalinien , sur toutes ces personnes sacrifiées au nom de l'idéal . Et puis que reste -t-il quand cet idéal s'effondre , que de vies gâchées pour rien .
Par un procédé original ; l'auteur ose un parallèle entre Trotsky et son meurtrier Ramon Mercadès , tous deux seront poursuivis toute leur vie , et seront apatrides .
Avec les portraits de Caridad et d' Africa , on touche à la passion destructrice qui anime ces passionnées d'une cause , elles renoncent à tous , même à leurs enfants .
Mais aussi , je garde en tête la plage cubaine avec les deux Barzoïs .
Un auteur qui me donne envie de le découvrir un peu plus .
Qui est l'homme qui aimait les chiens? Car personne ne les déteste dans ce roman. Ni Trotski, éternel errant, explorant chaque interstice du piège qui se referme sur lui pour exister encore politiquement, tandis que Staline écrabouille ceux qui le soutiennent encore, et d'abord ses enfants. Ni Ramón Mercader, idéaliste aux idéaux agonisants, qui tue Trotski comme Lorenzaccio tue Philippe de Médicis, parce qu'il n'est plus que ce meurtre pour justifier sa propre existence. Ni Iván l'écrivain d'autant plus raté qu'il n'écrit plus depuis que l'art doit être le fer de lance de la révolution.
« L'homme qui aimait les chiens » est d'abord une nouvelle de Chandler qui donna son nom à un prix que Padura obtint quelques années avant la parution de ce roman. le braqueur à l'origine de ce titre justifie ses crimes par l'amour qu'il voue à une tendre jeune fille. « Elle n'était plus là, dis-je. Tu étais juste assoiffé de sang. Et si tu n'avais pas gardé ce chien jusqu'à ce qu'il tue un homme, ton protecteur n'aurait pas été poussé par la peur à te dénoncer.
— J'aime les chiens, dit Saint posément. Je suis un brave type en dehors du boulot mais il ne faut pas trop me marcher sur les pieds. »
Dans le roman de Padura, les chiens ne tuent pas. Mais les hommes s'y trouvent aussi de complaisantes excuses pour sauver une révolution qui leur fait les yeux doux et qu'ils invoquent moins pour justifier leur soif de sang que leur désir d'être quelqu'un. Chantres d'un communisme égalitaire, Mercader, comme Trotski, veulent pourtant marquer L'Histoire et s'élever au-dessus du vulgum pecus. Car les chiens du titre sont des lévriers borzois, chiens de race, chiens des rois et des tsars, seuls et uniques vestiges d'un sacre qui n'eut pas lieu.
Padura tient la chronique précise de ses deux personnages. Il ne nous épargne aucun détail, aussi inflexible dans sa quête de la vérité qu'un chef-décorateur sur un film en costumes. S'il ensevelit Trotski et Mercader sous le poids de l'histoire, c'est pour mieux les maudire. Et notre coeur, à nous lecteurs, ne s'émeut que pour Iván, narrateur malgré lui, héraut mezzo voce d'une génération sacrifiée.
« Car le rôle d'Iván, c'est de représenter la masse, la foule condamnée à l'anonymat [...]. Lui, [la compassion], il la mérite totalement : il la mérite comme toutes les victimes, comme toutes les créatures tragiques dont le destin est commandé par des forces supérieures qui les dépassent et les manipulent au point de les anéantir. [...] Que Trotski aille se faire foutre avec son fanatisme obsessionnel et son complexe de personnage historique, s'il croyait que les tragédies personnelles n'existaient pas et qu'il n'y avait que des changements d'étapes sociales et supra-humaines. Et les personnes, alors? »
Les personnes ont trouvé refuge dans le roman. Trotski et Mercader ne seront que des personnages historiques, des entrées d'encyclopédie dont nous retiendrons peut-être le nom mais qui resteront des figures de cire, à nos coeurs indifférents.
« L'homme qui aimait les chiens » est d'abord une nouvelle de Chandler qui donna son nom à un prix que Padura obtint quelques années avant la parution de ce roman. le braqueur à l'origine de ce titre justifie ses crimes par l'amour qu'il voue à une tendre jeune fille. « Elle n'était plus là, dis-je. Tu étais juste assoiffé de sang. Et si tu n'avais pas gardé ce chien jusqu'à ce qu'il tue un homme, ton protecteur n'aurait pas été poussé par la peur à te dénoncer.
— J'aime les chiens, dit Saint posément. Je suis un brave type en dehors du boulot mais il ne faut pas trop me marcher sur les pieds. »
Dans le roman de Padura, les chiens ne tuent pas. Mais les hommes s'y trouvent aussi de complaisantes excuses pour sauver une révolution qui leur fait les yeux doux et qu'ils invoquent moins pour justifier leur soif de sang que leur désir d'être quelqu'un. Chantres d'un communisme égalitaire, Mercader, comme Trotski, veulent pourtant marquer L'Histoire et s'élever au-dessus du vulgum pecus. Car les chiens du titre sont des lévriers borzois, chiens de race, chiens des rois et des tsars, seuls et uniques vestiges d'un sacre qui n'eut pas lieu.
Padura tient la chronique précise de ses deux personnages. Il ne nous épargne aucun détail, aussi inflexible dans sa quête de la vérité qu'un chef-décorateur sur un film en costumes. S'il ensevelit Trotski et Mercader sous le poids de l'histoire, c'est pour mieux les maudire. Et notre coeur, à nous lecteurs, ne s'émeut que pour Iván, narrateur malgré lui, héraut mezzo voce d'une génération sacrifiée.
« Car le rôle d'Iván, c'est de représenter la masse, la foule condamnée à l'anonymat [...]. Lui, [la compassion], il la mérite totalement : il la mérite comme toutes les victimes, comme toutes les créatures tragiques dont le destin est commandé par des forces supérieures qui les dépassent et les manipulent au point de les anéantir. [...] Que Trotski aille se faire foutre avec son fanatisme obsessionnel et son complexe de personnage historique, s'il croyait que les tragédies personnelles n'existaient pas et qu'il n'y avait que des changements d'étapes sociales et supra-humaines. Et les personnes, alors? »
Les personnes ont trouvé refuge dans le roman. Trotski et Mercader ne seront que des personnages historiques, des entrées d'encyclopédie dont nous retiendrons peut-être le nom mais qui resteront des figures de cire, à nos coeurs indifférents.
En 1968, alors que les mouvements contestataires et les manifestations contre l'establishment essaimaient à travers le monde, y compris en Amérique latine, alors que le rock, la mouvance hippie et la contreculture en général influençaient une jeunesse aspirant à plus de liberté et à un nouvel ordre sociétal, à Cuba, déjà, «the dream is over ». Les structures locales du Parti Communiste Cubain (PCC), les Comités de Défense de la Révolution (CDR), la Centrale des Travailleurs de Cuba (CTC), qui s'étaient vu transformer progressivement en organes de contrôle idéologique, dissuadent ses citoyens de se livrer à toute forme de contestation politique; de même pour ce qui est de l'Union Nationale des Écrivains et Artistes de Cuba (UNEAC), qui au départ avait largement soutenu la création artistique et l'émergence de nouveaux talents littéraires dans l'île, muée définitivement en organe de censure : n'y sont désormais publiés que les auteurs certifiés idéologiquement conformes par les éditeurs d'État.
L'année 1968 scelle ainsi la fin définitive du rêve d'une Révolution cubaine dont la réussite et le caractère singulier se devaient non seulement à une adhésion et à une mobilisation massives de la société civile cubaine, mais aussi à une volonté manifeste d'indépendance politique de la part de ses dirigeants vis-à-vis de l'impérialisme pratiqué à large échelle par l'URSS. Si, par la force des choses (et surtout depuis le blocus imposé par les américains), le régime cubain ne pouvait totalement se soustraire à l'ombre du géant soviétique, il cherchait cependant, dans la mesure du possible, à se départir d'une dépendance trop exclusive et tutélaire au Kremlin. Au mois d'août 1968, Cuba, qui avait pourtant tenu à coeur, depuis la prise de pouvoir par les forces révolutionnaires une dizaine d'années plus tôt, de jouer un rôle politique et diplomatique prépondérant au sein du groupe des pays dits non-alignés, apportera son soutien inconditionnel à l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'URSS, suite au printemps de Prague. S'en suivra rapidement la promulgation en interne d'un premier plan de développement s'inspirant directement du modèle économique soviétique, ce qui aura pour conséquence, entre autres, de soumettre irréparablement l'économie cubaine à une dépendance intégrale au bloc communiste durant les deux décennies à venir, et jusqu'à l'effondrement de l'URSS dans les années quatre-vingt-dix, contraignant alors la nation cubaine, exsangue, affamée, démunie, à subir des carences et des privations jamais connues auparavant dans l'île, et condamnant la plupart de ses citoyens à toutes sortes de renoncements, quelquefois aux pires expédients, ou bien à l'exil définitif pour pouvoir survivre.
C'est dans ce contexte, après les ruptures emblématiques survenues donc à la fin des années 60, que le personnage et alter-ego de l'auteur, Iván, après des débuts prometteurs en tant que jeune écrivain, sera profondément marqué par la motion de censure venant frapper son oeuvre. «Nous étions la générations des naïfs, des romantiques qui avaient tout accepté et tout justifié, les yeux tournés vers l'avenir, qui coupèrent la canne à sucre, convaincus qu'ils devaient le faire (…) la génération qui fut la cible des attaques de l'intransigeance sexuelle, religieuse, idéologique, culturelle et même alcoolique, qu'elle endura tout au plus avec un hochement de tête et, bien souvent, sans éprouver le ressentiment ou le désespoir qui mène à la fuite.» Démotivé, désabusé par la tournure prise par les évènements, touché personnellement par la peur qui se faisait de plus en plus présente dans les consciences de son époque et de sa génération, suite aux remontrances et les sanctions effectives dont il avait fait l'objet, Iván finit par renoncer à toute illusion de poursuivre une carrière universitaire et littéraire. Quelques temps après, il trouve un travail de rédacteur dans une revue vétérinaire, se marie, fonde une famille, se résigne.
Un soir de mars 1977, sur la plage de Santa María del Mar, Iván fait la rencontre de celui qu'il surnommera «l'homme qui aimait les chiens», titre d'une des nouvelles du recueil de Raymond Chandler (« Un tueur sous la pluie ») qu'il lisait au moment où il entendit pour la première fois, à quelques mètres de lui, l'homme appeler ses deux magnifiques lévriers russes, «ces barzoïs si prisés» qu'Iván voyait «pour la première fois ailleurs que sur les planches d'un livre ou de la revue vétérinaire». Autour des chiens, se noue un dialogue entre les deux inconnus. Impressionné par l'allure et par les propos de ce personnage atypique dont la présence même à Cuba semble entourée d'une aura de mystère qui l'intrigue de plus en plus, au fil de leurs rencontres sur la plage qu'Iván cherchera à susciter en retournant régulièrement à Santa María del Mar, «l'homme qui aimait les chiens» en viendra petit à petit à lui livrer l'histoire de Ramón Mercader, l'assassin de Trotski. Mercader, côtoyé à plusieurs reprises par Jaime López, l'homme de la plage, à qui le jeune révolutionnaire espagnol responsable de l'assassinat de Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotski, se serait confié sans réserves, finiront tous les deux par se confondre en une seule et même image dans l'esprit d'Iván. La disparition subite et inexpliquée de l'énigmatique personnage, quelques mois après leur première rencontre, le laissera pourtant sans aucune réponse claire aux questions qui continueront à le tarauder pendant plus d'une vingtaine d'années: Qu'est-il arrivé au juste à Ramón Mercader après avoir purgé sa peine de vingt ans de prison au Mexique et avoir été exfiltré vers l'URSS, où Lopez, «l'homme qui aimait les chiens » l'aurait rencontré plus tard? Mais à vrai dire, qui est qui en fin de compte? Mercader et López ne seraient-ils le seul et même homme? Dans ce cas-là, pourquoi s'être confié à lui, Iván, tout en sachant qu'il avait un passé d'écrivain et qu'il avait publié un livre? Et puis, pourquoi en même temps lui avoir fait jurer de ne jamais révéler à personne toute cette histoire?
Malgré tous les écueils concrets auxquels il devrait faire face pour tenter d'assembler les pièces de cet étrange puzzle (d'autant que le régime castriste ayant proscrit tout ce qui avait trait à Trotski, l'oeuvre, la vie même ou la mort de ce dernier étaient à ce moment totalement méconnues et inaccessibles au commun des cubains), malgré également toute l'ambiguïté d'un tel projet (comment écrire sans trahir la promesse faite à l'homme qui aimait les chiens?), malgré, last but not least, lui-même, Iván et le combat intérieur qu'il livre contre ses propres fantômes, l'écrivain sommeillant au fond de lui ne résistera, in fine, à la tentation de s'en emparer et de s'investir dans la reconstruction des parcours tragiques de Trotski et de Ramon Mercader.
Leonardo Padura, situe en 1989, au même moment où tombait le Mur de Berlin, les toutes premières fondations de cet immense édifice que constituerait L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS, qui ne serait pourtant effectivement érigé et publié qu'une vingtaine d'années après. Fruit donc d'une très longue maturation dans l'esprit de son auteur, la pierre inaugurale de ce monument dédié aux ravages abominables provoqués par la plus grandiose et la plus tragique de toutes les utopies du XXème siècle, y fut posée cette même année, à l'occasion du premier voyage au Mexique de Lenardo Padura et à la suite du « choc purement humain, que causa (sa) visite de la maison où avait vécu et était mort Léon Trotski».
Il s'agit bien, en effet, avant tout de matière vive et humaine, personnifiée, incarnée dans des individualités au-delà du rôle supra-humain auquel on avait souhaité les astreindre, mises à l'épreuve de leurs croyances et de leurs doutes face à l'imposture idéologique dont elles ont été victimes. Dans ce roman fleuve à l'architecture complexe, alternant faits historiques et spéculation fictionnelle, trois parcours sont reconstruits parallèlement pour se rejoindre dans un épilogue sublime, bouquet final de vérité et d'humanité : celui de Léon Troski, depuis son exil de l'URSS en 1929, jusqu'à son assassinat au Mexique en 1940, celui de Ramon Mercader, jeune communiste espagnol combattant au sein des forces républicaines durant la guerre civile d'Espagne, embrigadé par les services secrets soviétiques, celui, enfin, d'Iván Cárdenas Maturell, écrivain cubain et double fictionnel de Leonardo Padura, personnage emblématique qui, selon son créateur, «fonctionne aussi comme métaphore d'une génération et comme le résultat prosaïque d'une défaite historique».
Appuyé par un travail de reconstitution historique détaillé, strictement fidèle à la chronologie des évènements, l'auteur, à partir «de ce qui est vérifiable et de ce qui est historiquement possible ou plausible d'après le contexte» tente surtout d'approcher, d'un point de vue essentiellement subjectif, les vicissitudes, les ambigüités, les épreuves psychologiques subies par ses personnages, entraînés dans le drame collectif provoqué par les dérives totalitaires et la débâcle effroyable de trois utopies majeures du XXème siècle : les révolutions russe, espagnole et cubaine .
Le lecteur suit pas à pas, sur près de sept-cents pages, une intrigue dont, après tout, il connaît déjà le dénouement aussi dramatique qu'inutile (d'un point de vue historique, aucun meurtre ne pouvant, bien évidemment, être considéré d'«utilité»). L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS étant un quelque sorte un anti-thriller politique, un roman construit essentiellement à partir de cette atmosphère particulière qui habite l'attente, l'angoisse, la peur, et qui donne une densité particulière au passage du temps, épaisseur toujours extensible par l'alternance irrésolue entre croyance aveugle en l'avenir et clairvoyance intolérable face à l'imminence du désastre, entre sentiments de révolte et de soumission face à des injonctions qui dépassent complètement les individus.
Les longueurs tant redoutées et habituellement honnies (souvent, d'ailleurs, à priori et de manière indiscriminée...) par un grand nombre de lecteurs contemporains, semblent donc constituer ici un élément essentiel à l'approche choisie par l'auteur, un choix de narration délibéré et auquel le lecteur doit pouvoir être en mesure de se laisser porter, grâce notamment à la finesse d'analyse et à la qualité exceptionnelle de la plume déliée et alerte de Leonardo Padura.
En définitive, une lecture aussi instructive d'un point de vue historique que touchante, un récit saisissant, empreint de sensibilité, d'empathie et de compassion pour ses personnages, victimes «happées par la fatigue historique et l'utopie pervertie ». Un grand roman où le mensonge collectif le dispute à la tragédie personnelle. Un auteur doté d'un immense talent de conteur, que je découvre avec ce livre et vers lequel je vais certainement revenir ultérieurement.
L'année 1968 scelle ainsi la fin définitive du rêve d'une Révolution cubaine dont la réussite et le caractère singulier se devaient non seulement à une adhésion et à une mobilisation massives de la société civile cubaine, mais aussi à une volonté manifeste d'indépendance politique de la part de ses dirigeants vis-à-vis de l'impérialisme pratiqué à large échelle par l'URSS. Si, par la force des choses (et surtout depuis le blocus imposé par les américains), le régime cubain ne pouvait totalement se soustraire à l'ombre du géant soviétique, il cherchait cependant, dans la mesure du possible, à se départir d'une dépendance trop exclusive et tutélaire au Kremlin. Au mois d'août 1968, Cuba, qui avait pourtant tenu à coeur, depuis la prise de pouvoir par les forces révolutionnaires une dizaine d'années plus tôt, de jouer un rôle politique et diplomatique prépondérant au sein du groupe des pays dits non-alignés, apportera son soutien inconditionnel à l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'URSS, suite au printemps de Prague. S'en suivra rapidement la promulgation en interne d'un premier plan de développement s'inspirant directement du modèle économique soviétique, ce qui aura pour conséquence, entre autres, de soumettre irréparablement l'économie cubaine à une dépendance intégrale au bloc communiste durant les deux décennies à venir, et jusqu'à l'effondrement de l'URSS dans les années quatre-vingt-dix, contraignant alors la nation cubaine, exsangue, affamée, démunie, à subir des carences et des privations jamais connues auparavant dans l'île, et condamnant la plupart de ses citoyens à toutes sortes de renoncements, quelquefois aux pires expédients, ou bien à l'exil définitif pour pouvoir survivre.
C'est dans ce contexte, après les ruptures emblématiques survenues donc à la fin des années 60, que le personnage et alter-ego de l'auteur, Iván, après des débuts prometteurs en tant que jeune écrivain, sera profondément marqué par la motion de censure venant frapper son oeuvre. «Nous étions la générations des naïfs, des romantiques qui avaient tout accepté et tout justifié, les yeux tournés vers l'avenir, qui coupèrent la canne à sucre, convaincus qu'ils devaient le faire (…) la génération qui fut la cible des attaques de l'intransigeance sexuelle, religieuse, idéologique, culturelle et même alcoolique, qu'elle endura tout au plus avec un hochement de tête et, bien souvent, sans éprouver le ressentiment ou le désespoir qui mène à la fuite.» Démotivé, désabusé par la tournure prise par les évènements, touché personnellement par la peur qui se faisait de plus en plus présente dans les consciences de son époque et de sa génération, suite aux remontrances et les sanctions effectives dont il avait fait l'objet, Iván finit par renoncer à toute illusion de poursuivre une carrière universitaire et littéraire. Quelques temps après, il trouve un travail de rédacteur dans une revue vétérinaire, se marie, fonde une famille, se résigne.
Un soir de mars 1977, sur la plage de Santa María del Mar, Iván fait la rencontre de celui qu'il surnommera «l'homme qui aimait les chiens», titre d'une des nouvelles du recueil de Raymond Chandler (« Un tueur sous la pluie ») qu'il lisait au moment où il entendit pour la première fois, à quelques mètres de lui, l'homme appeler ses deux magnifiques lévriers russes, «ces barzoïs si prisés» qu'Iván voyait «pour la première fois ailleurs que sur les planches d'un livre ou de la revue vétérinaire». Autour des chiens, se noue un dialogue entre les deux inconnus. Impressionné par l'allure et par les propos de ce personnage atypique dont la présence même à Cuba semble entourée d'une aura de mystère qui l'intrigue de plus en plus, au fil de leurs rencontres sur la plage qu'Iván cherchera à susciter en retournant régulièrement à Santa María del Mar, «l'homme qui aimait les chiens» en viendra petit à petit à lui livrer l'histoire de Ramón Mercader, l'assassin de Trotski. Mercader, côtoyé à plusieurs reprises par Jaime López, l'homme de la plage, à qui le jeune révolutionnaire espagnol responsable de l'assassinat de Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotski, se serait confié sans réserves, finiront tous les deux par se confondre en une seule et même image dans l'esprit d'Iván. La disparition subite et inexpliquée de l'énigmatique personnage, quelques mois après leur première rencontre, le laissera pourtant sans aucune réponse claire aux questions qui continueront à le tarauder pendant plus d'une vingtaine d'années: Qu'est-il arrivé au juste à Ramón Mercader après avoir purgé sa peine de vingt ans de prison au Mexique et avoir été exfiltré vers l'URSS, où Lopez, «l'homme qui aimait les chiens » l'aurait rencontré plus tard? Mais à vrai dire, qui est qui en fin de compte? Mercader et López ne seraient-ils le seul et même homme? Dans ce cas-là, pourquoi s'être confié à lui, Iván, tout en sachant qu'il avait un passé d'écrivain et qu'il avait publié un livre? Et puis, pourquoi en même temps lui avoir fait jurer de ne jamais révéler à personne toute cette histoire?
Malgré tous les écueils concrets auxquels il devrait faire face pour tenter d'assembler les pièces de cet étrange puzzle (d'autant que le régime castriste ayant proscrit tout ce qui avait trait à Trotski, l'oeuvre, la vie même ou la mort de ce dernier étaient à ce moment totalement méconnues et inaccessibles au commun des cubains), malgré également toute l'ambiguïté d'un tel projet (comment écrire sans trahir la promesse faite à l'homme qui aimait les chiens?), malgré, last but not least, lui-même, Iván et le combat intérieur qu'il livre contre ses propres fantômes, l'écrivain sommeillant au fond de lui ne résistera, in fine, à la tentation de s'en emparer et de s'investir dans la reconstruction des parcours tragiques de Trotski et de Ramon Mercader.
Leonardo Padura, situe en 1989, au même moment où tombait le Mur de Berlin, les toutes premières fondations de cet immense édifice que constituerait L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS, qui ne serait pourtant effectivement érigé et publié qu'une vingtaine d'années après. Fruit donc d'une très longue maturation dans l'esprit de son auteur, la pierre inaugurale de ce monument dédié aux ravages abominables provoqués par la plus grandiose et la plus tragique de toutes les utopies du XXème siècle, y fut posée cette même année, à l'occasion du premier voyage au Mexique de Lenardo Padura et à la suite du « choc purement humain, que causa (sa) visite de la maison où avait vécu et était mort Léon Trotski».
Il s'agit bien, en effet, avant tout de matière vive et humaine, personnifiée, incarnée dans des individualités au-delà du rôle supra-humain auquel on avait souhaité les astreindre, mises à l'épreuve de leurs croyances et de leurs doutes face à l'imposture idéologique dont elles ont été victimes. Dans ce roman fleuve à l'architecture complexe, alternant faits historiques et spéculation fictionnelle, trois parcours sont reconstruits parallèlement pour se rejoindre dans un épilogue sublime, bouquet final de vérité et d'humanité : celui de Léon Troski, depuis son exil de l'URSS en 1929, jusqu'à son assassinat au Mexique en 1940, celui de Ramon Mercader, jeune communiste espagnol combattant au sein des forces républicaines durant la guerre civile d'Espagne, embrigadé par les services secrets soviétiques, celui, enfin, d'Iván Cárdenas Maturell, écrivain cubain et double fictionnel de Leonardo Padura, personnage emblématique qui, selon son créateur, «fonctionne aussi comme métaphore d'une génération et comme le résultat prosaïque d'une défaite historique».
Appuyé par un travail de reconstitution historique détaillé, strictement fidèle à la chronologie des évènements, l'auteur, à partir «de ce qui est vérifiable et de ce qui est historiquement possible ou plausible d'après le contexte» tente surtout d'approcher, d'un point de vue essentiellement subjectif, les vicissitudes, les ambigüités, les épreuves psychologiques subies par ses personnages, entraînés dans le drame collectif provoqué par les dérives totalitaires et la débâcle effroyable de trois utopies majeures du XXème siècle : les révolutions russe, espagnole et cubaine .
Le lecteur suit pas à pas, sur près de sept-cents pages, une intrigue dont, après tout, il connaît déjà le dénouement aussi dramatique qu'inutile (d'un point de vue historique, aucun meurtre ne pouvant, bien évidemment, être considéré d'«utilité»). L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS étant un quelque sorte un anti-thriller politique, un roman construit essentiellement à partir de cette atmosphère particulière qui habite l'attente, l'angoisse, la peur, et qui donne une densité particulière au passage du temps, épaisseur toujours extensible par l'alternance irrésolue entre croyance aveugle en l'avenir et clairvoyance intolérable face à l'imminence du désastre, entre sentiments de révolte et de soumission face à des injonctions qui dépassent complètement les individus.
Les longueurs tant redoutées et habituellement honnies (souvent, d'ailleurs, à priori et de manière indiscriminée...) par un grand nombre de lecteurs contemporains, semblent donc constituer ici un élément essentiel à l'approche choisie par l'auteur, un choix de narration délibéré et auquel le lecteur doit pouvoir être en mesure de se laisser porter, grâce notamment à la finesse d'analyse et à la qualité exceptionnelle de la plume déliée et alerte de Leonardo Padura.
En définitive, une lecture aussi instructive d'un point de vue historique que touchante, un récit saisissant, empreint de sensibilité, d'empathie et de compassion pour ses personnages, victimes «happées par la fatigue historique et l'utopie pervertie ». Un grand roman où le mensonge collectif le dispute à la tragédie personnelle. Un auteur doté d'un immense talent de conteur, que je découvre avec ce livre et vers lequel je vais certainement revenir ultérieurement.
Au risque de me répéter (mais est-ce ma faute si tant d'excellents livres sont venus à moi depuis le début de l'année ?), "L'homme qui aimait les chiens" est un très grand roman, le premier que je lis du cubain Leonardo Padura (*).
Padura nous raconte de façon parallèle l'histoire de trois personnages : celle de Trotsky depuis son exil en Turquie jusqu'à son assassinat au Mexique, en 1940, commandité par Staline; celle de Ramon Mercader, son assassin, depuis son enrôlement dans le camp républicain pendant la guerre d'Espagne jusqu'à sa fin mystérieuse; celle enfin d'Ivan, un cubain, double de l'auteur, que les circonstances politiques de son pays ont empêché jusqu'alors de réaliser son rêve de devenir écrivain et qui devient un jour dépositaire de l'histoire de ce Ramon Mercader.
Quoi de plus périlleux que de se lancer dans une saga historique à la fois si célèbre (le destin tragique de Trotsky est bien connu par quiconque s'intéresse un peu à l'histoire du XXe siècle) et dont tant d'aspects ne sont que des conjectures ? Comment nous faire comprendre les ressorts qui font agir d'un côté le vieux révolutionnaire bolchévik en rupture de ban, fuyant de pays en pays les sbires de Staline, accompagné de sa femme et de quelques rares amis, et de l'autre le jeune communiste catalan Mercader, recruté par la police politique de Staline et modelé en un ennemi juré du "traître" Trotsky ? Et finalement, de quelle liberté peut jouir un écrivain cubain vivant encore sur cette île, pour rendre compte de cette tragédie historique, sachant les liens étroits qui ont lié Cuba et l'URSS ?
Le miracle de ce roman tient justement dans cette liberté de ton qu'a su trouver Leonardo Padura. Même si sa sympathie penche évidemment du côté du "Vieux", comme l'on surnommait Trotsky, il réussit à nous peindre un Mercader sinon attachant du moins très intéressant et toute la préparation de l'attentat est digne des meilleurs romans d'espionnage. Et la sympathie pour Trotsky ne va pas sans une lucidité à l'égard du compagnon de Lénine qui n'est pas totalement épargné dans ce récit. Et c'est là où le personnage d'Ivan est essentiel au roman pour nous montrer sans complaisance les tristes résultats d'une application rigoureuse des préceptes castristes, déclinaison latino-américaine mais relativement fidèle (sans jeu de mots) du credo léniniste.
D'un point de vue historique, ce roman porte aussi un éclairage passionnant sur toute la période de la guerre d'Espagne (avec notamment la prise de contrôle du camp républicain par les staliniens, éliminant progressivement leurs alliés socialistes, anarchistes et trotskystes, et notamment le leader du POUM, Andreu Nin) et aussi sur la période des procès de Moscou, où Staline, avec avec férocité inouïe, fait le ménage parmi les anciens bolchéviks, et aussi parmi les officiers et médecins juifs, préparant et consolidant le pacte Ribbentrop-Molotov de 1939 avec l'Allemagne nazie. La triste ironie de l'histoire est que c'est Trotsky qui était accusé par Staline de vouloir pactiser avec Hitler !
Au-delà de l'intérêt historique, Padura s'est attaché à restituer mille et un petits détails de la vie de ses personnages, ce qui rend son récit très crédible et très vivant. Ainsi les chiens ont une place particulière dans ce roman et c'est aussi un tour de force de Padura d'avoir trouvé pour titre de son roman une périphrase qui peut désigner l'un ou l'autre de ses trois personnages principaux.
Je ne le cache pas, "L'homme qui aimait les chiens" est un des tout meilleurs romans historiques que j'ai pu lire et c'est aussi un très grand roman humaniste.
(*) J'ai eu l'occasion de voir l'adaptation qui a été tirée en 4 épisodes de 4 de ses romans policiers avec comme personnage principal le flic Mario Conde (que, par facétie, Padura cite dans son roman "L'homme qui aimait les chiens") sous le titre "Quatre saisons à La Havanne" et j'ai beaucoup aimé !
Padura nous raconte de façon parallèle l'histoire de trois personnages : celle de Trotsky depuis son exil en Turquie jusqu'à son assassinat au Mexique, en 1940, commandité par Staline; celle de Ramon Mercader, son assassin, depuis son enrôlement dans le camp républicain pendant la guerre d'Espagne jusqu'à sa fin mystérieuse; celle enfin d'Ivan, un cubain, double de l'auteur, que les circonstances politiques de son pays ont empêché jusqu'alors de réaliser son rêve de devenir écrivain et qui devient un jour dépositaire de l'histoire de ce Ramon Mercader.
Quoi de plus périlleux que de se lancer dans une saga historique à la fois si célèbre (le destin tragique de Trotsky est bien connu par quiconque s'intéresse un peu à l'histoire du XXe siècle) et dont tant d'aspects ne sont que des conjectures ? Comment nous faire comprendre les ressorts qui font agir d'un côté le vieux révolutionnaire bolchévik en rupture de ban, fuyant de pays en pays les sbires de Staline, accompagné de sa femme et de quelques rares amis, et de l'autre le jeune communiste catalan Mercader, recruté par la police politique de Staline et modelé en un ennemi juré du "traître" Trotsky ? Et finalement, de quelle liberté peut jouir un écrivain cubain vivant encore sur cette île, pour rendre compte de cette tragédie historique, sachant les liens étroits qui ont lié Cuba et l'URSS ?
Le miracle de ce roman tient justement dans cette liberté de ton qu'a su trouver Leonardo Padura. Même si sa sympathie penche évidemment du côté du "Vieux", comme l'on surnommait Trotsky, il réussit à nous peindre un Mercader sinon attachant du moins très intéressant et toute la préparation de l'attentat est digne des meilleurs romans d'espionnage. Et la sympathie pour Trotsky ne va pas sans une lucidité à l'égard du compagnon de Lénine qui n'est pas totalement épargné dans ce récit. Et c'est là où le personnage d'Ivan est essentiel au roman pour nous montrer sans complaisance les tristes résultats d'une application rigoureuse des préceptes castristes, déclinaison latino-américaine mais relativement fidèle (sans jeu de mots) du credo léniniste.
D'un point de vue historique, ce roman porte aussi un éclairage passionnant sur toute la période de la guerre d'Espagne (avec notamment la prise de contrôle du camp républicain par les staliniens, éliminant progressivement leurs alliés socialistes, anarchistes et trotskystes, et notamment le leader du POUM, Andreu Nin) et aussi sur la période des procès de Moscou, où Staline, avec avec férocité inouïe, fait le ménage parmi les anciens bolchéviks, et aussi parmi les officiers et médecins juifs, préparant et consolidant le pacte Ribbentrop-Molotov de 1939 avec l'Allemagne nazie. La triste ironie de l'histoire est que c'est Trotsky qui était accusé par Staline de vouloir pactiser avec Hitler !
Au-delà de l'intérêt historique, Padura s'est attaché à restituer mille et un petits détails de la vie de ses personnages, ce qui rend son récit très crédible et très vivant. Ainsi les chiens ont une place particulière dans ce roman et c'est aussi un tour de force de Padura d'avoir trouvé pour titre de son roman une périphrase qui peut désigner l'un ou l'autre de ses trois personnages principaux.
Je ne le cache pas, "L'homme qui aimait les chiens" est un des tout meilleurs romans historiques que j'ai pu lire et c'est aussi un très grand roman humaniste.
(*) J'ai eu l'occasion de voir l'adaptation qui a été tirée en 4 épisodes de 4 de ses romans policiers avec comme personnage principal le flic Mario Conde (que, par facétie, Padura cite dans son roman "L'homme qui aimait les chiens") sous le titre "Quatre saisons à La Havanne" et j'ai beaucoup aimé !
Les deux personnages historiques au centre de ce roman -fleuve sont LéonTrotski et son assassin, Ramón Mercader. Trois fils narratifs alternent : une biographie de Trotski qui commence avec son exil, en 1929, très précise. Elle est suivie de celle de Ramón Mercader, communiste stalinien qui se battit dans les rangs républicains pendant la guerre civile d'Espagne avant d'être recruté (par sa mère !) pour un mystérieux projet. Sans rien en savoir, sinon que celui-ci exigeait un renoncement complet à son ancienne vie et à son identité…
Le troisième fil, plus tardif nous emmène à Cuba en 1977. Ivan, un jeune homme qui avait publié un livre prometteur n'a pas su poursuivre son élan. Il a tenté un second livre qui a été violemment retoqué par la censure d'état. Autant dire, un enterrement de première classe pour ses ambitions littéraires… Il se reconvertit comme vétérinaire semi-officiel. Ivan va rencontrer par hasard un homme âgé qui promène ses deux chiens, deux superbes barzoïs. Il va peu à peu se lier avec cet homme à la santé chancelante. Qui finira par vouloir lui raconter, et en lui demandant de n'en parler à personne, la vie de Ramón Mercader…
Ce roman est à l'évidence remarquablement documenté. le fil narratif de la biographie de Trotski m'a toutefois paru parfois bien aride car Leonardo Padura y a inclus beaucoup du contexte politique de l'époque. de Ramón Mercader je ne savais rien. Donc sa vie mouvementée, ses changements incessants d'identité, m'ont paru plus romanesques. On sait bien comment tout cela s'est terminé à Mexico mais l'auteur parvient à créer un véritable suspense autour de ce meurtre annoncé. La partie cubaine a été pour moi la plus facile à lire et ses personnages très attachants.
Une fois qu'on a bien compris que ces figures politiques de premier plan, de grands fauves, sont en guerre totale les uns contre les autres, avec des moyens humains et financiers considérables, le détail de leurs affrontements politiques m'a paru lassant, ce qui explique ma note mitigée. Je reconnais le grand et beau travail de Leonardo Padura sur ce sujet historique, mais je serai heureux de le retrouver plutôt avec une enquête de Mario Conde.
Le troisième fil, plus tardif nous emmène à Cuba en 1977. Ivan, un jeune homme qui avait publié un livre prometteur n'a pas su poursuivre son élan. Il a tenté un second livre qui a été violemment retoqué par la censure d'état. Autant dire, un enterrement de première classe pour ses ambitions littéraires… Il se reconvertit comme vétérinaire semi-officiel. Ivan va rencontrer par hasard un homme âgé qui promène ses deux chiens, deux superbes barzoïs. Il va peu à peu se lier avec cet homme à la santé chancelante. Qui finira par vouloir lui raconter, et en lui demandant de n'en parler à personne, la vie de Ramón Mercader…
Ce roman est à l'évidence remarquablement documenté. le fil narratif de la biographie de Trotski m'a toutefois paru parfois bien aride car Leonardo Padura y a inclus beaucoup du contexte politique de l'époque. de Ramón Mercader je ne savais rien. Donc sa vie mouvementée, ses changements incessants d'identité, m'ont paru plus romanesques. On sait bien comment tout cela s'est terminé à Mexico mais l'auteur parvient à créer un véritable suspense autour de ce meurtre annoncé. La partie cubaine a été pour moi la plus facile à lire et ses personnages très attachants.
Une fois qu'on a bien compris que ces figures politiques de premier plan, de grands fauves, sont en guerre totale les uns contre les autres, avec des moyens humains et financiers considérables, le détail de leurs affrontements politiques m'a paru lassant, ce qui explique ma note mitigée. Je reconnais le grand et beau travail de Leonardo Padura sur ce sujet historique, mais je serai heureux de le retrouver plutôt avec une enquête de Mario Conde.
Au travers de son personnage principal, Ramon Mercader, l'auteur retrace la désillusion que fût le "stalinisme".
La terreur que le petit "Père des peuples" à instauré et la Peur qui en à découlé, ont fermé les bouches et tués les consciences.
Ce livre est dense, précis, il nous promène de Moscou à Cuba et de Paris à Barcelone en passant par New-York.
C'est un mélange de fiction et de réalité, où la petite histoire d'un républicain espagnol rejoint la grande histoire du XXème siècle.
Padura Fuentes reste impartial et n'hésite pas à critiquer la "victime", il décrit les manipulations psychologique et dialectique misent en place par les penseurs moscovites du N.K.V.D, le "bras de fer" à distance entre Trotsky et Staline...très instructif.
La terreur que le petit "Père des peuples" à instauré et la Peur qui en à découlé, ont fermé les bouches et tués les consciences.
Ce livre est dense, précis, il nous promène de Moscou à Cuba et de Paris à Barcelone en passant par New-York.
C'est un mélange de fiction et de réalité, où la petite histoire d'un républicain espagnol rejoint la grande histoire du XXème siècle.
Padura Fuentes reste impartial et n'hésite pas à critiquer la "victime", il décrit les manipulations psychologique et dialectique misent en place par les penseurs moscovites du N.K.V.D, le "bras de fer" à distance entre Trotsky et Staline...très instructif.
Plutôt que « L'homme qui aimait les chiens» on pourrait dire les hommes qui aimaient les chiens car les protagonistes principaux de ce roman sont tous reliés, entre autre, par leur amour des chiens, et cet amour est un point d'ancrage pour leurs vies errantes, leurs vies volées et éclatées. Il leur permet de rester fidèles à eux-même, de garder un peu de leur âme.
« C'était la chronique même de l'avilissement d'un rêve et un témoignage sur l'un des crimes les plus abjects jamais commis, non seulement parce qu'il affectait le destin de Trotski, après tout concurrent de ce jeu pour le pouvoir et protagoniste de nombreuses atrocités historiques, mais aussi celui de millions de gens entraînés -- malgré eux, bien souvent sans que personne ne se souciât de leurs désirs -- par le ressac de l'histoire et la folie de leurs maîtres déguisés en bienfaiteurs, en messies, en élus, en héritiers de la nécessité historique et de la dialectique incontournable de la lutte des classes.» p 373 Cette réflexion que se fait Ivan, le narrateur cubain de cette longue histoire, résume bien ce que ce roman de Padura nous fait vivre, dans une démonstration et selon une construction sans faille.
C'est dans un climat de peur où règnent le mensonge et la délation que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire vont voir leur vie et celle de leur proches détruites. La manipulation est reine et le manipulateur suprême est Staline qui perfectionne son oeuvre d'effacement de la mémoire.
A travers la nasse mise en place, dès le début de l'exil de Trotski, qui se refermera lentement sur lui et sa famille, après que chaque maillon ait été forgé et soudé à un autre, nous revisitons l'histoire du XXème siècle où des millions d'êtres vont être broyés. L'idéal révolutionnaire qui a fait se soulever des millions de personnes a été détourné au profit du pouvoir bureaucratique et totalitaire d'un seul. Que ce soit ceux qui ont été tués comme opposants ou déclarés comme tels, ou ceux qui ont tué en se croyant justifiés par leur participation à l'avènement de ce rêve de société égalitaire, ils auront au final tous été cyniquement dupés, laminés après avoir perdu toute individualité. Et au-delà de la révolte et du dégoût que peut susciter ce gâchis on ne peut s'empêcher de ressentir une grande compassion devant tant de souffrance.
Comme Ivan le narrateur, qui s'efforce de rassembler tout ce que Jaime Lopez, l'homme aux deux Barzoï, rencontré sur la plage, lui a confié de la vie de Ramon Mercader l'assassin de Trotski, le lecteur va vouloir savoir, comprendre, tenter de découvrir et démêler le vrai du faux. Et Padura réussit à nous tenir en haleine au long des sept cents pages de ce roman qui, loin d'être rébarbatif devient de plus en plus passionnant. Une histoire aux multiples ramifications qui ne trouvera son épilogue tragique qu'en 2004.
« C'était la chronique même de l'avilissement d'un rêve et un témoignage sur l'un des crimes les plus abjects jamais commis, non seulement parce qu'il affectait le destin de Trotski, après tout concurrent de ce jeu pour le pouvoir et protagoniste de nombreuses atrocités historiques, mais aussi celui de millions de gens entraînés -- malgré eux, bien souvent sans que personne ne se souciât de leurs désirs -- par le ressac de l'histoire et la folie de leurs maîtres déguisés en bienfaiteurs, en messies, en élus, en héritiers de la nécessité historique et de la dialectique incontournable de la lutte des classes.» p 373 Cette réflexion que se fait Ivan, le narrateur cubain de cette longue histoire, résume bien ce que ce roman de Padura nous fait vivre, dans une démonstration et selon une construction sans faille.
C'est dans un climat de peur où règnent le mensonge et la délation que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire vont voir leur vie et celle de leur proches détruites. La manipulation est reine et le manipulateur suprême est Staline qui perfectionne son oeuvre d'effacement de la mémoire.
A travers la nasse mise en place, dès le début de l'exil de Trotski, qui se refermera lentement sur lui et sa famille, après que chaque maillon ait été forgé et soudé à un autre, nous revisitons l'histoire du XXème siècle où des millions d'êtres vont être broyés. L'idéal révolutionnaire qui a fait se soulever des millions de personnes a été détourné au profit du pouvoir bureaucratique et totalitaire d'un seul. Que ce soit ceux qui ont été tués comme opposants ou déclarés comme tels, ou ceux qui ont tué en se croyant justifiés par leur participation à l'avènement de ce rêve de société égalitaire, ils auront au final tous été cyniquement dupés, laminés après avoir perdu toute individualité. Et au-delà de la révolte et du dégoût que peut susciter ce gâchis on ne peut s'empêcher de ressentir une grande compassion devant tant de souffrance.
Comme Ivan le narrateur, qui s'efforce de rassembler tout ce que Jaime Lopez, l'homme aux deux Barzoï, rencontré sur la plage, lui a confié de la vie de Ramon Mercader l'assassin de Trotski, le lecteur va vouloir savoir, comprendre, tenter de découvrir et démêler le vrai du faux. Et Padura réussit à nous tenir en haleine au long des sept cents pages de ce roman qui, loin d'être rébarbatif devient de plus en plus passionnant. Une histoire aux multiples ramifications qui ne trouvera son épilogue tragique qu'en 2004.
En 1977, Ivan, écrivain cubain raté, rencontre sur une plage un étrange personnage qui dit avoir connu Ramòn Mercader, l'assassin de Trotski, et qui lui raconte cette histoire incroyable, inconnue à cette époque, du jeune communiste Espagnol fervent qui fut recruté par la police secrète de Staline pour en faire un de ses agents, dont la mission sera aussi difficile qu'historique, celle d'assassiner le renégat Trotski en exil au Mexique.
À travers le prisme de cet épisode troublant, l'auteur raconte le mensonge effroyable du régime soviétique, qui pervertit la révolution du peuple et s'en servit comme d'un paravent pour cacher au monde pendant soixante-quatorze ans l'une des pires dictatures de l'histoire, faisant des millions de morts dans son sillage et enterrant avec fracas la plus belle et grande utopie des temps modernes.
Le roman en montre les victimes à divers degrés: Trotski, initiateur de la révolution, qui n'hésita pas à utiliser le meurtre contre les «ennemis du peuple» mais qui comprend par la suite en avoir dès lors légitimé l'usage qui se tourna rapidement contre les camarades dits dissidents, et dont il finit par être lui-même la cible; Mercader, dont la foi révolutionnaire fut détournée sans scrupule au profit de la soif de pouvoir de Staline; enfin Ivan qui à Cuba souffre de la pauvreté socialiste avec une certaine acceptation jusqu'à ce que la vérité de l'histoire le rattrape et lui montre à quel point ce fut en vain ! La découverte de l'histoire de Mercader lui inflige également un dilemme qui le fait souffrir et qui nous fait réfléchir: un assassin politique peut-il avoir droit à la compassion ? et que dire d'un révolutionnaire qui fut responsable de quantité de meurtres ?
Un grand roman, qui demande un certain effort, mais dont l'envergure, l'humanité et la compréhension de l'Histoire vous récompenseront largement.
À travers le prisme de cet épisode troublant, l'auteur raconte le mensonge effroyable du régime soviétique, qui pervertit la révolution du peuple et s'en servit comme d'un paravent pour cacher au monde pendant soixante-quatorze ans l'une des pires dictatures de l'histoire, faisant des millions de morts dans son sillage et enterrant avec fracas la plus belle et grande utopie des temps modernes.
Le roman en montre les victimes à divers degrés: Trotski, initiateur de la révolution, qui n'hésita pas à utiliser le meurtre contre les «ennemis du peuple» mais qui comprend par la suite en avoir dès lors légitimé l'usage qui se tourna rapidement contre les camarades dits dissidents, et dont il finit par être lui-même la cible; Mercader, dont la foi révolutionnaire fut détournée sans scrupule au profit de la soif de pouvoir de Staline; enfin Ivan qui à Cuba souffre de la pauvreté socialiste avec une certaine acceptation jusqu'à ce que la vérité de l'histoire le rattrape et lui montre à quel point ce fut en vain ! La découverte de l'histoire de Mercader lui inflige également un dilemme qui le fait souffrir et qui nous fait réfléchir: un assassin politique peut-il avoir droit à la compassion ? et que dire d'un révolutionnaire qui fut responsable de quantité de meurtres ?
Un grand roman, qui demande un certain effort, mais dont l'envergure, l'humanité et la compréhension de l'Histoire vous récompenseront largement.
De l'assassinat de Trostky, je ne connaissais quasiment rien si ce n'est le lieu, la date approximative et l'arme du crime dont le choix m'est toujours apparu comme particulièrement cruel. Je savais aussi qu'il avait été commandité par Staline. Je suis donc entrée dans ce roman avec quelque difficulté ne voyant a priori pas de rapport immédiat entre la guerre d'Espagne et l'assassinat de Trostky au Mexique quelques années plus tard. J'ai dû m'armer d'un peu patience avant de me rendre compte que les trois trames narratives (celle de la vie d'exil de Trostky, celle du parcours militant de Mercader, l'assassin ,et celle de la rencontre entre ce dernier et l'écrivain — Comment ne pas y voir un double de Padura ? ) étaient les trois facettes de la même histoire, comprenant au fil de ma lecture que Mercader était un espagnol catalan. C'est alors que j'ai pu appréhender tout le travail d'archiviste que Padura avait dû effectuer et surtout toute son habileté pour me faire vivre tout un pan d'histoire, une des périodes le plus tragiques du XXè siècle et pas seulement pour les Soviétiques.
Même si je connaissais l'issue (la mort tragique de Trotsky), j'ai lu le roman presque comme une enquête policière et le savoir-faire de Padura connu comme écrivain de romans policiers n'est certainement pas étranger à cette impression. Les personnages m'ont paru extrêmement vivants et crédibles, tous à l'exception de Sylvia Ageloff (car j'ai eu bien du mal à l'imaginer aussi sotte et naïve que Padura nous la présente, capable d'avaler les incohérences de comportement de son compagnon Mercader et ses changements d'identité sans le moindre soupçon. J'aurais plutôt tendance à voir en elle une complice…)
Le roman s'étend, en fait, bien au-delà de la mort de Trostsky puis qu'on retrouve Mercader en URSS, après qu'il ait purgé 20 ans de réclusion au Mexique, donc après l'ère stalinienne. Et c'est l'occasion de conversations édifiantes avec son mentor du NKVD, lui même emprisonné pendant plusieurs années sous différents prétextes. Au delà de l'odieux du crime, Padura a su parfaitement remettre l'assassinat de Trostky dans le contexte des folies meurtrières du régime de Staline qui réussissait à faire de ses plus proches collaborateurs des traîtres à la cause communiste. Ceux qui échappaient à la mort en sont restés, comme Mercader que Padura nous montre à la fois assassin et victime d'un système ignoble, meurtris à vie.
Il y aurait beaucoup plus à dire sur ce roman extrêmement dense et je ne peux qu'en recommander la lecture tant pour la reconstitution des faits historiques que pour la qualité littéraire intrinsèque.
Padura a signe ici une oeuvre qui le classe au rang des très grands écrivains contemporains.
Même si je connaissais l'issue (la mort tragique de Trotsky), j'ai lu le roman presque comme une enquête policière et le savoir-faire de Padura connu comme écrivain de romans policiers n'est certainement pas étranger à cette impression. Les personnages m'ont paru extrêmement vivants et crédibles, tous à l'exception de Sylvia Ageloff (car j'ai eu bien du mal à l'imaginer aussi sotte et naïve que Padura nous la présente, capable d'avaler les incohérences de comportement de son compagnon Mercader et ses changements d'identité sans le moindre soupçon. J'aurais plutôt tendance à voir en elle une complice…)
Le roman s'étend, en fait, bien au-delà de la mort de Trostsky puis qu'on retrouve Mercader en URSS, après qu'il ait purgé 20 ans de réclusion au Mexique, donc après l'ère stalinienne. Et c'est l'occasion de conversations édifiantes avec son mentor du NKVD, lui même emprisonné pendant plusieurs années sous différents prétextes. Au delà de l'odieux du crime, Padura a su parfaitement remettre l'assassinat de Trostky dans le contexte des folies meurtrières du régime de Staline qui réussissait à faire de ses plus proches collaborateurs des traîtres à la cause communiste. Ceux qui échappaient à la mort en sont restés, comme Mercader que Padura nous montre à la fois assassin et victime d'un système ignoble, meurtris à vie.
Il y aurait beaucoup plus à dire sur ce roman extrêmement dense et je ne peux qu'en recommander la lecture tant pour la reconstitution des faits historiques que pour la qualité littéraire intrinsèque.
Padura a signe ici une oeuvre qui le classe au rang des très grands écrivains contemporains.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Leonardo Padura (21)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3165 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3165 lecteurs ont répondu