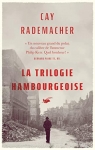Heinz Rein/5
45 notes
Résumé :
Publié en 1947 en Allemagne, vendu à plus de 100 000 exemplaires, Berlin finale est l'un des premiers best-sellers post-Seconde Guerre mondiale. Une œuvre passionnante, haletante, audacieuse, qui a su, alors que l'Europe se relevait à peine de la guerre, décrire dans toute sa complexité le rapport des Berlinois au nazisme.
Jusqu'alors inédit en France, un roman-reportage brillant qui nous raconte, à travers les destins d'une poignée de résistants, les dernier... >Voir plus
Jusqu'alors inédit en France, un roman-reportage brillant qui nous raconte, à travers les destins d'une poignée de résistants, les dernier... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Berlin finaleVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (19)
Voir plus
Ajouter une critique
Étonnant roman que Berlin Finale, pavé de presque neuf cent pages qui se lit moins pour son intrigue romanesque que pour la richesse documentaire qu'il apporte sur la bataille de Berlin et par la même occasion sur la fin du IIIe Reich.
Il y a bien une fiction qui se concentre sur un groupe d'antifascistes se réunissant chaque soir ou presque dans le bar de l'un d'eux avant l'alerte aérienne, mais les dialogues maladroits, répétitifs et très démonstratifs affectent l'intérêt. Ils éloignent le regard qui se porte plus volontiers sur la dimension historique. Ainsi on s'attarde moins sur leurs faits et gestes et les rebondissements très cinématographiques que sur l'incroyable traversée de Berlin que propose Heinz Rein, une traversée captivante autant géographique avec le bruit de fond constant de l'avancée des russes que humaine avec la description de la vie quotidienne des civils.
Il faut préciser qu'en s'intéressant à la biographie de l'auteur, on apprend qu'il a sillonné chaque jour d'avril 1945 les rues de Berlin pour enregistrer mini-reportages, messages militaires et conversations de ceux réfugiés dans les abris antiaériens.
Fort de cette expérience de guerre immédiate, le journaliste Rein a capté un matériau précieux, une densité informative qu'il a su exploiter dans son bouquin avec les sentiments de confusion et de fébrilité croissante qui vont avec. On se passionne pour un récit qui puise sa dramaturgie dans la double menace provenant de la progression des russes avec les bombardements puis la pénétration des fantassins, et la panique des autorités nazies qui, prêtes à anéantir la ville et sacrifier la population, a généré une terreur et un chaos sans commune mesure avec le désordre de la guerre et de la défaite.
Certaines scènes sont effroyables, on est saisi par la puissance des descriptions des paysages de ruine et des situations dramatiques sur lesquels l'auteur s'attarde. Elles sont bien plus convaincantes que les dialogues en forme d'exposé rappelant comment les dignitaires nazis ont réussi à créer un mythe plus puissant que la vérité, un mythe qui a aveuglé la population et qui a signé leur naufrage moral.
Malgré ses défauts littéraires, ce bouquin est essentiel car il se fait le témoin lucide d'une période où le discernement et le bon sens étaient ensevelis sous les décombres chez les nazis habités par leur utopie jusqu'au-boutiste, les soldats de la Wehrmarcht ferrés à leur devoir d'obéissance et les civils réfugiés dans les tunnels et abris antiaériens qui isolent de la vérité mais pas de la propagande hitlérienne.
Lecture marquante.
Il y a bien une fiction qui se concentre sur un groupe d'antifascistes se réunissant chaque soir ou presque dans le bar de l'un d'eux avant l'alerte aérienne, mais les dialogues maladroits, répétitifs et très démonstratifs affectent l'intérêt. Ils éloignent le regard qui se porte plus volontiers sur la dimension historique. Ainsi on s'attarde moins sur leurs faits et gestes et les rebondissements très cinématographiques que sur l'incroyable traversée de Berlin que propose Heinz Rein, une traversée captivante autant géographique avec le bruit de fond constant de l'avancée des russes que humaine avec la description de la vie quotidienne des civils.
Il faut préciser qu'en s'intéressant à la biographie de l'auteur, on apprend qu'il a sillonné chaque jour d'avril 1945 les rues de Berlin pour enregistrer mini-reportages, messages militaires et conversations de ceux réfugiés dans les abris antiaériens.
Fort de cette expérience de guerre immédiate, le journaliste Rein a capté un matériau précieux, une densité informative qu'il a su exploiter dans son bouquin avec les sentiments de confusion et de fébrilité croissante qui vont avec. On se passionne pour un récit qui puise sa dramaturgie dans la double menace provenant de la progression des russes avec les bombardements puis la pénétration des fantassins, et la panique des autorités nazies qui, prêtes à anéantir la ville et sacrifier la population, a généré une terreur et un chaos sans commune mesure avec le désordre de la guerre et de la défaite.
Certaines scènes sont effroyables, on est saisi par la puissance des descriptions des paysages de ruine et des situations dramatiques sur lesquels l'auteur s'attarde. Elles sont bien plus convaincantes que les dialogues en forme d'exposé rappelant comment les dignitaires nazis ont réussi à créer un mythe plus puissant que la vérité, un mythe qui a aveuglé la population et qui a signé leur naufrage moral.
Malgré ses défauts littéraires, ce bouquin est essentiel car il se fait le témoin lucide d'une période où le discernement et le bon sens étaient ensevelis sous les décombres chez les nazis habités par leur utopie jusqu'au-boutiste, les soldats de la Wehrmarcht ferrés à leur devoir d'obéissance et les civils réfugiés dans les tunnels et abris antiaériens qui isolent de la vérité mais pas de la propagande hitlérienne.
Lecture marquante.
Berlin finale est un roman de l'écrivain et journaliste allemand Heinz Rein, boycotté et persécuté par le régime nazi. Publié en Allemagne en 1947, ce livre n'a été publié en français que cette année par la maison d'édition Belfond.
A vrai dire, je ne m'explique pas pourquoi il a fallu attendre plus de soixante-dix ans pour proposer au lectorat francophone une traduction de ce roman hors normes. Sur la plateforme NetGalley grâce à laquelle j'ai pu lire ce livre en service de presse, le résumé proposé par l'éditeur m'avait tout de suite attiré :
" « Nous tenons entre nos mains un témoignage historique absolument unique. »
Fritz J. Raddatz, essayiste et journaliste
Publié en 1947 en Allemagne, vendu à plus de 100 000 exemplaires,
Berlin finale est l'un des premiers best-sellers post-Seconde Guerre mondiale. Une oeuvre passionnante, haletante, audacieuse, qui a su, alors que l'Europe se relevait à peine de la guerre, décrire dans toute sa complexité le rapport des Berlinois au nazisme.
Jusqu'alors inédit en France, un roman-reportage brillant qui nous raconte, à travers les destins d'une poignée de résistants, les derniers jours de Berlin avant sa chute. Un texte majeur, un Vintage événement. "
Heinz Rein nous plonge dans Berlin en avril-mai 1945, lorsque la ville est encerclée par l'armée russe et que le régime nazi ordonne à la population de se battre jusqu'au bout. Nous suivons plusieurs personnages engagés dans la résistance : un jeune soldat déserteur, un médecin social-démocrate, un syndicaliste pourchassé par la Gestapo, la femme de ce dernier, un ouvrier communiste, et un patron de bistrot qui accueille avec bienveillance ce petit groupe de résistants.
Ecrit juste après les événements qui y sont relatés, ce roman est un témoignage glaçant des dernières semaines du Troisième Reich et des combats dans Berlin. L'auteur montre parfaitement comment Hitler et ses sbires étaient prêts à sacrifier toute la population civile de Berlin plutôt qu'admettre la défaite face aux Alliés et en particulier face à l'ennemi soviétique. Il met également en évidence comment les nazis avaient réussi à mettre dans la tête de beaucoup de gens, soldats comme civils, que national-socialisme et Allemagne ne faisaient qu'un et que la chute du régime ne pouvait qu'entrainer la chute totale de la nation allemande.
Le texte d'Heinz Rein alterne des scènes d'action, avec leur lot de rebondissements, des descriptions glaçantes de la ville assiégée et détruite, et de longs dialogues.
Dans ces derniers, les personnages ont parfois tendance à parler comme dans un livre, se substituant ainsi à l'auteur pour lui permettre d'exprimer une opinion, une analyse, certes très souvent intéressante, mais qui ne cadre pas forcément avec les situations dans lesquelles sont plongées les personnages. Cela donne parfois un côté artificiel, faussement romanesque, mais les idées développées sont tellement fortes et intéressantes que cela ne réduit en rien la qualité de l'oeuvre. Dans sa post-face, Fritz J. Raddatz l'exprime bien mieux que moi :
" Dans les moments où Heinz Rein aimerait lui-même prendre la parole, en quelque sorte, où, dans les dialogues, il fait passer à travers la bouche des personnages de son livre ses positions politiques très honorables. D'un côté, c'est encore une fois un principe cinématographique ; car un film a besoin de dialogues, il ne peut fonctionner en se fondant uniquement sur des atmosphères, sur la contemplation extérieure de ses acteurs et actrices. Toutefois, Rein distend ce principe jusqu'à l'improbable. Il est vrai qu'il a réuni un ensemble de personnages intéressants avec son Dr Böttcher plutôt réservé, le pur Berlinois Klose, à la forte personnalité sympathique, le résistant Wiegand qui vit dans la clandestinité, et surtout le déserteur Lassehn qui, très hésitant au début, est toujours surpris de son propre courage. Mais ils parlent trop. Ils fatiguent souvent, sur plusieurs pages, avec des débats et des formes de dialogue laborieuses, avec leurs multiples exposés sur la nature du système nazi, les formes éventuelles de gouvernement après la guerre, sur des dilemmes moraux et sur la possible inutilité du travail de l'ombre : petits séminaires de sciences politiques au café de Klose. "
Parmi ces longues mais passionnantes réflexions de l'auteur à travers ses personnages, j'en ai surlignées de très nombreuses (sur mon Kindle, car je ne maltraite pas les livres papiers au stabilo). Je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais je tiens tout de même à partager celles qui me semblent les plus représentatives ou les plus fortes :
Sur la génération élevée sous le Troisième Reich :
" C'est bien la première fois dans l'histoire de l'humanité que la jeunesse ne se sent pas supérieure à la vieillesse, qu'elle n'est pas fière d'être jeune. Quand vous avez dit à l'instant, monsieur Lassehn, que vous nous enviiez notre âge, votre formule n'était pas tout à fait pertinente, ce n'est pas tellement notre âge que vous convoitez, mais le savoir et les expériences que nous avons accumulés à une époque où le national-socialisme n'avait pas encore restreint la pensée à une formule élémentaire unique. Bien sûr, la plupart de ceux de votre génération n'ont pas encore pris conscience de cette idée, parce qu'elle est masquée par la guerre et les discours de Hitler et de Goebbels qui s'évertuent à être rassurants, mais un jour la guerre finira, Hitler et Goebbels ne seront plus là, et quand le grand silence s'abattra sur eux et que plus personne ne sera là pour approuver leurs actes, quand, de tous côtés, on leur fera des reproches, alors seulement ils comprendront que leur jeunesse a été honteusement trahie, que leur capacité d'enthousiasme a été scandaleusement maltraitée, que leur pensée a été induite en erreur. Un vide immense s'ouvrira devant eux, car, tandis que les générations précédentes peuvent encore trouver refuge dans des conceptions antérieures, le socialisme, le communisme, le libéralisme ou la démocratie, l'Église ou un système philosophique quelconque, la jeunesse se retrouvera tout à fait démunie spirituellement.
[…]
Dans les vingt à vingt-cinq ans. C'est la génération sur laquelle les nazis ont eu une influence totale. Mais nous devons vraiment compter dessus et nous en rapprocher à tout prix. — Et pourquoi ça ? demande Schröter. — Parce que, un jour, quand nous nous retirerons – et ce moment n'est pas très lointain, car nous ne sommes plus tout jeunes, tous autant que nous sommes –, ils seront amenés à gouverner, répond le Dr Böttcher avec gravité.
Ce serait absurde de toute manière de condamner toute une génération, de la radier de la vie de la nation, de l'exclure de l'organisation de son propre avenir. Quand cette guerre désastreuse sera finie, il n'y aura – en gros –que deux directions pour la jeunesse : une partie sera incorrigible et restera aussi national-socialiste qu'avant, elle imputera l'échec aux insuffisances techniques et militaires ; l'autre partie, sans doute plus importante, sera nihiliste, elle errera et vivra en nomade sur le plan politique et intellectuel parce que les fondements de l'existence que les jeunes ont vécue jusqu'ici, de leur foi et de leur, disons, idéologie, leur auront été brusquement arrachés. Il est évident que nous ne pouvons pas assister à ça sans rien faire et laisser la jeunesse livrée à elle-même, mais nous ne devons pas non plus… »
[…]
Car si on en est arrivés au point où la jeunesse allemande est tombée entre les mains des criminels bruns et ne s'est pas rendu compte de la démence de leur doctrine, ce n'est pas sa faute – si toutefois on peut vraiment parler de faute –mais celle de ceux qui ont laissé faire ça. "
Sur la « fusion » entre nation allemande et national-socialisme :
" Les nazis ont réussi, dit Lassehn, à identifier le national-socialisme à la nation allemande, à rendre tout à fait naturelle l'idée que la chute du national-socialisme devait forcément signifier la chute de l'Allemagne et du peuple allemand. J'ai connu plusieurs camarades qui expliquaient en toute franchise qu'ils n'avaient pas de sympathie pour le national-socialisme mais qu'ils se trouvaient dans une situation contraignante et devaient défendre l'Allemagne.
[…]
Ils mettent l'Allemagne à terre en toute conscience parce qu'ils ne savent plus quoi faire. N'ont-ils pas dit clairement que si le parti national-socialiste devait sombrer, ils entraîneraient tout le peuple allemand dans leur chute pour qu'il ne soit pas livré au bon vouloir sadique et à l'asservissement des bolchevistes et des ploutocraties occidentales ? "
Sur le patriotisme allemand :
" Vous savez, dit-il, quand j'entends le mot “Allemagne”, j'ai toujours des sueurs froides, à chaque fois j'entends dzimboum ratatam ratatam et des coups de canon noirs, blancs et rouges.
— Et moi j'entends des Lieder de Schubert et des poèmes d'Eichendorff, je vois la forêt de Thuringe et le lit de la Weser, réplique le Dr Böttcher. Mon cher Schröter, chez certains d'entre vous – et vous semblez faire partie de ceux-là –c'est la même chose que pour les Juifs. de la même façon qu'ils flairent l'antisémitisme dès que quelqu'un ne fait même que prononcer le mot “Juif”, vous entendez toujours nationalisme dès qu'arrive le mot “Allemagne”. "
Sur la culpabilité du peuple allemand :
" Ce n'est pas bien de désigner un seul côté comme coupable, dit le Dr Böttcher. Si nous voulons vraiment aborder la question de la culpabilité, alors je peux vous dire tout de suite mon avis : tout le peuple allemand – à l'exception du petit noyau des combattants clandestins –est coupable, par négligence, par ignorance, par lâcheté, par cette nonchalance typiquement allemande, mais aussi par arrogance, méchanceté, cupidité et besoin de domination. "
Sur la nation allemande et l'humanité :
" En tant qu'Allemands, nous devons gagner cette guerre, avec toutefois cette petite réserve : en tant qu'hommes, nous en avons un peu peur.
— C'est une opinion largement répandue, dit le Dr Böttcher, mais il est facile de la réfuter. Comment peut-il y avoir une divergence entre “allemand” et “humain” ? Il y a quelque chose qui ne va pas, mon ami. Si “allemand” ne veut pas dire “humain”, si je dois dissocier de mon humanité mon identité allemande, alors je ne veux plus être allemand. Or ce qui est allemand a toujours été humain, Dürer, Beethoven, Kant, Goethe, Leibniz sont allemands et universels dans leurs oeuvres, il n'y a pas de différence entre leur origine ethnique et leur culture cosmopolite. Croyez-vous que Beethoven, s'il vivait aujourd'hui, aurait écrit dans le dernier mouvement de sa Neuvième : “Embrassez-vous, millions de sang allemand” ? Non, ce baiser était adressé au monde entier. Et ça ne devrait plus exister aujourd'hui ? "
Au-delà de ces tirades que j'ai trouvées très fortes, il y a un récit rythmé avec des personnages attachants, et surtout la description d'une ville assiégée qui attend la fin de la guerre dans une souffrance intolérable et incompréhensible. J'ai mis une dizaine de jours à le lire, c'est un pavé très riche (plus de 800 pages en version papier), mais ce roman est véritablement un témoignage passionnant et saisissant.
Toujours dans sa post-face, Fritz J. Raddatz résume parfaitement ce livre :
" Un film. Ce livre est un film tourné sur papier. Il a le rythme qu'affectionnent les réalisateurs de documentaires, le montage sec d'un thriller politique, le décor admirablement soigné des grands axes de circulation, des minuscules rues adjacentes, des « passages » quasi inextirpables d'une ville aux millions d'habitants, et cette direction des dialogues qui tantôt sont vifs comme des échanges de ping-pong, tantôt s'étendent largement, dont un roman n'a pas nécessairement besoin, mais dont le cinéma ne peut se passer. Et il a lui aussi un thème musical, dont le compositeur est Heinz Rein : sa haine des nazis, sa rage envers leur crime, appelé la guerre, son effroi devant ce qui a été infligé aux hommes dans l'Allemagne de Hitler, son horreur, doublée de supplication, face à l'assassinat de la ville nommée Berlin, perpétré par des fous – eux-mêmes lâches –méprisant l'humanité, dans un combat final absurde qui n'épargna ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards, ni les estropiés, pas plus que les jeunes aveuglés : Berlin finale."
En conclusion, je ne peux m'empêcher de citer celle de Fritz J. Raddatz, encore et toujours dans post-face :
" Nous devons nous rappeler. Et il faut rappeler ce purgatoire à ceux qui vivent aujourd'hui dans l'aisance, de manière si insoucieuse et agréable. Berlin finale est un livre noir de la honte. "
A vrai dire, je ne m'explique pas pourquoi il a fallu attendre plus de soixante-dix ans pour proposer au lectorat francophone une traduction de ce roman hors normes. Sur la plateforme NetGalley grâce à laquelle j'ai pu lire ce livre en service de presse, le résumé proposé par l'éditeur m'avait tout de suite attiré :
" « Nous tenons entre nos mains un témoignage historique absolument unique. »
Fritz J. Raddatz, essayiste et journaliste
Publié en 1947 en Allemagne, vendu à plus de 100 000 exemplaires,
Berlin finale est l'un des premiers best-sellers post-Seconde Guerre mondiale. Une oeuvre passionnante, haletante, audacieuse, qui a su, alors que l'Europe se relevait à peine de la guerre, décrire dans toute sa complexité le rapport des Berlinois au nazisme.
Jusqu'alors inédit en France, un roman-reportage brillant qui nous raconte, à travers les destins d'une poignée de résistants, les derniers jours de Berlin avant sa chute. Un texte majeur, un Vintage événement. "
Heinz Rein nous plonge dans Berlin en avril-mai 1945, lorsque la ville est encerclée par l'armée russe et que le régime nazi ordonne à la population de se battre jusqu'au bout. Nous suivons plusieurs personnages engagés dans la résistance : un jeune soldat déserteur, un médecin social-démocrate, un syndicaliste pourchassé par la Gestapo, la femme de ce dernier, un ouvrier communiste, et un patron de bistrot qui accueille avec bienveillance ce petit groupe de résistants.
Ecrit juste après les événements qui y sont relatés, ce roman est un témoignage glaçant des dernières semaines du Troisième Reich et des combats dans Berlin. L'auteur montre parfaitement comment Hitler et ses sbires étaient prêts à sacrifier toute la population civile de Berlin plutôt qu'admettre la défaite face aux Alliés et en particulier face à l'ennemi soviétique. Il met également en évidence comment les nazis avaient réussi à mettre dans la tête de beaucoup de gens, soldats comme civils, que national-socialisme et Allemagne ne faisaient qu'un et que la chute du régime ne pouvait qu'entrainer la chute totale de la nation allemande.
Le texte d'Heinz Rein alterne des scènes d'action, avec leur lot de rebondissements, des descriptions glaçantes de la ville assiégée et détruite, et de longs dialogues.
Dans ces derniers, les personnages ont parfois tendance à parler comme dans un livre, se substituant ainsi à l'auteur pour lui permettre d'exprimer une opinion, une analyse, certes très souvent intéressante, mais qui ne cadre pas forcément avec les situations dans lesquelles sont plongées les personnages. Cela donne parfois un côté artificiel, faussement romanesque, mais les idées développées sont tellement fortes et intéressantes que cela ne réduit en rien la qualité de l'oeuvre. Dans sa post-face, Fritz J. Raddatz l'exprime bien mieux que moi :
" Dans les moments où Heinz Rein aimerait lui-même prendre la parole, en quelque sorte, où, dans les dialogues, il fait passer à travers la bouche des personnages de son livre ses positions politiques très honorables. D'un côté, c'est encore une fois un principe cinématographique ; car un film a besoin de dialogues, il ne peut fonctionner en se fondant uniquement sur des atmosphères, sur la contemplation extérieure de ses acteurs et actrices. Toutefois, Rein distend ce principe jusqu'à l'improbable. Il est vrai qu'il a réuni un ensemble de personnages intéressants avec son Dr Böttcher plutôt réservé, le pur Berlinois Klose, à la forte personnalité sympathique, le résistant Wiegand qui vit dans la clandestinité, et surtout le déserteur Lassehn qui, très hésitant au début, est toujours surpris de son propre courage. Mais ils parlent trop. Ils fatiguent souvent, sur plusieurs pages, avec des débats et des formes de dialogue laborieuses, avec leurs multiples exposés sur la nature du système nazi, les formes éventuelles de gouvernement après la guerre, sur des dilemmes moraux et sur la possible inutilité du travail de l'ombre : petits séminaires de sciences politiques au café de Klose. "
Parmi ces longues mais passionnantes réflexions de l'auteur à travers ses personnages, j'en ai surlignées de très nombreuses (sur mon Kindle, car je ne maltraite pas les livres papiers au stabilo). Je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais je tiens tout de même à partager celles qui me semblent les plus représentatives ou les plus fortes :
Sur la génération élevée sous le Troisième Reich :
" C'est bien la première fois dans l'histoire de l'humanité que la jeunesse ne se sent pas supérieure à la vieillesse, qu'elle n'est pas fière d'être jeune. Quand vous avez dit à l'instant, monsieur Lassehn, que vous nous enviiez notre âge, votre formule n'était pas tout à fait pertinente, ce n'est pas tellement notre âge que vous convoitez, mais le savoir et les expériences que nous avons accumulés à une époque où le national-socialisme n'avait pas encore restreint la pensée à une formule élémentaire unique. Bien sûr, la plupart de ceux de votre génération n'ont pas encore pris conscience de cette idée, parce qu'elle est masquée par la guerre et les discours de Hitler et de Goebbels qui s'évertuent à être rassurants, mais un jour la guerre finira, Hitler et Goebbels ne seront plus là, et quand le grand silence s'abattra sur eux et que plus personne ne sera là pour approuver leurs actes, quand, de tous côtés, on leur fera des reproches, alors seulement ils comprendront que leur jeunesse a été honteusement trahie, que leur capacité d'enthousiasme a été scandaleusement maltraitée, que leur pensée a été induite en erreur. Un vide immense s'ouvrira devant eux, car, tandis que les générations précédentes peuvent encore trouver refuge dans des conceptions antérieures, le socialisme, le communisme, le libéralisme ou la démocratie, l'Église ou un système philosophique quelconque, la jeunesse se retrouvera tout à fait démunie spirituellement.
[…]
Dans les vingt à vingt-cinq ans. C'est la génération sur laquelle les nazis ont eu une influence totale. Mais nous devons vraiment compter dessus et nous en rapprocher à tout prix. — Et pourquoi ça ? demande Schröter. — Parce que, un jour, quand nous nous retirerons – et ce moment n'est pas très lointain, car nous ne sommes plus tout jeunes, tous autant que nous sommes –, ils seront amenés à gouverner, répond le Dr Böttcher avec gravité.
Ce serait absurde de toute manière de condamner toute une génération, de la radier de la vie de la nation, de l'exclure de l'organisation de son propre avenir. Quand cette guerre désastreuse sera finie, il n'y aura – en gros –que deux directions pour la jeunesse : une partie sera incorrigible et restera aussi national-socialiste qu'avant, elle imputera l'échec aux insuffisances techniques et militaires ; l'autre partie, sans doute plus importante, sera nihiliste, elle errera et vivra en nomade sur le plan politique et intellectuel parce que les fondements de l'existence que les jeunes ont vécue jusqu'ici, de leur foi et de leur, disons, idéologie, leur auront été brusquement arrachés. Il est évident que nous ne pouvons pas assister à ça sans rien faire et laisser la jeunesse livrée à elle-même, mais nous ne devons pas non plus… »
[…]
Car si on en est arrivés au point où la jeunesse allemande est tombée entre les mains des criminels bruns et ne s'est pas rendu compte de la démence de leur doctrine, ce n'est pas sa faute – si toutefois on peut vraiment parler de faute –mais celle de ceux qui ont laissé faire ça. "
Sur la « fusion » entre nation allemande et national-socialisme :
" Les nazis ont réussi, dit Lassehn, à identifier le national-socialisme à la nation allemande, à rendre tout à fait naturelle l'idée que la chute du national-socialisme devait forcément signifier la chute de l'Allemagne et du peuple allemand. J'ai connu plusieurs camarades qui expliquaient en toute franchise qu'ils n'avaient pas de sympathie pour le national-socialisme mais qu'ils se trouvaient dans une situation contraignante et devaient défendre l'Allemagne.
[…]
Ils mettent l'Allemagne à terre en toute conscience parce qu'ils ne savent plus quoi faire. N'ont-ils pas dit clairement que si le parti national-socialiste devait sombrer, ils entraîneraient tout le peuple allemand dans leur chute pour qu'il ne soit pas livré au bon vouloir sadique et à l'asservissement des bolchevistes et des ploutocraties occidentales ? "
Sur le patriotisme allemand :
" Vous savez, dit-il, quand j'entends le mot “Allemagne”, j'ai toujours des sueurs froides, à chaque fois j'entends dzimboum ratatam ratatam et des coups de canon noirs, blancs et rouges.
— Et moi j'entends des Lieder de Schubert et des poèmes d'Eichendorff, je vois la forêt de Thuringe et le lit de la Weser, réplique le Dr Böttcher. Mon cher Schröter, chez certains d'entre vous – et vous semblez faire partie de ceux-là –c'est la même chose que pour les Juifs. de la même façon qu'ils flairent l'antisémitisme dès que quelqu'un ne fait même que prononcer le mot “Juif”, vous entendez toujours nationalisme dès qu'arrive le mot “Allemagne”. "
Sur la culpabilité du peuple allemand :
" Ce n'est pas bien de désigner un seul côté comme coupable, dit le Dr Böttcher. Si nous voulons vraiment aborder la question de la culpabilité, alors je peux vous dire tout de suite mon avis : tout le peuple allemand – à l'exception du petit noyau des combattants clandestins –est coupable, par négligence, par ignorance, par lâcheté, par cette nonchalance typiquement allemande, mais aussi par arrogance, méchanceté, cupidité et besoin de domination. "
Sur la nation allemande et l'humanité :
" En tant qu'Allemands, nous devons gagner cette guerre, avec toutefois cette petite réserve : en tant qu'hommes, nous en avons un peu peur.
— C'est une opinion largement répandue, dit le Dr Böttcher, mais il est facile de la réfuter. Comment peut-il y avoir une divergence entre “allemand” et “humain” ? Il y a quelque chose qui ne va pas, mon ami. Si “allemand” ne veut pas dire “humain”, si je dois dissocier de mon humanité mon identité allemande, alors je ne veux plus être allemand. Or ce qui est allemand a toujours été humain, Dürer, Beethoven, Kant, Goethe, Leibniz sont allemands et universels dans leurs oeuvres, il n'y a pas de différence entre leur origine ethnique et leur culture cosmopolite. Croyez-vous que Beethoven, s'il vivait aujourd'hui, aurait écrit dans le dernier mouvement de sa Neuvième : “Embrassez-vous, millions de sang allemand” ? Non, ce baiser était adressé au monde entier. Et ça ne devrait plus exister aujourd'hui ? "
Au-delà de ces tirades que j'ai trouvées très fortes, il y a un récit rythmé avec des personnages attachants, et surtout la description d'une ville assiégée qui attend la fin de la guerre dans une souffrance intolérable et incompréhensible. J'ai mis une dizaine de jours à le lire, c'est un pavé très riche (plus de 800 pages en version papier), mais ce roman est véritablement un témoignage passionnant et saisissant.
Toujours dans sa post-face, Fritz J. Raddatz résume parfaitement ce livre :
" Un film. Ce livre est un film tourné sur papier. Il a le rythme qu'affectionnent les réalisateurs de documentaires, le montage sec d'un thriller politique, le décor admirablement soigné des grands axes de circulation, des minuscules rues adjacentes, des « passages » quasi inextirpables d'une ville aux millions d'habitants, et cette direction des dialogues qui tantôt sont vifs comme des échanges de ping-pong, tantôt s'étendent largement, dont un roman n'a pas nécessairement besoin, mais dont le cinéma ne peut se passer. Et il a lui aussi un thème musical, dont le compositeur est Heinz Rein : sa haine des nazis, sa rage envers leur crime, appelé la guerre, son effroi devant ce qui a été infligé aux hommes dans l'Allemagne de Hitler, son horreur, doublée de supplication, face à l'assassinat de la ville nommée Berlin, perpétré par des fous – eux-mêmes lâches –méprisant l'humanité, dans un combat final absurde qui n'épargna ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards, ni les estropiés, pas plus que les jeunes aveuglés : Berlin finale."
En conclusion, je ne peux m'empêcher de citer celle de Fritz J. Raddatz, encore et toujours dans post-face :
" Nous devons nous rappeler. Et il faut rappeler ce purgatoire à ceux qui vivent aujourd'hui dans l'aisance, de manière si insoucieuse et agréable. Berlin finale est un livre noir de la honte. "
Avril 1945: une ville qui agonise sous les bombardements.
Après la reddition allemande, Heinz Rein produit un docu-fiction glaçant et réaliste de l'effroyable vécu des berlinois au printemps 1945, coincés entre les deux fronts alliés, vivant comme des rats dans les décombres avec un stoïcisme apparent.
Le lecteur est immergé dans le quotidien de survie, la peur de l'anéantissement, le « jusqu'au boutisme » imposé, l'ébauche d'un esprit de résistance anti nazi, et le fatalisme général.
Berlin Finale est un récit de l'intérieur apportant une image complète de l'évolution des mentalités de la société allemande depuis la fin de la Grande Guerre. le parcours de personnages symboliques offre un décryptage psychologique d'un pays entraîné par consentement ambiguë dans l'horreur du national-socialisme. Ceci permet de comprendre comment tout un peuple s'est peu à peu soudé derrière son dirigeant, au point de demeurer autiste à la défaite jusqu'aux derniers jours, ou de faire «comme si» par crainte du terrorisme d'Etat.
C'est un témoignage très littéraire, presque théâtrale dans les dialogues. On imagine bien que certaines conversations n'ont pu avoir lieu dans l'état d'urgence du moment. L'ensemble privilégie la réflexion, l'analyse et l'introspection à la fiction narrative, permettant une approche avec plusieurs angles de vue. Les événements sont néanmoins décrits par le menu, que ce soient les déplacements ou les combats de rues.
Avec des extraits de discours ou informations, c'est tout à fait remarquable historiquement.
Un regret de ne pouvoir s'appuyer sur une carte de l'ancien Berlin, qui aurait été bien utile pour suivre les précisions millimétrées des quartiers décrits, et une réserve sur quelques longueurs qui frôlent le risque d'ennui.
#HeinzRein#Berlinfinale#NetGalleyFrance
Après la reddition allemande, Heinz Rein produit un docu-fiction glaçant et réaliste de l'effroyable vécu des berlinois au printemps 1945, coincés entre les deux fronts alliés, vivant comme des rats dans les décombres avec un stoïcisme apparent.
Le lecteur est immergé dans le quotidien de survie, la peur de l'anéantissement, le « jusqu'au boutisme » imposé, l'ébauche d'un esprit de résistance anti nazi, et le fatalisme général.
Berlin Finale est un récit de l'intérieur apportant une image complète de l'évolution des mentalités de la société allemande depuis la fin de la Grande Guerre. le parcours de personnages symboliques offre un décryptage psychologique d'un pays entraîné par consentement ambiguë dans l'horreur du national-socialisme. Ceci permet de comprendre comment tout un peuple s'est peu à peu soudé derrière son dirigeant, au point de demeurer autiste à la défaite jusqu'aux derniers jours, ou de faire «comme si» par crainte du terrorisme d'Etat.
C'est un témoignage très littéraire, presque théâtrale dans les dialogues. On imagine bien que certaines conversations n'ont pu avoir lieu dans l'état d'urgence du moment. L'ensemble privilégie la réflexion, l'analyse et l'introspection à la fiction narrative, permettant une approche avec plusieurs angles de vue. Les événements sont néanmoins décrits par le menu, que ce soient les déplacements ou les combats de rues.
Avec des extraits de discours ou informations, c'est tout à fait remarquable historiquement.
Un regret de ne pouvoir s'appuyer sur une carte de l'ancien Berlin, qui aurait été bien utile pour suivre les précisions millimétrées des quartiers décrits, et une réserve sur quelques longueurs qui frôlent le risque d'ennui.
#HeinzRein#Berlinfinale#NetGalleyFrance
Lassehn se réfugie dans le café de Klose le 14 avril 1945 à Berlin. Il a déserté 3 mois plus tôt.
Activistes anti fascistes, Klose et ses amis, le Dc Böttcher et le syndicaliste Wiegand vont le prendre sous leur aile dans ces jours cruciaux de la bataille de Berlin.
Entre alertes aériennes, caches, conciliabules dans l'arrière salle du café, distributions de tracts anti nazis, déplacements risqués à travers les rues en ruine pour échapper aux SS, à la Gestapo, aux réquisitions du Volksturm (ces unités constituées de civils âgés, malades) censées défendre la capitale du grand Reich contre les chars russes… Heinz Rein nous donne à voir la ville , ses rues éventrées, ses murs effondrés, ses canalisations crevées, dans laquelle les incendies font rage.
Et bien sûr, il nous donne à voir et à entendre les Berlinois.
Ceux qui comme Lassehn ouvrent enfin les yeux sur la folie nazie, qui n'en peuvent plus, qui critiquent en douce quand aucune chemise brune ne traine dans le coin ou bien, crie, hurle leur souffrance après la perte d'un proche, d'un enfant.
Des Berlinois tellement convaincus de la supériorité allemande, tellement embrigadés aux théories nazies qui croient ou veulent croire à la propagande qui inondera jusqu'aux derniers instants les populations d'annonces de succès, de renforts, d'armes secrètes.... et les exhortera à résister jusqu'au bout.
Et enfin, les brutes, les purs, les durs, acculés, prêts comme leur Führer à sacrifier la ville entière et sa population dans l'hystérie guerrière.
Le texte est étonnant (ce ne serait pas un roman, ce n'est pas un document, l'auteur s'en défendait).
Entre d'abondantes descriptions de la ville martyrisée, les dialogues sont nombreux et permettent de confronter les différents points de vue des personnages, de mener des réflexions sur l'avenir, HR mêle des textes réels : extraits de journaux de propagande, de discours de Goebbels habilement introduits dans le récit par le souci de chacun de se tenir au courant des événements, de faire la part du vrai et du faux des informations diffusées.
Enfin, il y a aussi des chapitres entiers consacrés à un personnage absolument secondaire mais dont le destin éclaire le propos général. Ce sont comme de petites parenthèses, des anecdotes dans ce déroulement chronologique implacable : une biographie d'un national-socialiste, la folie d'un homme frappé par le deuil.
J'ai beaucoup aimé ce roman qui m'a fait énormément penser à deux textes de Sébastien Haffner « Considérations sur Hitler » et « Journal d'un Allemand ». La lucidité de Heinz Rein qui publie dès 1947 laisse entrevoir sa détestation du national-socialisme. Les dernières paroles échangées par ses personnages laisse entrevoir à leur tour l'avenir de ce qui deviendra bien vite la RDA et la position de l'auteur face au nouvel ordre soviétique.
Je n'ai qu'un regret. J'ai choisi la version audio-livre. Non pas que la lecture de Jean Christophe Lebert soit mauvaise, au contraire. Elle est agréable, vivante, juste.
Je pense cependant, que pour moi, en tous cas, la version papier aurait été plus judicieuse me permettant de farfouiller dans le volume, de relire des échanges d'arguments.
Un livre hors norme. Une découverte.
Activistes anti fascistes, Klose et ses amis, le Dc Böttcher et le syndicaliste Wiegand vont le prendre sous leur aile dans ces jours cruciaux de la bataille de Berlin.
Entre alertes aériennes, caches, conciliabules dans l'arrière salle du café, distributions de tracts anti nazis, déplacements risqués à travers les rues en ruine pour échapper aux SS, à la Gestapo, aux réquisitions du Volksturm (ces unités constituées de civils âgés, malades) censées défendre la capitale du grand Reich contre les chars russes… Heinz Rein nous donne à voir la ville , ses rues éventrées, ses murs effondrés, ses canalisations crevées, dans laquelle les incendies font rage.
Et bien sûr, il nous donne à voir et à entendre les Berlinois.
Ceux qui comme Lassehn ouvrent enfin les yeux sur la folie nazie, qui n'en peuvent plus, qui critiquent en douce quand aucune chemise brune ne traine dans le coin ou bien, crie, hurle leur souffrance après la perte d'un proche, d'un enfant.
Des Berlinois tellement convaincus de la supériorité allemande, tellement embrigadés aux théories nazies qui croient ou veulent croire à la propagande qui inondera jusqu'aux derniers instants les populations d'annonces de succès, de renforts, d'armes secrètes.... et les exhortera à résister jusqu'au bout.
Et enfin, les brutes, les purs, les durs, acculés, prêts comme leur Führer à sacrifier la ville entière et sa population dans l'hystérie guerrière.
Le texte est étonnant (ce ne serait pas un roman, ce n'est pas un document, l'auteur s'en défendait).
Entre d'abondantes descriptions de la ville martyrisée, les dialogues sont nombreux et permettent de confronter les différents points de vue des personnages, de mener des réflexions sur l'avenir, HR mêle des textes réels : extraits de journaux de propagande, de discours de Goebbels habilement introduits dans le récit par le souci de chacun de se tenir au courant des événements, de faire la part du vrai et du faux des informations diffusées.
Enfin, il y a aussi des chapitres entiers consacrés à un personnage absolument secondaire mais dont le destin éclaire le propos général. Ce sont comme de petites parenthèses, des anecdotes dans ce déroulement chronologique implacable : une biographie d'un national-socialiste, la folie d'un homme frappé par le deuil.
J'ai beaucoup aimé ce roman qui m'a fait énormément penser à deux textes de Sébastien Haffner « Considérations sur Hitler » et « Journal d'un Allemand ». La lucidité de Heinz Rein qui publie dès 1947 laisse entrevoir sa détestation du national-socialisme. Les dernières paroles échangées par ses personnages laisse entrevoir à leur tour l'avenir de ce qui deviendra bien vite la RDA et la position de l'auteur face au nouvel ordre soviétique.
Je n'ai qu'un regret. J'ai choisi la version audio-livre. Non pas que la lecture de Jean Christophe Lebert soit mauvaise, au contraire. Elle est agréable, vivante, juste.
Je pense cependant, que pour moi, en tous cas, la version papier aurait été plus judicieuse me permettant de farfouiller dans le volume, de relire des échanges d'arguments.
Un livre hors norme. Une découverte.
Berlin Finale est un témoignage cruellement immersif de ce Berlin à l'agonie en ce printemps 45. Nous y sommes: dans la poussière, le sang, les ruines et les flammes, dans le chaos des esprits laminés et résignés, dans la défaite nazie qui refuse de dire son nom.
Les descriptions sont débitées avec la précision chirurgicale du scalpel, les sons et les odeurs exhalées des pages vous prennent à la gorge au fil des mots.
Nous y sommes.
La documentation historique est exceptionnelle, imagées d'extraits de journaux ou de proclamations officielles, émaillée de dialogues pointus et engagés (trop parfois!). La frénésie de tuerie est omniprésente, dans un souci d'auto-destruction des nazis les plus acharnés, mais aussi par instinct de survie. le chaos et l'anarchie décime les rues berlinoises aussi sûrement que l'avancée des russes et des Alliés. La Grande Histoire se déroule mais c'est aussi la terreur de chacun qui blanchit l'aube…
Car toute description physique, aussi fidèle, réaliste et précise qu'elle soit, n'émeut pas si des êtres humains ne sont pas présents pour faire vibrer l'ensemble. Et c'est ce que l'auteur nous accorde avec le récit de ces personnages, que ce soit un médecin devenu résistant, que ce soit un déserteur ou un clandestin. Des instantanés de vies, d'état d'esprit, de réflexion, de croyances, de fidélités. Des moments de doutes, de peurs et d'incertitudes également. Et quand la trivialité du quotidien effilochent les relations humaines, il reste les convictions pour avancer. Et les inévitables traîtres et compromissions.
Un bémol? Quelques longueurs ou répétitions accompagnées d'une couleur politique qui aurait pu se faire plus discrète et un cruel manque d'une carte de l'ancien Berlin pour suivre les déplacements ultra-précis décrits dans ce docu-roman.
Berlin Finale est un témoignage historique de première main, exceptionnel, tant par le déroulement des événements, sa fidélité historique, que par l'analyse de la situation et de la psyché des berlinois dans les derniers mois de la guerre, au jour le jour. Incontournable pour tenter de cerner la complexité de ce qui liait les allemands au nazisme alors que Berlin chute car nous le savons bien, rien n'est tout noir ou tout blanc…
Lien : http://livrenvieblackkatsblo..
Les descriptions sont débitées avec la précision chirurgicale du scalpel, les sons et les odeurs exhalées des pages vous prennent à la gorge au fil des mots.
Nous y sommes.
La documentation historique est exceptionnelle, imagées d'extraits de journaux ou de proclamations officielles, émaillée de dialogues pointus et engagés (trop parfois!). La frénésie de tuerie est omniprésente, dans un souci d'auto-destruction des nazis les plus acharnés, mais aussi par instinct de survie. le chaos et l'anarchie décime les rues berlinoises aussi sûrement que l'avancée des russes et des Alliés. La Grande Histoire se déroule mais c'est aussi la terreur de chacun qui blanchit l'aube…
Car toute description physique, aussi fidèle, réaliste et précise qu'elle soit, n'émeut pas si des êtres humains ne sont pas présents pour faire vibrer l'ensemble. Et c'est ce que l'auteur nous accorde avec le récit de ces personnages, que ce soit un médecin devenu résistant, que ce soit un déserteur ou un clandestin. Des instantanés de vies, d'état d'esprit, de réflexion, de croyances, de fidélités. Des moments de doutes, de peurs et d'incertitudes également. Et quand la trivialité du quotidien effilochent les relations humaines, il reste les convictions pour avancer. Et les inévitables traîtres et compromissions.
Un bémol? Quelques longueurs ou répétitions accompagnées d'une couleur politique qui aurait pu se faire plus discrète et un cruel manque d'une carte de l'ancien Berlin pour suivre les déplacements ultra-précis décrits dans ce docu-roman.
Berlin Finale est un témoignage historique de première main, exceptionnel, tant par le déroulement des événements, sa fidélité historique, que par l'analyse de la situation et de la psyché des berlinois dans les derniers mois de la guerre, au jour le jour. Incontournable pour tenter de cerner la complexité de ce qui liait les allemands au nazisme alors que Berlin chute car nous le savons bien, rien n'est tout noir ou tout blanc…
Lien : http://livrenvieblackkatsblo..
critiques presse (1)
Pour sa précision dans les descriptions de la vie quotidienne du Berlin en guerre, pour l’humanité qu’il dégage, pour son illustration des capacités de l’humain, ce roman mérite d’être classé dans les romans-repères de cette époque. A (re)découvrir sans plus tarder.
Lire la critique sur le site : Actualitte
Citations et extraits (35)
Voir plus
Ajouter une citation
Berlin, avril 1945
Lisbonne, San Francisco et Tokyo furent détruits par un tremblement de terre en quelques minutes, et il fallut plusieurs jours pour que les incendies de Rome, Chicago et Londres s’éteignissent. Les brasiers et séismes qui se sont déchaînés sur l’endroit de la surface de la terre situé à 52° et 30´ de latitude nord et 13° et 24´ de longitude est ont duré presque deux ans. Ils ont débuté dans la nuit claire et sombre du 23 août 1943 et fini sous le ciel gris et pluvieux du 2 mai 1945.
Là, à trente-deux mètres au-dessus du niveau de la mer, encastrée dans une dune de l’ère glaciaire, s’étendait la ville de Berlin, jusqu’à cette nuit où la destruction a entamé sa marche funeste. D’ancien village de pêcheurs, elle avait été élevée au rang de bourg, de siège des margraves et des princes-électeurs du Brandebourg, de résidence des rois de Prusse et enfin de capitale de l’Empire allemand impérial et républicain. Créée après l’avancée des tribus allemandes dans le territoire des Wendes et des Slaves, des siècles durant, elle se tint à l’écart des régions de culture allemande, forteresse dans le pays colonial, bastion retranché de la vieille partie occidentale, avant-poste de la nouvelle partie orientale, elle n’entra dans le domaine de l’histoire allemande que plus tard, et bien plus tard encore elle y occupa la place centrale. Elle était composée d’une multitude de villes petites, grandes et de taille moyenne, de villages, de hameaux, de propriétés et de fermes, qui étaient dispersés entre la Havel et la partie est du plateau des lacs de Brandebourg, avant de se réunir en s’étirant vers les vieux bourgs de Berlin et de Cölln. Le ciselet de l’Histoire a œuvré avec parcimonie, il y a très peu de traces de son ascension et de sa métamorphose, mais ses multiples visages ont été affinés en quelques traits nobles gravés en profondeur dans le cœur de la ville.
Les vestiges du déclin qui a immédiatement suivi son accession au statut de capitale du Grand Empire allemand sont innombrables. Les feux, appelés grands incendies, les orages d’acier tissés dans des tapis de bombes ont transformé la figure ensanglantée de la ville en une tête de mort grimaçante.
La ville s’est vu infliger sa blessure initiale le 23 août 1943, lorsque deux cents avions de l’armée de l’air britannique ont porté la première attaque d’envergure. Les banlieues sud de Lankwitz, Südende et Lichterfelde sont devenues une île de mort, noircie par la fumée, dans l’océan de la vie, mais, cette fois-ci, ce ne fut pas l’océan qui engloutit l’île, mais l’île qui repoussa l’océan, et bientôt elle n’a plus été seule, partout, dans Moabit et la Friedrichstadt, autour de la gare d’Ostkreuz et à Charlottenbourg, sur la Moritzplatz et dans le Lustgarten, des îles de mort sont apparues, elles n’ont cessé de repousser plus loin leurs rivages et se sont rejointes, jusqu’à ce que la ville entière finisse par devenir un pays de mort, au milieu de quelques étendues d’eau dans lesquelles on trouve encore un peu de vie. Chaque attaque arrache un morceau à la structure de la ville, anéantit les biens, dégrade les conditions de vie.
Des quartiers entiers sont détruits et se dépeuplent. D’immenses zones industrielles deviennent des déserts de halles effondrées et de machines rouillées, de tuyaux, de barres, de câbles et de poutrelles métalliques. De nombreuses rues dont les façades toujours debout bordent encore les trottoirs ne sont plus que de cyniques trompe-l’œil. D’autres secteurs sont si mutilés qu’ils en deviennent méconnaissables, emplis d’une vie au souffle court, les restes de maisons déformées se dressent, dénudés et affreux, au milieu des tas de ruines, ces restes s’élèvent comme des îles au-dessus de la mer de destruction, les maisons sont dépouillées et échevelées, les chevrons des toits extraits telles des côtes auxquelles on aurait retiré la peau, les fenêtres sont aussi aveugles que des yeux aux paupières constamment baissées, ne clignant que de temps en temps pour laisser échapper un regard vitreux, les murs sont nus et sans plus d’éclat, semblables à de vieilles femmes dont le rouge et le maquillage auraient été effacés par une éponge impipoyable.
Dans d’autres parties de la ville, la dévastation n’est pas aussi totale, certes, la patte de la guerre a creusé d’énormes trouées, laissant souvent entrevoir de façon inattendue des immeubles d’arrière-cour rescapés des frappes, visibles pour la première fois, depuis les trottoirs, ils ne peuvent plus cacher leur horrible figure derrière l’apparat bas de gamme des maisons côté rue, puisque l’ouragan des explosions a, d’une certaine manière, levé le rideau. On trouve là tous les degrés et les variétés de la désolation, de l’anéantissement complet aux maisons en carton et cellulose ; des bâtiments dont les charpentes ont brûlé, certains totalement consumés par les flammes, à l’exception du premier étage, d’autres encore que les déflagrations ont balayés arrachant les croisées des fenêtres, les stores et les portes, et en haut desquels les squelettes décharnés des charpentes s’élancent vers le ciel comme des os sortent des cadavres. Des appartements sont perchés comme des nids d’hirondelles au-dessus des devantures éclatées, signe que les bombes sont tombées en biais, des caves ont tenu bon face à la pression des maisons effondrées, et seuls des tuyaux de poêle fumant au milieu de montagnes de gravats de plusieurs mètres de haut laissent voir que des gens y végètent comme dans la tanière d’un renard. L’anatomie des maisons s’expose à nu, les escaliers, les cloisons, les cages d’ascenseur et les cheminées sont les os, les conduites d’eau et de gaz, les artères, les radiateurs et les baignoires, les tripes. Un reste de vie lutte au milieu de la jungle de ruines, et la nature commence à coloniser la destruction brute en envahissant de mauvaises herbes les décombres.
La toile du réseau de transports aux multiples ramifications, tissée des nombreuses lignes de tramways et d’autobus, de métros souterrains et aériens, de la Stadtbahn et de la Ringbahn, des trains de banlieue et des S-Bahn, est déchirée, raccommodée en urgence, arrangée de manière provisoire, les horaires changent de jour en jour car les destructions de rails, de caténaires, de rails conducteurs, de câbles de signalisation, de tunnels, de viaducs, de ponts et de gares provoquent des restrictions, des suppressions, des dérivations.
Les traits représentatifs de la ville, les édifices du classicisme bourgeois groupés autour de l’île de la Spree et de l’axe tournant de l’avenue Unter den Linden, les caractéristiques de son visage créé de main de maître par Schinkel, Schlüter et Eosander, Rauch, Knobelsdorff et Langhans sont anéantis, et après que l’architecture de planche à dessin de Speer en a pris possession, ses emblèmes sont les bunkers, ces accumulateurs de la peur, ces inhalateurs de la déroute, blocs de béton gris-vert armés de batteries de canons antiaériens, aussi imposants que des mammouths géants, ils écrasent le quartier de Friedrichshain, le parc de Humboldthain et le Jardin zoologique, aucune ligne agréable ne venant adoucir leur architecture si brutalement fonctionnelle. À ceux-ci viennent s’ajouter les nombreux abris, souterrains et en surface, sur les places et à proximité des gares du centre-ville, dans les lotissements et les jardins ouvriers, ainsi que leur forme la plus primitive, les tranchées, creusées dans les parcs, les coins de forêt et au bord des talus qui longent les voies des trains de banlieue.
Au moment où la guerre a éclaté, la ville comptait 4 330 000 habitants, en avril 1945 il n’en reste plus que 2 850 000. Les hommes sont appelés au service militaire, réquisitionnés pour l’Organisation Todt, mobilisés pour le Volkssturm, transférés avec leurs entreprises, les femmes sont réfugiées dans les zones a priori non touchées par les menaces aériennes, les personnes âgées et les malades sont évacués, les jeunes gens sont convoqués au Service du travail, les écoliers sont envoyés dans les camps d’éloignement à la campagne, les Juifs sont déportés. Les pertes démographiques sont en réalité bien plus importantes, sur les 2 850 000 habitants de la ville, 700 000 sont des travailleurs forcés étrangers venus de pays soumis et assujettis, des Ukrainiens, des Polonais, des Roumains, des Grecs, des Yougoslaves, des Tchèques, des Italiens, des Français, des Belges, des Hollandais, des Norvégiens, des Danois, des Hongrois, des Juifs capables de travailler et des concentrationnaires des camps de la mort de l’Est. Ils sont parqués dans des baraquements construits à la hâte et entourés de barbelés, sur les étendues désertes entre la ville et les banlieues, des décharges et des terrains vagues, le plus souvent le long des voies ferrées. Ces bâtiments présentent une ressemblance frappante avec les logements provisoires érigés pour les victimes de bombardements, qui se tiennent, mornes et gris, entre les bois et les jardins ouvriers, à la seule différence qu’ici (comme partout) les barbelés sont remplacés par le réseau invisible d’un système de surveillance et de coercition hautement perfectionné.
Les ministères ont quitté Berlin, sont « délocalisés » ou éloignés dans des « points d’évitement », sur la Wilhelmstrasse les locaux sont démontés, jour et nuit on charge dans des camions des dossiers, des armoires et des caisses, mais aussi des meubles, des ustensiles de ménage et des valises. Les hautes administrations des ministères et du parti fuient la ville, seuls ce qu’on appelle des « centres de contrôle » restent sur place, mais pour eux aussi on s’inquiète et on met à leur disposition les trains spéciaux « Adler » et « Dohle » à Lichterfelde-West et Michendorf ainsi que de nombreuses voitures privées.
Lisbonne, San Francisco et Tokyo furent détruits par un tremblement de terre en quelques minutes, et il fallut plusieurs jours pour que les incendies de Rome, Chicago et Londres s’éteignissent. Les brasiers et séismes qui se sont déchaînés sur l’endroit de la surface de la terre situé à 52° et 30´ de latitude nord et 13° et 24´ de longitude est ont duré presque deux ans. Ils ont débuté dans la nuit claire et sombre du 23 août 1943 et fini sous le ciel gris et pluvieux du 2 mai 1945.
Là, à trente-deux mètres au-dessus du niveau de la mer, encastrée dans une dune de l’ère glaciaire, s’étendait la ville de Berlin, jusqu’à cette nuit où la destruction a entamé sa marche funeste. D’ancien village de pêcheurs, elle avait été élevée au rang de bourg, de siège des margraves et des princes-électeurs du Brandebourg, de résidence des rois de Prusse et enfin de capitale de l’Empire allemand impérial et républicain. Créée après l’avancée des tribus allemandes dans le territoire des Wendes et des Slaves, des siècles durant, elle se tint à l’écart des régions de culture allemande, forteresse dans le pays colonial, bastion retranché de la vieille partie occidentale, avant-poste de la nouvelle partie orientale, elle n’entra dans le domaine de l’histoire allemande que plus tard, et bien plus tard encore elle y occupa la place centrale. Elle était composée d’une multitude de villes petites, grandes et de taille moyenne, de villages, de hameaux, de propriétés et de fermes, qui étaient dispersés entre la Havel et la partie est du plateau des lacs de Brandebourg, avant de se réunir en s’étirant vers les vieux bourgs de Berlin et de Cölln. Le ciselet de l’Histoire a œuvré avec parcimonie, il y a très peu de traces de son ascension et de sa métamorphose, mais ses multiples visages ont été affinés en quelques traits nobles gravés en profondeur dans le cœur de la ville.
Les vestiges du déclin qui a immédiatement suivi son accession au statut de capitale du Grand Empire allemand sont innombrables. Les feux, appelés grands incendies, les orages d’acier tissés dans des tapis de bombes ont transformé la figure ensanglantée de la ville en une tête de mort grimaçante.
La ville s’est vu infliger sa blessure initiale le 23 août 1943, lorsque deux cents avions de l’armée de l’air britannique ont porté la première attaque d’envergure. Les banlieues sud de Lankwitz, Südende et Lichterfelde sont devenues une île de mort, noircie par la fumée, dans l’océan de la vie, mais, cette fois-ci, ce ne fut pas l’océan qui engloutit l’île, mais l’île qui repoussa l’océan, et bientôt elle n’a plus été seule, partout, dans Moabit et la Friedrichstadt, autour de la gare d’Ostkreuz et à Charlottenbourg, sur la Moritzplatz et dans le Lustgarten, des îles de mort sont apparues, elles n’ont cessé de repousser plus loin leurs rivages et se sont rejointes, jusqu’à ce que la ville entière finisse par devenir un pays de mort, au milieu de quelques étendues d’eau dans lesquelles on trouve encore un peu de vie. Chaque attaque arrache un morceau à la structure de la ville, anéantit les biens, dégrade les conditions de vie.
Des quartiers entiers sont détruits et se dépeuplent. D’immenses zones industrielles deviennent des déserts de halles effondrées et de machines rouillées, de tuyaux, de barres, de câbles et de poutrelles métalliques. De nombreuses rues dont les façades toujours debout bordent encore les trottoirs ne sont plus que de cyniques trompe-l’œil. D’autres secteurs sont si mutilés qu’ils en deviennent méconnaissables, emplis d’une vie au souffle court, les restes de maisons déformées se dressent, dénudés et affreux, au milieu des tas de ruines, ces restes s’élèvent comme des îles au-dessus de la mer de destruction, les maisons sont dépouillées et échevelées, les chevrons des toits extraits telles des côtes auxquelles on aurait retiré la peau, les fenêtres sont aussi aveugles que des yeux aux paupières constamment baissées, ne clignant que de temps en temps pour laisser échapper un regard vitreux, les murs sont nus et sans plus d’éclat, semblables à de vieilles femmes dont le rouge et le maquillage auraient été effacés par une éponge impipoyable.
Dans d’autres parties de la ville, la dévastation n’est pas aussi totale, certes, la patte de la guerre a creusé d’énormes trouées, laissant souvent entrevoir de façon inattendue des immeubles d’arrière-cour rescapés des frappes, visibles pour la première fois, depuis les trottoirs, ils ne peuvent plus cacher leur horrible figure derrière l’apparat bas de gamme des maisons côté rue, puisque l’ouragan des explosions a, d’une certaine manière, levé le rideau. On trouve là tous les degrés et les variétés de la désolation, de l’anéantissement complet aux maisons en carton et cellulose ; des bâtiments dont les charpentes ont brûlé, certains totalement consumés par les flammes, à l’exception du premier étage, d’autres encore que les déflagrations ont balayés arrachant les croisées des fenêtres, les stores et les portes, et en haut desquels les squelettes décharnés des charpentes s’élancent vers le ciel comme des os sortent des cadavres. Des appartements sont perchés comme des nids d’hirondelles au-dessus des devantures éclatées, signe que les bombes sont tombées en biais, des caves ont tenu bon face à la pression des maisons effondrées, et seuls des tuyaux de poêle fumant au milieu de montagnes de gravats de plusieurs mètres de haut laissent voir que des gens y végètent comme dans la tanière d’un renard. L’anatomie des maisons s’expose à nu, les escaliers, les cloisons, les cages d’ascenseur et les cheminées sont les os, les conduites d’eau et de gaz, les artères, les radiateurs et les baignoires, les tripes. Un reste de vie lutte au milieu de la jungle de ruines, et la nature commence à coloniser la destruction brute en envahissant de mauvaises herbes les décombres.
La toile du réseau de transports aux multiples ramifications, tissée des nombreuses lignes de tramways et d’autobus, de métros souterrains et aériens, de la Stadtbahn et de la Ringbahn, des trains de banlieue et des S-Bahn, est déchirée, raccommodée en urgence, arrangée de manière provisoire, les horaires changent de jour en jour car les destructions de rails, de caténaires, de rails conducteurs, de câbles de signalisation, de tunnels, de viaducs, de ponts et de gares provoquent des restrictions, des suppressions, des dérivations.
Les traits représentatifs de la ville, les édifices du classicisme bourgeois groupés autour de l’île de la Spree et de l’axe tournant de l’avenue Unter den Linden, les caractéristiques de son visage créé de main de maître par Schinkel, Schlüter et Eosander, Rauch, Knobelsdorff et Langhans sont anéantis, et après que l’architecture de planche à dessin de Speer en a pris possession, ses emblèmes sont les bunkers, ces accumulateurs de la peur, ces inhalateurs de la déroute, blocs de béton gris-vert armés de batteries de canons antiaériens, aussi imposants que des mammouths géants, ils écrasent le quartier de Friedrichshain, le parc de Humboldthain et le Jardin zoologique, aucune ligne agréable ne venant adoucir leur architecture si brutalement fonctionnelle. À ceux-ci viennent s’ajouter les nombreux abris, souterrains et en surface, sur les places et à proximité des gares du centre-ville, dans les lotissements et les jardins ouvriers, ainsi que leur forme la plus primitive, les tranchées, creusées dans les parcs, les coins de forêt et au bord des talus qui longent les voies des trains de banlieue.
Au moment où la guerre a éclaté, la ville comptait 4 330 000 habitants, en avril 1945 il n’en reste plus que 2 850 000. Les hommes sont appelés au service militaire, réquisitionnés pour l’Organisation Todt, mobilisés pour le Volkssturm, transférés avec leurs entreprises, les femmes sont réfugiées dans les zones a priori non touchées par les menaces aériennes, les personnes âgées et les malades sont évacués, les jeunes gens sont convoqués au Service du travail, les écoliers sont envoyés dans les camps d’éloignement à la campagne, les Juifs sont déportés. Les pertes démographiques sont en réalité bien plus importantes, sur les 2 850 000 habitants de la ville, 700 000 sont des travailleurs forcés étrangers venus de pays soumis et assujettis, des Ukrainiens, des Polonais, des Roumains, des Grecs, des Yougoslaves, des Tchèques, des Italiens, des Français, des Belges, des Hollandais, des Norvégiens, des Danois, des Hongrois, des Juifs capables de travailler et des concentrationnaires des camps de la mort de l’Est. Ils sont parqués dans des baraquements construits à la hâte et entourés de barbelés, sur les étendues désertes entre la ville et les banlieues, des décharges et des terrains vagues, le plus souvent le long des voies ferrées. Ces bâtiments présentent une ressemblance frappante avec les logements provisoires érigés pour les victimes de bombardements, qui se tiennent, mornes et gris, entre les bois et les jardins ouvriers, à la seule différence qu’ici (comme partout) les barbelés sont remplacés par le réseau invisible d’un système de surveillance et de coercition hautement perfectionné.
Les ministères ont quitté Berlin, sont « délocalisés » ou éloignés dans des « points d’évitement », sur la Wilhelmstrasse les locaux sont démontés, jour et nuit on charge dans des camions des dossiers, des armoires et des caisses, mais aussi des meubles, des ustensiles de ménage et des valises. Les hautes administrations des ministères et du parti fuient la ville, seuls ce qu’on appelle des « centres de contrôle » restent sur place, mais pour eux aussi on s’inquiète et on met à leur disposition les trains spéciaux « Adler » et « Dohle » à Lichterfelde-West et Michendorf ainsi que de nombreuses voitures privées.
On ne peut véritablement comprendre le national-socialisme, son ampleur monstrueuse et sa puissance terrible, sa cruauté impitoyable et son amoralité absolue, qu’en analysant les caractères et les tempéraments, les souhaits et les objectifs, les intérêts et les raisons des hommes qui ont rejoint le parti dès avant 1933, ce sont eux qui ont donné au parti son identité, ses principes et sa teneur, dans la deuxième phase de l’histoire du parti ils ont poursuivi leur engagement sans rien changer, et ils n’ont jamais perdu leur légitimité. Malgré tous les travestissements et les circonlocutions, malgré tous les vernis culturels et l’élégance diplomatique, la substance réelle transparaissait partout et toujours. Sur ce point, il ne fait aucun doute que Hitler avait raison quand il disait que le parti devait toujours agir selon les règles qui le définissaient. Ces règles étaient la trahison, le meurtre, la terreur, la cruauté, l’amoralité, et la fidélité à ces règles. Les avoir appliquées en tout temps et en tout lieu, c’est en réalité la seule loyauté qu’on peut concéder aux nazis.
Aussi hétérogènes qu’aient été les éléments qui se sont retrouvés dans le parti avant qu’il devienne le parti d’État, ils étaient tous rassemblés sous un dénominateur commun : chacun d’entre eux était sorti des rails, ou était sur le point de le faire. Il y a en premier lieu les soldats incapables de s’adapter à un emploi paisible, ou qui n’en ont jamais eu, et les officiers dont la fonction a soudain perdu de son prestige et ne leur offre plus aucune perspective ; ils ont en commun ce besoin de se soumettre et en même temps de pouvoir donner des ordres, éternels sous-officiers habitués à obéir et à n’assumer aucune responsabilité puisqu’ils reçoivent les ordres de titulaires de postes plus élevés. Et puis il y a ceux, innombrables, qui ont fait naufrage dans le civil et à qui la faute n’incombe jamais, qui ne mettent pas en cause leurs défauts ou leur paresse mais toujours ceux des autres et les circonstances défavorables. Dans cette catégorie, il faut compter les éternels désœuvrés, les vieux croûtons universitaires, ceux qui n’ont pas réussi à devenir chef comptable ou maître d’œuvre. Et ceux qui sont marqués par la nature, dont l’infériorité va de pair avec un besoin érostratique de se faire remarquer, et les membres des associations de malfaiteurs à qui l’occasion s’offre ici, sur leur territoire attitré, de descendre dans l’arène politique. Tous ont décidé de se lancer dans la politique, parce que le Führer l’avait fait et que cela semblait la façon la plus simple et la moins fatigante de réussir.
Ils ont été rejoints par les masses de la petite bourgeoisie et de la classe moyenne ; sans ambition politique, elles étaient, au fond, ce que leur Führer avait désigné un jour avec mépris comme un tas d’amateurs, elles s’accrochaient au national-socialisme comme à l’unique espoir d’empêcher l’effondrement de l’ordre social bourgeois et de rétablir la stabilité de cet édifice chancelant et craquelant. Enfin, il faut aussi mentionner une horde de desperados politiques, à savoir tous ceux dont l’arrivisme n’avait pas été servi par d’autres partis, qui n’avaient pas pu s’imposer ou qui, la plupart du temps pour des raisons tout à fait évidentes, en étaient plus ou moins forcément exclus. Et c’est ce conglomérat de traits de caractère mêlant attitude de mercenaire, instinct de gangster, désir bourgeois de possession, échec à vivre, fatalisme existentiel, sentiment de persécution, besoin maladif de briller, arrogance raciale, c’est cette créature étrange et contre nature qui symbolise le soi-disant Homo teutonicus novus, censé apporter une culture nouvelle, et qui a réussi à faire entrer toute la richesse et la variété d’un peuple débordant de talents dans le lit de Procuste d’un manuel politique minable. Tout cela sera élevé au rang de thèse et de dogme par les hommes de main savants et les gardes-chiourmes philosophes avant d’être transmis tel quel de génération en génération en tant qu’axiome, comme une forme de légitimation et de justification a posteriori, une tentative d’enfiler le masque de l’honnête homme par-dessus la figure grimaçante du barbare. Ce qui demeurait d’idéalisme sincère et de croyance naïve n’avait pas le moindre impact sur la ligne prétendument idéologique et n’était toléré qu’à la marge, avec une profonde méfiance. L’essence du parti était fondée de manière inaltérable et irrévocable sur la clique hétéroclite de baroudeurs, de bourgeoisie déracinée et de sous-prolétariat abject, et plus encore sur le troupeau sans volonté ni instinct de la petite et moyenne bourgeoisie apolitique, qui se sent menacé par le capitalisme monopoliste et craint l’effondrement dans le prolétariat industriel.
Aussi hétérogènes qu’aient été les éléments qui se sont retrouvés dans le parti avant qu’il devienne le parti d’État, ils étaient tous rassemblés sous un dénominateur commun : chacun d’entre eux était sorti des rails, ou était sur le point de le faire. Il y a en premier lieu les soldats incapables de s’adapter à un emploi paisible, ou qui n’en ont jamais eu, et les officiers dont la fonction a soudain perdu de son prestige et ne leur offre plus aucune perspective ; ils ont en commun ce besoin de se soumettre et en même temps de pouvoir donner des ordres, éternels sous-officiers habitués à obéir et à n’assumer aucune responsabilité puisqu’ils reçoivent les ordres de titulaires de postes plus élevés. Et puis il y a ceux, innombrables, qui ont fait naufrage dans le civil et à qui la faute n’incombe jamais, qui ne mettent pas en cause leurs défauts ou leur paresse mais toujours ceux des autres et les circonstances défavorables. Dans cette catégorie, il faut compter les éternels désœuvrés, les vieux croûtons universitaires, ceux qui n’ont pas réussi à devenir chef comptable ou maître d’œuvre. Et ceux qui sont marqués par la nature, dont l’infériorité va de pair avec un besoin érostratique de se faire remarquer, et les membres des associations de malfaiteurs à qui l’occasion s’offre ici, sur leur territoire attitré, de descendre dans l’arène politique. Tous ont décidé de se lancer dans la politique, parce que le Führer l’avait fait et que cela semblait la façon la plus simple et la moins fatigante de réussir.
Ils ont été rejoints par les masses de la petite bourgeoisie et de la classe moyenne ; sans ambition politique, elles étaient, au fond, ce que leur Führer avait désigné un jour avec mépris comme un tas d’amateurs, elles s’accrochaient au national-socialisme comme à l’unique espoir d’empêcher l’effondrement de l’ordre social bourgeois et de rétablir la stabilité de cet édifice chancelant et craquelant. Enfin, il faut aussi mentionner une horde de desperados politiques, à savoir tous ceux dont l’arrivisme n’avait pas été servi par d’autres partis, qui n’avaient pas pu s’imposer ou qui, la plupart du temps pour des raisons tout à fait évidentes, en étaient plus ou moins forcément exclus. Et c’est ce conglomérat de traits de caractère mêlant attitude de mercenaire, instinct de gangster, désir bourgeois de possession, échec à vivre, fatalisme existentiel, sentiment de persécution, besoin maladif de briller, arrogance raciale, c’est cette créature étrange et contre nature qui symbolise le soi-disant Homo teutonicus novus, censé apporter une culture nouvelle, et qui a réussi à faire entrer toute la richesse et la variété d’un peuple débordant de talents dans le lit de Procuste d’un manuel politique minable. Tout cela sera élevé au rang de thèse et de dogme par les hommes de main savants et les gardes-chiourmes philosophes avant d’être transmis tel quel de génération en génération en tant qu’axiome, comme une forme de légitimation et de justification a posteriori, une tentative d’enfiler le masque de l’honnête homme par-dessus la figure grimaçante du barbare. Ce qui demeurait d’idéalisme sincère et de croyance naïve n’avait pas le moindre impact sur la ligne prétendument idéologique et n’était toléré qu’à la marge, avec une profonde méfiance. L’essence du parti était fondée de manière inaltérable et irrévocable sur la clique hétéroclite de baroudeurs, de bourgeoisie déracinée et de sous-prolétariat abject, et plus encore sur le troupeau sans volonté ni instinct de la petite et moyenne bourgeoisie apolitique, qui se sent menacé par le capitalisme monopoliste et craint l’effondrement dans le prolétariat industriel.
La pensée élève l'homme au-dessus de l'animal ? dit-elle. Mon cher garçon, c'est ce que disent les philosophes qui croupissent dans leur pièce, seuls et abandonnés des dieux, ou qui planent bien loin au-dessus de la terre sur des nuages roses. Aucun animal n'est aussi cruel, lâche, sournois, méchant que l'homme doué de pensée. En quoi élevons-nous au-dessus de l'animal ? En inventant des lance-flammes, des bombes incendiaires au phosphore, des chambres à gaz, des gaz toxiques ? Ha, et ne me parle pas de l'homme comme noble créature.
p. 508
p. 508
Ils sont parqués dans des baraquements construits à la hâte et entourés de barbelés, sur les étendues désertes entre la ville et les banlieues, des décharges et des terrains vagues, le plus souvent le long des voies ferrées. Ces bâtiments présentent une ressemblance frappante avec les logements provisoires érigés pour les victimes de bombardements, qui se tiennent, mornes et gris, entre les bois et les jardins ouvriers, à la seule différence qu'ici (comme partout) les barbelés sont remplacés par le réseau invisible d'un système de surveillance et de coercition hautement perfectionné.
p. 17-18
p. 17-18
Kiepert fait partie de ces personnes qui n’ont rejoint le parti national-socialiste qu’après 1933 et, aux yeux d’un observateur peu attentif, ils passent pour de bons nazis, ils n’ont rien à voir avec la brutalité des anciens combattants et des camarades du parti d’avant 1933. Ils ne se rendent pas compte non plus qu’ils sont bien plus coupables que ces derniers, parce qu’ils agissent par pur intérêt personnel et professionnel, et aussi par confort, en connaissance de cause et contre la voix de leur conscience, ils se considèrent comme des individus car ils ont des réserves sur tel ou tel dogme national-socialiste, alors qu’au fond ils se laissent prendre par des ruses de maquignon, ils ont sombré lentement mais sûrement dans la pensée de masse, finissent par réellement croire que Hitler est le bras de la Providence et que les Allemands sont le peuple élu, et abandonnent leurs derniers états d’âme lorsque la guerre soulève la question de l’être ou du non-être. Depuis, sans le remarquer et peut-être même sans le vouloir, ils se sont attachés si étroitement au régime national-socialiste que perdre la guerre, voir chuter le parti, signifierait aussi l’effondrement de leur propre existence. Le tour de passe-passe qui consiste à assimiler le parti national-socialiste au peuple allemand a ainsi définitivement marché, et si cette guerre n’a pas déclenché d’enthousiasme, la disposition intérieure du peuple allemand, en particulier du côté de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie, n’a pas été moindre que l’exaltation massive de 1914.
Le lieutenant de police Kiepert ne tolérerait probablement pas qu’on le décrive comme un homme enclin à se livrer à des brutalités et à des excès, une telle accusation ne provoquerait sans doute qu’un sourire incrédule et compatissant de sa part. Et de fait, c’est un homme plutôt agréable qui mène une vie de famille harmonieuse et ne manque de respect à personne, il n’est pas vraiment conscient d’être l’instrument d’un État tyrannique, d’une justice policière cruelle et d’une politique répressive monstrueuse. Quand, de temps à autre, il sonde sa conscience et soumet sa conduite à un examen, il se sent innocent. Certes, il exécute certains ordres avec réticence et il ne peut réprimer tout à fait un sentiment de pitié envers les personnes touchées, mais il ne s’attribue aucune responsabilité pour autant. Et quand ses états d’âme le tourmentent, il se justifie selon l’argument suivant : s’il y a faute, elle est à imputer aux ordres, sur lesquels il n’a aucun pouvoir et ne peut formuler aucune critique.
Kiepert est le citoyen type du IIIe Reich, une synthèse de respectabilité personnelle, de faible caractère et d’obéissance inconditionnelle à toutes les exigences de l’État. La schizophrénie de l’Allemand lambda, sa négation de l’unité entre l’être social et l’être individuel, et enfin l’étroitesse d’esprit imposée d’en haut conduisent à une pensée raciste qui permet à tout un peuple, à des millions de personnes laborieuses et ordonnées, de sombrer en une armée d’ilotes qui sape frénétiquement toute humanité avec le mécanisme d’un robot.
Le lieutenant de police Kiepert ne tolérerait probablement pas qu’on le décrive comme un homme enclin à se livrer à des brutalités et à des excès, une telle accusation ne provoquerait sans doute qu’un sourire incrédule et compatissant de sa part. Et de fait, c’est un homme plutôt agréable qui mène une vie de famille harmonieuse et ne manque de respect à personne, il n’est pas vraiment conscient d’être l’instrument d’un État tyrannique, d’une justice policière cruelle et d’une politique répressive monstrueuse. Quand, de temps à autre, il sonde sa conscience et soumet sa conduite à un examen, il se sent innocent. Certes, il exécute certains ordres avec réticence et il ne peut réprimer tout à fait un sentiment de pitié envers les personnes touchées, mais il ne s’attribue aucune responsabilité pour autant. Et quand ses états d’âme le tourmentent, il se justifie selon l’argument suivant : s’il y a faute, elle est à imputer aux ordres, sur lesquels il n’a aucun pouvoir et ne peut formuler aucune critique.
Kiepert est le citoyen type du IIIe Reich, une synthèse de respectabilité personnelle, de faible caractère et d’obéissance inconditionnelle à toutes les exigences de l’État. La schizophrénie de l’Allemand lambda, sa négation de l’unité entre l’être social et l’être individuel, et enfin l’étroitesse d’esprit imposée d’en haut conduisent à une pensée raciste qui permet à tout un peuple, à des millions de personnes laborieuses et ordonnées, de sombrer en une armée d’ilotes qui sape frénétiquement toute humanité avec le mécanisme d’un robot.
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Quiz
Voir plus
QUIZ LIBRE (titres à compléter)
John Irving : "Liberté pour les ......................"
ours
buveurs d'eau
12 questions
287 lecteurs ont répondu
Thèmes :
roman
, littérature
, témoignageCréer un quiz sur ce livre287 lecteurs ont répondu