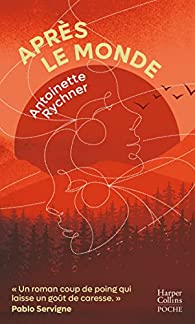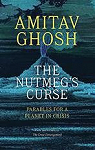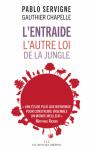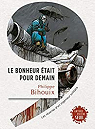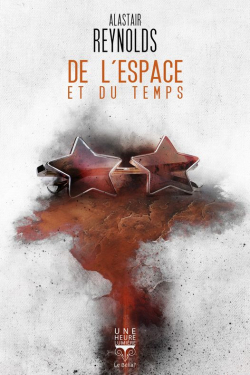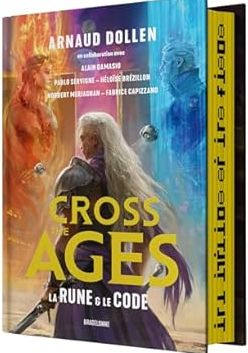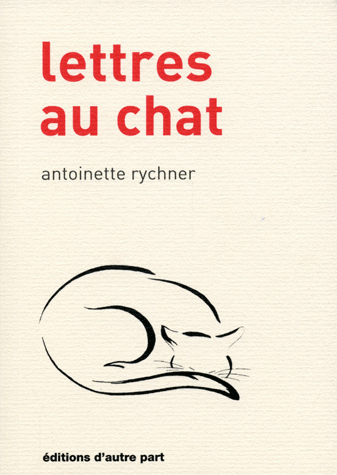Antoinette Rychner/5
183 notes
Résumé :
Novembre 2022. Un cyclone d’ampleur inédite ravage la côte ouest des États-Unis. Incapables de rembourser les dégâts, les compagnies d’assurance font faillite ; à leur suite, le système financier américain s’effondre, entraînant dans sa chute le système mondial. Plus d’argent disponible, plus de sources d’énergie, des catastrophes climatiques en chaîne, plus de communications… En quelques mois, le monde entier tel que nous le connaissons est englouti.
... >Voir plus
... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Après le mondeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (43)
Voir plus
Ajouter une critique
COLLAPSOBOBOLOGIE APPLIQUÉE
À tout seigneur, tout honneur : remercions pour commencer les vénérables éditions Buchet-Chastel ainsi que notre site bibliomaniaque en ligne préféré, l'incontournable Biblio.com, pour cet envoi réalisé dans le cadre d'une Masse Critique spéciale.
Avant d'entamer une chronique probablement assez rapide, il nous fallait préciser que nos lectures nous portent assez régulièrement vers ces genres que l'on désigne aujourd'hui bien souvent par les termes que voici : roman dystopique, post-apocalyptique (souvent désigné par son apocope de "post-apo"), parfois "anticipation" - qui a un peu vieilli mais que nous trouvions pourtant à notre goût -, plus rarement encore "contre-utopie", qui implique bien souvent une part non négligeable de descriptions et d'explications savantes, philosophiques, politiques d'où la part romanesque est généralement évincée ; de toute manière, ce genre qui fit les beaux jours des rayons des libraires de la fin du XIXè et du début du siècle précédent ne fait plus guère recette aujourd'hui. L'un des plus récent et parmi les plus remarquable est bien évidemment le fulgurant roman de l'américain Cormac Mc Carthy, La route qui, sans jamais faire dans la démonstration ni l'étude de thème fastidieux, est d'une puissance colossale, servi par un style souvent bref mais d'une étrange et souvent violente poésie. Mais il en existe bien d'autres.
Hélas, c'est un peu tout l'inverse ici. Reprenons depuis le début :
Nous sommes dans pas bien longtemps (fin 2022 pour être exact). "Cela" débute par un simple ouragan un peu plus fort que les autres, un peu plus destructeur et surtout atteignant la région la plus riche du globe : les côtes de la Californie. Jusque-là, rien que de très malheureusement (de plus en plus) commun. Sauf que... Sauf que l'effondrement tant craint (espéré ?) par certains, à commencer par ceux que l'on nomme désormais de ce néologisme plutôt bien trouvé, les collapsologues, est déjà en cours : les sommes à rembourser sont tellement faramineuses, les dégâts tellement incroyables, que le marché, jusque-là bon prince, les sociétés d'assurance, véritables hydres financières modernes, ne peuvent s'en sortir. Au Noël de cette annus horribilis, il est désormais clair que le système n'est plus assez résilient pour s'en sortir, malgré toutes les "réunions au sommet" de rigueur. Par effet domino, c'est l'ensemble des secteurs économiques puis sociaux et politiques qui vont être touchés, d'abord aux USA puis sur toute la planète, pour ne plus jamais pouvoir faire machine arrière.
La suite, c'est principalement à travers le regard - et la voix, dite ou scandée, à la manière, ou supposée telle, des bardes celtes : c'est une dimension essentielle du roman - de deux femmes que le hasard a réuni au moment où s'instauraient le pouvoir inique des "Frères Helvètes" (clin d’œil ironiquement renversé aux tristement célèbres "Frères Musulmans" ?), Barbara et Christelle, jugées pas assez purement suisses pour pouvoir rester au sein de la petite communauté (racialiste) des nouveaux dominants. Après un long voyage en Maramure - une région de Transylvanie à la frontière entre Roumanie et Ukraine, jugée par a priori écolo-bobo plus résiliente car moins atteinte par les assauts néfastes de la post-modernité : cela s'avérera plus un rêve qu'une réalité -, ces deux femmes, accompagnées d'un mari et d'une enfant pour l'une, de ses souvenirs pour l'autres, s'en reviennent à la Chaux de Fonds afin de tenter à nouveau leur chance dans la région de l'ancienne Suisse où elles avaient fait leur vie d'avant.
S'ensuit alors toute une galerie de portraits - hâtivement brossés et manquant bien souvent de profondeur - de ces survivants de l'après, de descriptions plus ou moins précises de ces micro-sociétés reconstruites bien souvent autour d'une poignée de "sachants" aux savoirs techniques et agricoles devenus immensément précieux (mais qu'on voit en réalité fort peu), ayant eu à lutter ou luttant encore contre des chefs de bande sans scrupule mais qui ont compris que ces petites expériences communautaires plus ou moins anarchisantes (dans un sens politique) sont leur principales sources de ravitaillement et qu'il est préférable de les contrôler, d'en limiter la propagation tout en les laissant vivre à défaut de ne plus pouvoir maintenir leur propre nouvel ordre, violent, brutal, raciste, machiste, intolérant mais généralement assez improductif. Chaque personnage croisé au sein de ces petites structures porte en lui son lot de drames récents, de désespoir mais aussi d'espoirs, de volonté de vivre et de reconstruire "autre chose", mieux, plus juste, plus solidaire, plus équitable. Chaque chapitre amène ainsi son lot de témoignages, d'expériences manquées ou sur le point de réussir, de ce petit groupe initial qui se fait et se défait au fil des pages, au fil des rencontres mais aussi des drames.
D'une construction très audacieuse autour de l'ordre alphabétique des prénoms des personnages croisés au fil du texte, abécédaire humain et humaniste au milieu duquel s'entremêlent plusieurs chapitres de "chants" - celui construit peu à peu par ces deux femmes - relatant le passé proche, le présent en passe de se reconstruire et du futur espéré malgré l'horreur d'un monde s'enfonçant peu à peu dans le chaos, l'ensemble, pourtant servi par un style très agréable, vif, facile sans être jamais simpliste, ne convainc pas. C'est alors qu'on se souvient que le roman est accompagné d'un bandeau : "lu et approuvé par Pablo Servigne" (les lecteurs de cette chronique pardonneront cette extrapolation. Ceci relève plus d'une interprétation très personnelle que de la réalité). Pourquoi en faire état ici ? Tout simplement pour la raison qu'il est évident que l'autrice de cette dystopie a lu, très à font, le fameux collapsologue. Ainsi que quelques autres, tel Dominique Bourg dont une citation de son Une nouvelle Terre - chroniqué par votre serviteur sur Babelio - dont une citation sert aussi de frontispice. Il est probable que mes lectures m'ayant déjà régulièrement porté vers ces rivages catastrophistes - mais possiblement réalistes -, l'effet de sidération qu'un tel roman pouvait provoquer sur votre humble serviteur s'en est trouvé irrémédiablement affaibli. Mais il y a aussi, et cela m'a paru vraiment insupportable, qu'il m'a semblé découvrir avec cet Après le monde, une sorte de copier-coller romanesque et théâtralisé (Antoinette Rychner est par ailleurs une brillante dramaturge) du désormais fameux Comment tout peut s'effondrer : Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, et ses avatars éditoriaux successifs.
Sans aucun doute les intentions étaient-elles très bonnes et particulièrement ambitieuses, mais sans un certain recul, sans avoir bien pris le temps de mâcher et remâcher cette vision du monde à venir - tout à la fois terrifiante et pleine d'espoirs, même minuscules -, à vouloir aussi trop embrasser de thématiques - pêle-mêle : la violence, le racisme, le féminisme, la survie, les expériences politiques en milieu extrême, la culture et sa transmission, les rapports homme-femme, la féminité, le patriarcat, etc. Un feu d'artifice de thématiques bobos de très grandes villes, trop souvent ressassés et lassants -, Antoinette Rychner a pris le risque d'écrire un roman total, et s'est un peu fourvoyée.
Trop démonstratif, trop en surface, sans bien prendre le temps de pénétrer l'âme humaine à force de passer d'un portrait à un autre, guère convaincante dans les moments qui auraient dû se révéler les plus puissants, les plus forts tel le récit des périodes les plus dures. Ainsi, le lecteur prend le risque de voir défiler une sorte de catalogue collapso bien moins persuasif et suggestif - un comble - que les essais économiques, politiques et sociaux dont l'ouvrage s'inspire assurément. Il faudra par exemple attendre le troisième tiers du roman pour ressentir pleinement, sans filtre ni faux-semblants, une véritable peine humaine, en l'occurrence la douleur vécue par les parents d'une gamine qui se meurt d'une péritonite, par défaut de soins désormais inaccessibles... C'est long !
Lecture en demi-teinte, donc, pour ce récit intelligent (peut-être trop, dans une certaine mesure ?), trop prévisible, tellement gauche des beaux quartiers (par exemple la plupart des portraits sont ceux d'individus que l'on pourrait qualifier assez globalement de "CSP"... Alors qu'à un certain moment l'une des femmes de l'histoire reconnait que les survivants aux connaissances strictement pratiques sont franchement avantagés dans ce nouveau monde ! Mais où sont-ils dans ce livre, à part quelques fantômes croisés de loin en loin ?) et décidément trop démonstratif. On songe aussi à une suite ininterrompue de didascalies très développées. Si de telles notules sont indispensables à une mise en scène, elles sont loin de suffire à faire oeuvre. Même cette idée assez géniale de relater les chants presque intégralement au féminin en lieu et place du masculin grammatical habituel : l'idée est excellente mais finit très rapidement par n'être qu'un exercice de style dont on peine à voir le but, sinon que l'un prend la place de l'autre, et c'est tout. Une vraie déception tant j'aurais aimé apprécier un tel texte consacré à un sujet tellement crucial et dans une veine littéraire que j'apprécie tout particulièrement.
À tout seigneur, tout honneur : remercions pour commencer les vénérables éditions Buchet-Chastel ainsi que notre site bibliomaniaque en ligne préféré, l'incontournable Biblio.com, pour cet envoi réalisé dans le cadre d'une Masse Critique spéciale.
Avant d'entamer une chronique probablement assez rapide, il nous fallait préciser que nos lectures nous portent assez régulièrement vers ces genres que l'on désigne aujourd'hui bien souvent par les termes que voici : roman dystopique, post-apocalyptique (souvent désigné par son apocope de "post-apo"), parfois "anticipation" - qui a un peu vieilli mais que nous trouvions pourtant à notre goût -, plus rarement encore "contre-utopie", qui implique bien souvent une part non négligeable de descriptions et d'explications savantes, philosophiques, politiques d'où la part romanesque est généralement évincée ; de toute manière, ce genre qui fit les beaux jours des rayons des libraires de la fin du XIXè et du début du siècle précédent ne fait plus guère recette aujourd'hui. L'un des plus récent et parmi les plus remarquable est bien évidemment le fulgurant roman de l'américain Cormac Mc Carthy, La route qui, sans jamais faire dans la démonstration ni l'étude de thème fastidieux, est d'une puissance colossale, servi par un style souvent bref mais d'une étrange et souvent violente poésie. Mais il en existe bien d'autres.
Hélas, c'est un peu tout l'inverse ici. Reprenons depuis le début :
Nous sommes dans pas bien longtemps (fin 2022 pour être exact). "Cela" débute par un simple ouragan un peu plus fort que les autres, un peu plus destructeur et surtout atteignant la région la plus riche du globe : les côtes de la Californie. Jusque-là, rien que de très malheureusement (de plus en plus) commun. Sauf que... Sauf que l'effondrement tant craint (espéré ?) par certains, à commencer par ceux que l'on nomme désormais de ce néologisme plutôt bien trouvé, les collapsologues, est déjà en cours : les sommes à rembourser sont tellement faramineuses, les dégâts tellement incroyables, que le marché, jusque-là bon prince, les sociétés d'assurance, véritables hydres financières modernes, ne peuvent s'en sortir. Au Noël de cette annus horribilis, il est désormais clair que le système n'est plus assez résilient pour s'en sortir, malgré toutes les "réunions au sommet" de rigueur. Par effet domino, c'est l'ensemble des secteurs économiques puis sociaux et politiques qui vont être touchés, d'abord aux USA puis sur toute la planète, pour ne plus jamais pouvoir faire machine arrière.
La suite, c'est principalement à travers le regard - et la voix, dite ou scandée, à la manière, ou supposée telle, des bardes celtes : c'est une dimension essentielle du roman - de deux femmes que le hasard a réuni au moment où s'instauraient le pouvoir inique des "Frères Helvètes" (clin d’œil ironiquement renversé aux tristement célèbres "Frères Musulmans" ?), Barbara et Christelle, jugées pas assez purement suisses pour pouvoir rester au sein de la petite communauté (racialiste) des nouveaux dominants. Après un long voyage en Maramure - une région de Transylvanie à la frontière entre Roumanie et Ukraine, jugée par a priori écolo-bobo plus résiliente car moins atteinte par les assauts néfastes de la post-modernité : cela s'avérera plus un rêve qu'une réalité -, ces deux femmes, accompagnées d'un mari et d'une enfant pour l'une, de ses souvenirs pour l'autres, s'en reviennent à la Chaux de Fonds afin de tenter à nouveau leur chance dans la région de l'ancienne Suisse où elles avaient fait leur vie d'avant.
S'ensuit alors toute une galerie de portraits - hâtivement brossés et manquant bien souvent de profondeur - de ces survivants de l'après, de descriptions plus ou moins précises de ces micro-sociétés reconstruites bien souvent autour d'une poignée de "sachants" aux savoirs techniques et agricoles devenus immensément précieux (mais qu'on voit en réalité fort peu), ayant eu à lutter ou luttant encore contre des chefs de bande sans scrupule mais qui ont compris que ces petites expériences communautaires plus ou moins anarchisantes (dans un sens politique) sont leur principales sources de ravitaillement et qu'il est préférable de les contrôler, d'en limiter la propagation tout en les laissant vivre à défaut de ne plus pouvoir maintenir leur propre nouvel ordre, violent, brutal, raciste, machiste, intolérant mais généralement assez improductif. Chaque personnage croisé au sein de ces petites structures porte en lui son lot de drames récents, de désespoir mais aussi d'espoirs, de volonté de vivre et de reconstruire "autre chose", mieux, plus juste, plus solidaire, plus équitable. Chaque chapitre amène ainsi son lot de témoignages, d'expériences manquées ou sur le point de réussir, de ce petit groupe initial qui se fait et se défait au fil des pages, au fil des rencontres mais aussi des drames.
D'une construction très audacieuse autour de l'ordre alphabétique des prénoms des personnages croisés au fil du texte, abécédaire humain et humaniste au milieu duquel s'entremêlent plusieurs chapitres de "chants" - celui construit peu à peu par ces deux femmes - relatant le passé proche, le présent en passe de se reconstruire et du futur espéré malgré l'horreur d'un monde s'enfonçant peu à peu dans le chaos, l'ensemble, pourtant servi par un style très agréable, vif, facile sans être jamais simpliste, ne convainc pas. C'est alors qu'on se souvient que le roman est accompagné d'un bandeau : "lu et approuvé par Pablo Servigne" (les lecteurs de cette chronique pardonneront cette extrapolation. Ceci relève plus d'une interprétation très personnelle que de la réalité). Pourquoi en faire état ici ? Tout simplement pour la raison qu'il est évident que l'autrice de cette dystopie a lu, très à font, le fameux collapsologue. Ainsi que quelques autres, tel Dominique Bourg dont une citation de son Une nouvelle Terre - chroniqué par votre serviteur sur Babelio - dont une citation sert aussi de frontispice. Il est probable que mes lectures m'ayant déjà régulièrement porté vers ces rivages catastrophistes - mais possiblement réalistes -, l'effet de sidération qu'un tel roman pouvait provoquer sur votre humble serviteur s'en est trouvé irrémédiablement affaibli. Mais il y a aussi, et cela m'a paru vraiment insupportable, qu'il m'a semblé découvrir avec cet Après le monde, une sorte de copier-coller romanesque et théâtralisé (Antoinette Rychner est par ailleurs une brillante dramaturge) du désormais fameux Comment tout peut s'effondrer : Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, et ses avatars éditoriaux successifs.
Sans aucun doute les intentions étaient-elles très bonnes et particulièrement ambitieuses, mais sans un certain recul, sans avoir bien pris le temps de mâcher et remâcher cette vision du monde à venir - tout à la fois terrifiante et pleine d'espoirs, même minuscules -, à vouloir aussi trop embrasser de thématiques - pêle-mêle : la violence, le racisme, le féminisme, la survie, les expériences politiques en milieu extrême, la culture et sa transmission, les rapports homme-femme, la féminité, le patriarcat, etc. Un feu d'artifice de thématiques bobos de très grandes villes, trop souvent ressassés et lassants -, Antoinette Rychner a pris le risque d'écrire un roman total, et s'est un peu fourvoyée.
Trop démonstratif, trop en surface, sans bien prendre le temps de pénétrer l'âme humaine à force de passer d'un portrait à un autre, guère convaincante dans les moments qui auraient dû se révéler les plus puissants, les plus forts tel le récit des périodes les plus dures. Ainsi, le lecteur prend le risque de voir défiler une sorte de catalogue collapso bien moins persuasif et suggestif - un comble - que les essais économiques, politiques et sociaux dont l'ouvrage s'inspire assurément. Il faudra par exemple attendre le troisième tiers du roman pour ressentir pleinement, sans filtre ni faux-semblants, une véritable peine humaine, en l'occurrence la douleur vécue par les parents d'une gamine qui se meurt d'une péritonite, par défaut de soins désormais inaccessibles... C'est long !
Lecture en demi-teinte, donc, pour ce récit intelligent (peut-être trop, dans une certaine mesure ?), trop prévisible, tellement gauche des beaux quartiers (par exemple la plupart des portraits sont ceux d'individus que l'on pourrait qualifier assez globalement de "CSP"... Alors qu'à un certain moment l'une des femmes de l'histoire reconnait que les survivants aux connaissances strictement pratiques sont franchement avantagés dans ce nouveau monde ! Mais où sont-ils dans ce livre, à part quelques fantômes croisés de loin en loin ?) et décidément trop démonstratif. On songe aussi à une suite ininterrompue de didascalies très développées. Si de telles notules sont indispensables à une mise en scène, elles sont loin de suffire à faire oeuvre. Même cette idée assez géniale de relater les chants presque intégralement au féminin en lieu et place du masculin grammatical habituel : l'idée est excellente mais finit très rapidement par n'être qu'un exercice de style dont on peine à voir le but, sinon que l'un prend la place de l'autre, et c'est tout. Une vraie déception tant j'aurais aimé apprécier un tel texte consacré à un sujet tellement crucial et dans une veine littéraire que j'apprécie tout particulièrement.
Ce roman d'Antoinette Rychner est ma première déception de l'année, c'est un flop pour ma part, un livre singulier qui ne plaira pas à tout le monde mais dont je n'exclus pas une relecture dans quelques années.
J'ai pour tout dire failli abandonner ma lecture en cours de route. Je n'aurais d'ailleurs très honnêtement pas fait l'effort de poursuivre ma lecture si je n'avais pas reçu ce roman dans le cadre d'une masse critique. Je l'avais cochée car j'aime beaucoup la couverture, que c'était du post-apo et que le roman était court : 267 pages seulement.
Je pensais que cela se lirait vite et bien, pas vraiment en réalité… J'ai vite ramé dans ma lecture peinant à me raccrocher à un élément me motivant à tourner les pages de ce roman que je trouvais déprimant. J'ai eu un mois de janvier compliqué et je n'étais clairement pas dans les meilleures dispositions possibles pour lire ce genre de roman. Il n'y a pas d'action ou très peu et s'il y a des personnages, la construction du récit rend très difficile l'attachement à ces derniers, d'ailleurs ils sont à peine esquissés. L'intérêt de la lecture n'est pas là. Si vous recherchez un roman de post-apo dynamique avec des personnages attachants, en bref un chouette roman de divertissement je ne conseille pas cette lecture.
Non tout l'intérêt du roman se fait dans la réflexion sur l'effondrement et la chute du système mondiale et l'après. En s'inspirant de la théorie de la “collapsologie” défini par Wikipédia comme étant “un courant de pensée transdisciplinaire apparu dans les années 2010 qui envisage les risques, causes et conséquences d'un effondrement de la civilisation industrielle et ses conséquences” l'auteure nous propose un roman qui apparaît comme étant probable, réaliste et de ce fait effrayant mais aussi très sombre. Il n'est pas agréable de se dire que tout ce que nous tenons comme acquis sans même y songer car nous avons toujours vécu ainsi peut en quelques semaines, mois totalement s'effondrer. C'est un roman qui incite à s'interroger sur l'environnement, notre consommation, le capitalisme, la nature humaine et notre capacité à vivre ensemble. Les interrogations sont concrètes, parfois très crues. C'est un roman qui ne donne pas vraiment espoir en l'avenir et la nature humaine. Nos pires aspects l'emportent bien souvent sur les meilleurs…
Si le propos est intéressant, raison pour laquelle je mets la moyenne à ce roman je pense que c'est la forme qui m'a pour ma part le plus dérangé : l'auteure a fait le choix d'écrire tout son roman au féminin pluriel, un choix un peu déstabilisant au début même si on s'y fait vite. En revanche, l'alternance des points de vue, pas moins de 20 en tout entrecoupés de “chants”, mémoire et réflexion de deux femmes que l'on retrouve au gré des points de vue tout au long du roman racontant l'effondrement mondial et les années qui suivent celui-ci m'a moins convaincu. J'aurai sans doute davantage adhéré à une construction plus classique avec des personnages plus creusés.
Malgré cet avis mitigé, il est indéniable qu'Antoinette Rychner propose ici un roman singulier qui se démarque de ce que j'ai déjà pu lire dans ce genre là. C'est un roman travaillé qui à défaut de vous plaire ne vous laissera pas indifférent je pense. Il m'a laissé songeur sur ce qui pourrait peut-être bien nous arriver dans un futur plus ou moins proche. Rien de très réjouissant…
Merci à Babelio et à Happer Collins pour l'envoi de ce roman.
J'ai pour tout dire failli abandonner ma lecture en cours de route. Je n'aurais d'ailleurs très honnêtement pas fait l'effort de poursuivre ma lecture si je n'avais pas reçu ce roman dans le cadre d'une masse critique. Je l'avais cochée car j'aime beaucoup la couverture, que c'était du post-apo et que le roman était court : 267 pages seulement.
Je pensais que cela se lirait vite et bien, pas vraiment en réalité… J'ai vite ramé dans ma lecture peinant à me raccrocher à un élément me motivant à tourner les pages de ce roman que je trouvais déprimant. J'ai eu un mois de janvier compliqué et je n'étais clairement pas dans les meilleures dispositions possibles pour lire ce genre de roman. Il n'y a pas d'action ou très peu et s'il y a des personnages, la construction du récit rend très difficile l'attachement à ces derniers, d'ailleurs ils sont à peine esquissés. L'intérêt de la lecture n'est pas là. Si vous recherchez un roman de post-apo dynamique avec des personnages attachants, en bref un chouette roman de divertissement je ne conseille pas cette lecture.
Non tout l'intérêt du roman se fait dans la réflexion sur l'effondrement et la chute du système mondiale et l'après. En s'inspirant de la théorie de la “collapsologie” défini par Wikipédia comme étant “un courant de pensée transdisciplinaire apparu dans les années 2010 qui envisage les risques, causes et conséquences d'un effondrement de la civilisation industrielle et ses conséquences” l'auteure nous propose un roman qui apparaît comme étant probable, réaliste et de ce fait effrayant mais aussi très sombre. Il n'est pas agréable de se dire que tout ce que nous tenons comme acquis sans même y songer car nous avons toujours vécu ainsi peut en quelques semaines, mois totalement s'effondrer. C'est un roman qui incite à s'interroger sur l'environnement, notre consommation, le capitalisme, la nature humaine et notre capacité à vivre ensemble. Les interrogations sont concrètes, parfois très crues. C'est un roman qui ne donne pas vraiment espoir en l'avenir et la nature humaine. Nos pires aspects l'emportent bien souvent sur les meilleurs…
Si le propos est intéressant, raison pour laquelle je mets la moyenne à ce roman je pense que c'est la forme qui m'a pour ma part le plus dérangé : l'auteure a fait le choix d'écrire tout son roman au féminin pluriel, un choix un peu déstabilisant au début même si on s'y fait vite. En revanche, l'alternance des points de vue, pas moins de 20 en tout entrecoupés de “chants”, mémoire et réflexion de deux femmes que l'on retrouve au gré des points de vue tout au long du roman racontant l'effondrement mondial et les années qui suivent celui-ci m'a moins convaincu. J'aurai sans doute davantage adhéré à une construction plus classique avec des personnages plus creusés.
Malgré cet avis mitigé, il est indéniable qu'Antoinette Rychner propose ici un roman singulier qui se démarque de ce que j'ai déjà pu lire dans ce genre là. C'est un roman travaillé qui à défaut de vous plaire ne vous laissera pas indifférent je pense. Il m'a laissé songeur sur ce qui pourrait peut-être bien nous arriver dans un futur plus ou moins proche. Rien de très réjouissant…
Merci à Babelio et à Happer Collins pour l'envoi de ce roman.
Et si….. Et si tout à coup, le monde que nous connaissons n'existait plus ? Suite au dérèglement climatique et à d'autres catastrophes, nous nous retrouvons dans un monde de survivants, ou la technologie n'est plus la solution et où il faut se battre pour sa survie.
C'est à travers une sorte de chant choral, avec deux voix principales, Barbara et Christelle, relayées par d'autres voix de femmes, que nous suivons l'évolution de l'humanité au milieu d'un monde bien hostile… le plus grand danger viendra-t-il des changements climatiques, des usines qui déversent peu à peu leurs poisons faute de maintenance, ou plus simplement de l'homme ? Car je ne peux m'empêcher de citer cette phrase, certes fort connue, mais tellement de circonstance : » L'homme est un loup pour l'homme ».
Un roman visionnaire ? En tout cas, sa lecture ne laisse pas indemne, elle me rappelle un peu le sentiment que j'avais éprouvé lors de la lecture de « La route » de Cormac McCarthy …Oui, il faut dire que ce sont des lectures à éviter si l'on broie déjà du noir…
L'écriture de l'auteur est concise, précise et nous permet de suivre l'histoire sans aucun problème, malgré le changement fréquent de narratrices…
Une lecture intéressante, mais là il faut que j'embraye vraiment avec quelque chose de plus léger….
Encore merci à Babelio et son opération de masse Critique ainsi qu'aux Éditions Buchet-Chastel pour l'envoi de ce livre.
Challenge Mauvais Genres 2020
Challenge ABC 2019/2020
C'est à travers une sorte de chant choral, avec deux voix principales, Barbara et Christelle, relayées par d'autres voix de femmes, que nous suivons l'évolution de l'humanité au milieu d'un monde bien hostile… le plus grand danger viendra-t-il des changements climatiques, des usines qui déversent peu à peu leurs poisons faute de maintenance, ou plus simplement de l'homme ? Car je ne peux m'empêcher de citer cette phrase, certes fort connue, mais tellement de circonstance : » L'homme est un loup pour l'homme ».
Un roman visionnaire ? En tout cas, sa lecture ne laisse pas indemne, elle me rappelle un peu le sentiment que j'avais éprouvé lors de la lecture de « La route » de Cormac McCarthy …Oui, il faut dire que ce sont des lectures à éviter si l'on broie déjà du noir…
L'écriture de l'auteur est concise, précise et nous permet de suivre l'histoire sans aucun problème, malgré le changement fréquent de narratrices…
Une lecture intéressante, mais là il faut que j'embraye vraiment avec quelque chose de plus léger….
Encore merci à Babelio et son opération de masse Critique ainsi qu'aux Éditions Buchet-Chastel pour l'envoi de ce livre.
Challenge Mauvais Genres 2020
Challenge ABC 2019/2020
Cette lecture m'a profondément et durablement remuée. Je ne saurais pas précisément expliquer pourquoi. Sans doute parce qu'il n'y a pas d'éléments concrets de réponse, cela relève plutôt du champs des émotions primaires : angoisses, espoirs et un espèce de truc ancestral (ça me plaît d'imaginer ça en tous cas), un peu comme lorsqu'on accouche et qu'on sent ce lien si puissant qui nous relie à nos ancêtres et à la mort. Ah je vous vois déjà vous demander si j'ai fumé avant d'entamer la rédaction de ce billet ! Et la réponse est non.
Pour être tout à fait honnête, je dois vous dire que j'ai commencé ma lecture assez dubitative, notamment à cause de la forme adoptée par Antoinette Rychner : le lecteur suit les deux personnages principaux, que sont Barbara et Christelle, à travers le regard des femmes qui les croisent tout au long de leur périple (à la recherche d'une communauté d'accueil, de la Suisse à la Roumanie, puis de la Roumanie à la Suisse, en passant par les Pays-Bas, la Finlande...) mais aussi grâce aux chants qu'elles composent à quatre mains et à deux voix (chaque chant formant également un chapitre qui alterne avec ceux des femmes). C'est déjà assez particulier en soi mais il faut encore ajouter à cela l'emploi du féminin pluriel dans le récit, même lorsqu'il n'est question que d'un seul homme. Un début un peu difficile quoi. Mais on s'y fait rapidement !
La catastrophe à laquelle le monde doit faire face dans le récit, après l'effondrement économique des Etats-Unis en 2023 à la suite d'un énorme ouragan, est prétexte à questionner notre rapport au monde, à la nature, aux êtres vivants qui peuplent la terre. Les nouvelles sociétés que l'auteur invente sont profondément réalistes. C'est pour cela sans doute que c'est si effrayant.
Antoinette Rychner ne se contente pas de s'interroger sur de grandes questions telles que la surconsommation, le système politique et économique, les frontières (réelles ou imaginées), la place des femmes dans la société, l'agriculture, le réchauffement climatique etc... mais aussi sur des sujets beaucoup plus prosaïques tels que : comment retirer ce stérilet obsolète ? quid des lunettes de vue impossible à fabriquer ? des caries que l'on ne peut plus soigner (sans parler des appendicites ou autres maladies qui nous paraissent bénignes grâce à la technologie actuelle). Et comment se passer de papier toilette quand on a eu l'habitude d'en utiliser à volonté ??
J'ai beaucoup aimé lire sa proposition de nouvelles communautés qui pensent autrement l'architecture, l'agriculture, la culture (il y a un très beau travail sur la transmission orale). La réapparition d'ancien métiers aux noms si désuets et charmants.
Grâce à Babelio et aux éditions Buchet-Chastel, c'est un très beau livre que j'ai eu l'occasion de lire. Un roman étrange, vraiment surprenant, mais aussi très puissant, poétique, noir. Très beau, vous dis-je.
Je me demande franchement si l'être humain parviendra un jour à trouver comment vivre en harmonie avec son environnement naturel et ses semblables. J'espère que oui. Mais...
Pour être tout à fait honnête, je dois vous dire que j'ai commencé ma lecture assez dubitative, notamment à cause de la forme adoptée par Antoinette Rychner : le lecteur suit les deux personnages principaux, que sont Barbara et Christelle, à travers le regard des femmes qui les croisent tout au long de leur périple (à la recherche d'une communauté d'accueil, de la Suisse à la Roumanie, puis de la Roumanie à la Suisse, en passant par les Pays-Bas, la Finlande...) mais aussi grâce aux chants qu'elles composent à quatre mains et à deux voix (chaque chant formant également un chapitre qui alterne avec ceux des femmes). C'est déjà assez particulier en soi mais il faut encore ajouter à cela l'emploi du féminin pluriel dans le récit, même lorsqu'il n'est question que d'un seul homme. Un début un peu difficile quoi. Mais on s'y fait rapidement !
La catastrophe à laquelle le monde doit faire face dans le récit, après l'effondrement économique des Etats-Unis en 2023 à la suite d'un énorme ouragan, est prétexte à questionner notre rapport au monde, à la nature, aux êtres vivants qui peuplent la terre. Les nouvelles sociétés que l'auteur invente sont profondément réalistes. C'est pour cela sans doute que c'est si effrayant.
Antoinette Rychner ne se contente pas de s'interroger sur de grandes questions telles que la surconsommation, le système politique et économique, les frontières (réelles ou imaginées), la place des femmes dans la société, l'agriculture, le réchauffement climatique etc... mais aussi sur des sujets beaucoup plus prosaïques tels que : comment retirer ce stérilet obsolète ? quid des lunettes de vue impossible à fabriquer ? des caries que l'on ne peut plus soigner (sans parler des appendicites ou autres maladies qui nous paraissent bénignes grâce à la technologie actuelle). Et comment se passer de papier toilette quand on a eu l'habitude d'en utiliser à volonté ??
J'ai beaucoup aimé lire sa proposition de nouvelles communautés qui pensent autrement l'architecture, l'agriculture, la culture (il y a un très beau travail sur la transmission orale). La réapparition d'ancien métiers aux noms si désuets et charmants.
Grâce à Babelio et aux éditions Buchet-Chastel, c'est un très beau livre que j'ai eu l'occasion de lire. Un roman étrange, vraiment surprenant, mais aussi très puissant, poétique, noir. Très beau, vous dis-je.
Je me demande franchement si l'être humain parviendra un jour à trouver comment vivre en harmonie avec son environnement naturel et ses semblables. J'espère que oui. Mais...
2022 : un cyclone balaie la côte ouest des USA, provoquant des dizaines de milliers de morts. La crise qui s'en suit provoque l'effondrement des économies américaine puis mondiale : les transports, la production d'énergie, les réseaux de communication, les usines de haute technologie, tout s'arrête progressivement.
Quelques années plus tard, des communautés se sont installées tentant de recréer des micro-sociétés autonomes et de résister aux pillards, sans pouvoir s'appuyer sur des technologies connues mais impossible à mettre en oeuvre.
Antoinette Rychner nous livre une histoire dont l'argument principal ressemble un peu à celui de Malevil de Robert Merle ou de la route de Cormac McCarthy : la construction, ou pas, de nouvelles vies sociales après une catastrophe ayant détruit notre société.
J'y ai cependant trouvé deux ingrédients majeurs, qui apportent une originalité intéressante à Après le monde :
- la nature de la catastrophe à l'origine des destructions : ici pas de bombe nucléaire ou de collision avec une météorite, juste un cyclone un peu plus fort que les autres qui frappe au mauvais endroit, San Francisco et la Silicon Valley, entraînant une série de faillites et un arrêt presque complet de l'économie mondialisée. Cela ne manque pas de nous rappeler les conséquences de la crise COVID-19...
- la forme de la narration : elle s'appuie sur quelques chapitres contant le délitement de l'économie mondiale et les efforts de survie des uns et des autres, et de nombreux portraits d'individu(e)s (l'histoire est racontée par des femmes, au féminin !) permettant d'entrer plus en détail dans les conditions de (sur)vie sur terre au cours des plus de 35 ans qui suivent la catastrophe.
Ajoutons la belle écriture de l'auteure, à la fois riche et simple, se laissant lire avec fluidité, et tous les ingrédients sont réunis pour un coup de coeur !
Lien : http://michelgiraud.fr/2020/..
Quelques années plus tard, des communautés se sont installées tentant de recréer des micro-sociétés autonomes et de résister aux pillards, sans pouvoir s'appuyer sur des technologies connues mais impossible à mettre en oeuvre.
Antoinette Rychner nous livre une histoire dont l'argument principal ressemble un peu à celui de Malevil de Robert Merle ou de la route de Cormac McCarthy : la construction, ou pas, de nouvelles vies sociales après une catastrophe ayant détruit notre société.
J'y ai cependant trouvé deux ingrédients majeurs, qui apportent une originalité intéressante à Après le monde :
- la nature de la catastrophe à l'origine des destructions : ici pas de bombe nucléaire ou de collision avec une météorite, juste un cyclone un peu plus fort que les autres qui frappe au mauvais endroit, San Francisco et la Silicon Valley, entraînant une série de faillites et un arrêt presque complet de l'économie mondialisée. Cela ne manque pas de nous rappeler les conséquences de la crise COVID-19...
- la forme de la narration : elle s'appuie sur quelques chapitres contant le délitement de l'économie mondiale et les efforts de survie des uns et des autres, et de nombreux portraits d'individu(e)s (l'histoire est racontée par des femmes, au féminin !) permettant d'entrer plus en détail dans les conditions de (sur)vie sur terre au cours des plus de 35 ans qui suivent la catastrophe.
Ajoutons la belle écriture de l'auteure, à la fois riche et simple, se laissant lire avec fluidité, et tous les ingrédients sont réunis pour un coup de coeur !
Lien : http://michelgiraud.fr/2020/..
Citations et extraits (31)
Voir plus
Ajouter une citation
Un petit texte utopique, ironique et critique d'Antoinette Rychner:
Parce qu’il nous reste les mots
– On n’a pas besoin d’EasyJet. On n’a pas besoin de Coca-cola. On n’a pas besoin de parcs d’attractions, ni de centres thermaux ni de centres de fitness, on n’a pas besoin de manger de la viande tous les jours. On n’a pas besoin des actionnaires. On n’a pas besoin des Jeux olympiques. On n’a pas besoin de coiffeurs pour chiens. On n’a pas besoin d’ongleries. On n’a pas besoin de stars du football. On n’a pas besoin de promoteurs immobiliers. Ni de spéculateurs sur le blé. On n’a pas besoin de fabriquer des citrouilles en plastique pour Halloween. On n’a pas besoin de girafes en peluche. On n’a pas besoin de voitures électriques. On n’a pas besoin de construire plus de routes. On n’a pas besoin de publier sur les réseaux sociaux des photos de soi enfant. On n’a pas besoin de vidéos de chats. On n’a pas besoin de data center au pôle Nord. On n’a pas besoin de pipeline sur les territoires sioux. On n’a pas besoin de contrats de quatre cents pages, ni de labels ni de permis ni de certificats à foison. On n’a pas besoin de publicité dans les espaces publics. On n’a pas besoin d’obsolescence programmée. On n’a pas besoin de vendre des armes. On n’a pas besoin de 524 titres à la rentrée littéraire, et on n’a pas besoin de plus de revues et de magazines qu’on ne pourra jamais en lire. On n’a pas besoin de produire et produire et produire des contenus pour la folie d’en produire. On n’a pas besoin d’autant de festivals. On n’a pas besoin de ketchup. On n’a pas besoin de pêcher dans les mers jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien. On n’a pas besoin de pesticides. On n’a pas besoin de s’envoyer autant de mails, on n’a pas besoin de visualiser des vidéos partout et en tout temps, on n’a pas besoin de 5G et on n’a pas besoin d’autant de suggestions pour ne pas s’ennuyer en temps de confinement.
C’est pourquoi, articula la porte-parole de la Coalition mondiale pour tout changer en vrai, nous demandons aux gouvernements la promesse de ne sauver aucune entreprise.
– Mais… balbutia un parlementaire. Les emplois perdus… les faillites…
– Nous assurerons la distribution d’un revenu généralisé. Les services publics seront renforcés. L’accès à l’eau, aux consommations d’énergie de base et aux biens de première nécessité sera gratuit. La récession ne sera pas meurtrière.
– Sur quelle base comptez-vous prioriser les besoins ?
– Nous allons revenir à la pyramide de Maslow, et en ériger les deux premiers niveaux comme objectif universel. Nous pensons qu’une politique qui ne permet pas de couvrir, au minimum, les besoins physiologiques et la sécurité de l’ensemble des habitants de la planète est une politique indigne.
(…)
– Excusez-moi, la coupa un autre ; qu’est-ce qui pourrait être pire que les catastrophes annoncées par les scientifiques si nous n’agissons pas ?
– Heu… personnellement, je crois que je préfère risquer les pénuries d’eau douce, la montée des mers, les vagues de chaleur létales, les ouragans et nouvelles maladies transmissibles à l’horizon 2030 ou 2040 plutôt que de tout vouloir changer maintenant. L’important, c’est d’abord de garantir à nos concitoyens le retour le plus rapide possible à la vie pré-Covid-19, même si ce n’est que pour durer dix ou quinze ans.
– C’est vrai, enchaîna quelqu’un. Contentons-nous de mesures raisonnables, on a eu suffisamment de bouleversements pour le moment.
La porte-parole de la Coalition mondiale pour tout changer en vrai fut donc priée de remballer son programme.
« Dommage », songea-t-elle en quittant la tribune. « Il s’en est fallu d’un cheveu. Mais on était en démocratie – et n’aurait-il pas été de bien mauvais goût de ne point s’en féliciter ? »
Antoinette Rychner
Le Temps - Publié samedi 23 mai 2020
https://www.letemps.ch/culture/ecrivains-face-virus-un-programme-simplement-super-dantoinette-rychner
Parce qu’il nous reste les mots
– On n’a pas besoin d’EasyJet. On n’a pas besoin de Coca-cola. On n’a pas besoin de parcs d’attractions, ni de centres thermaux ni de centres de fitness, on n’a pas besoin de manger de la viande tous les jours. On n’a pas besoin des actionnaires. On n’a pas besoin des Jeux olympiques. On n’a pas besoin de coiffeurs pour chiens. On n’a pas besoin d’ongleries. On n’a pas besoin de stars du football. On n’a pas besoin de promoteurs immobiliers. Ni de spéculateurs sur le blé. On n’a pas besoin de fabriquer des citrouilles en plastique pour Halloween. On n’a pas besoin de girafes en peluche. On n’a pas besoin de voitures électriques. On n’a pas besoin de construire plus de routes. On n’a pas besoin de publier sur les réseaux sociaux des photos de soi enfant. On n’a pas besoin de vidéos de chats. On n’a pas besoin de data center au pôle Nord. On n’a pas besoin de pipeline sur les territoires sioux. On n’a pas besoin de contrats de quatre cents pages, ni de labels ni de permis ni de certificats à foison. On n’a pas besoin de publicité dans les espaces publics. On n’a pas besoin d’obsolescence programmée. On n’a pas besoin de vendre des armes. On n’a pas besoin de 524 titres à la rentrée littéraire, et on n’a pas besoin de plus de revues et de magazines qu’on ne pourra jamais en lire. On n’a pas besoin de produire et produire et produire des contenus pour la folie d’en produire. On n’a pas besoin d’autant de festivals. On n’a pas besoin de ketchup. On n’a pas besoin de pêcher dans les mers jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien. On n’a pas besoin de pesticides. On n’a pas besoin de s’envoyer autant de mails, on n’a pas besoin de visualiser des vidéos partout et en tout temps, on n’a pas besoin de 5G et on n’a pas besoin d’autant de suggestions pour ne pas s’ennuyer en temps de confinement.
C’est pourquoi, articula la porte-parole de la Coalition mondiale pour tout changer en vrai, nous demandons aux gouvernements la promesse de ne sauver aucune entreprise.
– Mais… balbutia un parlementaire. Les emplois perdus… les faillites…
– Nous assurerons la distribution d’un revenu généralisé. Les services publics seront renforcés. L’accès à l’eau, aux consommations d’énergie de base et aux biens de première nécessité sera gratuit. La récession ne sera pas meurtrière.
– Sur quelle base comptez-vous prioriser les besoins ?
– Nous allons revenir à la pyramide de Maslow, et en ériger les deux premiers niveaux comme objectif universel. Nous pensons qu’une politique qui ne permet pas de couvrir, au minimum, les besoins physiologiques et la sécurité de l’ensemble des habitants de la planète est une politique indigne.
(…)
– Excusez-moi, la coupa un autre ; qu’est-ce qui pourrait être pire que les catastrophes annoncées par les scientifiques si nous n’agissons pas ?
– Heu… personnellement, je crois que je préfère risquer les pénuries d’eau douce, la montée des mers, les vagues de chaleur létales, les ouragans et nouvelles maladies transmissibles à l’horizon 2030 ou 2040 plutôt que de tout vouloir changer maintenant. L’important, c’est d’abord de garantir à nos concitoyens le retour le plus rapide possible à la vie pré-Covid-19, même si ce n’est que pour durer dix ou quinze ans.
– C’est vrai, enchaîna quelqu’un. Contentons-nous de mesures raisonnables, on a eu suffisamment de bouleversements pour le moment.
La porte-parole de la Coalition mondiale pour tout changer en vrai fut donc priée de remballer son programme.
« Dommage », songea-t-elle en quittant la tribune. « Il s’en est fallu d’un cheveu. Mais on était en démocratie – et n’aurait-il pas été de bien mauvais goût de ne point s’en féliciter ? »
Antoinette Rychner
Le Temps - Publié samedi 23 mai 2020
https://www.letemps.ch/culture/ecrivains-face-virus-un-programme-simplement-super-dantoinette-rychner
QUEENIE
Elle avait beau, lorsque montait la nostalgie, se répéter qu'elle pouvait déjà s'estimer heureuse d'avoir échappé à la mort d'inanition, de maladie infectieuse ou violente, elle restait incapable, plus de sept ans après la grande rupture, d'accepter que le monde dans lequel elle avait grandi ne reviendrait pas.
Son deuil le plus difficile concernait sa vie professionnelle. Il fallait dire qu'au moment de la débâcle, on venait de lui octroyer une promotion : de Project and Process Risk Management Leader, elle était passée Design Quality Manager.
Mais le printemps 2023 était arrivé. Comme des millions d'habitants de pays où des emplois bureaucratiques et numérisés avaient remplacé le secteur primaire comme l'industrie, Queenie avait vu son activité perdre toute utilité du jour au lendemain. D'un même coup elle avait découvert, ébahie, des couches de métiers dont elle avait ignoré jusqu'à l'existence, allant du nettoyage à l'entretien d'infrastructures, en passant par les transports, les égouts et la voirie – secteurs auxquels les citoyens de sa classe n'avaient commencé de prêter attention qu'à partir du moment où ils s'étaient mis à dysfonctionner.
Design Quality Manager, se répéta-t-elle, histoire de se donner une importance rétrospective. Nul doute qu'elle s'était trouvée cette année-là en pleine ascension, et la frustration la minait. Comment pardonner au destin de l'avoir privée de ce à quoi son mérite, son potentiel et sa persévérance lui auraient donné droit ?
Pour reconstituer la réalité du monde qu'elle avait connu, il lui arrivait de recourir à la liste des professions qu'avaient exercées ses contacts Linkedln : « Responsable Customer Care Center, secrétaire de rédaction web-print, Social Media Expert, Head of Corporate Communications chez Chloé Droncourt GmbH, Office Coordinator chez Asop SA, stagiaire chez Content Management, Brand Content Manager chez Totemo, Fondateur & CEO chez Hello Productions, Freelance Housing Architect, responsable éditorial chez Trivial Mass SA, consultant en communication pour le développement, responsable promotion R-diffusion, Sales and Office Assistant, Copywriter EMEA, Marketing Coordinator, Senior Editor, conseiller SAW, Sales Advisor, créateur d'espace digital, directeur général Pole-Position, superviseur commercial, Software Analyst, chargé d'innovation, Supply Chain Manager » et ainsi de suite, égrena, pendant dix minutes, Queenie assise sur la cuvette.
Si de tels titres ne servaient plus à rien, ils recélaient une vertu puissamment réconfortante, comme autant de talismans posthumes.
Mais Queenie ne s'était pas seulement définie par son cursus professionnel. Son identité s'était aussi forgée à travers ses loisirs, puisqu'elle avait été une fervente adepte du cake design, ou art de modeler la pâte à sucre, consacrant des sommes considérables à l'achat de gammes aromatisées ou de colorants lui permettant de donner à ses cupcakes et pièces montées un aspect spectaculaire. Sur les forums spécialisés, les photos qu'elle publiait obtenaient des commentaires encenseurs. Qu'étaient devenus les internautes qui l'avaient acclamée aux quatre coins du monde ? Se pouvait-il qu'ils se débrouillent aujourd'hui de la même façon qu'elle, avec substitut de savon et sciure en guise de papier hygiénique ?
Une telle pensée lui faisait mal. Dans ses conceptions, être quelqu'un de bien, voire faire le bien signifiait avoir ; disposer de tout. Aussi ne pouvait-elle imaginer que ses cohabitants de Bastogne fussent de bonne foi lorsqu'ils clamaient que le partage des ressources et la sobriété représentaient des buts autrement plus enthousiasmants que l'accumulation primaire et sans limites de richesses matérielles.
Comme elle comprenait certains ressortissants de pays dits émergents d'avoir tout fait, à l'époque, pour gagner les continents du gaspillage, où il avait été possible d'acheter, utiliser et jeter autant de Tampax qu'on le voulait en une journée – oh oui ! comme elle comprenait que ce besoin ait représenté une pulsion absolue, plus forte que tout ! se dit encore Queenie, avant que quelqu'un ne toque à la porte des W.-C., exigeant qu'on lui cède la place en demandant ironiquement si elle était « tombée dans le trou ».
Elle avait beau, lorsque montait la nostalgie, se répéter qu'elle pouvait déjà s'estimer heureuse d'avoir échappé à la mort d'inanition, de maladie infectieuse ou violente, elle restait incapable, plus de sept ans après la grande rupture, d'accepter que le monde dans lequel elle avait grandi ne reviendrait pas.
Son deuil le plus difficile concernait sa vie professionnelle. Il fallait dire qu'au moment de la débâcle, on venait de lui octroyer une promotion : de Project and Process Risk Management Leader, elle était passée Design Quality Manager.
Mais le printemps 2023 était arrivé. Comme des millions d'habitants de pays où des emplois bureaucratiques et numérisés avaient remplacé le secteur primaire comme l'industrie, Queenie avait vu son activité perdre toute utilité du jour au lendemain. D'un même coup elle avait découvert, ébahie, des couches de métiers dont elle avait ignoré jusqu'à l'existence, allant du nettoyage à l'entretien d'infrastructures, en passant par les transports, les égouts et la voirie – secteurs auxquels les citoyens de sa classe n'avaient commencé de prêter attention qu'à partir du moment où ils s'étaient mis à dysfonctionner.
Design Quality Manager, se répéta-t-elle, histoire de se donner une importance rétrospective. Nul doute qu'elle s'était trouvée cette année-là en pleine ascension, et la frustration la minait. Comment pardonner au destin de l'avoir privée de ce à quoi son mérite, son potentiel et sa persévérance lui auraient donné droit ?
Pour reconstituer la réalité du monde qu'elle avait connu, il lui arrivait de recourir à la liste des professions qu'avaient exercées ses contacts Linkedln : « Responsable Customer Care Center, secrétaire de rédaction web-print, Social Media Expert, Head of Corporate Communications chez Chloé Droncourt GmbH, Office Coordinator chez Asop SA, stagiaire chez Content Management, Brand Content Manager chez Totemo, Fondateur & CEO chez Hello Productions, Freelance Housing Architect, responsable éditorial chez Trivial Mass SA, consultant en communication pour le développement, responsable promotion R-diffusion, Sales and Office Assistant, Copywriter EMEA, Marketing Coordinator, Senior Editor, conseiller SAW, Sales Advisor, créateur d'espace digital, directeur général Pole-Position, superviseur commercial, Software Analyst, chargé d'innovation, Supply Chain Manager » et ainsi de suite, égrena, pendant dix minutes, Queenie assise sur la cuvette.
Si de tels titres ne servaient plus à rien, ils recélaient une vertu puissamment réconfortante, comme autant de talismans posthumes.
Mais Queenie ne s'était pas seulement définie par son cursus professionnel. Son identité s'était aussi forgée à travers ses loisirs, puisqu'elle avait été une fervente adepte du cake design, ou art de modeler la pâte à sucre, consacrant des sommes considérables à l'achat de gammes aromatisées ou de colorants lui permettant de donner à ses cupcakes et pièces montées un aspect spectaculaire. Sur les forums spécialisés, les photos qu'elle publiait obtenaient des commentaires encenseurs. Qu'étaient devenus les internautes qui l'avaient acclamée aux quatre coins du monde ? Se pouvait-il qu'ils se débrouillent aujourd'hui de la même façon qu'elle, avec substitut de savon et sciure en guise de papier hygiénique ?
Une telle pensée lui faisait mal. Dans ses conceptions, être quelqu'un de bien, voire faire le bien signifiait avoir ; disposer de tout. Aussi ne pouvait-elle imaginer que ses cohabitants de Bastogne fussent de bonne foi lorsqu'ils clamaient que le partage des ressources et la sobriété représentaient des buts autrement plus enthousiasmants que l'accumulation primaire et sans limites de richesses matérielles.
Comme elle comprenait certains ressortissants de pays dits émergents d'avoir tout fait, à l'époque, pour gagner les continents du gaspillage, où il avait été possible d'acheter, utiliser et jeter autant de Tampax qu'on le voulait en une journée – oh oui ! comme elle comprenait que ce besoin ait représenté une pulsion absolue, plus forte que tout ! se dit encore Queenie, avant que quelqu'un ne toque à la porte des W.-C., exigeant qu'on lui cède la place en demandant ironiquement si elle était « tombée dans le trou ».
Nous allions comprendre que la finance globale n’était pas qu’une sphère stéréotypée, ce décor où circulaient des hommes en complet-cravate et des femmes en tailleur dans les séries que nous regardions, mais ce dont nous dépendions pour tout ; de nos comptes-épargne aux services qui nous protégeaient, de nos retraites aux soins auxquels nous avions droit en cas d’accident, de nos cartes d’embarquement low cost aux importations des produits auxquels nous étions addicts.
C'était en 2023. Sur les huit milliards d'habitants que comptaient la terre, environ un milliard et demi de personnes vivaient dans des pays appelés «pays développés à économie de marché». Nous en faisions partie. Nous consommions, en moyenne, plus de 250 litres d'eau par jour et par personne - par année, plus de 3 000 litres de pétrole. Nos ménages s'élevaient à 2,5 personnes. Ils participaient à la production de centaines de millions de tonnes de déchets par an, garantissaient la consommation destructrice de masse et contribuaient à dévaster le monde ; nous le reconnaissions.
Quelle chance, se dit Marie-Géralde sans écouter Mathieu expliquer le fonctionnement de sa turbine, qu'un homme comme lui fasse partie de Cucheroux ! Bien-sûr, il était stupide d'opposer intellectuels et techniciens, comme il était stupide de comparer rendements musculaires masculin et féminin. N'empêche, Marie-Géralde ne pouvait s'interdire de penser que les groupes où le hasard avait placé des bricoleurs, des gars forts et démerdes étaient partis avec une longueur d'avance sur ceux où s'entassaient d'ex-employés de bureau.
Videos de Antoinette Rychner (7)
Voir plusAjouter une vidéo
Antoinette Rychner est une écrivaine née en Suisse. Elle est l'auteure de plusieurs pièces de théâtre, d'un recueil de nouvelles et de deux romans. Son dernier, "Après le monde" est paru aux éditions Buchet-Chastel au début de l'année 2020.
Elle y présente la catastrophe écologique en cours sous la forme d'un désastre, d'un ravage dont la violence ne peut que saisir le lecteur pour mieux l'alarmer sur la situation en cours.
Dans ce roman inspiré des théories de la "collapsologie" (un courant de pensée récent qui étudie les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et ce qui pourrait succéder à la société actuelle), elle dévoile les conséquences sociales et économiques sans précédent qu'un cyclone d'ampleur inédite peut entraîner.
Retrouvez l'intégralité de l'interview ci-dessous : https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison-12/1503121-et-apres.html
Retrouvez l'intégralité de l'interview ci-dessous : https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison-12/1503121-et-apres.html
+ Lire la suite
autres livres classés : collapsologieVoir plus
Les plus populaires : Imaginaire
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Antoinette Rychner (7)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les plus grands classiques de la science-fiction
Qui a écrit 1984
George Orwell
Aldous Huxley
H.G. Wells
Pierre Boulle
10 questions
4869 lecteurs ont répondu
Thèmes :
science-fictionCréer un quiz sur ce livre4869 lecteurs ont répondu