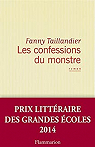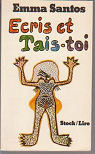Emma Santos
EAN : 9782721000934
Editions des Femmes (14/05/1977)
/5
6 notes
Editions des Femmes (14/05/1977)
Résumé :
L'itinéraire psychiatrique
"Ecrire c'est mourir. Je ne suis pas un médicament qui se vend."
---------------------------------------------------
Un livre après l'autre, un cri après l'autre. Emma Santos arpente les scènes où elle s'est laissée enfermer à son corps et à ses mots défendants.
"Je voudrais tenter d'expliquer mon entrée en psychiatrie, huit années en psychiatrie en commettant les mêmes erreurs que les psy... >Voir plus
"Ecrire c'est mourir. Je ne suis pas un médicament qui se vend."
---------------------------------------------------
Un livre après l'autre, un cri après l'autre. Emma Santos arpente les scènes où elle s'est laissée enfermer à son corps et à ses mots défendants.
"Je voudrais tenter d'expliquer mon entrée en psychiatrie, huit années en psychiatrie en commettant les mêmes erreurs que les psy... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'itineraire psychiatriqueVoir plus
Citations et extraits (8)
Voir plus
Ajouter une citation
Le système, comment on y rentre (Emma Santos )
[mardi 11 juin 2013par C. J.]
Le système de la folie, on sait à peu près comment ça commence. Bêtement, par hasard, on s’approche, on rentre et puis ils font le reste. Ils se chargent de vous enfoncer. Comment ça finit, là je ne sais pas…
La folie, ça commence doucement chez les médecins tranquilles bedonnants, la bonne moyenne, qui prononcent le mot « psychiatrie » avec respect. Pudeur. Tact. Décence. En tout cas jamais ils ne diront fou, cinglé ou taré. Ils font gaffe, ils se méfient de la réaction. Faut comprendre leur approche timide. C’est difficile d’annoncer à quelqu’un, comme ça, tout d’un coup, qu’il est passé de l’autre côté. Qu’à partir de maintenant, il ne sera plus comme les autres. Qu’il portera pour toujours la marque des aliénés comme les esclaves d’antan portaient leur tatouage. Le brave généraliste très paternel vous envoie chez le spécialiste. Ça n’a l’air de rien, inoffensif, simple contrôle, presque routine. Attention, on est encore dans le « privé », on peut encore s’en sortir. Sans faire de bruit, discret, sur la pointe des pieds.
La folie, ça commence par une jeune femme fraîchement sortie de l’Université dans sa blouse blanche nette neuve. Un peu hystérique quand même avec ses ongles rongés au-delà du « normal ». Elle crie zigzaguant entre les lits : vite, vite mon Dieu, aujourd’hui il y a présentation des malades au grand patron… je n’ai pas le temps… plus tard, plus tard… Le grand patron.
J’ai envie de me lever et de crier plus fort : mais on souffre nous. Votre grand patron, il peut toujours attendre… On n’est pas des marionnettes, des joujoux à médecin. Regardez-nous un peu, Madame. Ayez honte, Madame, on est des gens. On souffre. Ne jouez pas avec nous…
J’entre dans un quelconque hôpital pour une petite angine blanche et je ne m’en sors plus. Je me fais traiter de rebelle dérangeante hostile, sans manières, asociale… Je me retrouve assommée, droguée par les psychiatres. Je résiste. Je tiens bon. Je décide de ne pas me laisser avoir. Ils vont quand même pas me faire perdre la tête, non ?
A l’hôpital, c’était une grande salle de 60 lits alignés, séparés par une table en fer blanc sur laquelle on pose le crachoir. Au pied du lit, le bassin et la bouteille d’urine. Au fond de la salle deux lavabos sans rideau et la porte des W.-C. demi-défoncée. La chasse d’eau cassée depuis six mois, paraît-il. On a brisé une vitre pour laisser s’échapper les odeurs. Une sorte de salle d’attente. un centre de tri. Un peu de médecine générale, de l’endocrinologie aussi. Des gens déposés là depuis longtemps en attendant qu’on les transporte vers les services compétents. Qu’il y ait une vague, un lit libre. Des gens oubliés par leurs familles, leurs amis, les autres. Quelques suicidés ratés dans un coin parlent peu, discrets honteux culpabilisés. Une femme geint enfermée dans un lit à barreaux, ficelée au sommier. Un ou deux ulcères mourants. Une mongolienne dans les trente ans serrant contre elle son amour : un vieux lapin sale en peluche grise.
La dame de service, elle nettoie le carrelage et ramasse les bassins. Affable, diligente, autoritaire, toujours réponse à tout, la bonne explication : quand ça ne va pas ce sont les glandes qui travaillent. On met en endocrinologie…
Pour certaines, les glandes ne fonctionnaient plus, on les expédiait à l’asile de vieillards : la sénilité précoce. Pour d’autres, les glandes fonctionnaient trop, ça s’échauffait, on les expédiait à l’asile psychiatrique : c’était la folie. C’était des fous, des vrais. La preuve, c’était écrit sur leur corps. On ne se trompe pas. Il n’y a qu’à lire, qu’à regarder les tests.
Puis je me retrouve dans le bureau de la surveillante gradée qui me demande de déposer mes affaires. Autorité, froideur précise. Je proteste que j’ai mes objets personnels, mes cahiers, mes livres. Non, il faut. On me les rendra après la fouille de principe. On promet. Je m’exécute. On m’accompagne à ma chambre.
Je ne savais pas encore que j’avais échoué dans le service psychiatrique de l’hôpital. Ils ne m’avaient rien dit.
Un prend un couloir long aux multiples portes d’un bleu baveux. On s’arrête au milieu, devant une des portes. Ils l’ouvrent : ma nouvelle chambre. Chambre nue avec un lit blanc, seul, insolite. Rien d’autre, rien. Une fenêtre à barreaux. On me dit de me coucher. Ils s aperçoivent alors que j’ai encore une bague, ils me l’arrachent de force, méchamment. Puis sans un mot ils sortent en tapant la porte.
Je reste là, allongée, immobile. J’essaie de penser. Ma tête bien confuse. Bizarre… ils sont devenus hostiles, soupçonneux, silencieux. Qu’est-ce que ça cache, on verra… Pour l’instant je suis au calme… personne ne m’a fait de mal. Je me lève. Je tourne dans la pièce. Je cherche à comprendre… Etrange quand même… leur froideur. Je vais sortir. Il faut que je leur parle, qu’on s’explique. Je veux sortir. La porte n’a pas de poignée intérieure. Je suis bouclée. Je ne peux pas. Coincée, prisonnière, enfermée, je m’en aperçois maintenant. Je fonds en larmes. Je m’assieds par terre et je pleure longtemps, longtemps, tristement. Ils m’ont eue. Prise comme un rat. Je réagis. Ça existe donc… Oui prise. Le piège. Sans prévenir. Perdue, je tape contre la porte. Je me déchaîne. Je crie, appelle… Ils vont m’ouvrir, finir par m’expliquer pourquoi… Je donne des coups de poing, pied, reins contre le bois. Je m’excite en frappant de plus en plus fort, de plus en plus vite, en criant de plus en plus haut. Pas de réponse.
Il y a un judas sur la porte. De l’autre côté, ils me regardent. C’est sûr. Ils assistent au spectacle. Je me donne en pâture. Je sais, je ne peux pas faire autrement. Je m’agite ridiculement, gesticule encore. Eux, je les entends. Eux, ils rient.
Pas possible de s’échapper du côté de la fenêtre, d’appeler au secours, de contacter quelqu’un. Aucune aide. Rien. Un lit seul, des draps, une bouteille en plastique remplie d’eau, un gobelet plastique aussi, plein de marques de dents. Les fous d’avant moi, ils passaient leur colère et désespoir sur le gobelet. Pauvre gobelet, pauvres fous. Être bête, chien réduit à ça. Fendiller, mordiller, s’acharner sur une timbale.
J’ai réfléchi encore. Je ne faisais que ça, réfléchir, rêver mes fuites, manigancer mes projets irréalisables, attendre un miracle ou leur bonne volonté. Ils en auront marre à la fin, c’est forcé. Ils se fatigueront, ils céderont. Ils vont bien voir que je ne suis pas folle, c’est obligé. Je tape contre la porte. Je vais leur expliquer. J’implore minable, méprisable et mendiante : ouvrez-moi mais ouvrez-moi… ouvrez donc… je vous en supplie… ouvrez.., Moi je me fatigue, eux, ils se relaient derrière le judas. Il y a toujours un nouveau gardien en pleine forme derrière la porte. Ils me font bien sentir qu’ils sont de l’autre côté, ils toussotent ou ricanent, font des commentaires.
Ils se sont bien amusés puis ils en ont eu assez. Deux hommes sont entrés dans ma cellule. Deux hommes de service gros et brusques. Ils ne doivent servir qu’à ça : raisonner, mater les malades qui font des histoires.
Quatre bras musclés durs m’ont attrapée sous les aisselles, comprimant ma poitrine, m’écrasant, me soulevant. Je ne pouvais plus respirer. Je suffoquais. J’étouffais, bavais. Mes yeux révulsés ne voyaient plus. Je les entendais m’insulter. J’étais absente, étrangère, double presque : t’as fini oui… t’as compris maintenant… t’as fini ton cirque sale emmerdeuse ou on t’attache… Puis moqueurs : tu t’en sortiras plus si tu continues comme ça… t’es cuite ma belle… ah ! fallait pas faire la maligne là-bas !… On n’aime pas les petits crâneurs ici, ni les gens qui ont leurs idées…
Puis voulant m’humilier : pas mal hein… joli cul n’est-ce pas… ; elle est bien faite cette garce, on pourrait se marrer tous les trois… Je me révoltais, ils riaient. Je pleurais, ils s’esclaffaient, faisaient des gestes obscènes. Je me débattais, je me réfugiais dans un coin de la pièce, ils me narguaient : eh ! fais pas la mijaurée, t’en as vu d’autres, non… ?
Une infirmière est entrée avec une seringue à la main, interrompant leurs moqueries, Valium, Valium et revalium. Je ne pensais plus ou alors au ralenti. Lent et cotonneux. Tout devenait difficile à comprendre. Le temps n’existait plus. Mes gestes lourds. Une torpeur envahissante comme la paresse. Vivre au rythme de la piqûre. La vie dedans s’organise : la cellule, les murs, le plafond, les silences humiliants. Des larmes coulent de mes yeux sans bruit, sans scandale, tout doucement. Je n’ai plus la force de me révolter. Je ne suis ni heureuse ni malheureuse. Tout est difficile, ralenti, sans intérêt. Je suis arrêtée.
Dehors ça existe encore. Toujours sans nouvelles. Je ne sais plus. Rien. Le vide. Je demande papier et crayon pour écrire. On refuse. J’insiste. Je veux prévenir ma famille, ami. Non.
Il y a quelqu’un qui passe me voir le matin. Moitié ours, moitié général, brusque, saccadé, le médecin. Il ne dit rien. Me regarde, jette un coup d’œil sur la feuille de maladie. Ne pose jamais de questions. Il prescrit, dicte sa volonté. Jamais content, jamais assez la dose de calmants. La surveillante à côté s’affaire, note tout attentive, insiste, fignole, en redemande, a peur d’avoir mal compris, s’excuse, reprend ses notes, ajoute. Calmants, calmants, toujours des calmants. C’est de moi qu’ils parlent et tout cela m’est indifférent. Je ne réagis plus. Je ne me sens pas concernée. Autrement personne, toujours seule. Rien. Le lit, les draps, ma chemise de nuit autour de moi, liquette trop grande, dure, râpeuse. La bouteille d’eau et le gobelet que j’ai commencé à mordre, par terre à côté du lit.
De temps en temps vient le repas. L’assiette en plastique, la viande coupée en petits morceaux. Jamais de couteaux, d’objets dangereux dans la pièce. Je leur ai pourtant dit que je n’ai pas envie de me tuer. Je veux vivre, je veux sortir d’ici, voir des gens… Ces pré
-Littérature et psychiatrie-
"La magie du verbe permet de reconstruire et son corps et la vie, offrant ainsi au sujet une position à patrir de laquelle se définir et se nommer devient à nouveau possible.
Où aller si la fuite dans les mots est frappée d'interdit ?
Emma Santos nous livre à ce propos sa lutte avec les soignants et le monde. Elle montre de façon exemplaire qu'à vouloir tuer "le mal" et mettre fin au surgissement de toute parole "indécente" c'est une vie qui, par l'entreprise soignante, se trouve à jamais confisquée" -Maud Mannoni
"La magie du verbe permet de reconstruire et son corps et la vie, offrant ainsi au sujet une position à patrir de laquelle se définir et se nommer devient à nouveau possible.
Où aller si la fuite dans les mots est frappée d'interdit ?
Emma Santos nous livre à ce propos sa lutte avec les soignants et le monde. Elle montre de façon exemplaire qu'à vouloir tuer "le mal" et mettre fin au surgissement de toute parole "indécente" c'est une vie qui, par l'entreprise soignante, se trouve à jamais confisquée" -Maud Mannoni
J'entre dans un quelconque hôpital pour un contrôle médical et je n'en sors plus. Je me fais traiter de rebelle dérangeante hostile, sans manière, associale...je me retrouve assommée, droguée par les psychiatres. Je résiste. Je tiens bon. Je décide de ne pas me laisser avoir. Ils vont quand même pas me faire perdre la tête, non ? (p.19)
Cette solitude qui m'étreint m'étouffe et m'étrangle le samedi jusqu'au lundi matin. (...)
On se suicide généralement le dimanche. (p.105-107)
On se suicide généralement le dimanche. (p.105-107)
Je décide de dire merci, bonjour, amen. Je souris. Je les aurai à la finesse polie. Sournoise, je pose des questions. Ils ont fait une enquête. Ils me disent, ils m'apprennent que je suis hostile, rebelle, associable, j'emploie mal l'argent que je gagne, je fréquente des gens douteux, je subis une mauvaise influence d'un milieu néfaste Montparnasse et ses artistes. il faut m'éloigner pour mon bien, si possible par la force. (p.29)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Emma Santos (8)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Testez vos connaissances en poésie ! (niveau difficile)
Dans quelle ville Verlaine tira-t-il sur Rimbaud, le blessant légèrement au poignet ?
Paris
Marseille
Bruxelles
Londres
10 questions
1220 lecteurs ont répondu
Thèmes :
poésie
, poèmes
, poètesCréer un quiz sur ce livre1220 lecteurs ont répondu