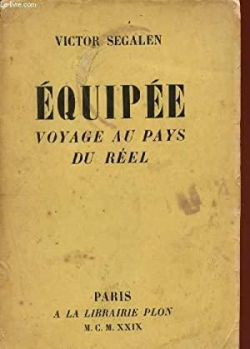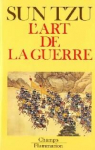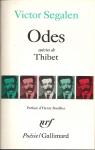Victor Segalen/5
30 notes
Résumé :
OEuvre née d’une mission archéologique. Contrepoint au labeur technique. Inachevé. Ce n’est pas un journal poétique de la mission mais c’est l’expérience de deux voyages en Chine.
Récit de voyage très particulier qui doit répondre à la question : « L’imaginaire déchoit-il ou se renforce quand il
se confronte au réel ? »
Voyage dans le réel puis dans la pensée. Justification morale de la littérature (les mots doivent d’abord passer
dans l... >Voir plus
Récit de voyage très particulier qui doit répondre à la question : « L’imaginaire déchoit-il ou se renforce quand il
se confronte au réel ? »
Voyage dans le réel puis dans la pensée. Justification morale de la littérature (les mots doivent d’abord passer
dans l... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après ÉquipéeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (6)
Voir plus
Ajouter une critique
"Équipée - Voyage au pays du réel" est un récit difficilement catégorisable. Récit d'un voyage en Chine en 1914, lors d'une mission archéologique, il est tout à la fois un journal de bord, un journal intime délesté de ses dates, un récit onirique, une digression littéraire et enfin, selon le propre mot de l'auteur qui ne m'en voudra pas de l'emprunt, une "expertise".
Victor Segalen fut un touche-à-tout. Éduqué dans les sciences (école de médecine, notamment), intéressé par les maladies nerveuses, linguiste (il apprendra le chinois en un an), curieux, voyageur, explorateur, expatrié, poète et écrivain, il s'est proposé ici de coucher sur le papier sa quête analytique sur le Voyage, avec pour but de distinguer le réel de l'irréel, la réalité du rêve ou encore le pragmatisme de la poésie. Ainsi, chaque période du voyage est minutieusement - presque voluptueusement - décrite, narrée, analysée : le choix de la destination (ici, la Chine), la préparation au voyage, la description du matériel approprié et des moyens humains à envisager, toutes les étapes dans leur dimension géographique (fleuve, col, plaine...) et poétique (traditions, cultes, mythes...), les émotions ressenties, les périls déjoués, les découvertes et les rencontres. Et à chaque pas, le questionnement existentiel revient sur ce discernement entre un réel exotique et un irréel littéraire, deux entités aussi délicates à dissocier que l'est un blanc d’œuf de son jaune.
Le texte est beau et plein d'une douce poésie très évocatrice même si la narration peut facilement paraître surannée à un lecteur actuel. Il faut, pour l'apprécier, se mettre dans la peau de ces hommes partis "vers de belles aventures" tout en acceptant leur part de mystère. Un mystère très concret, né de l'approximation des cartes, de l'absence de routes, du côtoiement d'autres cultures, de l'hostilité des contrées entreprises et de la pauvreté des transports indigènes.
Pour ma part, ce furent surtout quelques heures d'évasion vers un pays immense que je connais encore très mal mais dont j'apprécie l'évocation.
Challenge PETITS PLAISIRS 2014 - 2015
Victor Segalen fut un touche-à-tout. Éduqué dans les sciences (école de médecine, notamment), intéressé par les maladies nerveuses, linguiste (il apprendra le chinois en un an), curieux, voyageur, explorateur, expatrié, poète et écrivain, il s'est proposé ici de coucher sur le papier sa quête analytique sur le Voyage, avec pour but de distinguer le réel de l'irréel, la réalité du rêve ou encore le pragmatisme de la poésie. Ainsi, chaque période du voyage est minutieusement - presque voluptueusement - décrite, narrée, analysée : le choix de la destination (ici, la Chine), la préparation au voyage, la description du matériel approprié et des moyens humains à envisager, toutes les étapes dans leur dimension géographique (fleuve, col, plaine...) et poétique (traditions, cultes, mythes...), les émotions ressenties, les périls déjoués, les découvertes et les rencontres. Et à chaque pas, le questionnement existentiel revient sur ce discernement entre un réel exotique et un irréel littéraire, deux entités aussi délicates à dissocier que l'est un blanc d’œuf de son jaune.
Le texte est beau et plein d'une douce poésie très évocatrice même si la narration peut facilement paraître surannée à un lecteur actuel. Il faut, pour l'apprécier, se mettre dans la peau de ces hommes partis "vers de belles aventures" tout en acceptant leur part de mystère. Un mystère très concret, né de l'approximation des cartes, de l'absence de routes, du côtoiement d'autres cultures, de l'hostilité des contrées entreprises et de la pauvreté des transports indigènes.
Pour ma part, ce furent surtout quelques heures d'évasion vers un pays immense que je connais encore très mal mais dont j'apprécie l'évocation.
Challenge PETITS PLAISIRS 2014 - 2015
Victor Segalen écrit ce journal de voyage avec un objectif bien défini : confronter l'imaginaire au réel, dans le cadre de la Chine du début du XXème siècle. Quelle belle idée ! C'est pourquoi j'ai sauté sur l'occasion de découvrir cet auteur.
Mais la partie imaginaire de cette oeuvre ne m'a pas franchement comblé. Dès les premiers chapitres, Segalen se disperse en expressions grandiloquentes : l'ascension de la montagne anticipée comme une « conquête » ou une « domination divine », la descente et la remontée du fleuve comme un « abandon femelle », puis une « domination mâle »… Quant au monde intérieur, il est assimilé à une « chambre aux porcelaines » qui doit « conquérir » (encore !) le monde extérieur. Les termes martiaux et sexualisés (auxquels on pourrait ajouter « prendre possession », « orgie », etc.) se bousculent à travers le livre, si bien qu'il devient difficile d'envisager que la porcelaine reste en un seul morceau à l'issue du périple. Nous avons là un occidental qui joue les barbares en Asie, mais dans un registre hélas plus premier degré qu'Henri Michaux.
Malgré ces nombreuses lourdeurs stylistiques, Segalen manifeste un esprit curieux, capable de poser un regard ironique sur la dépouille d'un prêtre missionnaire abattu par des brigands (confrontant la réalité sordide de son cadavre à l'image d'Épinal des martyrs chrétiens), ou de s'approprier une petite idole locale et d'en faire son « dieu du voyage ».
Il y a aussi de beaux passages, comme celui où l'on découvre une grande ville chinoise de l'époque, dans toute son agitation de senteurs et de couleurs. Pour ne rien gâcher, cette description du réel est précédée d'une anticipation imaginaire plus fouillée. le fantasme et le concret s'opposent en deux tableaux successifs, avec même des tableaux dans les tableaux :
« il traîne dans les rues des peintures sombres et farouches, où parmi des auréoles de bleu vif, sur un fond rouge, d'épouvantables et féconds dieux membrés, pénètrent des parèdres ravies et renversées, en agitant dix bras et cent doigts devinés dans la nuit d'un fond de fumée ; ce sont les peintures Tibétaines »
Dans les chapitres réussis, on peut aussi citer les pérégrinations dans les vallées reculées de la Chine, qui font affleurer la vision d'un village hors du temps, où le réel et l'imaginaire ne peuvent plus se démêler ; puis une intéressante critique du topos de la description des paysages dans les récits de voyage : « Souvent le rythme de la vision s'est par avance cliché dans des phrases et découpé dans des alinéas. » Fidèle à la mission qu'il s'est donnée, l'auteur tente donc de déconstruire le paysage préexistant dans ses fantasmes, et renverse les descriptions habituelles des montagnes, qui deviennent rassurantes en leurs hauteurs et violentes dans les formes minérales éclatées de leurs vallées.
Ces chapitres illustrent le potentiel de l'oeuvre. Mais dans l'ensemble, le style ampoulé de l'auteur peine à offrir une vision de la Chine qui me satisfasse. Et certainement pas lorsque Segalen, dans sa position de privilégié, se livre à une satire hautaine de la condition des porteurs montagnards (qualifiés de « bétail humain »). En somme, ce que l'on entraperçoit du réel est intéressant, mais cela est voilé par un imaginaire très inégal. Heureusement pour lui, Segalen est davantage satisfait de la musique de sa prose, comme le montre cette jolie citation finale :
« Dans ces centaines de rencontres quotidiennes entre l'Imaginaire et le Réel, j'ai été moins retentissant à l'un d'entre eux, qu'attentif à leur opposition. — J'avais à me prononcer entre le marteau et la cloche. J'avoue, maintenant, avoir surtout recueilli le son. »
Mais la partie imaginaire de cette oeuvre ne m'a pas franchement comblé. Dès les premiers chapitres, Segalen se disperse en expressions grandiloquentes : l'ascension de la montagne anticipée comme une « conquête » ou une « domination divine », la descente et la remontée du fleuve comme un « abandon femelle », puis une « domination mâle »… Quant au monde intérieur, il est assimilé à une « chambre aux porcelaines » qui doit « conquérir » (encore !) le monde extérieur. Les termes martiaux et sexualisés (auxquels on pourrait ajouter « prendre possession », « orgie », etc.) se bousculent à travers le livre, si bien qu'il devient difficile d'envisager que la porcelaine reste en un seul morceau à l'issue du périple. Nous avons là un occidental qui joue les barbares en Asie, mais dans un registre hélas plus premier degré qu'Henri Michaux.
Malgré ces nombreuses lourdeurs stylistiques, Segalen manifeste un esprit curieux, capable de poser un regard ironique sur la dépouille d'un prêtre missionnaire abattu par des brigands (confrontant la réalité sordide de son cadavre à l'image d'Épinal des martyrs chrétiens), ou de s'approprier une petite idole locale et d'en faire son « dieu du voyage ».
Il y a aussi de beaux passages, comme celui où l'on découvre une grande ville chinoise de l'époque, dans toute son agitation de senteurs et de couleurs. Pour ne rien gâcher, cette description du réel est précédée d'une anticipation imaginaire plus fouillée. le fantasme et le concret s'opposent en deux tableaux successifs, avec même des tableaux dans les tableaux :
« il traîne dans les rues des peintures sombres et farouches, où parmi des auréoles de bleu vif, sur un fond rouge, d'épouvantables et féconds dieux membrés, pénètrent des parèdres ravies et renversées, en agitant dix bras et cent doigts devinés dans la nuit d'un fond de fumée ; ce sont les peintures Tibétaines »
Dans les chapitres réussis, on peut aussi citer les pérégrinations dans les vallées reculées de la Chine, qui font affleurer la vision d'un village hors du temps, où le réel et l'imaginaire ne peuvent plus se démêler ; puis une intéressante critique du topos de la description des paysages dans les récits de voyage : « Souvent le rythme de la vision s'est par avance cliché dans des phrases et découpé dans des alinéas. » Fidèle à la mission qu'il s'est donnée, l'auteur tente donc de déconstruire le paysage préexistant dans ses fantasmes, et renverse les descriptions habituelles des montagnes, qui deviennent rassurantes en leurs hauteurs et violentes dans les formes minérales éclatées de leurs vallées.
Ces chapitres illustrent le potentiel de l'oeuvre. Mais dans l'ensemble, le style ampoulé de l'auteur peine à offrir une vision de la Chine qui me satisfasse. Et certainement pas lorsque Segalen, dans sa position de privilégié, se livre à une satire hautaine de la condition des porteurs montagnards (qualifiés de « bétail humain »). En somme, ce que l'on entraperçoit du réel est intéressant, mais cela est voilé par un imaginaire très inégal. Heureusement pour lui, Segalen est davantage satisfait de la musique de sa prose, comme le montre cette jolie citation finale :
« Dans ces centaines de rencontres quotidiennes entre l'Imaginaire et le Réel, j'ai été moins retentissant à l'un d'entre eux, qu'attentif à leur opposition. — J'avais à me prononcer entre le marteau et la cloche. J'avoue, maintenant, avoir surtout recueilli le son. »
Victor Segalen écrit Equipée, un ensemble de 28 fragments dont certains peuvent se lire comme de véritables poèmes en prose, en marge des relevés archéologiques qu'il effectue en Chine entre 1914 et 1915. L'incipit, à l'instar de celui du roman René Leys (« j'avais cru le tenir d'avance, plus fini, plus vendable que n'importe quel roman patenté… »), dévoile d'abord le projet en creux, en négatif : non, il ne s'agira pas d'un journal de voyage.
Pour lire la suite : http://ivressedupalimpseste.blogspot.com/2008/07/victor-segalen-equipee.html
Pour lire la suite : http://ivressedupalimpseste.blogspot.com/2008/07/victor-segalen-equipee.html
Je suis extrêmement déçu par ce livre que je n'ai pas compris.
Je pensais qu'il traitait d'expériences de voyages que Victor Segalen a effectué en Chine. En fait, ce partage de témoignages ne représente qu'une petite partie de l'ouvrage.
C'est bien dommage car ces séquences sont très intéressantes.
Pour le reste il s'agit à mon sens de réflexions prétentieuses, d'un alignement de mots pourtant intelligibles mais qui forment des phrases creuses dont je ne garderai rien.
Exemple pris au hasard : "L'Etape (sic) s'impose, non plus sur un monde immobile attentif aux autres tournants, mais sur les animaux en marche, respectueux de la litière. L'étape est catégorique et se suffit."
Il y a mieux à dire sur son expérience de voyage en Chine en début de XXe siècle je pense. Heureusement le livre est court !
Je pensais qu'il traitait d'expériences de voyages que Victor Segalen a effectué en Chine. En fait, ce partage de témoignages ne représente qu'une petite partie de l'ouvrage.
C'est bien dommage car ces séquences sont très intéressantes.
Pour le reste il s'agit à mon sens de réflexions prétentieuses, d'un alignement de mots pourtant intelligibles mais qui forment des phrases creuses dont je ne garderai rien.
Exemple pris au hasard : "L'Etape (sic) s'impose, non plus sur un monde immobile attentif aux autres tournants, mais sur les animaux en marche, respectueux de la litière. L'étape est catégorique et se suffit."
Il y a mieux à dire sur son expérience de voyage en Chine en début de XXe siècle je pense. Heureusement le livre est court !
J'eus aimé parer de cinq étoiles cet ouvrage pour "ces pas sur la route";mais les chapitres de "l'homme de bât" et de " la femme, au lit du réel" avec la mauvaise suffisance de l'homme blanc conquérant et machiste gâche cet ouvrage posthume. Autres temps,autres moeurs me direz vous ? ...mais tout de même !
Citations et extraits (145)
Voir plus
Ajouter une citation
Une ville populeuse, peuplée, mais non populacière. Ni trop ordonnée, ni trop compliquée. Les rues, dallées de ce large grès velouté, gris-violet, doux au fer des sabots et aux semelles ; des rues que l'échange des pas remplit, et pourtant où l'on peut trotter à l'aise à grande allure ; où les riches maisons de vente dégorgent incessamment les soies et les couleurs et les odeurs... même inattendues, des chaussures, minutieusement cousues, relèvent leur poulaine courte. Des jambons arrondissent leur fesse luisante ; des cordes de tabac et leur note grave ; des œufs rouges, d'une garance effroyable, des œufs peints, sont moins riches que la lueur ambrée et le verdâtre des œufs conservés, épluchés, leurs voisins. Ces délicats bijoux de plumes bleu turquoise, niellés d'argent ; des cuirs tannés, et des cuirs vivant encore ; des ceintures anciennes et ces cartouchières neuves... Voici des calots de soie mauve, et des coupons empilés, colonnes denses de soie, de soie dure, vendue au poids de soie, sous les teintures gris de pigeon, les verts de Chine, les grenats. Puis, des écheveaux affadis du rouge au blanc, laissant glisser le son comme une corde de luth dont on dévisse la clef. Ces denrées, ces matières papillotantes à l'extrême, encastrées méticuleusement dans chaque échoppe ou magasin, dont le cadre est fait de ceci : un beau noir et or. Les poteaux laqués du beau vernis brun sombre à luisants noirs et reflets roux, la laque de Tch'eng-tou, et non d'ailleurs...
DANS LE GROS TORRENT, LE BAIN est toute une aventure non prévue ; un sport vif et frais de toute la peau, qui n’a pas appris à se sentir, certes, dans toutes les représentations esthétiques du nu. La littérature et la musique sont peu instructives à cet égard, et ne sont pas en cause ici. Les peintres seuls ont abusé du bain, et se servent couramment du nu avec une candeur ridicule. On ne peut être nu comme à souhait. On ne peut, sans déconvenues ni découvertes, les unes comme les autres, étonnantes, s’allonger tout d’un coup dans l’eau vivante du torrent. — D’abord, bien plus que la mer informe, l’eau courante, fuyante, furieuse et cascadante, a sa personnalité, sa pudeur, son étreinte, — véritablement son corps à corps. Le bain dans la mer ne fait point participer à l’infini des mers, et nulle marée Atlantique n’est perçue comme un halètement, si ce n’est par la plume sèche du poète terrien. Mais on vit de l’essor du torrent puisque l’on s’oppose à sa course. Et que le premier geste, en entrant dans le bain, dans le gros torrent, est d’avoir à s’opposer de toutes forces à lui.
C’est la première des surprises. On est puissamment bousculé. Aussitôt les pieds heurtés aux roches ou piqués de gravats font mal. Quand, enfin, l’on a retrouvé son assiette, on peut goûter la saveur sans cesse à l’indéfini renouvelée, de l’eau, sur les pores de la peau. — A l’encontre du sens un peu trop alimentaire du goût, que l’on ne peut ni ralentir ni retenir, et qui n’est pas réversible, et qui dépend si goulûment de la plénitude d’une poche ! la peau est un admirable organe étendu, mince et subtil ; et le seul qui puisse, pour ainsi dire, jouir de son organe jumeau : d’autres peaux, d’un grain égal ou différent, d’une tactilité, d’un dépoli sensible... Le regard seul a cet immédiat dans la réponse..., mais voir est si différent d’être vu ; cependant que toucher est le même geste qu’être touché... Et cependant les poètes et grands imaginaires, si féconds en échanges d’âmes à travers les prunelles, à travers des mots et la voix, à travers des moments spasmodiques si grossièrement réglés par la physiologie, — les poètes ont peu chanté l’immédiat et le charme et la jouissance de la peau.
C’est tout d’abord ce que la plongée au creux, au lit du grand torrent, révèle. Dès qu’on a retrouvé son assiette, on est étourdi, frotté, décapé, attaqué sur toutes les coutures. Le corps à corps avec toute l’eau descendue est complet et presque sans aides : la pesanteur, si cuisante dans la chute vraie, si vertigineuse au bas-ventre durant l’imaginaire de la chute —, la pesanteur n’existe presque plus, et le bon sol solide très habituel, père de l’immobilité, n’est ici représenté que par ces ronds et gros galets moussus, qu’on sent prêts à entrer en danse eux-mêmes, à se rouler dans l’eau, à fuir ; — et, pour comble, recouverts d’une peau verte, veloutée, fuyante et glissante aussi, sur laquelle on a moins de prises que sur l’eau...
L’eau heurte durement, lutte constante. Peu à peu la fatigue vient, avec le froid... le froid surprend, saisit et stupéfie. Sortant de ce grand et dur été aérien, de cet air enclavé de montagnes, chauffé, tout stagnant dans ses cuvettes d’où il monte en bouffées verticales, mais sans pouvoir s’animer jusqu’au vent traversier, - l’on ne croyait plus qu’il fut possible d’avoir froid, et l’on soupirait vers la fraîcheur irréelle... Le froid est tombé en ouragan fluide et divisé. Le froid avec le bruit éclaboussant. Avec la poussée continue ; et l’on sait d’où il vient : toutes les eaux, depuis deux mois de marche, coulent du Tibet, tout poche, et s’en vont à la mer, à plus de mille lieues... C’est l’haleine dure, le vent des cimes, la cascade du Tibet...
Grelottant, l’on sort du bain. Tout d’un coup repris par l’air tiède, puis chaud ; étonné de l’immobile serre qui vous reprend, où, de nouveau, il faut faire aller ses muscles massés et alanguis d’eau froide, et des baisers de l’eau renouvelée qui lave elle-même son baiser.
C’est la première des surprises. On est puissamment bousculé. Aussitôt les pieds heurtés aux roches ou piqués de gravats font mal. Quand, enfin, l’on a retrouvé son assiette, on peut goûter la saveur sans cesse à l’indéfini renouvelée, de l’eau, sur les pores de la peau. — A l’encontre du sens un peu trop alimentaire du goût, que l’on ne peut ni ralentir ni retenir, et qui n’est pas réversible, et qui dépend si goulûment de la plénitude d’une poche ! la peau est un admirable organe étendu, mince et subtil ; et le seul qui puisse, pour ainsi dire, jouir de son organe jumeau : d’autres peaux, d’un grain égal ou différent, d’une tactilité, d’un dépoli sensible... Le regard seul a cet immédiat dans la réponse..., mais voir est si différent d’être vu ; cependant que toucher est le même geste qu’être touché... Et cependant les poètes et grands imaginaires, si féconds en échanges d’âmes à travers les prunelles, à travers des mots et la voix, à travers des moments spasmodiques si grossièrement réglés par la physiologie, — les poètes ont peu chanté l’immédiat et le charme et la jouissance de la peau.
C’est tout d’abord ce que la plongée au creux, au lit du grand torrent, révèle. Dès qu’on a retrouvé son assiette, on est étourdi, frotté, décapé, attaqué sur toutes les coutures. Le corps à corps avec toute l’eau descendue est complet et presque sans aides : la pesanteur, si cuisante dans la chute vraie, si vertigineuse au bas-ventre durant l’imaginaire de la chute —, la pesanteur n’existe presque plus, et le bon sol solide très habituel, père de l’immobilité, n’est ici représenté que par ces ronds et gros galets moussus, qu’on sent prêts à entrer en danse eux-mêmes, à se rouler dans l’eau, à fuir ; — et, pour comble, recouverts d’une peau verte, veloutée, fuyante et glissante aussi, sur laquelle on a moins de prises que sur l’eau...
L’eau heurte durement, lutte constante. Peu à peu la fatigue vient, avec le froid... le froid surprend, saisit et stupéfie. Sortant de ce grand et dur été aérien, de cet air enclavé de montagnes, chauffé, tout stagnant dans ses cuvettes d’où il monte en bouffées verticales, mais sans pouvoir s’animer jusqu’au vent traversier, - l’on ne croyait plus qu’il fut possible d’avoir froid, et l’on soupirait vers la fraîcheur irréelle... Le froid est tombé en ouragan fluide et divisé. Le froid avec le bruit éclaboussant. Avec la poussée continue ; et l’on sait d’où il vient : toutes les eaux, depuis deux mois de marche, coulent du Tibet, tout poche, et s’en vont à la mer, à plus de mille lieues... C’est l’haleine dure, le vent des cimes, la cascade du Tibet...
Grelottant, l’on sort du bain. Tout d’un coup repris par l’air tiède, puis chaud ; étonné de l’immobile serre qui vous reprend, où, de nouveau, il faut faire aller ses muscles massés et alanguis d’eau froide, et des baisers de l’eau renouvelée qui lave elle-même son baiser.
Un moment magique : l'obstacle a crevé. La pesanteur se traite
de haut. La montagne est surmontée, la muraille démurée. Le lieu
borné n'a plus tout d’un coup d'autres bornes que la feinte
prolongée de l'horizon. Deux versants se sont écartés avec
noblesse pour laisser voir, dans un triangle étendu aux confins,
l'arrière-plan d'un arrière-monde.
C'est tout à fait un autre monde. L'on grimpait jusque-là dans
les étroits fourrés humides où des sources pétillent partout, avec l'angoisse, inverse de la soif — le supplice de l'eau — d'avoir plus à
boire que l'on a soif. L'on heurtait souvent un versant vertical trop
proche, et collé sur les yeux, mais voici que derrière le col, la large
vallée descendante recule, ses flancs creux et roses, ses flancs
désertiques, desséchés par un autre régime des vents et du soleil.
C'est, de nouveau, la promesse haletante de désirs altérés, l'espoir
de tendre vers la source — que l'abondance des sources avait tari.
C'est aussi la transmutation dans l'effort. Ayant, jusqu'ici, tout fait
pour élever son corps, l'ayant porté à chaque pas, c'est
maintenant le corps qui se déverse, chute et entraîne. L'effort
change bout pour bout comme un sablier. Les genoux qui
soulevaient vont recevoir. Les jarrets actifs se font amortisseurs.
Les bras nagent dans un équilibre entrecoupé de cascade, et le
regard, précurseur aux bonds de dix lieues, plane et se pose à
volonté sur cet espace. Ceci est peut-être le symbole physique de
la joie ? La descente aurait-elle plus de joie que l'effort à la
hauteur, et cette vertu paradoxale de prolonger ce moment
essentiellement bref : le regard par-dessus le col.
Non. La descente est une chute déguisée, entrecoupée, et sans
même la beauté du vertige. La dévalée n'est qu'un emprunt au
saut de chèvre, une glissade raccrochée aux pierres et aux ronces.
Descendre est voisin de déchoir. Et rien ne vaut ce que j'imaginais.
Vite, les mouvements nouveaux, répétés et identiques, deviennent
insupportables. Les genoux se font douloureux, les chevilles
tournent et vacillent si je ne crispe la jambe pour éviter, à chaque
pas, le faux pas. Alors, le moindre bout de sentier plat est
reposant, et agréable, et, s'il remonte, fait regretter tous les
mérites de l'effort ascensionnel. Même, si la route n'était point la
route, c'est-à-dire impérieusement tendue vers ce point
imaginaire, — hors des monts et des ravins, — l'autre but,
volontiers je me retournerais vers la hauteur d'où je dévale pour
escalader à rebours et regagner le col. Le dévers a compensé et
mis en valeur balancée la puissance montante de l'avers, et
démontré surtout l'incomparable harmonie, la plénitude, l'inouï de
ce moment fait de contraires, le premier regard par-dessus le col.
de haut. La montagne est surmontée, la muraille démurée. Le lieu
borné n'a plus tout d’un coup d'autres bornes que la feinte
prolongée de l'horizon. Deux versants se sont écartés avec
noblesse pour laisser voir, dans un triangle étendu aux confins,
l'arrière-plan d'un arrière-monde.
C'est tout à fait un autre monde. L'on grimpait jusque-là dans
les étroits fourrés humides où des sources pétillent partout, avec l'angoisse, inverse de la soif — le supplice de l'eau — d'avoir plus à
boire que l'on a soif. L'on heurtait souvent un versant vertical trop
proche, et collé sur les yeux, mais voici que derrière le col, la large
vallée descendante recule, ses flancs creux et roses, ses flancs
désertiques, desséchés par un autre régime des vents et du soleil.
C'est, de nouveau, la promesse haletante de désirs altérés, l'espoir
de tendre vers la source — que l'abondance des sources avait tari.
C'est aussi la transmutation dans l'effort. Ayant, jusqu'ici, tout fait
pour élever son corps, l'ayant porté à chaque pas, c'est
maintenant le corps qui se déverse, chute et entraîne. L'effort
change bout pour bout comme un sablier. Les genoux qui
soulevaient vont recevoir. Les jarrets actifs se font amortisseurs.
Les bras nagent dans un équilibre entrecoupé de cascade, et le
regard, précurseur aux bonds de dix lieues, plane et se pose à
volonté sur cet espace. Ceci est peut-être le symbole physique de
la joie ? La descente aurait-elle plus de joie que l'effort à la
hauteur, et cette vertu paradoxale de prolonger ce moment
essentiellement bref : le regard par-dessus le col.
Non. La descente est une chute déguisée, entrecoupée, et sans
même la beauté du vertige. La dévalée n'est qu'un emprunt au
saut de chèvre, une glissade raccrochée aux pierres et aux ronces.
Descendre est voisin de déchoir. Et rien ne vaut ce que j'imaginais.
Vite, les mouvements nouveaux, répétés et identiques, deviennent
insupportables. Les genoux se font douloureux, les chevilles
tournent et vacillent si je ne crispe la jambe pour éviter, à chaque
pas, le faux pas. Alors, le moindre bout de sentier plat est
reposant, et agréable, et, s'il remonte, fait regretter tous les
mérites de l'effort ascensionnel. Même, si la route n'était point la
route, c'est-à-dire impérieusement tendue vers ce point
imaginaire, — hors des monts et des ravins, — l'autre but,
volontiers je me retournerais vers la hauteur d'où je dévale pour
escalader à rebours et regagner le col. Le dévers a compensé et
mis en valeur balancée la puissance montante de l'avers, et
démontré surtout l'incomparable harmonie, la plénitude, l'inouï de
ce moment fait de contraires, le premier regard par-dessus le col.
L’HOMME DE BÂT n’est pas ce coolie de bonne ou mauvaise volonté, muni de jambes et de bras et qui s’offre partout en Chine à soulever des poids, pour un peu d’argent, de cuivre ou de riz. Il n’est pas donné à tout homme, même solide, d’être un bon porteur. — Le portage est une science, une tradition, un sport, une profession, une ascèse. Tout homme peut devenir un grand fonctionnaire de l’Empire, mais le porteur naît porteur et ne s’improvise point par un titre.
Le portage exige en effet la réunion des qualités que voici : la force, l’adresse, — une connaissance de l’équilibre ; une attention continuelle au terrain ; une peau solide et peu sensible au frottement ; une certaine honnêteté corporative ; de bons poumons ; une gaieté réservée ; et l’art d’arrimer au mieux du poids les fardeaux en mouvement. Tout animal de somme peut avoir jusqu’à certains points ces qualités diverses. Mais une autre échelle et une autre hiérarchie est donnée par les différents apparaux, par les divers mécanismes, par le lien choisi, intermédiaire entre le poids et le porteur, — et s’il est seul ou s’ils sont plusieurs à porter le même poids.
L’homme peut simplement porter sur son dos par l’entremise d’une hotte.
Il peut confier à un bambou flexible le soin de balancer deux paquets suspendus et d’amortir ainsi les ressauts de la marche.
Le bambou enfin peut reposer à longue distance sur deux ou plusieurs épaules, et suspendre sa charge au milieu.
Le premier moyen est simple, formidable et grossier. La hotte, reposant sur un coussinet de bourre, peut supporter un poids énorme : douze ballots de thé comprimé, de vingt livres chacun, soit : deux cent quarante livres sur les reins, les genoux, les chevilles et les plantes. Ou bien trois marmites de fonte, ou bien deux ais épais de bois de cercueil... Cela qui fait un gros bipède de stature effrayante va lentement, trop lentement au gré de celui qui veut le dépasser, encombre les sentiers de montagnes, mais arrive à tout escalader, marches et pentes où l’homme seul glisse et dévale, et qui plus est arrive à descendre sans rouler au bas. Quand cela s’arrête, on voit la pyramide sortir un bâton fourchu et asseoir un instant, sur cette troisième jambe, le fardeau colossal. L’homme à la hotte va lentement, pesamment, indiscontinûment à travers la montagne, là où les autres refusent de passer.
Le porteur élastique, au bambou bien équilibré, est tout autre : moins de la moitié ou du tiers, il n’est pas inquiet du poids, mais des balancements et des secousses : ses pieds travaillent moins que ses reins, élastiques autant que le bambou... Et il prépare à bien comprendre l’effort ambulant et dansant à la fois des trois porteurs de chaise, de la chaise qui m’enlève et d’où je médite et expertise tout ceci.
La chaise est d’abord une bien singulière expérience. Se sentir enlevé par d’autres muscles que les siens est désagréable et indécent. Perdre la notion d’équilibre volontaire est possible à cheval, si l’on a bien la bête entre les jambes, ou en bateau si l’on est à la barre, l’autre main sur l’écoute de grand’voile. Ici, aucune autre action — que la voix — sur ces mécaniques humaines qui vous emportent, un peu malgré soi...
L’enlevé de la chaise, et son vacillement est pénible. La mise au pas irritante ; — et l’on se penche malgré soi en avant, et l’on se crispe sur les bambous, augmentant le balancement... Et l’on se calme et l’on se résigne et l’on se laisse marcher, avec si besoin, le recours au sommeil. — Cependant, certains instants demeurent pathétiques : le passage d’un pont fait de deux planches flexibles ; un tournant net durant lequel la chaise surplombe l’abîme ; ou bien la dévalée dans les éboulis crépitants... Et puis, tout se calme, et l’on n’en vient plus à se préoccuper que de la formation d’une bonne équipe.
Ceci demande du coup d’œil. Ne pas se fier à la grosseur des muscles, ni des épaules, ni des cuisses. De bonnes chevilles-paturons. — En revanche, les masses lombaires doivent demeurer fortes et souples. — Des épaules voûtées portent bien. Exiger des soles sans défaut, des mains fines, un regard vif et surtout un bon poil : toute maladie de peau pourrait être prétexte à renâcler. Il faut se préoccuper enfin, puisqu’il s’agit d’un étalon humain, — du moral.
Ne pas choisir un époux trop fidèle ou économe, qui regrette la femme gratuite demeurée au logis ; mais plutôt un joyeux garçon prêt aux aventures de la route. N’accepter point de buveur reconnu de vin d’orge chinois, bien mal distillé dans les villages, — et l’alcool, même impur, ne pousse point à marcher droit ! Rechercher au besoin le fumeur, silencieux, maigre et réservé. S’assurer avant de quitter la grande étape qu’il a bien fait sa provision de drogue, et qu’elle suffira à tout le voyage. Lui avancer au besoin l’argent nécessaire pour qu’il ne diminue point sa respectable dose quotidienne. Car l’opium enchérit beaucoup dans les temps visités par la moralité occidentale. Enfin s’il est blême et défait au matin, s’il a l’œil grand et béant de noir, s’il vous parle avec une respectueuse douceur expirante, soyez sûr qu’il n’a point dormi d’un vrai sommeil mais que l’étape sera bonne et se prolongera au besoin dans l’autre nuit, qu’il passera de nouveau sans sommeil. — Capable ainsi d’un effort paradoxal que nulle bête ne consentirait à fournir. Et ceci marque la supériorité sur la bête, de l’homme de bât.
D’où vient donc que malgré soi j’en prenne moins de soin que de mes bêtes ? Et surtout que je compatisse avec moins d’immédiat dans la fatigue ou le coup de rein ? Si le cheval qui me porte bute ou bronche, ou s’essouffle à galoper une côte, ou prend sa volte sur le mauvais pied, ou boite, ou est gêné par le mors ; — je me sens boiteux ou gêné, mal à l’aise, fatigué tout d’un coup de la fatigue de la bête, et je descends et la ménage avant de l’avoir éreintée. Mais un porteur essoufflé, un homme, est moins compris de l’homme qui le porte et qui ne veut point être dupé. Le cheval simule aussi pourtant, ayant remarqué une fois qu’une boiterie légère le rend libre... Mais il est soupçonné plus tardivement. L’homme se méfie plus de l’homme que de la bête. Et si l’homme qui porte est blessé, l’autre, voyant la blessure apparente, dira : "Je sais ce que c’est. Marche" là où il n’osera pas pousser un cheval jusqu’au bout de peur de le claquer sans remède, et de le voir tomber sur le flanc dans une crise, pour des raisons de mécanique animale qu’il ignore. L’homme ne meurt point à la tâche, avant d’avoir beaucoup geint ; le cheval grogne à peine, souffle un peu plus fort, et tout d’un coup n’est plus qu’un grand sac gonflé, muni d’un cou plat, d’une grosse tête sur l’herbe et de quatre jambes horizontales, raides. Et aussi : dans les pays de grand portage humain, le cheval est rare et l’homme de bât abondant et bon marché. Plus commun. Moins rare. Plus médiocre. Cela se sent, et l’on s’attache naturellement moins à l’homme vulgaire qu’à la bête rare. Je n’aurais aucun plaisir à revoir les meilleurs de mes porteurs de chaise, même celui dont les jambes longues et minces, parfaites de formes, parfaites de peau, et qui marchait pour moi bien assis, s’arrêtant à un balancement de mon coude, repartant gaiement, enlevant son portage d’avant avec décision et jeunesse... et qui mettait des fleurs aux portants de ma chaise... même celui-là, hors des grandes montagnes où il se mouvait me serait d’une médiocre rencontre comparée à la retrouvée face à face, dans le fumet d’écurie, de la bête blanche au grand trot, aux foulées de galop successives et dont chacune dépassait l’autre en avalant l’effort, et qui cependant, nerveuse et rauque au départ, assagie par la route, m’a mené de Péking aux Marches Tibétaines. Je savais d’avance comment il passerait ce pont, et l’écart à cause de ce rayon de soleil, et son refoulement de l’eau dans les gués, et sa façon convaincue de me rejoindre quand, laissé seul et nu, de l’autre côté des fleuves non guéables, il nageait en levant juste les naseaux et les oreilles. Savoir qu’il tourne maintenant une meule à fromage est pour moi un remords circulaire comparable seulement au remords de Samson. Je n’ai cure du lot échu à mes porteurs : ma reconnaissance dort bien puisqu’ils ont été bien payés.
C’est peut-être cela. On achète le cheval qui devient à soi. On paie l’homme qui reste indépendant, bon à tous, bon au plus offrant. Mieux valait acheter l’homme aussi, et le bien traiter en esclave, avec la parfaite entente de la force contenue en lui ; et sa nourriture, et la femelle à lui donner. Ceci est l’autre raison de connaître mon cheval favori mieux qu’un homme, de le préférer à mon porteur favori.
Mais surtout la mésentente et le mépris relatif de l’homme porté pour son porteur vient du manque d’action directe, de l’impuissance à se faire comprendre, — musculairement. Il faut toujours recourir à la voix ! À la parole articulée ! dont on aperçoit ici la gaucherie et la lenteur. "Tournez à gauche" ne vaut pas la légère pression des rênes. — Et le départ n’est jamais indiqué comme la poussée en avant de la bête glissant comme une grosse cerise chatouilleuse entre les jambes. En chaise, si l’on double les ordres de la voix de gesticulations insolites, l’on devient à la fois incompréhensible et impuissant, imprudent aussi car tout se renverse et me voilà par terre. On peut espérer mieux, comme compréhension directe, avec ces porteurs sellés d’une sorte de bât, et qu’on chevauche véritablement... et qui font partie de la cavalerie de certains petits roitelets Tibétains, qui les offrent et que l’on monte véritablement. L’idée est bonne, mais n’est pas conduite à bout ; car l’on n’est encore qu’un colis sur leurs épaules et l’on n’a que la voix pour les exciter. Il fallait compléter aussi le harnachement et réaliser ainsi la parfaite monture en montagne : l’homme est vêtu selon le climat, ferré pour la glace. On l’a choisi, parmi les porteurs à deux cents livres. Dans la b
Le portage exige en effet la réunion des qualités que voici : la force, l’adresse, — une connaissance de l’équilibre ; une attention continuelle au terrain ; une peau solide et peu sensible au frottement ; une certaine honnêteté corporative ; de bons poumons ; une gaieté réservée ; et l’art d’arrimer au mieux du poids les fardeaux en mouvement. Tout animal de somme peut avoir jusqu’à certains points ces qualités diverses. Mais une autre échelle et une autre hiérarchie est donnée par les différents apparaux, par les divers mécanismes, par le lien choisi, intermédiaire entre le poids et le porteur, — et s’il est seul ou s’ils sont plusieurs à porter le même poids.
L’homme peut simplement porter sur son dos par l’entremise d’une hotte.
Il peut confier à un bambou flexible le soin de balancer deux paquets suspendus et d’amortir ainsi les ressauts de la marche.
Le bambou enfin peut reposer à longue distance sur deux ou plusieurs épaules, et suspendre sa charge au milieu.
Le premier moyen est simple, formidable et grossier. La hotte, reposant sur un coussinet de bourre, peut supporter un poids énorme : douze ballots de thé comprimé, de vingt livres chacun, soit : deux cent quarante livres sur les reins, les genoux, les chevilles et les plantes. Ou bien trois marmites de fonte, ou bien deux ais épais de bois de cercueil... Cela qui fait un gros bipède de stature effrayante va lentement, trop lentement au gré de celui qui veut le dépasser, encombre les sentiers de montagnes, mais arrive à tout escalader, marches et pentes où l’homme seul glisse et dévale, et qui plus est arrive à descendre sans rouler au bas. Quand cela s’arrête, on voit la pyramide sortir un bâton fourchu et asseoir un instant, sur cette troisième jambe, le fardeau colossal. L’homme à la hotte va lentement, pesamment, indiscontinûment à travers la montagne, là où les autres refusent de passer.
Le porteur élastique, au bambou bien équilibré, est tout autre : moins de la moitié ou du tiers, il n’est pas inquiet du poids, mais des balancements et des secousses : ses pieds travaillent moins que ses reins, élastiques autant que le bambou... Et il prépare à bien comprendre l’effort ambulant et dansant à la fois des trois porteurs de chaise, de la chaise qui m’enlève et d’où je médite et expertise tout ceci.
La chaise est d’abord une bien singulière expérience. Se sentir enlevé par d’autres muscles que les siens est désagréable et indécent. Perdre la notion d’équilibre volontaire est possible à cheval, si l’on a bien la bête entre les jambes, ou en bateau si l’on est à la barre, l’autre main sur l’écoute de grand’voile. Ici, aucune autre action — que la voix — sur ces mécaniques humaines qui vous emportent, un peu malgré soi...
L’enlevé de la chaise, et son vacillement est pénible. La mise au pas irritante ; — et l’on se penche malgré soi en avant, et l’on se crispe sur les bambous, augmentant le balancement... Et l’on se calme et l’on se résigne et l’on se laisse marcher, avec si besoin, le recours au sommeil. — Cependant, certains instants demeurent pathétiques : le passage d’un pont fait de deux planches flexibles ; un tournant net durant lequel la chaise surplombe l’abîme ; ou bien la dévalée dans les éboulis crépitants... Et puis, tout se calme, et l’on n’en vient plus à se préoccuper que de la formation d’une bonne équipe.
Ceci demande du coup d’œil. Ne pas se fier à la grosseur des muscles, ni des épaules, ni des cuisses. De bonnes chevilles-paturons. — En revanche, les masses lombaires doivent demeurer fortes et souples. — Des épaules voûtées portent bien. Exiger des soles sans défaut, des mains fines, un regard vif et surtout un bon poil : toute maladie de peau pourrait être prétexte à renâcler. Il faut se préoccuper enfin, puisqu’il s’agit d’un étalon humain, — du moral.
Ne pas choisir un époux trop fidèle ou économe, qui regrette la femme gratuite demeurée au logis ; mais plutôt un joyeux garçon prêt aux aventures de la route. N’accepter point de buveur reconnu de vin d’orge chinois, bien mal distillé dans les villages, — et l’alcool, même impur, ne pousse point à marcher droit ! Rechercher au besoin le fumeur, silencieux, maigre et réservé. S’assurer avant de quitter la grande étape qu’il a bien fait sa provision de drogue, et qu’elle suffira à tout le voyage. Lui avancer au besoin l’argent nécessaire pour qu’il ne diminue point sa respectable dose quotidienne. Car l’opium enchérit beaucoup dans les temps visités par la moralité occidentale. Enfin s’il est blême et défait au matin, s’il a l’œil grand et béant de noir, s’il vous parle avec une respectueuse douceur expirante, soyez sûr qu’il n’a point dormi d’un vrai sommeil mais que l’étape sera bonne et se prolongera au besoin dans l’autre nuit, qu’il passera de nouveau sans sommeil. — Capable ainsi d’un effort paradoxal que nulle bête ne consentirait à fournir. Et ceci marque la supériorité sur la bête, de l’homme de bât.
D’où vient donc que malgré soi j’en prenne moins de soin que de mes bêtes ? Et surtout que je compatisse avec moins d’immédiat dans la fatigue ou le coup de rein ? Si le cheval qui me porte bute ou bronche, ou s’essouffle à galoper une côte, ou prend sa volte sur le mauvais pied, ou boite, ou est gêné par le mors ; — je me sens boiteux ou gêné, mal à l’aise, fatigué tout d’un coup de la fatigue de la bête, et je descends et la ménage avant de l’avoir éreintée. Mais un porteur essoufflé, un homme, est moins compris de l’homme qui le porte et qui ne veut point être dupé. Le cheval simule aussi pourtant, ayant remarqué une fois qu’une boiterie légère le rend libre... Mais il est soupçonné plus tardivement. L’homme se méfie plus de l’homme que de la bête. Et si l’homme qui porte est blessé, l’autre, voyant la blessure apparente, dira : "Je sais ce que c’est. Marche" là où il n’osera pas pousser un cheval jusqu’au bout de peur de le claquer sans remède, et de le voir tomber sur le flanc dans une crise, pour des raisons de mécanique animale qu’il ignore. L’homme ne meurt point à la tâche, avant d’avoir beaucoup geint ; le cheval grogne à peine, souffle un peu plus fort, et tout d’un coup n’est plus qu’un grand sac gonflé, muni d’un cou plat, d’une grosse tête sur l’herbe et de quatre jambes horizontales, raides. Et aussi : dans les pays de grand portage humain, le cheval est rare et l’homme de bât abondant et bon marché. Plus commun. Moins rare. Plus médiocre. Cela se sent, et l’on s’attache naturellement moins à l’homme vulgaire qu’à la bête rare. Je n’aurais aucun plaisir à revoir les meilleurs de mes porteurs de chaise, même celui dont les jambes longues et minces, parfaites de formes, parfaites de peau, et qui marchait pour moi bien assis, s’arrêtant à un balancement de mon coude, repartant gaiement, enlevant son portage d’avant avec décision et jeunesse... et qui mettait des fleurs aux portants de ma chaise... même celui-là, hors des grandes montagnes où il se mouvait me serait d’une médiocre rencontre comparée à la retrouvée face à face, dans le fumet d’écurie, de la bête blanche au grand trot, aux foulées de galop successives et dont chacune dépassait l’autre en avalant l’effort, et qui cependant, nerveuse et rauque au départ, assagie par la route, m’a mené de Péking aux Marches Tibétaines. Je savais d’avance comment il passerait ce pont, et l’écart à cause de ce rayon de soleil, et son refoulement de l’eau dans les gués, et sa façon convaincue de me rejoindre quand, laissé seul et nu, de l’autre côté des fleuves non guéables, il nageait en levant juste les naseaux et les oreilles. Savoir qu’il tourne maintenant une meule à fromage est pour moi un remords circulaire comparable seulement au remords de Samson. Je n’ai cure du lot échu à mes porteurs : ma reconnaissance dort bien puisqu’ils ont été bien payés.
C’est peut-être cela. On achète le cheval qui devient à soi. On paie l’homme qui reste indépendant, bon à tous, bon au plus offrant. Mieux valait acheter l’homme aussi, et le bien traiter en esclave, avec la parfaite entente de la force contenue en lui ; et sa nourriture, et la femelle à lui donner. Ceci est l’autre raison de connaître mon cheval favori mieux qu’un homme, de le préférer à mon porteur favori.
Mais surtout la mésentente et le mépris relatif de l’homme porté pour son porteur vient du manque d’action directe, de l’impuissance à se faire comprendre, — musculairement. Il faut toujours recourir à la voix ! À la parole articulée ! dont on aperçoit ici la gaucherie et la lenteur. "Tournez à gauche" ne vaut pas la légère pression des rênes. — Et le départ n’est jamais indiqué comme la poussée en avant de la bête glissant comme une grosse cerise chatouilleuse entre les jambes. En chaise, si l’on double les ordres de la voix de gesticulations insolites, l’on devient à la fois incompréhensible et impuissant, imprudent aussi car tout se renverse et me voilà par terre. On peut espérer mieux, comme compréhension directe, avec ces porteurs sellés d’une sorte de bât, et qu’on chevauche véritablement... et qui font partie de la cavalerie de certains petits roitelets Tibétains, qui les offrent et que l’on monte véritablement. L’idée est bonne, mais n’est pas conduite à bout ; car l’on n’est encore qu’un colis sur leurs épaules et l’on n’a que la voix pour les exciter. Il fallait compléter aussi le harnachement et réaliser ainsi la parfaite monture en montagne : l’homme est vêtu selon le climat, ferré pour la glace. On l’a choisi, parmi les porteurs à deux cents livres. Dans la b
UNE CHAIR GLORIEUSE ! un corps d’élu ! une relique non dépecée, le chef-d’œuvre frais du martyre ; la conquête de l’esprit sur tout le grossier Temporel ; la figure, sous face humaine, de ce qui, vivant, a vaincu la mort et toutes ses suites ; la défroque d’une âme déchaussée, démembrée dépouillée, dépulpée, libre et purement âme ; ce qui reste, le témoin de la Lutte : le manteau fait de sang et de muscles, ironique otage, méprisable laissé pour compte aux bourreaux, et sur lequel ils ont dansé bestialement, croyant ainsi venger le César, ou détruire l’hérésie, cependant que le souffle désincarné dans son grand essor parabolique revient tourner sur la dépouille dont il rit. Et pourtant, qu’elle apparut belle, dans les œuvres peintes ou lyriques, habillée de mots plus célestes que le bleu Angelico. Des musiques ont chanté plus haut et plus fort que les martyrs. Si on en parle, c’est afin d’exprimer l’allégement, l’évasion... Le mot seul de martyr détache une symphonie bruissante de harpes et d’ailes, de rayons, de flammes et de pleurs presque amoureux. Et si d’en haut on revient à la terre, un corps tombé au bon combat ne peut pas s’imaginer d’une autre manière que celle-ci : si c’est un homme, qu’il soit nu du crâne à la ceinture, des orteils aux genoux, fort et musclé, — le renoncement au corps ne fut que plus méritoire, — et alors, couvert de rouges plaies — dans sa chair encore palpitante, le sang fume comme un encens fume. Les bourreaux qui l’ont éventré, écorcé, brûlé, divisé, tenaillé, énervé dans tous les replis douloureux, n’ont pas égratigné la peau sereine du visage, beau et fort. Ou bien, si les privations historiques ont été longues, si le Saint a longtemps résisté sous terre dans la faim, et dans l’ombre pleine de tentations plus cuisantes que le gril, on consent qu’il paraisse blême, maigre, jaune-extatique, déformé, et sec à la vie humaine. — Une Sainte doit être préservée, et toujours avant tout elle sera belle. On accepte qu’elle ait été mère, mais non déformée. On l’honore dans sa beauté terrestre, image de sa splendeur dans les cieux. Sur ce corps miraculé les pires outrages, volontiers décrits, laissent peu de traces peintes. Dépouillée, souillée, on ne la voit plus que rajustée, les bras à peine nus, défendant le cœur passionné pour l’Époux-Unique. Les cheveux fouillés dans la luxure ont repris leur attache, leur grâce ; — et d’invisibles mains de sœurs déjà célestes ont tout réparé du spectacle abominable que serait le même corps, profané par les mêmes violences, mais que le but ne sanctifierait pas. Car du principe où le corps est jugé glorieux, toutes les habitudes naturelles s’arrêtent pour lui : comme l’âme est insaisissable avec les brutales mains à cinq doigts de la vie et non divisible par le sabre, le corps échappe à la décomposition. Il participe déjà à l’essence de ces chairs vraiment glorieuses : corps d’Élus après le Dernier Jugement ; corps pénétrants, filtrants, fluents... Et d’ailleurs, des fidèles, des amis, des parents — jaloux du triomphe — viennent précocement inhumer le cadavre, et parfois, par conviction sans doute insuffisante, sans attendre la preuve pourrie, la "tache verte" sur le ventre, — l’embaument.
Mille ans plus tard, quand trois miracles révolus auront proclamé la sainteté, l’on ouvrira la chambre sèche, et l’on s’étonnera, ou bien de la conservation, ou du poli jaune des os que l’on se partagera de reliquaires en reliquaires. L’on gardera aussi les cheveux, matière impérissable ; et les dents, et les rognures d’ongles trop négligées durant la vie. Et dans tout cela, rien de déplacé, ni déplaisant, ni répugnant. Mais une grande envolée réconfortante : un allégement, dans les mots, dans les couleurs et les formes, dans l’esprit et dans le cœur, tout se distille en ce léger et enivrant parfum de sainteté... Voilà ce qu’il est décent d’imaginer au seul prononcé de ces mots : Martyrologe, Martyrisé, Martyr et Sainte Relique... Un corps élu ; une chair glorieuse.
Mais voici ce que j’ai vu : une charogne. Glorieuse, oui, et je le sais ; mais avant tout, et pour toujours : une charogne. C’est ici, au confin de la Chine et du Tibet, que je l’ai regardée, reconnue, touchée.
Sous un hangar, un cercueil chinois fort étriqué, misérablement économe de son bois. Un jeune missionnaire chargé des cérémonies, et très affairé, papillonne autour d’un prélat, évêque d’Héracléopolis, in partibus infidelium. L’un et l’autre semblent fort préoccupés de l’odeur. Le cadavre est vieux de vingt-deux jours ; vingt-deux jours de route chaude depuis l’embuscade où les lamas Tibétains l’ont fusillé mécaniquement, puis amputé, lacéré, trépigné, meurtri. Il faut lutter contre l’odeur qu’on ne sent pas encore, mais qu’on redoute. On cherche des produits chinois, un peu païens : les bâtonnets à la crotte de chameau, mêlée d’encens et dont les bouddhistes font usage. On en achète au coin de la rue. On les fiche partout : dans les ais disjoints du cercueil, dans les fentes des poutres du hangar... on en offre aux assistants ; on racle aussi des copeaux de santal, qu’on s’efforce d’allumer ; on songe à faire flamber le puant alcool chinois, et l’on remue le dispensaire et ses fonds de flacons désinfectants. Seuls les bâtonnets rougeoient bien, et encensent l’air gris, immobile. On se risque à ouvrir le cercueil.
Sans suaire, sauf un mauvais drap suintant, sur la face, le corps est vêtu, trop vêtu, trop naturellement recouvert de ses vrais vêtements d’humain vivant ; la sorte de robe-soutane chinoise, ballonnée au ventre, étriquée aux épaules que le cercueil trop étroit ratatine, — les coudes gênés, serrés en avant ; — un qui fut un homme étouffe là, ayant voyagé vingt et un jours dans cette boîte, avec ses mouches vertes, sous le soleil bourdonnant d’éclosions...
C’est un martyr. Le cas est indiscutable. Si j’avais à le plaider en cour de Rome, je ferais voir le bon droit du confesseur : non seulement le Père était en tournée pastorale, et ce n’est pas jeu de brigands, mais vengeance : le coup ne peut s’expliquer autrement que par volonté d’un Lama, d’un diabolique suppôt de cette religion caricature des gestes romains liturgiques, et qui n’ignore ni l’eau consacrée, ni les cloches, ni les pèlerinages, ni les oraisons jaculatoires remetteuses de sept ans et de sept quarantaines. — Un satanique concurrent, un échappé d’enfer, armé par la permission divine d’un excellent Mauser importé d’Allemagne par la frontière himalayenne, a fait le coup... ressentiment prémédité du Lama, contre qui le Père volait des âmes, les arrachant aux sectes jaunes pour les "donner à Jésus". Le martyre est donc indiscutable. Et malgré la répugnance du spectacle, les glaires, le ballonnement et les taches, on peut croire à une spiritualité légère, victorieuse de tout ceci...
Peut-être quelque prière d’une voix vivante, pour rejoindre l’âme, l’appeler, l’évoquer... Peut-être un peu d’eau lustrale, bénite sous les mots romains pour laver, pour décoller l’étoffe grise et jaune du visage...
D’une main de femme au-dessus de la bière, d’une longue manche blanche, tombent en effet des gouttes sur l’étoffe, sur le cœur... et une abominable odeur se répand : toute la sale et puante pharmacopée se déverse sur le cadavre... Toujours afin de tuer l’odeur du saint, une religieuse l’inonde d’un vieux flacon de phénol.
Et l’on peut découvrir la face. Non plus la face ; il n’y en a plus ; ce qui fut le visage est, non pas pourri, mais noir et sec. Tout s’est rétréci sur les os. La tête est rentrée dans le cou, le cou dans le tronc ; la petite figure de momie encore humide rit abominablement "en dedans". Quelques cheveux gras ; des poils de barbe rousse, européenne. Le crâne est presque vide, vert et liquéfié. Les mains qui ne sont pas jointes, ni résignées, tordent leurs doigts noirs et secs. On se penche : la tempe gauche, trouée largement, témoigne que la mort fut brève, qu’il n’y eut pas de souffrance. On se félicite que celui-ci admis à l’ineffable sacrifice de soi n’ait pas eu le temps d’en goûter consciemment, dans sa force, la splendeur. Ayant vu ce trou, et reconnu que la barbe jaune ne pouvait être chinoise, ayant fait ce constat policier, il semble que tout est bien ainsi, et l’on va se retirer, poliment, mais vite, comme les parents éloignés...
Mais cela pourrait "sentir" encore cette nuit : des coolies et des enfants, accourus à ce curieux spectacle d’un squelette d’Européen, s’emploient à piler dans des auges des racines d’assa fœtida. On hésite. On s’en va. Rien ne montera dans l’air... Rien n’appelle un peu d’esprit... Les bâtonnets fumants, l’odeur païenne s’absorbe et s’éteint. On recloue la bière. On lui tourne le dos. L’air gris est immobile et pesant. Que penser... que penser : pas une prière, pas un geste. Le mort glorieux n’est qu’un mort, total dans sa putréfaction. L’âme est morte. Rien ne s’est manifesté. Le confesseur n’a rien avoué de sa bouche déformée ; ne nous a rien appris, sinon par son crâne creux, ses yeux pourris : le triomphe cadavérique de la mort, de la chair sur l’esprit, — rien, sinon le prix même de la durée temporelle, de l’être, du voir, du sentir et du penser. Plus fort que les ignobles baumes médicaux montait le parfum de la vie.
La chose finie, l’Évêque a poliment remercié l’honorable assistance, et, inquiet sur les haut-le-cœur possibles, s’est détourné sur le pas de sa porte... engageant, simple et paternel...
— Eh ! messieurs, un petit verre de vin de messe, pour combattre les "miasmes" ?
Refusé.
Mille ans plus tard, quand trois miracles révolus auront proclamé la sainteté, l’on ouvrira la chambre sèche, et l’on s’étonnera, ou bien de la conservation, ou du poli jaune des os que l’on se partagera de reliquaires en reliquaires. L’on gardera aussi les cheveux, matière impérissable ; et les dents, et les rognures d’ongles trop négligées durant la vie. Et dans tout cela, rien de déplacé, ni déplaisant, ni répugnant. Mais une grande envolée réconfortante : un allégement, dans les mots, dans les couleurs et les formes, dans l’esprit et dans le cœur, tout se distille en ce léger et enivrant parfum de sainteté... Voilà ce qu’il est décent d’imaginer au seul prononcé de ces mots : Martyrologe, Martyrisé, Martyr et Sainte Relique... Un corps élu ; une chair glorieuse.
Mais voici ce que j’ai vu : une charogne. Glorieuse, oui, et je le sais ; mais avant tout, et pour toujours : une charogne. C’est ici, au confin de la Chine et du Tibet, que je l’ai regardée, reconnue, touchée.
Sous un hangar, un cercueil chinois fort étriqué, misérablement économe de son bois. Un jeune missionnaire chargé des cérémonies, et très affairé, papillonne autour d’un prélat, évêque d’Héracléopolis, in partibus infidelium. L’un et l’autre semblent fort préoccupés de l’odeur. Le cadavre est vieux de vingt-deux jours ; vingt-deux jours de route chaude depuis l’embuscade où les lamas Tibétains l’ont fusillé mécaniquement, puis amputé, lacéré, trépigné, meurtri. Il faut lutter contre l’odeur qu’on ne sent pas encore, mais qu’on redoute. On cherche des produits chinois, un peu païens : les bâtonnets à la crotte de chameau, mêlée d’encens et dont les bouddhistes font usage. On en achète au coin de la rue. On les fiche partout : dans les ais disjoints du cercueil, dans les fentes des poutres du hangar... on en offre aux assistants ; on racle aussi des copeaux de santal, qu’on s’efforce d’allumer ; on songe à faire flamber le puant alcool chinois, et l’on remue le dispensaire et ses fonds de flacons désinfectants. Seuls les bâtonnets rougeoient bien, et encensent l’air gris, immobile. On se risque à ouvrir le cercueil.
Sans suaire, sauf un mauvais drap suintant, sur la face, le corps est vêtu, trop vêtu, trop naturellement recouvert de ses vrais vêtements d’humain vivant ; la sorte de robe-soutane chinoise, ballonnée au ventre, étriquée aux épaules que le cercueil trop étroit ratatine, — les coudes gênés, serrés en avant ; — un qui fut un homme étouffe là, ayant voyagé vingt et un jours dans cette boîte, avec ses mouches vertes, sous le soleil bourdonnant d’éclosions...
C’est un martyr. Le cas est indiscutable. Si j’avais à le plaider en cour de Rome, je ferais voir le bon droit du confesseur : non seulement le Père était en tournée pastorale, et ce n’est pas jeu de brigands, mais vengeance : le coup ne peut s’expliquer autrement que par volonté d’un Lama, d’un diabolique suppôt de cette religion caricature des gestes romains liturgiques, et qui n’ignore ni l’eau consacrée, ni les cloches, ni les pèlerinages, ni les oraisons jaculatoires remetteuses de sept ans et de sept quarantaines. — Un satanique concurrent, un échappé d’enfer, armé par la permission divine d’un excellent Mauser importé d’Allemagne par la frontière himalayenne, a fait le coup... ressentiment prémédité du Lama, contre qui le Père volait des âmes, les arrachant aux sectes jaunes pour les "donner à Jésus". Le martyre est donc indiscutable. Et malgré la répugnance du spectacle, les glaires, le ballonnement et les taches, on peut croire à une spiritualité légère, victorieuse de tout ceci...
Peut-être quelque prière d’une voix vivante, pour rejoindre l’âme, l’appeler, l’évoquer... Peut-être un peu d’eau lustrale, bénite sous les mots romains pour laver, pour décoller l’étoffe grise et jaune du visage...
D’une main de femme au-dessus de la bière, d’une longue manche blanche, tombent en effet des gouttes sur l’étoffe, sur le cœur... et une abominable odeur se répand : toute la sale et puante pharmacopée se déverse sur le cadavre... Toujours afin de tuer l’odeur du saint, une religieuse l’inonde d’un vieux flacon de phénol.
Et l’on peut découvrir la face. Non plus la face ; il n’y en a plus ; ce qui fut le visage est, non pas pourri, mais noir et sec. Tout s’est rétréci sur les os. La tête est rentrée dans le cou, le cou dans le tronc ; la petite figure de momie encore humide rit abominablement "en dedans". Quelques cheveux gras ; des poils de barbe rousse, européenne. Le crâne est presque vide, vert et liquéfié. Les mains qui ne sont pas jointes, ni résignées, tordent leurs doigts noirs et secs. On se penche : la tempe gauche, trouée largement, témoigne que la mort fut brève, qu’il n’y eut pas de souffrance. On se félicite que celui-ci admis à l’ineffable sacrifice de soi n’ait pas eu le temps d’en goûter consciemment, dans sa force, la splendeur. Ayant vu ce trou, et reconnu que la barbe jaune ne pouvait être chinoise, ayant fait ce constat policier, il semble que tout est bien ainsi, et l’on va se retirer, poliment, mais vite, comme les parents éloignés...
Mais cela pourrait "sentir" encore cette nuit : des coolies et des enfants, accourus à ce curieux spectacle d’un squelette d’Européen, s’emploient à piler dans des auges des racines d’assa fœtida. On hésite. On s’en va. Rien ne montera dans l’air... Rien n’appelle un peu d’esprit... Les bâtonnets fumants, l’odeur païenne s’absorbe et s’éteint. On recloue la bière. On lui tourne le dos. L’air gris est immobile et pesant. Que penser... que penser : pas une prière, pas un geste. Le mort glorieux n’est qu’un mort, total dans sa putréfaction. L’âme est morte. Rien ne s’est manifesté. Le confesseur n’a rien avoué de sa bouche déformée ; ne nous a rien appris, sinon par son crâne creux, ses yeux pourris : le triomphe cadavérique de la mort, de la chair sur l’esprit, — rien, sinon le prix même de la durée temporelle, de l’être, du voir, du sentir et du penser. Plus fort que les ignobles baumes médicaux montait le parfum de la vie.
La chose finie, l’Évêque a poliment remercié l’honorable assistance, et, inquiet sur les haut-le-cœur possibles, s’est détourné sur le pas de sa porte... engageant, simple et paternel...
— Eh ! messieurs, un petit verre de vin de messe, pour combattre les "miasmes" ?
Refusé.
Videos de Victor Segalen (17)
Voir plusAjouter une vidéo
Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Saviez qu'en chinois il n'existe pas d'équivalent au mot français « impossible » ? Et savez-vous quel grand roman raconte qu'impossible n'est pas chinois ?
« René Leys », de Victor Segalen, c'est à lire en poche chez Folio.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Saviez qu'en chinois il n'existe pas d'équivalent au mot français « impossible » ? Et savez-vous quel grand roman raconte qu'impossible n'est pas chinois ?
« René Leys », de Victor Segalen, c'est à lire en poche chez Folio.
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Victor Segalen (39)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Année du Dragon
Ce samedi 10 février 2024, l'année du lapin d'eau laisse sa place à celle du dragon de bois dans le calendrier:
grégorien
chinois
hébraïque
8 questions
127 lecteurs ont répondu
Thèmes :
dragon
, Astrologie chinoise
, signes
, signes du zodiaques
, chine
, culture générale
, littérature
, cinemaCréer un quiz sur ce livre127 lecteurs ont répondu