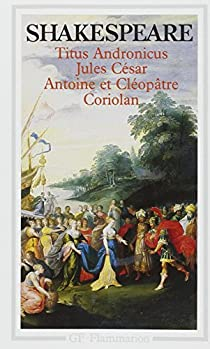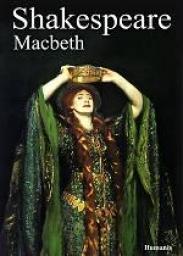J'ai entendu ou lu beaucoup de mal de cette tragédie. On l'accuse d'à peu près tout ; on met en doute qu'elle soit bien de la main de Shakespeare ; on l'accuse de verser dans le gore et l'horreur ; de facilité pour satisfaire un public peu raffiné, et de mille autres maux encore.
Et bien permettez-moi de ne pas souscrire à ce concert de crachats. Je n'affirmerai pas qu'il s'agit de la meilleure tragédie de son auteur, ça non. Mais en tout cas, je la trouve extraordinairement plus intéressante que la dernière comédie de William Shakespeare que j'aie lu, le Songe D'Une Nuit D'Été.
Alors, c'est vrai ; c'est vrai qu'il n'a pas eu peur de faire jaillir l'hémoglobine à chaque coin de scène ; c'est vrai qu'il a misé sur le fait de choquer son public pour faire naître de l'empathie vis-à-vis d'actes, eux-mêmes, horribles.
Qu'en est-il ? Titus Andronicus est un vieux général romain à la droiture et au patriotisme irréprochables, tout auréolé de gloire, qui s'en revient d'une campagne fructueuse (surtout tueuse) en Germanie. Il a réussi à soumettre les Goths et ramène d'ailleurs, au titre de trophée de guerre, la reine d'entre-eux, Tamora, ainsi que ses trois fils.
Pendant ce temps à Rome, les fils de l'empereur décédé, Saturnius et Bassianus, s'écharpent à qui mieux mieux pour savoir lequel des deux sera le prochain souverain. Au sénat, beaucoup pensent que Titus Andronicus ferait un bien meilleur empereur que ces deux jouvenceaux bouffis d'orgueil et à la morale discutable.
Toutefois, le vieux général décline l'honneur qui lui est fait et préfère se montrer loyal envers la lignée impériale. Il préfère jouir paisiblement de son prestige auprès des quelques fils qui lui reste et qui se sont illustrés, comme lui, sur le champs de bataille. Tous les autres sont morts au combat pour Rome.
Titus Andronicus prend donc le sage parti d'incliner en faveur de Saturnius, l'aîné des deux frères, en qualité d'Empereur et d'accorder sa somptueuse fille Lavinia à Bassianus : prix de consolation amplement suffisant aux yeux de l'intéressé tant tout Rome souhaitait obtenir la main de la belle.
Saturnius qui était sur le banc des prétendants à la main de Lavinia se voit donc dans l'obligation de reporter ses ardeurs amoureuses sur la non moins pulpeuse reine des Goths, Tamora, dont on espère ainsi apaiser le peuple fraîchement soumis. (J'ai écrit " pulpeuse " sans aucune indication concordante dans le texte, uniquement en souvenir d'un antique slogan publicitaire, " Tamora relève le plat ", veuillez me pardonner.)
Tout va bien, alors ? me direz-vous. Nul besoin de sang ni de tragédie dans ce monde idyllique. Euh... pas tout à fait, en fait. D'une part, Titus Andronicus satisfait à la tradition religieuse romaine du vainqueur de sacrifier aux Dieux le fils aîné des vaincus. Tamora l'implore à genoux d'épargner son fils Alarbus mais rien n'y fait ; celui-ci est sacrifié en bonne et due forme.
Imaginez l'onde de ressentiment qui émane de Tamora à l'endroit de Titus (je vous laisse quelques secondes pour imaginer). Voilà, vous voyez, ce n'est pas rien. Sachant, en plus qu'elle s'accoquine d'un Maure aux noirs desseins (et je crois qu'elle aime bien d'ailleurs ses noirs dessins). Attention, attention, c'est là qu'il risque d'y avoir du sport. Vous avez aimé les carnages de la Reine Margot ? Ça vous a plu ? Vous en voulez encore ?
Pas de problème, ça va gicler de partout. Tamora demande à ses deux fils de s'en prendre à la fille de Titus. Le Maure machiavélique imagine le moyen d'assouvir la vengeance de la reine. Lors d'une partie de chasse où le gratin est convié, les deux fils de Tamora s'arrangent pour assassiner Bassianus, le frère de l'empereur, sous les yeux de sa charmante jeune épouse Lavinia.
La pauvre, horrifiée, témoin embarrassant du crime n'a sans doute plus qu'à mourir. Mais non, et c'est là que les conseils abjects du Maure prennent toute leur dimension d'horreur. Les deux lurons violent Lavinia en bonne et due forme et, pour que l'abjection soit complète, lui tranchent les deux mains, pour qu'elle ne puisse plus écrire, et surtout, lui découpent la langue, afin qu'elle ne puisse plus parler.
Vous êtes écoeurés ? Attendez, vous n'avez pas tout vu. Le Maure s'arrange pour que deux fils de Titus découvrent le cadavre de Bassanius au fond d'une fosse et, tandis qu'ils s'émeuvent du crime, le Maure amène Saturnius, Empereur et frère de l'assassiné, auprès du cadavre, en indiquant que ces deux-là sont les auteurs du méfait.
Le résultat de se faire pas attendre. Les deux fils de Titus sont conduits à Rome pour y être décapités. Mais le vieux Titus espère encore intercéder en leur faveur, eu égard aux nombreux services rendus, afin de prouver leur innocence. Et là encore, le Maure trouve un stratagème odieux. Il annonce à Titus que s'il lui offre sa main tranchée en signe de soumission, l'empereur épargnera ses deux fils. Mais, vous imaginez bien qu'à peine la main arrive sur le bureau de l'empereur, les deux têtes de ses fils atterrissent sur la table de Titus.
Si je récapitule, pour Titus, deux fils décapité, une adorable fille violée, démembrée, défigurée, son dernier fils banni de la ville de Rome et lui même, allégé d'une main. Peut-on gravir encore un échelon sur l'échelle de l'horreur ?
Sans doute, mais ça, ce sera à vous de le découvrir si le coeur vous en dit. Sachez toutefois que cette tragédie annonce à bien des égards d'autres tragédies fameuses de William Shakespeare. Le Maure, par exemple, n'est autre qu'un avatar de Iago dans Othello. Tamora, la reine sanguinaire rappelle à s'y méprendre la mémorable Lady Macbeth.
Songeons, au demeurant, que pour nos amis anglais, l'histoire de Boudica (ou Boadicée), la reine celte qui s'est insurgée contre Rome dans le sang à l'Antiquité est bien présente dans l'imaginaire. Donc, rien d'étonnant, dans le contexte sanglant des guerres de religion (en France notamment) et avec une telle histoire nationale que Shakespeare soit allé lorgner du côté obscur de la tradition latine, notamment les écrits de Lucrèce, témoin d'abominations autour du pouvoir à Rome.
Je ne partage donc pas l'opinion commune qui consiste à considérer cette pièce comme du " sous-Shakespeare ". C'est un autre Shakespeare, mais pas moins bon, pas moins fort que tous les autres aspects de son talent. On peut, évidemment, être moins admiratif de telle ou telle facette de sa production théâtrale. Personnellement, j'aime encore mieux cette tragédie bien sanglante que ses comédies bourrées d'elfes et de fées qui ne me font rien passer. C'est affaire de goût. Et, une fois encore, une fois pour toutes, ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, bien peu de chose.
Et bien permettez-moi de ne pas souscrire à ce concert de crachats. Je n'affirmerai pas qu'il s'agit de la meilleure tragédie de son auteur, ça non. Mais en tout cas, je la trouve extraordinairement plus intéressante que la dernière comédie de William Shakespeare que j'aie lu, le Songe D'Une Nuit D'Été.
Alors, c'est vrai ; c'est vrai qu'il n'a pas eu peur de faire jaillir l'hémoglobine à chaque coin de scène ; c'est vrai qu'il a misé sur le fait de choquer son public pour faire naître de l'empathie vis-à-vis d'actes, eux-mêmes, horribles.
Qu'en est-il ? Titus Andronicus est un vieux général romain à la droiture et au patriotisme irréprochables, tout auréolé de gloire, qui s'en revient d'une campagne fructueuse (surtout tueuse) en Germanie. Il a réussi à soumettre les Goths et ramène d'ailleurs, au titre de trophée de guerre, la reine d'entre-eux, Tamora, ainsi que ses trois fils.
Pendant ce temps à Rome, les fils de l'empereur décédé, Saturnius et Bassianus, s'écharpent à qui mieux mieux pour savoir lequel des deux sera le prochain souverain. Au sénat, beaucoup pensent que Titus Andronicus ferait un bien meilleur empereur que ces deux jouvenceaux bouffis d'orgueil et à la morale discutable.
Toutefois, le vieux général décline l'honneur qui lui est fait et préfère se montrer loyal envers la lignée impériale. Il préfère jouir paisiblement de son prestige auprès des quelques fils qui lui reste et qui se sont illustrés, comme lui, sur le champs de bataille. Tous les autres sont morts au combat pour Rome.
Titus Andronicus prend donc le sage parti d'incliner en faveur de Saturnius, l'aîné des deux frères, en qualité d'Empereur et d'accorder sa somptueuse fille Lavinia à Bassianus : prix de consolation amplement suffisant aux yeux de l'intéressé tant tout Rome souhaitait obtenir la main de la belle.
Saturnius qui était sur le banc des prétendants à la main de Lavinia se voit donc dans l'obligation de reporter ses ardeurs amoureuses sur la non moins pulpeuse reine des Goths, Tamora, dont on espère ainsi apaiser le peuple fraîchement soumis. (J'ai écrit " pulpeuse " sans aucune indication concordante dans le texte, uniquement en souvenir d'un antique slogan publicitaire, " Tamora relève le plat ", veuillez me pardonner.)
Tout va bien, alors ? me direz-vous. Nul besoin de sang ni de tragédie dans ce monde idyllique. Euh... pas tout à fait, en fait. D'une part, Titus Andronicus satisfait à la tradition religieuse romaine du vainqueur de sacrifier aux Dieux le fils aîné des vaincus. Tamora l'implore à genoux d'épargner son fils Alarbus mais rien n'y fait ; celui-ci est sacrifié en bonne et due forme.
Imaginez l'onde de ressentiment qui émane de Tamora à l'endroit de Titus (je vous laisse quelques secondes pour imaginer). Voilà, vous voyez, ce n'est pas rien. Sachant, en plus qu'elle s'accoquine d'un Maure aux noirs desseins (et je crois qu'elle aime bien d'ailleurs ses noirs dessins). Attention, attention, c'est là qu'il risque d'y avoir du sport. Vous avez aimé les carnages de la Reine Margot ? Ça vous a plu ? Vous en voulez encore ?
Pas de problème, ça va gicler de partout. Tamora demande à ses deux fils de s'en prendre à la fille de Titus. Le Maure machiavélique imagine le moyen d'assouvir la vengeance de la reine. Lors d'une partie de chasse où le gratin est convié, les deux fils de Tamora s'arrangent pour assassiner Bassianus, le frère de l'empereur, sous les yeux de sa charmante jeune épouse Lavinia.
La pauvre, horrifiée, témoin embarrassant du crime n'a sans doute plus qu'à mourir. Mais non, et c'est là que les conseils abjects du Maure prennent toute leur dimension d'horreur. Les deux lurons violent Lavinia en bonne et due forme et, pour que l'abjection soit complète, lui tranchent les deux mains, pour qu'elle ne puisse plus écrire, et surtout, lui découpent la langue, afin qu'elle ne puisse plus parler.
Vous êtes écoeurés ? Attendez, vous n'avez pas tout vu. Le Maure s'arrange pour que deux fils de Titus découvrent le cadavre de Bassanius au fond d'une fosse et, tandis qu'ils s'émeuvent du crime, le Maure amène Saturnius, Empereur et frère de l'assassiné, auprès du cadavre, en indiquant que ces deux-là sont les auteurs du méfait.
Le résultat de se faire pas attendre. Les deux fils de Titus sont conduits à Rome pour y être décapités. Mais le vieux Titus espère encore intercéder en leur faveur, eu égard aux nombreux services rendus, afin de prouver leur innocence. Et là encore, le Maure trouve un stratagème odieux. Il annonce à Titus que s'il lui offre sa main tranchée en signe de soumission, l'empereur épargnera ses deux fils. Mais, vous imaginez bien qu'à peine la main arrive sur le bureau de l'empereur, les deux têtes de ses fils atterrissent sur la table de Titus.
Si je récapitule, pour Titus, deux fils décapité, une adorable fille violée, démembrée, défigurée, son dernier fils banni de la ville de Rome et lui même, allégé d'une main. Peut-on gravir encore un échelon sur l'échelle de l'horreur ?
Sans doute, mais ça, ce sera à vous de le découvrir si le coeur vous en dit. Sachez toutefois que cette tragédie annonce à bien des égards d'autres tragédies fameuses de William Shakespeare. Le Maure, par exemple, n'est autre qu'un avatar de Iago dans Othello. Tamora, la reine sanguinaire rappelle à s'y méprendre la mémorable Lady Macbeth.
Songeons, au demeurant, que pour nos amis anglais, l'histoire de Boudica (ou Boadicée), la reine celte qui s'est insurgée contre Rome dans le sang à l'Antiquité est bien présente dans l'imaginaire. Donc, rien d'étonnant, dans le contexte sanglant des guerres de religion (en France notamment) et avec une telle histoire nationale que Shakespeare soit allé lorgner du côté obscur de la tradition latine, notamment les écrits de Lucrèce, témoin d'abominations autour du pouvoir à Rome.
Je ne partage donc pas l'opinion commune qui consiste à considérer cette pièce comme du " sous-Shakespeare ". C'est un autre Shakespeare, mais pas moins bon, pas moins fort que tous les autres aspects de son talent. On peut, évidemment, être moins admiratif de telle ou telle facette de sa production théâtrale. Personnellement, j'aime encore mieux cette tragédie bien sanglante que ses comédies bourrées d'elfes et de fées qui ne me font rien passer. C'est affaire de goût. Et, une fois encore, une fois pour toutes, ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, bien peu de chose.
Mon édition rassemble quatre tragédies du grand William prenant place dans l'Antiquité, toutes traduites par François-Victor Hugo, et dans leur ordre de conception.
Tout d'abord, donc, Titus Andronicus : Réputée comme sa pièce la plus violente, de façon la plus démesurée, jusqu'à ce que cela puisse même en devenir comique, elle a donné lieu à moult spéculations et interprétations. Certains ont longtemps refusé de l'attribuer au maître, tant elle se rapprochait plus de dramaturges comme Marlowe.
Mais il se trouve que la tragédie sanglante était un genre à part entière à l'époque élizabethaine, et, personnellement, je trouve qu'on y décèle certains ingrédients shakespeariens, comme le déguisement de Tamora et ses fils vers la fin. On a aussi mis l'extraordinaire étrangeté de la pièce sur le compte des débuts de Shakespeare, voire de sa propre intention de parodier la tragédie. Des commentateurs voient également dans la pièce des incohérences et des faiblesses d'écriture, et il est vrai que la temporalité est pour le moins loufoque et ne s'embarrasse pas de la moindre cohérence (accouchement soudain de Tamora alors que rien ne l'indiquait enceinte, etc.).
J'ai cependant apprécié la poésie de certaines répliques, toujours en lien avec la nature... À voir également à quel point la pièce a inspiré Victor Hugo, à la fois dans sa violence, et dans les images d'Andronicus se mettant en scène seul au milieu de la tempête (même si on songera bien sûr davantage à Prospéro). Mais la pièce ne se hisse absolument pas dans les sommets shakespeariens. Elle reste, à mes yeux, une curiosité dans son oeuvre. le rôle de Lavinia doit être particulièrement sympathique à interpréter...
Tout d'abord, donc, Titus Andronicus : Réputée comme sa pièce la plus violente, de façon la plus démesurée, jusqu'à ce que cela puisse même en devenir comique, elle a donné lieu à moult spéculations et interprétations. Certains ont longtemps refusé de l'attribuer au maître, tant elle se rapprochait plus de dramaturges comme Marlowe.
Mais il se trouve que la tragédie sanglante était un genre à part entière à l'époque élizabethaine, et, personnellement, je trouve qu'on y décèle certains ingrédients shakespeariens, comme le déguisement de Tamora et ses fils vers la fin. On a aussi mis l'extraordinaire étrangeté de la pièce sur le compte des débuts de Shakespeare, voire de sa propre intention de parodier la tragédie. Des commentateurs voient également dans la pièce des incohérences et des faiblesses d'écriture, et il est vrai que la temporalité est pour le moins loufoque et ne s'embarrasse pas de la moindre cohérence (accouchement soudain de Tamora alors que rien ne l'indiquait enceinte, etc.).
J'ai cependant apprécié la poésie de certaines répliques, toujours en lien avec la nature... À voir également à quel point la pièce a inspiré Victor Hugo, à la fois dans sa violence, et dans les images d'Andronicus se mettant en scène seul au milieu de la tempête (même si on songera bien sûr davantage à Prospéro). Mais la pièce ne se hisse absolument pas dans les sommets shakespeariens. Elle reste, à mes yeux, une curiosité dans son oeuvre. le rôle de Lavinia doit être particulièrement sympathique à interpréter...
J'avais vu la pièce filmée par la BBC dans les années 1980, avant de lire la pièce. J'avais été très étonnée de la noirceur de cette tragédie, surtout de sa violence. Mais paradoxalement, même si cette pièce ne reflète absolument le style de Shakespeare, c'est par elle que j'ai découvert cet auteur.
Bien des années plus tard, j'ai réussi à choquer une de mes collègues, fan de films et de livres gore, en lui faisant lire cette tragédie... Elle n'en revenait pas et m'a même dit que si un auteur écrivait quelque chose d'aussi violent maintenant, il ne serait probablement pas édité...
Bien des années plus tard, j'ai réussi à choquer une de mes collègues, fan de films et de livres gore, en lui faisant lire cette tragédie... Elle n'en revenait pas et m'a même dit que si un auteur écrivait quelque chose d'aussi violent maintenant, il ne serait probablement pas édité...
J'hallucine ! Ce n'est pas possible que cette pièce soit l'oeuvre de Shakespeare ?
On se croirait dans l'ambiance 'gore' d'un roman policier islandais : viol, mutilations, infanticide, cannibalisme. C'est sanglant, plat et vulgaire.
Comme l'écrit Doisneau dans son autobiographie à propos de la plupart des photographes et des regardeurs d'images, ce qui intéresse le plus c'est la violence et le nu. C'est une parfaite illustration de cette pièce écrite des siècles plus tôt mais c'est dit avec raffinement, raffinement qui est totalement absent de cette tragédie, qui est la première du nom à être attribuée à Shakespeare.
Dire qu'il s'agit d'un pastiche de la barbarie comme beaucoup de critiques le font, me paraît hasardeux. Si c'était le cas, il y aurait une morale à la fin de l'histoire. Or, rien de tel.
Vous ne ratez rien en tout cas à ne avoir lu cette pièce.
On se croirait dans l'ambiance 'gore' d'un roman policier islandais : viol, mutilations, infanticide, cannibalisme. C'est sanglant, plat et vulgaire.
Comme l'écrit Doisneau dans son autobiographie à propos de la plupart des photographes et des regardeurs d'images, ce qui intéresse le plus c'est la violence et le nu. C'est une parfaite illustration de cette pièce écrite des siècles plus tôt mais c'est dit avec raffinement, raffinement qui est totalement absent de cette tragédie, qui est la première du nom à être attribuée à Shakespeare.
Dire qu'il s'agit d'un pastiche de la barbarie comme beaucoup de critiques le font, me paraît hasardeux. Si c'était le cas, il y aurait une morale à la fin de l'histoire. Or, rien de tel.
Vous ne ratez rien en tout cas à ne avoir lu cette pièce.
Ce volume rassemble, dans la traduction canonique de François-Victor Hugo, les tragédies romaines de Shakespeare. Il y a un monde, et de longues années d'évolution du dramaturge, entre "Titus Andronicus", que J.C. Maxwell date de 1590 environ, et "Jules César", oeuvre d'un dramaturge lecteur attentif de Plutarque, qu'il scénarise et dramatise. Il n'y a aucune raison de douter que Shakespeare soit l'auteur de "Titus Andronicus", et le choc ressenti par les lecteurs et spectateurs d'aujourd'hui ne fait que nous éclairer sur leurs préjugés, sans aider à la compréhension du texte. Le modèle incontesté de tout théâtre tragique à la Renaissance, française, anglaise ou italienne, est Sénèque le tragique, dont les pièces comme Thyeste se complaisent dans l'horreur ou, dirait-on aujourd'hui, le "gore". Cela ne faisait pas peur au spectateur anglais, pas plus qu'aux amateurs français de Hardy en 1620. D'ailleurs, les idées les plus morbides de Titus Andronicus, comme il est naturel au XVI°s, ne sont pas du cru de l'auteur, mais se légitiment par des précédents latins : Thyeste, on l'a dit, Philomèle et Térée dans Ovide, et une nouvelle de Bandello fondée sur l'histoire d'un viol et d'une mutilation analogues. Les publics d'antan aimaient les spectacles violents, eux aussi, ou du moins, leur récit au théâtre.
"Jules César" est une pièce d'une autre trempe. Certes, le sang coule, des fantômes agitent leurs chaînes, et l'on a tout le surnaturel nécessaire pour contenter un public friand. Cependant, nos préjugés littéraires sont un peu moins mis à mal, puisque la pièce de Shakespeare est la réécriture savante, pour la scène, des Vies de Plutarque (Vie de César, Vie de Brutus, Vie de Marc-Antoine), traduites vingt ans auparavant par Thomas North de la version française d'Amyot. Si le spectacle est magnifique (une mention pour le film des Frères Taviani, "Cesare deve morire", tourné dans la prison romaine de Rebibbia avec des détenus), il ne faut pas négliger l'inflexion politique ajoutée par l'auteur : alors que Plutarque donne au peuple, au dêmos encore en démocratie, un certain pouvoir et un grand poids, ce peuple dans Shakespeare n'est plus qu'une masse abrutie que le républicain Brutus a bien tort d'estimer, et que Marc-Antoine achète cyniquement.
Je ne dis rien des deux autres tragédies romaines, car je ne les ai ni vues, ni lues.
"Jules César" est une pièce d'une autre trempe. Certes, le sang coule, des fantômes agitent leurs chaînes, et l'on a tout le surnaturel nécessaire pour contenter un public friand. Cependant, nos préjugés littéraires sont un peu moins mis à mal, puisque la pièce de Shakespeare est la réécriture savante, pour la scène, des Vies de Plutarque (Vie de César, Vie de Brutus, Vie de Marc-Antoine), traduites vingt ans auparavant par Thomas North de la version française d'Amyot. Si le spectacle est magnifique (une mention pour le film des Frères Taviani, "Cesare deve morire", tourné dans la prison romaine de Rebibbia avec des détenus), il ne faut pas négliger l'inflexion politique ajoutée par l'auteur : alors que Plutarque donne au peuple, au dêmos encore en démocratie, un certain pouvoir et un grand poids, ce peuple dans Shakespeare n'est plus qu'une masse abrutie que le républicain Brutus a bien tort d'estimer, et que Marc-Antoine achète cyniquement.
Je ne dis rien des deux autres tragédies romaines, car je ne les ai ni vues, ni lues.
Ces quatre tragédies romaines de William Shakespeare sont assez étonnantes, la première notamment, une véritable pièce gore et sanglante. Titus Andronicus, c'est un peu "Massacre à la tronçonneuse" avant l'heure. On y viole, on y torture, on y mutile et on y tue comme on irait cueillir des pommes. L'hémoglobine coule à flot. Mais ce n'est pas cette avalanche d'atrocités qui m'a dérangé le plus (on a tendance, pour s'en protéger, à devenir insensible à l'horreur). Ce serait plutôt le message très sectaire qui se dégage de cette tragédie. Si je résume, il nous dit ceci: Ne laissez pas des individus étrangers, des barbares, prendre place dans la cité comme des égaux, car, inévitablement, cela se retournera contre elle, leur perfidie la perdra...
Heureusement que l'énergie émotive de la passion amoureuse qui se dégage d'Antoine et Cléopâtre et qui s'y déploie avec fulgurance, redonne foi en Shakespeare.
Enfin, la dernière tragédie, Coriolan, est sans doute celle que je préfère. le pouvoir démocratique y est remis en cause à travers la peinture d'un peuple girouette qui s'emporte, se dédit, se contredit et juge en fonction des yeux et non de la raison. Mais cette critique de la république romaine ne va pas jusqu'à célébrer l'inégalité aristocratique, car le personnage qui en porte les valeurs provoque à la fois la pitié, l'irritation, l'admiration et la révolte. du grand art, signé Shakespeare!
Heureusement que l'énergie émotive de la passion amoureuse qui se dégage d'Antoine et Cléopâtre et qui s'y déploie avec fulgurance, redonne foi en Shakespeare.
Enfin, la dernière tragédie, Coriolan, est sans doute celle que je préfère. le pouvoir démocratique y est remis en cause à travers la peinture d'un peuple girouette qui s'emporte, se dédit, se contredit et juge en fonction des yeux et non de la raison. Mais cette critique de la république romaine ne va pas jusqu'à célébrer l'inégalité aristocratique, car le personnage qui en porte les valeurs provoque à la fois la pitié, l'irritation, l'admiration et la révolte. du grand art, signé Shakespeare!
Titus Andronicus est une de ces atrocités immorales qui illustrent parfaitement ce que Nietzsche entend, s'agissant de la tragédie, par l'expression « plaisir de la destruction » : tout y est rédigé dans l'unique dessein de soulever la sensibilité du spectateur, de provoquer l'horreur la plus insoutenable et le plus grand choc, au moyen d'injustices exacerbées jusqu'au comble de l'ignominie. Toute sa structure, en somme, n'est qu'un prétexte à accumuler et à exposer des scènes monstrueuses, quitte à multiplier les invraisemblances et les outrances les plus éhontées. Voici comment :
Titus revient de campagne militaire contre les Goths dont il a capturé la reine Tamora et son serviteur et amant Aaron, un Maure. À Rome, il est encensé pour sa bravoure exemplaire, nombre de ses fils étant morts au combat, on le réclame empereur à l'heure où Saturninus et Bassanius se disputent cet honneur. Titus décline l'invitation mais intronise Saturninus, alors que les fils de Tamora, enlevés avec elle, sont condamnés à mort. Dès lors, tout ira mal pour Titus, toutes les puissances étant mécontentes de lui : ses fils seront décapités ou bannis, sa fille sera violée et privée de mains et de langue, lui-même se tranchera un membre, et bien d'autres méfaits et crimes, tous ayant lieu sur scène, émailleront joyeusement la pièce en prodigieux flots de sang peut-être réjouissants, selon la tournure plus ou moins conventionnelle de votre esprit.
Mais tout ceci, il faut bien le reconnaître, littérairement n'a que peu d'intérêt : l'intrigue est une pure surenchère d'artifice, les motifs psychologiques sont réduits à des stéréotypes, on n'y croit guère et il faut n'y trouver que le plaisir un peu cruel d'un défoulement, à la manière contemporaine d'un cinéma d'épouvante à gros trucages. Peu de figures pour enjoliver même, pas de tirade ou de monologues empourprés pour y donner quelque contenance noble, point d'originalités vraiment surprenantes, un dénouement où l'on achève tout le monde parce qu'il le faut bien sans souci de détails, une sorte de précipitation constante dans la composition truffée de faux suspenses évidents. Que l'expression élevée atténue cette façon de grossièreté, c'est le moins qu'on puisse espérer d'une pièce élisabéthaine, mais cette élégance classique compense mal la vacuité de l'argument de l'oeuvre et de ses enchaînements : on termine la lecture blasé de toutes ses chairs remontées à la surface et dont l'effet, sans doute, est plus manifeste de visu qu'à la lecture seule, mais on n'en retient pas grand-chose, rien en tous cas de profond, nulle éloquence par laquelle la mémoire en quête d'admiration pourrait rester impressionnée – il n'y a guère à citer dans cette pièce que des résumés de massacres. C'est une oeuvre anecdotique, en somme, une sorte de réalisation populaire avec effets spéciaux, preuve que jamais une renommée ne légitime l'absoluité inconditionnelle des compliments qu'on peut adresser à quelqu'un.
Jules César est une pièce qu'il a fallu nommer ainsi au lieu de Marcus Brutus pour ce que l'effet en est évidemment plus éclatant auprès du public et plus riche de promesses peut-être, en tous cas plus à sa disposition intellectuelle – la preuve, s'il était encore besoin, que la complaisance est de tous les siècles –, mais le personnage éponyme, qui meurt dès le deuxième acte, y tient une faible place et, étonnamment, on découvre à la place de la statue hiératique du général romain un être piètre moralement et physiquement, amateur de flatteries, aux jugements hâtifs et erronés, et si vieux qu'il tombe en pâmoison quand il est ému ou entouré par beaucoup de personnes – comme si, à en croire la peinture du dramaturge élisabéthain, la tragédie de son assassinat l'avait dignifié. Sa figure blafarde et pauvrement commune justifie relativement qu'on hésite à le tuer, d'autant qu'on ne peut savoir s'il ambitionne véritablement de se faire offrir le titre de roi de Rome et s'il approche du tyran, ce qui nuirait fort à la démocratie qu'on prétend durablement y entretenir.
Brutus, en ce contexte, résume à lui seul la plupart des consciences conjuratrices qu'on trouve éparpillées dans la littérature dramatique notamment d'après Seconde Guerre mondiale, celles de Sartre ou de Camus surtout dont j'interroge alors l'originalité : c'est un homme qui n'est hostile qu'aux personnifications de pouvoir totalitaire et qui balance longtemps, tâchant de sonder les lignes mystérieuses de sa destinée, avant de former la conspiration des assassins de César. Il est mu par une variété curieusement précoce de cet esprit plébéien, citoyen et déjà lointainement prolétaire qui redoute et essaie d'anticiper les coups d'État et les despotes, sorte de volonté ferme et préoccupée quoique sans souci politicien, et cependant il ne dispose d'aucune certitude. Il sait au surcroît que César est un homme petit dont le meurtre ne sera pas difficile ; mais il se soucie du Bien, de sa postérité, toutes choses que décidera le peuple tôt ou tard dont il redoute les réactions face au bain de sang qu'il projette, craignant son retournement, voulant à ses yeux demeurer le tribun honorable et juste au mobile légitime et vertueux ; c'est pourquoi il juge primordial de faire entendre son geste, d'en expliciter et d'en partager les motifs, refusant que l'histoire en fasse un inhumain ou un traître sanguinaire : c'est donc bien une conscience que ce Brutus un peu simple et populaire. Il sait aussi qu'Octave et Antoine affidés à César ne pardonneront pas facilement un tel attentat et pourraient vouloir poursuivre les conjurés si, dans les heures qui suivent le crime, ils parvenaient à révolter le peuple et s'il n'avait pas, lui, réussi à susciter les faveurs de Rome. Et puis, objection plus terrible encore que son incertitude : il ne hait pas César qu'il croit seulement versatile et tenté mais dont il ignore les projets véritables, il éprouve même à son égard une certaine compassion amicale, seulement il pense discerner en lui des signes d'ambition qui font réagir son sens du devoir ; c'est tout.
Cette hésitation constitue à mon avis tout l'intérêt de la pièce et supplante assez bien, je crois, tout ce qu'on fit abondamment sur le même thème dans la littérature du XXe siècle. On suit le déroulement du complot jusqu'à la mort de César, puis la façon dont le peuple malléable est persuadé en faveur du mort, jusqu'à la fuite et le suicide de Brutus poursuivi et submergé par l'armée d'Antoine ; il s'y mêle au surplus force considérations éloquentes sur la naissance et le rôle de l'individu qui trouvent une place opportune dans le cadre des religions et croyances romaines, auspices et présages : on s'interroge si les véritables acteurs de l'Histoire sont des hommes ou des dieux, s'il vaut encore la peine dans un tel contexte de mûrir des plans et une volonté personnelle, si tout n'est pas déterminé par des forces inexorables qu'on doit tâcher de rallier plutôt que de contrecarrer en vain. Ce questionnement constant sur le choix individuel constitue une porte d'accès à l'intimité pathétique de Brutus s'interrogeant et se consultant sans cesse, et dont les fréquents reculs stoïques figurent une caractéristique, je crois, du théâtre classique et notamment du théâtre shakespearien. Sa sombreur étrange, le pittoresque de ses humeurs, ses introversions contrastées à possibles rebondissements, induisent le lecteur dans autant d'immersions d'âme aux couleurs de gouffre, pesantes et enivrantes, où tout est à la fois profond par le trouble insaisissable qu'il produit et léger par le dérisoire objectif qu'elles exposent relativement à tout point de vue sur l'existence : chez Shakespeare, même l'homme qui regarde au plus loin des effets de ses actes n'oublie jamais tout à fait cet artifice qu'il est en train de se regarder regarder, de sorte que ses explorations mentales ne sont pareilles qu'aux pas discrets d'un homme à la superficie de la Terre et que son trépas qui mettrait un terme à ses visions n'est pas plus conséquent que celui des insectes qui disparaissent continuellement dans l'indifférence générale. Même César, à ce que Brutus comprend, n'a été en somme qu'une occasion de succès, qu'une coïncidence chanceuse, qu'un hasard réalisé avantageusement sans beaucoup de mérite, parce que tout dans la destinée humaine ne correspond qu'à des revers de fortune plus ou moins favorables, avec ou sans l'appui des dieux qui peuvent n'être tout aussi bien que des prétextes inventés pour se croire un appui supérieur et des vertus transcendantes. Rien chez Shakespeare, je crois, n'est absolument sérieux, le spectateur assiste à un spectacle d'hommes qui se savent eux-mêmes les premiers spectateurs de leur vie, les pires atrocités ont un caractère et une saveur de provisoire et de vanité auxquels ne manque que la mort pour tout abréger, au même titre qu'un simple rideau tombant sur une scène pour le divertissement général. Et je me demande si cette conception n'est pas au fond l'unique génie du dramaturge, son principal attribut, la recette aux cent variations d'un homme qui savait aussi bien que beaucoup d'autres assembler des répliques, car Jules César ne propose guère qu'une tonalité d'incertitude inquiète mêlée d'immense absurdité de surplomb (ce qui certes en soi n'est déjà pas mal). Eh quoi ! si Brutus accepte de tuer, ce n'est même pas un suspense – on a l'habitude, il est vrai, des tragédies historiques dont on connaît la fin, mais celle-ci ne se construit pas du tout sur une tension d'où naitrait le doute ou sur une illusion de possible « uchronie » –, sa décision du meurtre n'est guère motivée dans la pièce, on y discerne d'étonnant que des nuances de réflexion au sujet du crime, que des pensées sans génie sur des manières et fort peu sur des raisons, l'assassin n'en profite pas par exemple pour dresser quelque éloge de la république, c'est presque un attentat sans idéal tel qu'il est exposé, en revanche tout s'appuie encore sur une mécanique des actes et des effets : on ne présente pas Brutus comme nourrissant fondamentalement une cause supérieure et sacrée, il n'oeuvre pas explicitement pour l'amélioration du monde ou bien cette vision est éludée, mais il se préoccupe incessamment des contingences et des vicissitudes qui peuvent le précipiter dans le camp des victorieux ou des vaincus, il ne tâche qu'à augurer l'infime déclic par lequel il espère sentir la venue de son avenir, triomphe superbe ou abîme terrible. Toute sa contention d'esprit, sa monomanie et sa névrose est à chercher les indices de sa mort ou de son heur, tous les signes infinitésimaux qui confirmeront non la vérité et la justesse universelles de sa cause mais son opportunité circonstancielle ; son tort ou son droit semble n'avoir qu'un faible intérêt pour lui, à l'heure d'agir c'est avant tout un être qui craint la bascule de sa destinée, qui, sans pourtant tenir à la vie, redoute l'inflexion fatidique de sa geste, de son aura, de son honneur, et voilà pourquoi il ne s'agit toujours pour lui que d'augurer en une terreur innommable et sourde les prodromes de son accomplissement ou de sa déchéance : comment réagiront les conjurés ? comment réagiront Antoine et Octave ? et le peuple témoin ? et l'armée dans la bataille ? et les alliés dans la tourmente ? Mais à qui peut-on vraiment se fier pour, surtout, voir venir la fin ?
Ainsi, une fascination angoissée traverse toute cette pièce, et ce n'est pas tant au juste celle de la mort que celle d'un cheminement implacable vers la mort, que d'une anticipation de se savoir pour ainsi dire « décadent », je veux ici dire en route secrète vers le trépas, à son insu. C'est l'idée d'une vieillesse de la destinée, d'une oblitération de soi, d'une insensible débâcle, d'un abandon irrésistible et définitif qui consume Brutus au point que celui-ci semble même jouer régulièrement à hâter sa fin quelle qu'elle soit plutôt que de la laisser lui arriver d'ailleurs imprévisiblement. C'est ce qui justifie que le rythme élevé de la pièce pousse l'action vers un dénouement presque littéral, je veux dire au sens où il importe davantage de « défaire » le noeud cruellement tendu du suspense que de préparer consciencieusement les événements à suivre : c'est ainsi lorsque Brutus provoque délibérément son ami général Cassius, l'incitant presque à rompre avec lui de vexation et à trahir ses serments, ou quand il décide l'assaut de son armée au plus tôt et avec des raisons expédiées ; on croirait voir un homme lassé d'attendre sa mort qu'il devine prochaine, voilà ! ses délibérations sont toujours raccourcies sans souci de stratégie pour procéder à la libération des forces qui « compriment » : n'importe où va la flèche, il faut que la corde se repose, il faut faire, n'importe si ce faire poussera à la défaite et au gâchis, ce que résume parfaitement l'extrait suivant dont la brièveté en fait un aphorisme apparemment impromptu et faussement anecdotique :
« Brutus : Destins ! nous connaîtrons votre bon plaisir. Nous savons que nous mourrons ; ce n'est que l'époque et le nombre des jours qui tiennent les hommes en suspens.
Cassius : Aussi, celui qui soustrait vingt ans à la vie, soustrait autant d'années à la crainte de la mort.
Brutus : Reconnaissez cela et la mort est un bienfait. Ainsi nous sommes les amis de César, nous qui avons abrégé son temp de craindre la mort. »
Et en effet : comme Brutus semble vouloir accélérer le temps, sans précaution ni préparation, aux antipodes de ceux qui triomphent de lui et qui marquent la postérité ! Peu diplomate ni rusé, franchement inadaptable comme un héros romantique, plutôt que de trembler au suspense de sa fin et que d'y surseoir au moyen d'habiles combinaisons, il va provocant au-devant de la mort et, sans pour autant devenir maître de sa destinée, dilapide en frénésie l'intelligente patience qu'il lui faudrait déployer pour réussir dans ses entreprises – il y a en cela une façon de suicide en lui qui interpelle, c'est en tous cas de toute évidence un mauvais allié, un caractère lunatique en décisions quoique fiable en paroles, un désespéré, quelqu'un dont on ne voudrait pas dans son camp si l'on ambitionnait de gagner plus que par chance et par coups évidents. C'est lui en fin de compte qui, par son manque de finesse et sa confiance brute, fait échouer tous ses amis, il a la passion inaltérée mais ne détient aucun des mystères subtils permettant d'avoir sur le monde une influence déterminante, il est emporté comme une bûche épaisse par un courant froid et sinueux capable de le circonvenir, il sombre dans l'oubli des mérites et des récompenses ainsi qu'un donneur de leçons sans réflexion des moyens de sa cause.
Et je me demande, après cela, si Shakespeare n'est pas un de ces auteurs d'une seule idée retournée, resucée, recyclée en des variations de situations comme autant de prétextes plus ou moins centripètes, reposant sur la précarité de l'existence, conception selon laquelle tout homme même d'importance est un spectacle dont la fin est par trop « impatientante », tant je ne me souviens pas en général dans ces pièces – hormis cette couleur qui, logiquement après ce que j'ai montré, tend à mélanger les registres –, d'une originalité de composition, tant j'ai même souvent oublié, sitôt après les avoir lues, Hamlet, Macbeth ou le Songe d'une nuit d'été qui passent pourtant pour ses oeuvres les plus caractérisées mais auxquelles je préfère d'assez loin Beaucoup de bruit pour rien, Othello ou le Roi Lear dont il me reste au moins à l'esprit longtemps après une intrigue. On trouve parfois ne serait-ce que des astuces de construction dans Roméo et Juliette tandis que Richard III n'en laisse pas le souvenir… mais je m'aventure en conjectures peut-être regrettables et préfère ne pas affirmer davantage, car il faisait des ans que je n'avais pas lu Shakespeare (Post-scriptum : événement justement étrange et peut-être caractéristique, dans ma bibliothèque j'ai trouvé La Tempête dont l'édition est de 2018 : j'ai donc acheté récemment cette pièce et l'ai rangée comme si je l'avais lue, pourtant je suis incapable de me souvenir de son sujet – c'est peut-être une erreur, quoiqu'improbable, il faut donc que je la relise… et possiblement que je l'oublie de nouveau !). Voyons si ce Antoine et Cléopâtre confirme mon soupçon, et notamment si le thème attendu de l'amour trouvera ici un traitement inédit, sinon différent, qui justifierait la relation théâtrale de ces êtres historiques – mon hypothèse à cette heure étant que c'est encore la relativité de la vie et de sa valeur qui fera de ces amants (ou de l'un des deux) des créatures dérisoires et languides, fatalistes aux forces qui les submergent et plutôt promptes, par lâcheté de fabriquer des machines et d'attendre glisser lentement la mort vers eux, à précipiter leur trépas.
C'est plus que je n'avais prédit, mais c'est dans le même sens : il y a jusque du ridicule dans Antoine et Cléopâtre, et combien d'ampoule !
On y découvre un couple assez bassement moderne – étonnamment ignoble même et sans grandeur – où Cléopâtre incarne une mégère versatile absolument insupportable et où Antoine retient ses lamentations et ses cris à l'abord de cette beauté exaspérante à laquelle il est attaché d'idiotie, et qui a tout de la mauvaise foi acariâtre ! C'est surprenant de déchéance, la façon dont Shakespeare est parvenu à retirer de cette femme tout caractère d'envoûtement et de séduction légendaires ainsi que la manière dont le brillant général romain est avili de bonasserie insensée ; ça n'a pas du tout la saveur de la vraisemblance ; on croirait voir le couple voisin qui se dispute encore dans la rue pour une broutille ; beaucoup de babil criard et faux ; il n'est pas, je crois, de toute la pièce, une scène d'affection où les amants semblent exprimer sincèrement leur tendresse. Mais il faut encore admettre une chose qu'on m'attribuera comme un hardi sacrilège, c'est que Shakespeare n'a à peu près jamais su parler d'amour, si l'on excepte peut-être Beaucoup de bruit pour rien où une cruauté mutuelle et verbale tient lieu d'aiguillon au sentiment : mais son Roméo et Juliette est une accumulation de figures imposées, de l'exclusive rhétorique, flatteuse mais mensongère, où les amants prennent surtout plaisir à se voir aimer, aimant l'amour, dans une pose où leur égard va manifestement davantage à eux-mêmes et à leur transport qui les théâtralement exalte et valori
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Titus revient de campagne militaire contre les Goths dont il a capturé la reine Tamora et son serviteur et amant Aaron, un Maure. À Rome, il est encensé pour sa bravoure exemplaire, nombre de ses fils étant morts au combat, on le réclame empereur à l'heure où Saturninus et Bassanius se disputent cet honneur. Titus décline l'invitation mais intronise Saturninus, alors que les fils de Tamora, enlevés avec elle, sont condamnés à mort. Dès lors, tout ira mal pour Titus, toutes les puissances étant mécontentes de lui : ses fils seront décapités ou bannis, sa fille sera violée et privée de mains et de langue, lui-même se tranchera un membre, et bien d'autres méfaits et crimes, tous ayant lieu sur scène, émailleront joyeusement la pièce en prodigieux flots de sang peut-être réjouissants, selon la tournure plus ou moins conventionnelle de votre esprit.
Mais tout ceci, il faut bien le reconnaître, littérairement n'a que peu d'intérêt : l'intrigue est une pure surenchère d'artifice, les motifs psychologiques sont réduits à des stéréotypes, on n'y croit guère et il faut n'y trouver que le plaisir un peu cruel d'un défoulement, à la manière contemporaine d'un cinéma d'épouvante à gros trucages. Peu de figures pour enjoliver même, pas de tirade ou de monologues empourprés pour y donner quelque contenance noble, point d'originalités vraiment surprenantes, un dénouement où l'on achève tout le monde parce qu'il le faut bien sans souci de détails, une sorte de précipitation constante dans la composition truffée de faux suspenses évidents. Que l'expression élevée atténue cette façon de grossièreté, c'est le moins qu'on puisse espérer d'une pièce élisabéthaine, mais cette élégance classique compense mal la vacuité de l'argument de l'oeuvre et de ses enchaînements : on termine la lecture blasé de toutes ses chairs remontées à la surface et dont l'effet, sans doute, est plus manifeste de visu qu'à la lecture seule, mais on n'en retient pas grand-chose, rien en tous cas de profond, nulle éloquence par laquelle la mémoire en quête d'admiration pourrait rester impressionnée – il n'y a guère à citer dans cette pièce que des résumés de massacres. C'est une oeuvre anecdotique, en somme, une sorte de réalisation populaire avec effets spéciaux, preuve que jamais une renommée ne légitime l'absoluité inconditionnelle des compliments qu'on peut adresser à quelqu'un.
Jules César est une pièce qu'il a fallu nommer ainsi au lieu de Marcus Brutus pour ce que l'effet en est évidemment plus éclatant auprès du public et plus riche de promesses peut-être, en tous cas plus à sa disposition intellectuelle – la preuve, s'il était encore besoin, que la complaisance est de tous les siècles –, mais le personnage éponyme, qui meurt dès le deuxième acte, y tient une faible place et, étonnamment, on découvre à la place de la statue hiératique du général romain un être piètre moralement et physiquement, amateur de flatteries, aux jugements hâtifs et erronés, et si vieux qu'il tombe en pâmoison quand il est ému ou entouré par beaucoup de personnes – comme si, à en croire la peinture du dramaturge élisabéthain, la tragédie de son assassinat l'avait dignifié. Sa figure blafarde et pauvrement commune justifie relativement qu'on hésite à le tuer, d'autant qu'on ne peut savoir s'il ambitionne véritablement de se faire offrir le titre de roi de Rome et s'il approche du tyran, ce qui nuirait fort à la démocratie qu'on prétend durablement y entretenir.
Brutus, en ce contexte, résume à lui seul la plupart des consciences conjuratrices qu'on trouve éparpillées dans la littérature dramatique notamment d'après Seconde Guerre mondiale, celles de Sartre ou de Camus surtout dont j'interroge alors l'originalité : c'est un homme qui n'est hostile qu'aux personnifications de pouvoir totalitaire et qui balance longtemps, tâchant de sonder les lignes mystérieuses de sa destinée, avant de former la conspiration des assassins de César. Il est mu par une variété curieusement précoce de cet esprit plébéien, citoyen et déjà lointainement prolétaire qui redoute et essaie d'anticiper les coups d'État et les despotes, sorte de volonté ferme et préoccupée quoique sans souci politicien, et cependant il ne dispose d'aucune certitude. Il sait au surcroît que César est un homme petit dont le meurtre ne sera pas difficile ; mais il se soucie du Bien, de sa postérité, toutes choses que décidera le peuple tôt ou tard dont il redoute les réactions face au bain de sang qu'il projette, craignant son retournement, voulant à ses yeux demeurer le tribun honorable et juste au mobile légitime et vertueux ; c'est pourquoi il juge primordial de faire entendre son geste, d'en expliciter et d'en partager les motifs, refusant que l'histoire en fasse un inhumain ou un traître sanguinaire : c'est donc bien une conscience que ce Brutus un peu simple et populaire. Il sait aussi qu'Octave et Antoine affidés à César ne pardonneront pas facilement un tel attentat et pourraient vouloir poursuivre les conjurés si, dans les heures qui suivent le crime, ils parvenaient à révolter le peuple et s'il n'avait pas, lui, réussi à susciter les faveurs de Rome. Et puis, objection plus terrible encore que son incertitude : il ne hait pas César qu'il croit seulement versatile et tenté mais dont il ignore les projets véritables, il éprouve même à son égard une certaine compassion amicale, seulement il pense discerner en lui des signes d'ambition qui font réagir son sens du devoir ; c'est tout.
Cette hésitation constitue à mon avis tout l'intérêt de la pièce et supplante assez bien, je crois, tout ce qu'on fit abondamment sur le même thème dans la littérature du XXe siècle. On suit le déroulement du complot jusqu'à la mort de César, puis la façon dont le peuple malléable est persuadé en faveur du mort, jusqu'à la fuite et le suicide de Brutus poursuivi et submergé par l'armée d'Antoine ; il s'y mêle au surplus force considérations éloquentes sur la naissance et le rôle de l'individu qui trouvent une place opportune dans le cadre des religions et croyances romaines, auspices et présages : on s'interroge si les véritables acteurs de l'Histoire sont des hommes ou des dieux, s'il vaut encore la peine dans un tel contexte de mûrir des plans et une volonté personnelle, si tout n'est pas déterminé par des forces inexorables qu'on doit tâcher de rallier plutôt que de contrecarrer en vain. Ce questionnement constant sur le choix individuel constitue une porte d'accès à l'intimité pathétique de Brutus s'interrogeant et se consultant sans cesse, et dont les fréquents reculs stoïques figurent une caractéristique, je crois, du théâtre classique et notamment du théâtre shakespearien. Sa sombreur étrange, le pittoresque de ses humeurs, ses introversions contrastées à possibles rebondissements, induisent le lecteur dans autant d'immersions d'âme aux couleurs de gouffre, pesantes et enivrantes, où tout est à la fois profond par le trouble insaisissable qu'il produit et léger par le dérisoire objectif qu'elles exposent relativement à tout point de vue sur l'existence : chez Shakespeare, même l'homme qui regarde au plus loin des effets de ses actes n'oublie jamais tout à fait cet artifice qu'il est en train de se regarder regarder, de sorte que ses explorations mentales ne sont pareilles qu'aux pas discrets d'un homme à la superficie de la Terre et que son trépas qui mettrait un terme à ses visions n'est pas plus conséquent que celui des insectes qui disparaissent continuellement dans l'indifférence générale. Même César, à ce que Brutus comprend, n'a été en somme qu'une occasion de succès, qu'une coïncidence chanceuse, qu'un hasard réalisé avantageusement sans beaucoup de mérite, parce que tout dans la destinée humaine ne correspond qu'à des revers de fortune plus ou moins favorables, avec ou sans l'appui des dieux qui peuvent n'être tout aussi bien que des prétextes inventés pour se croire un appui supérieur et des vertus transcendantes. Rien chez Shakespeare, je crois, n'est absolument sérieux, le spectateur assiste à un spectacle d'hommes qui se savent eux-mêmes les premiers spectateurs de leur vie, les pires atrocités ont un caractère et une saveur de provisoire et de vanité auxquels ne manque que la mort pour tout abréger, au même titre qu'un simple rideau tombant sur une scène pour le divertissement général. Et je me demande si cette conception n'est pas au fond l'unique génie du dramaturge, son principal attribut, la recette aux cent variations d'un homme qui savait aussi bien que beaucoup d'autres assembler des répliques, car Jules César ne propose guère qu'une tonalité d'incertitude inquiète mêlée d'immense absurdité de surplomb (ce qui certes en soi n'est déjà pas mal). Eh quoi ! si Brutus accepte de tuer, ce n'est même pas un suspense – on a l'habitude, il est vrai, des tragédies historiques dont on connaît la fin, mais celle-ci ne se construit pas du tout sur une tension d'où naitrait le doute ou sur une illusion de possible « uchronie » –, sa décision du meurtre n'est guère motivée dans la pièce, on y discerne d'étonnant que des nuances de réflexion au sujet du crime, que des pensées sans génie sur des manières et fort peu sur des raisons, l'assassin n'en profite pas par exemple pour dresser quelque éloge de la république, c'est presque un attentat sans idéal tel qu'il est exposé, en revanche tout s'appuie encore sur une mécanique des actes et des effets : on ne présente pas Brutus comme nourrissant fondamentalement une cause supérieure et sacrée, il n'oeuvre pas explicitement pour l'amélioration du monde ou bien cette vision est éludée, mais il se préoccupe incessamment des contingences et des vicissitudes qui peuvent le précipiter dans le camp des victorieux ou des vaincus, il ne tâche qu'à augurer l'infime déclic par lequel il espère sentir la venue de son avenir, triomphe superbe ou abîme terrible. Toute sa contention d'esprit, sa monomanie et sa névrose est à chercher les indices de sa mort ou de son heur, tous les signes infinitésimaux qui confirmeront non la vérité et la justesse universelles de sa cause mais son opportunité circonstancielle ; son tort ou son droit semble n'avoir qu'un faible intérêt pour lui, à l'heure d'agir c'est avant tout un être qui craint la bascule de sa destinée, qui, sans pourtant tenir à la vie, redoute l'inflexion fatidique de sa geste, de son aura, de son honneur, et voilà pourquoi il ne s'agit toujours pour lui que d'augurer en une terreur innommable et sourde les prodromes de son accomplissement ou de sa déchéance : comment réagiront les conjurés ? comment réagiront Antoine et Octave ? et le peuple témoin ? et l'armée dans la bataille ? et les alliés dans la tourmente ? Mais à qui peut-on vraiment se fier pour, surtout, voir venir la fin ?
Ainsi, une fascination angoissée traverse toute cette pièce, et ce n'est pas tant au juste celle de la mort que celle d'un cheminement implacable vers la mort, que d'une anticipation de se savoir pour ainsi dire « décadent », je veux ici dire en route secrète vers le trépas, à son insu. C'est l'idée d'une vieillesse de la destinée, d'une oblitération de soi, d'une insensible débâcle, d'un abandon irrésistible et définitif qui consume Brutus au point que celui-ci semble même jouer régulièrement à hâter sa fin quelle qu'elle soit plutôt que de la laisser lui arriver d'ailleurs imprévisiblement. C'est ce qui justifie que le rythme élevé de la pièce pousse l'action vers un dénouement presque littéral, je veux dire au sens où il importe davantage de « défaire » le noeud cruellement tendu du suspense que de préparer consciencieusement les événements à suivre : c'est ainsi lorsque Brutus provoque délibérément son ami général Cassius, l'incitant presque à rompre avec lui de vexation et à trahir ses serments, ou quand il décide l'assaut de son armée au plus tôt et avec des raisons expédiées ; on croirait voir un homme lassé d'attendre sa mort qu'il devine prochaine, voilà ! ses délibérations sont toujours raccourcies sans souci de stratégie pour procéder à la libération des forces qui « compriment » : n'importe où va la flèche, il faut que la corde se repose, il faut faire, n'importe si ce faire poussera à la défaite et au gâchis, ce que résume parfaitement l'extrait suivant dont la brièveté en fait un aphorisme apparemment impromptu et faussement anecdotique :
« Brutus : Destins ! nous connaîtrons votre bon plaisir. Nous savons que nous mourrons ; ce n'est que l'époque et le nombre des jours qui tiennent les hommes en suspens.
Cassius : Aussi, celui qui soustrait vingt ans à la vie, soustrait autant d'années à la crainte de la mort.
Brutus : Reconnaissez cela et la mort est un bienfait. Ainsi nous sommes les amis de César, nous qui avons abrégé son temp de craindre la mort. »
Et en effet : comme Brutus semble vouloir accélérer le temps, sans précaution ni préparation, aux antipodes de ceux qui triomphent de lui et qui marquent la postérité ! Peu diplomate ni rusé, franchement inadaptable comme un héros romantique, plutôt que de trembler au suspense de sa fin et que d'y surseoir au moyen d'habiles combinaisons, il va provocant au-devant de la mort et, sans pour autant devenir maître de sa destinée, dilapide en frénésie l'intelligente patience qu'il lui faudrait déployer pour réussir dans ses entreprises – il y a en cela une façon de suicide en lui qui interpelle, c'est en tous cas de toute évidence un mauvais allié, un caractère lunatique en décisions quoique fiable en paroles, un désespéré, quelqu'un dont on ne voudrait pas dans son camp si l'on ambitionnait de gagner plus que par chance et par coups évidents. C'est lui en fin de compte qui, par son manque de finesse et sa confiance brute, fait échouer tous ses amis, il a la passion inaltérée mais ne détient aucun des mystères subtils permettant d'avoir sur le monde une influence déterminante, il est emporté comme une bûche épaisse par un courant froid et sinueux capable de le circonvenir, il sombre dans l'oubli des mérites et des récompenses ainsi qu'un donneur de leçons sans réflexion des moyens de sa cause.
Et je me demande, après cela, si Shakespeare n'est pas un de ces auteurs d'une seule idée retournée, resucée, recyclée en des variations de situations comme autant de prétextes plus ou moins centripètes, reposant sur la précarité de l'existence, conception selon laquelle tout homme même d'importance est un spectacle dont la fin est par trop « impatientante », tant je ne me souviens pas en général dans ces pièces – hormis cette couleur qui, logiquement après ce que j'ai montré, tend à mélanger les registres –, d'une originalité de composition, tant j'ai même souvent oublié, sitôt après les avoir lues, Hamlet, Macbeth ou le Songe d'une nuit d'été qui passent pourtant pour ses oeuvres les plus caractérisées mais auxquelles je préfère d'assez loin Beaucoup de bruit pour rien, Othello ou le Roi Lear dont il me reste au moins à l'esprit longtemps après une intrigue. On trouve parfois ne serait-ce que des astuces de construction dans Roméo et Juliette tandis que Richard III n'en laisse pas le souvenir… mais je m'aventure en conjectures peut-être regrettables et préfère ne pas affirmer davantage, car il faisait des ans que je n'avais pas lu Shakespeare (Post-scriptum : événement justement étrange et peut-être caractéristique, dans ma bibliothèque j'ai trouvé La Tempête dont l'édition est de 2018 : j'ai donc acheté récemment cette pièce et l'ai rangée comme si je l'avais lue, pourtant je suis incapable de me souvenir de son sujet – c'est peut-être une erreur, quoiqu'improbable, il faut donc que je la relise… et possiblement que je l'oublie de nouveau !). Voyons si ce Antoine et Cléopâtre confirme mon soupçon, et notamment si le thème attendu de l'amour trouvera ici un traitement inédit, sinon différent, qui justifierait la relation théâtrale de ces êtres historiques – mon hypothèse à cette heure étant que c'est encore la relativité de la vie et de sa valeur qui fera de ces amants (ou de l'un des deux) des créatures dérisoires et languides, fatalistes aux forces qui les submergent et plutôt promptes, par lâcheté de fabriquer des machines et d'attendre glisser lentement la mort vers eux, à précipiter leur trépas.
C'est plus que je n'avais prédit, mais c'est dans le même sens : il y a jusque du ridicule dans Antoine et Cléopâtre, et combien d'ampoule !
On y découvre un couple assez bassement moderne – étonnamment ignoble même et sans grandeur – où Cléopâtre incarne une mégère versatile absolument insupportable et où Antoine retient ses lamentations et ses cris à l'abord de cette beauté exaspérante à laquelle il est attaché d'idiotie, et qui a tout de la mauvaise foi acariâtre ! C'est surprenant de déchéance, la façon dont Shakespeare est parvenu à retirer de cette femme tout caractère d'envoûtement et de séduction légendaires ainsi que la manière dont le brillant général romain est avili de bonasserie insensée ; ça n'a pas du tout la saveur de la vraisemblance ; on croirait voir le couple voisin qui se dispute encore dans la rue pour une broutille ; beaucoup de babil criard et faux ; il n'est pas, je crois, de toute la pièce, une scène d'affection où les amants semblent exprimer sincèrement leur tendresse. Mais il faut encore admettre une chose qu'on m'attribuera comme un hardi sacrilège, c'est que Shakespeare n'a à peu près jamais su parler d'amour, si l'on excepte peut-être Beaucoup de bruit pour rien où une cruauté mutuelle et verbale tient lieu d'aiguillon au sentiment : mais son Roméo et Juliette est une accumulation de figures imposées, de l'exclusive rhétorique, flatteuse mais mensongère, où les amants prennent surtout plaisir à se voir aimer, aimant l'amour, dans une pose où leur égard va manifestement davantage à eux-mêmes et à leur transport qui les théâtralement exalte et valori
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Les oeuvres de Shakespeare sont unanimement reconnus comme des chefs d'oeuvres dans le répertoire mondial par leur richesse et leurs interprétations qui n'ont pas tari, et des pièces comme Roméo et Juliette, le Roi Lear, le Songe d'une nuit d'été, Othello, Macbeth, Hamlet où encore Richard III. Des pièces que tout le monde révère par leurs beautés et leurs profondeurs et qui malgré les détracteurs qu'elles ont pu trouver, ont toujours été considérées comme magnifiques, digne orfèvre du dramaturge élisabéthain. Mais pour Titus Andronicus, c'est une autre paire de manche si j'ose dire, une affaire toute autre peuchère. Cette pièce rédigée dans sa jeunesse suscite le dégout, l'écoeurement et le mépris à son encontre et fut longtemps considérée comme l'une des plus ignobles jamais écrites, rarement jouée sur la scène anglaise durant trois siècles avant d'être reconsidérée à sa juste valeur au XXeme siècle. Mais pourquoi donc a -t-elle provoquée tant de répugnance et d'effroi ? C'est ce que nous allons voir tout de suite.
Antiquité romaine, sous l'invasion des barbares. L''empereur romain vient de mourir, et on se dispute sa succession, qui est vite calmée par le retour du général notoire Titus Andronicus revenant de sa guerre contre les Goths d'où il a ramené un grand nombre de prisonnier, malgré lesquels la reine des Goth Tamora et ses fils Alarbus, Chiron et Demetrius. Pour remercier les exploits du général, on lui propose d'offrir la couronne impériale et l'un des fils du défunt auguste demande la main de sa fille Lavinia. Titus refuse l'une par humilité mais accorde volontiers le second souhait. Titus honore sa victoire en sacrifiant aux dieux Alarbus, ce qui déclenche la colère immense de Tamora qui compte se venger des romains. Elle va alors orchestrer un plan sordide avec ses fils et son amant Aaron un singulier maure bien sournois pour entraîner dans la déchéance la famille de Titus. Les conséquences en sont horribles : Lavinia est violée et mutilée par les deux fils et devient veuve en même temps, et les deux fils préférés de Titus seront accusés faussement d'un meurtre et exécutés pour cela. Titus et ses proches sont bannis de Rome et perdent tout prestige. Mais à son tour Titus compte se venger... l'engrenage machiavélique est en place alors et va s'huiler de bien de sang...
Déjà le synopsis est quelque peu terrible mais ce n'est rien comparé à ce qui se produit dans toute la pièce, et dont on peut comprendre vite pourquoi elle a été victime de rejet immédiat : toute l'intrigue baigne dans une violence épouvantable qui va jusqu'en une surenchère atroce. Les morts s'enchainent dans une sinistre hécatombe et les tortures sont légion. On assiste à des scènes abominables qui rend nauséeux l'âme la plus sensible qu'il soit : qu'on pense notamment à l'insoutenable passage qui suit après le viol où Lavinia où encore tout ce passage marqué . L'innocence est rarement respectée, presque systématiquement bafouée et les criminels profitent longuement de leur méfait avant de trouver la mort sous de laides façons. La sauvagerie a cours et plus aucune décence semble freiner les acteurs pas même le héros Titus qui verse aussi dans les noires infamies pour redorer son blason. Assurément la monstruosité est prégnante avec un Mal qui triomphe même dans la fin où presque tous ses acteurs y trépassent, ce qui explique pourquoi la pièce qui au temps de Shakespeare était très appréciée pour son coté gore (le siècle élisabéthain n'étant pas frileux sur les représentations sanglantes, entre les oeuvres de Christopher Marlowe où La Tragédie Espagnole de Thomas Kyd qui regorgent de boucheries) a par la suite donnée autant de répulsion aux spectateurs et aux bonnes moeurs, ne comprenant pas que l'auteur de ces carnages soit le même poète des tragédies historiques et des romances théâtrales délicates. le style de Shakespeare est précieux, dans sa splendeur total même dans ses jeunes ans et use de métaphores et d'allitérations vibrantes pour aborder les sujets odieux, ce qui rend paradoxalement l'horreur des situations plus frappantes. Les tirades résonnent de vieilles références mythiques et historiques toutes tournant sur la férocité des hommes et l'injuste subi par les innocents, avec le mythe d'Atrée si bien choisie (Atrée qui tua les enfants de son frère Thyeste pour les faire manger en repas en guise de vengeance) où encore de Virginius contraint d'user les pires moyens pour sauver sa fille Virginia du déshonneur général et on se révère souvent sous le dieu Saturne, dieu des plus sombres s'il en est, le tout reprenant le stoïcisme de Sénéque dont les tragédies étaient bien chargées en hécatombes et autres scènes de désespoirs ce dont s'inspire Shakespeare fin connaisseur de la culture antique.
On peut être surpris que les personnages de cette morbide pièce ne soient pour la plupart guère vertueux, ne s'offusquant pas de commettre d'immondes actes pour leur dessein personnel : Tamora la reine des Goth vicieuse jusqu'au bout des ongles, Cersei avant l'heure qui manipule les hommes pour sa revanche, Chiron et Demetrius les deux gredins aux noms tristement ironiques (Chiron le sage centaure et Demetrius un philosophe avisé et réputé calme) doué d'un sadisme élevé, Saturnius le dupé qui est assoiffé de pouvoir... et Titus, ce même valeureux général voulant punir les coupables et qu'anime une juste conviction va dégénérer en froid meurtrier sans culpabilité ressentie. Ils sont bien rares les individus doté d'un coeur pur, et ils finissent souvent immolés sur l'autel de l'indignité : pauvre Lavinia, réduite à son rang d'objet qu'on abuse allégrement, nouvelle Philomèle mythique qui ne retrouvera plus la quiétude qu'elle voulait même aprés que la vengeance soit accomplie, simplet jouet aux mains des hommes. Etonnamment, le plus humain de toute cette clique est pourtant le plus immoral, Aaron l'amant noir de Tamora. Aaron l'être sans scrupule qui n'éprouve aucune compassion pour quiconque, aussi bien de ses victimes que de ses soutiens, se révèle extraordinairement touchant et émouvant . Et c'est à lui que se termine la pièce dans des derniers vers poignant, qui concluent avec joliesse la pièce. Shakespeare réutilisera le motif du maure romanesque dans Othello mais Aaron est déjà un coup de maître, pendant maléfique d'Othello et Iago en peau d'ébène mais qui surprend par des derniers gestes d'humanité inattendues de sa part qui redonnent une lumière dans ces ténèbres, faible cependant, prouvant la valeur mal connue de ce grand antagoniste du théâtre de Shakespeare qui mérite d'être plus nommé en terme de personnalité de méchant romanesque.
Titus Andronicus est bien une pièce de jeunesse cependant et on voit bien les défauts apparents que Shakespeare corrigera à bon escient dans des pièces tardivement : tout d'abord la temporalité quasiment illogique qui est présent dans l'oeuvre (pas historique j'entend, au théâtre élisabéthain ils n'en avaient pas l'intérêt de respecter L Histoire, adaptant les époques à la leur dans les fictions) avec des événements qui surviennent sans qu'ils aient été annoncés , la plupart des personnages il faut le dire sont peu construit et apparaissent comme stupides, quand on voit les imbécilités commises par les fils de l'empereur défunt où même Titus qui la première de la pièce est obnubilé par ses valeurs guerrières oubliant la situation et sa gravité en place et le coté grotesque qu'on peut ressentir devant la cascade d'horrifiques atrocités, qui semblent parfois granguignolesques. Et ce qui rajoute encore plus à sa détestation est que cette pièce se termine sans de réelle morale où du moins sous la pieuse mais insipide maxime des méchants qui chutent toujours dans leurs crimes quoi qu'ils en pensent mais qu'on ressort avec d'amertume et nausée devant cette accumulations d'épouvantes et de saletés humains qui pleuvent.
La pièce est pendant trois siècles quasi honnie par l'avis général : le poète et critique littéraire américain T.S Eliot prix Nobel de la paix en 1948 la traite comme "une des pièces les plus stupides que l'ont ait jamais écrites" dans ses essais au début du XXeme siècle. L'accumulation de brutalité et de forfaits repoussent les érudits et les amateurs du théâtre qui peinent à croire sur le bien-fondé de cet étalage d'excès inhumains sur les maux de l'homme et qu'il soit si prompt à faire du mal à autrui. On ne peut que guère être surpris que Titus Andronicus ait retrouvé ses lettres de noblesse au milieu du XXeme siècle, la Seconde Guerre Mondiale ayant douloureusement démontrée le Mal inhérent chez les hommes avec le génocide, les camps de concentrations, les débarquements, les viols massifs et les largages de bombes atomiques. Monté en scène dans la décennie de 1950, elle est adaptée en film en 1999 avec Anthony Hopkins jouant alors Hannibal Lecter et qui se retrouve dans le rôle-titre, consacrant à jamais la pièce singulière de Shakespeare dans la mémoire collective et prouvant la modernité de cette pièce qui raconte malgré ses faiblesses et l'aspect grotesque des scènes choquantes sur l'absurdité et le désespoir du Mal que provoquent et suscitent les hommes entre eux, un Mal qui semble résolu à ne jamais quitter l'humanité et que le siècle moderne semble avoir tristement prouvé. Titus Andronicus est la pièce la plus noire de Shakespeare, qui gêne, terrifie et rend nauséeux les âmes sensibles et ceux croyant au bien inhérent de l'homme mais doit être lu et vu en scène pour admirer la formation d'un dramaturge tragique qui pointe tout juste sur les turpitudes humaines, thème tout entier chez Shakespeare. Titus Andronicus ne peut que laisser indifférent ceux qui le découvrent mais ce pénible voyage dans les noirceurs de l'homme et du cycle de vengeance est salutaire et méritant pour apprécier la poésie toute jeune d'un futur auteur génial et la part importante des désirs et vengeances qu'éprouve l'homme de toutes les époques.
Antiquité romaine, sous l'invasion des barbares. L''empereur romain vient de mourir, et on se dispute sa succession, qui est vite calmée par le retour du général notoire Titus Andronicus revenant de sa guerre contre les Goths d'où il a ramené un grand nombre de prisonnier, malgré lesquels la reine des Goth Tamora et ses fils Alarbus, Chiron et Demetrius. Pour remercier les exploits du général, on lui propose d'offrir la couronne impériale et l'un des fils du défunt auguste demande la main de sa fille Lavinia. Titus refuse l'une par humilité mais accorde volontiers le second souhait. Titus honore sa victoire en sacrifiant aux dieux Alarbus, ce qui déclenche la colère immense de Tamora qui compte se venger des romains. Elle va alors orchestrer un plan sordide avec ses fils et son amant Aaron un singulier maure bien sournois pour entraîner dans la déchéance la famille de Titus. Les conséquences en sont horribles : Lavinia est violée et mutilée par les deux fils et devient veuve en même temps, et les deux fils préférés de Titus seront accusés faussement d'un meurtre et exécutés pour cela. Titus et ses proches sont bannis de Rome et perdent tout prestige. Mais à son tour Titus compte se venger... l'engrenage machiavélique est en place alors et va s'huiler de bien de sang...
Déjà le synopsis est quelque peu terrible mais ce n'est rien comparé à ce qui se produit dans toute la pièce, et dont on peut comprendre vite pourquoi elle a été victime de rejet immédiat : toute l'intrigue baigne dans une violence épouvantable qui va jusqu'en une surenchère atroce. Les morts s'enchainent dans une sinistre hécatombe et les tortures sont légion. On assiste à des scènes abominables qui rend nauséeux l'âme la plus sensible qu'il soit : qu'on pense notamment à l'insoutenable passage qui suit après le viol où Lavinia où encore tout ce passage marqué . L'innocence est rarement respectée, presque systématiquement bafouée et les criminels profitent longuement de leur méfait avant de trouver la mort sous de laides façons. La sauvagerie a cours et plus aucune décence semble freiner les acteurs pas même le héros Titus qui verse aussi dans les noires infamies pour redorer son blason. Assurément la monstruosité est prégnante avec un Mal qui triomphe même dans la fin où presque tous ses acteurs y trépassent, ce qui explique pourquoi la pièce qui au temps de Shakespeare était très appréciée pour son coté gore (le siècle élisabéthain n'étant pas frileux sur les représentations sanglantes, entre les oeuvres de Christopher Marlowe où La Tragédie Espagnole de Thomas Kyd qui regorgent de boucheries) a par la suite donnée autant de répulsion aux spectateurs et aux bonnes moeurs, ne comprenant pas que l'auteur de ces carnages soit le même poète des tragédies historiques et des romances théâtrales délicates. le style de Shakespeare est précieux, dans sa splendeur total même dans ses jeunes ans et use de métaphores et d'allitérations vibrantes pour aborder les sujets odieux, ce qui rend paradoxalement l'horreur des situations plus frappantes. Les tirades résonnent de vieilles références mythiques et historiques toutes tournant sur la férocité des hommes et l'injuste subi par les innocents, avec le mythe d'Atrée si bien choisie (Atrée qui tua les enfants de son frère Thyeste pour les faire manger en repas en guise de vengeance) où encore de Virginius contraint d'user les pires moyens pour sauver sa fille Virginia du déshonneur général et on se révère souvent sous le dieu Saturne, dieu des plus sombres s'il en est, le tout reprenant le stoïcisme de Sénéque dont les tragédies étaient bien chargées en hécatombes et autres scènes de désespoirs ce dont s'inspire Shakespeare fin connaisseur de la culture antique.
On peut être surpris que les personnages de cette morbide pièce ne soient pour la plupart guère vertueux, ne s'offusquant pas de commettre d'immondes actes pour leur dessein personnel : Tamora la reine des Goth vicieuse jusqu'au bout des ongles, Cersei avant l'heure qui manipule les hommes pour sa revanche, Chiron et Demetrius les deux gredins aux noms tristement ironiques (Chiron le sage centaure et Demetrius un philosophe avisé et réputé calme) doué d'un sadisme élevé, Saturnius le dupé qui est assoiffé de pouvoir... et Titus, ce même valeureux général voulant punir les coupables et qu'anime une juste conviction va dégénérer en froid meurtrier sans culpabilité ressentie. Ils sont bien rares les individus doté d'un coeur pur, et ils finissent souvent immolés sur l'autel de l'indignité : pauvre Lavinia, réduite à son rang d'objet qu'on abuse allégrement, nouvelle Philomèle mythique qui ne retrouvera plus la quiétude qu'elle voulait même aprés que la vengeance soit accomplie, simplet jouet aux mains des hommes. Etonnamment, le plus humain de toute cette clique est pourtant le plus immoral, Aaron l'amant noir de Tamora. Aaron l'être sans scrupule qui n'éprouve aucune compassion pour quiconque, aussi bien de ses victimes que de ses soutiens, se révèle extraordinairement touchant et émouvant . Et c'est à lui que se termine la pièce dans des derniers vers poignant, qui concluent avec joliesse la pièce. Shakespeare réutilisera le motif du maure romanesque dans Othello mais Aaron est déjà un coup de maître, pendant maléfique d'Othello et Iago en peau d'ébène mais qui surprend par des derniers gestes d'humanité inattendues de sa part qui redonnent une lumière dans ces ténèbres, faible cependant, prouvant la valeur mal connue de ce grand antagoniste du théâtre de Shakespeare qui mérite d'être plus nommé en terme de personnalité de méchant romanesque.
Titus Andronicus est bien une pièce de jeunesse cependant et on voit bien les défauts apparents que Shakespeare corrigera à bon escient dans des pièces tardivement : tout d'abord la temporalité quasiment illogique qui est présent dans l'oeuvre (pas historique j'entend, au théâtre élisabéthain ils n'en avaient pas l'intérêt de respecter L Histoire, adaptant les époques à la leur dans les fictions) avec des événements qui surviennent sans qu'ils aient été annoncés , la plupart des personnages il faut le dire sont peu construit et apparaissent comme stupides, quand on voit les imbécilités commises par les fils de l'empereur défunt où même Titus qui la première de la pièce est obnubilé par ses valeurs guerrières oubliant la situation et sa gravité en place et le coté grotesque qu'on peut ressentir devant la cascade d'horrifiques atrocités, qui semblent parfois granguignolesques. Et ce qui rajoute encore plus à sa détestation est que cette pièce se termine sans de réelle morale où du moins sous la pieuse mais insipide maxime des méchants qui chutent toujours dans leurs crimes quoi qu'ils en pensent mais qu'on ressort avec d'amertume et nausée devant cette accumulations d'épouvantes et de saletés humains qui pleuvent.
La pièce est pendant trois siècles quasi honnie par l'avis général : le poète et critique littéraire américain T.S Eliot prix Nobel de la paix en 1948 la traite comme "une des pièces les plus stupides que l'ont ait jamais écrites" dans ses essais au début du XXeme siècle. L'accumulation de brutalité et de forfaits repoussent les érudits et les amateurs du théâtre qui peinent à croire sur le bien-fondé de cet étalage d'excès inhumains sur les maux de l'homme et qu'il soit si prompt à faire du mal à autrui. On ne peut que guère être surpris que Titus Andronicus ait retrouvé ses lettres de noblesse au milieu du XXeme siècle, la Seconde Guerre Mondiale ayant douloureusement démontrée le Mal inhérent chez les hommes avec le génocide, les camps de concentrations, les débarquements, les viols massifs et les largages de bombes atomiques. Monté en scène dans la décennie de 1950, elle est adaptée en film en 1999 avec Anthony Hopkins jouant alors Hannibal Lecter et qui se retrouve dans le rôle-titre, consacrant à jamais la pièce singulière de Shakespeare dans la mémoire collective et prouvant la modernité de cette pièce qui raconte malgré ses faiblesses et l'aspect grotesque des scènes choquantes sur l'absurdité et le désespoir du Mal que provoquent et suscitent les hommes entre eux, un Mal qui semble résolu à ne jamais quitter l'humanité et que le siècle moderne semble avoir tristement prouvé. Titus Andronicus est la pièce la plus noire de Shakespeare, qui gêne, terrifie et rend nauséeux les âmes sensibles et ceux croyant au bien inhérent de l'homme mais doit être lu et vu en scène pour admirer la formation d'un dramaturge tragique qui pointe tout juste sur les turpitudes humaines, thème tout entier chez Shakespeare. Titus Andronicus ne peut que laisser indifférent ceux qui le découvrent mais ce pénible voyage dans les noirceurs de l'homme et du cycle de vengeance est salutaire et méritant pour apprécier la poésie toute jeune d'un futur auteur génial et la part importante des désirs et vengeances qu'éprouve l'homme de toutes les époques.
Au crépuscule de sa carrière militaire, Titus Andronicus loyal et courageux général romain, va connaître en quelques jours plus de turpitudes et d'horreurs qu'il n'en aura jamais rencontrer dans toute une vie sur les champs de bataille. Rare sont les personnages dans cette pièce à être épargnés par l'appel du vice. Ce que Shakespeare nous apprend ici, c'est que tout le monde devient une fois arrivé à l'âge adulte, soit une proie innocente et piégée par la folie des hommes, soit un tortionnaire aveugle sans foi ni loi. A ce titre il n'est pas surprenant de retrouver dans la première catégorie les jeunes, les enfants, voir les bébés, et dans la seconde, tous les autres à l'exception du grand homme Lucius, futur empereur et seul personnage vertueux de la pièce. Son ennemi,le fascinant Aaron, est d'une noirceur glaçante, d'une noirceur plus essentielle encore que la couleur de sa peau. Il est sans aucune chance de rémission et il va resté dans sa méchanceté métabolique, inlassablement jusqu'à la fin de l'histoire.
Ce fameux poète et dramaturge anglais que je découvre littéralement dans cette pièce terrifiante surement pas la plus facile, doit avoir plusieurs hôtes dans son corps et dans sa tête pour faire ça. Son imagination pousse tellement loin dans l'horreur tragique que cela en devient presque gênant. La scène où la perfide Tamora dévore ses propres enfants lors d'un repas manigancé par Titus, lui ayant pris soin de les broyés préalablement et réduit en pâte pour les consommer plus facilement, est atterrante. Lorsque l'on regarde le chemin parcouru depuis le XVI° siècle, on ne peut que consentir à l'importance de la prémonition de cet homme.
Ce fameux poète et dramaturge anglais que je découvre littéralement dans cette pièce terrifiante surement pas la plus facile, doit avoir plusieurs hôtes dans son corps et dans sa tête pour faire ça. Son imagination pousse tellement loin dans l'horreur tragique que cela en devient presque gênant. La scène où la perfide Tamora dévore ses propres enfants lors d'un repas manigancé par Titus, lui ayant pris soin de les broyés préalablement et réduit en pâte pour les consommer plus facilement, est atterrante. Lorsque l'on regarde le chemin parcouru depuis le XVI° siècle, on ne peut que consentir à l'importance de la prémonition de cet homme.
Avis chrono'
Mon premier article sur Shakespeare... avec un texte qui ne lui ressemble pas! Quel dommage! Univers et personnages déroutants dans cette pièce sanglante et assez abominable... Quelques passages néanmoins sont de véritables chef-d'oeuvre de cynisme.
_________________________
Je vais tenter un résumé succinct mais je ne promets rien, il y a tellement de personnages!
Titus est un général romain. Il rentre avec une captive, Tamora, dont il sacrifie un fils pour faire plaisir aux Dieux. Ce qui plaît beaucoup moins à la mère, en revanche... laquelle va passer toute la pièce à se venger à l'aide de ses autres fils qu'on nommera C. et D. pour plus de commodité.
Titus a lui aussi des enfants (dont une bonne vingtaine sont morts glorieusement à la guerre! Génial non?) il lui en reste quand même quatre ou cinq au début de la pièce... et beaucoup moins à la fin (il les tue lui-même, souvent, pour gagner du temps).
C'est une tragédie, que voulez-vous...
Il a, dans le lot, une fille Lavinia qui doit épouser l'empereur, puis finalement, non, celui-ci préfère épouser Tamora, qui elle, a un amant, Aaron, un gars pas gentil du tout... Extrait de sa morale personnelle. Lisez (oui! tout!), ça vaut le coup d'oeil:
« ... et même en ce moment je maudis le jour où je n'aie fait quelque grand mal, comme de massacrer un homme ou de machiner sa mort, de violer une vierge ou d'imaginer le moyen d'y arriver, d'accuser quelque innocent ou de me parjurer moi-même, de semer une haine mortelle entre deux amis, de faire rompre le cou aux bestiaux des pauvres gens, d'incendier les granges et les meules de foin dans la nuit, et de dire aux propriétaires d'éteindre l'incendie avec leurs larmes: souvent j'ai exhumé les morts de leurs tombeaux, et j'ai placé leurs cadavres à la porte de leurs meilleurs amis lorsque leur douleur était presque oubliée, et sur leur peau, comme sur l'écorce d'un arbre, j'ai gravé avec mon couteau en lettres romaines: Que votre douleur ne meure pas quoique je sois mort. En un mot, j'ai fait mille choses horribles avec l'indifférence qu'un autre met à tuer une mouche; et rien ne me fait vraiment de la peine que la pensée de ne plus pouvoir en commettre dix mille autres. »
Lavinia va être violée, sur le cadavre de son mari, par C. et D. qui vont lui couper les mains et la langue aussi. Je vous laisse découvrir seuls les autres joyeusetés dont la pièce est semée : parricides et infanticides, assassinats nombreux et viols, accusations mensongères... et un peu de cannibalisme sur la fin.
On en prend plein la gueule, une fois qu'on a réussi à s'y retrouver dans les personnages en -us: mucius, mutius, lucius (x2!), quintus, titus, démétrius, publius et j'en passe bien d'autres...
Il n'y a que Lavinia que j'aie identifiée tout de suite!
L'ensemble est convaincant. Pas du tout une mauvaise pièce, d'ailleurs, elle se bonifie avec le temps. Ma lecture date de deux semaines (je n'ai QUE trois billets en retard!) et j'ai l'impression que chaque jour j'aime un peu plus ce texte. Faut dire que depuis j'en ai raconté l'histoire trois fois en détail, la familiarité aide à l'apprécier.
Mais ce qui m'a gênée, c'est vraiment l'écriture. (en espérant que ça ne soit pas dû à la traduction, j'ai lu le texte sur internet et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver). Rien là dedans ne me rappelait Shakespeare. Il faut que je me plonge dans les pièces qui me restent à lire, comme Macbeth... Et que j'en relise d'autres... On peut rêver (de trouver le temps...).
Je signale tout de même deux passages d'anthologie! Des perles...
La scène qui suit celle du viol est à mes yeux une merveille. Mais je préviens tout de même, une merveille de sadisme! Les deux violeurs "raccompagnent" leur victime et en profitent pour faire des... comment dire ça... des plaisanteries... (disons même des blagues à deux balles) sur ses mutilations...
C'est ignoble mais divinement écrit! D'une irrévérence hallucinante...
Et le second passage, c'est une citation que j'ai relevée parce qu'elle m'a fait rire (et ça marche encore). Vous allez être déçu, il m'en faut peu!
Titus apprend de la bouche du diabolique Aaron la mort de son frère...
« - Mon frère mort? Tu ne parles pas sérieusement; son épouse et lui sont vers le nord de la forêt, au rendez-vous de cette agréable chasse; il n'y a pas encore une heure que je l'y ai laissé. »
- Nous ne savons pas où vous l'avez laissé vivant, mais, hélas! nous l'avons trouvé mort ici. »
J'en ai encore fait une tartine!! Je crois que ça mérite un changement de catégorie, je le mets dans les urgences!
Je conclus: c'est diabolique, infâme, barbare et grandiose!
Lien : http://talememore.hautetfort..
Mon premier article sur Shakespeare... avec un texte qui ne lui ressemble pas! Quel dommage! Univers et personnages déroutants dans cette pièce sanglante et assez abominable... Quelques passages néanmoins sont de véritables chef-d'oeuvre de cynisme.
_________________________
Je vais tenter un résumé succinct mais je ne promets rien, il y a tellement de personnages!
Titus est un général romain. Il rentre avec une captive, Tamora, dont il sacrifie un fils pour faire plaisir aux Dieux. Ce qui plaît beaucoup moins à la mère, en revanche... laquelle va passer toute la pièce à se venger à l'aide de ses autres fils qu'on nommera C. et D. pour plus de commodité.
Titus a lui aussi des enfants (dont une bonne vingtaine sont morts glorieusement à la guerre! Génial non?) il lui en reste quand même quatre ou cinq au début de la pièce... et beaucoup moins à la fin (il les tue lui-même, souvent, pour gagner du temps).
C'est une tragédie, que voulez-vous...
Il a, dans le lot, une fille Lavinia qui doit épouser l'empereur, puis finalement, non, celui-ci préfère épouser Tamora, qui elle, a un amant, Aaron, un gars pas gentil du tout... Extrait de sa morale personnelle. Lisez (oui! tout!), ça vaut le coup d'oeil:
« ... et même en ce moment je maudis le jour où je n'aie fait quelque grand mal, comme de massacrer un homme ou de machiner sa mort, de violer une vierge ou d'imaginer le moyen d'y arriver, d'accuser quelque innocent ou de me parjurer moi-même, de semer une haine mortelle entre deux amis, de faire rompre le cou aux bestiaux des pauvres gens, d'incendier les granges et les meules de foin dans la nuit, et de dire aux propriétaires d'éteindre l'incendie avec leurs larmes: souvent j'ai exhumé les morts de leurs tombeaux, et j'ai placé leurs cadavres à la porte de leurs meilleurs amis lorsque leur douleur était presque oubliée, et sur leur peau, comme sur l'écorce d'un arbre, j'ai gravé avec mon couteau en lettres romaines: Que votre douleur ne meure pas quoique je sois mort. En un mot, j'ai fait mille choses horribles avec l'indifférence qu'un autre met à tuer une mouche; et rien ne me fait vraiment de la peine que la pensée de ne plus pouvoir en commettre dix mille autres. »
Lavinia va être violée, sur le cadavre de son mari, par C. et D. qui vont lui couper les mains et la langue aussi. Je vous laisse découvrir seuls les autres joyeusetés dont la pièce est semée : parricides et infanticides, assassinats nombreux et viols, accusations mensongères... et un peu de cannibalisme sur la fin.
On en prend plein la gueule, une fois qu'on a réussi à s'y retrouver dans les personnages en -us: mucius, mutius, lucius (x2!), quintus, titus, démétrius, publius et j'en passe bien d'autres...
Il n'y a que Lavinia que j'aie identifiée tout de suite!
L'ensemble est convaincant. Pas du tout une mauvaise pièce, d'ailleurs, elle se bonifie avec le temps. Ma lecture date de deux semaines (je n'ai QUE trois billets en retard!) et j'ai l'impression que chaque jour j'aime un peu plus ce texte. Faut dire que depuis j'en ai raconté l'histoire trois fois en détail, la familiarité aide à l'apprécier.
Mais ce qui m'a gênée, c'est vraiment l'écriture. (en espérant que ça ne soit pas dû à la traduction, j'ai lu le texte sur internet et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver). Rien là dedans ne me rappelait Shakespeare. Il faut que je me plonge dans les pièces qui me restent à lire, comme Macbeth... Et que j'en relise d'autres... On peut rêver (de trouver le temps...).
Je signale tout de même deux passages d'anthologie! Des perles...
La scène qui suit celle du viol est à mes yeux une merveille. Mais je préviens tout de même, une merveille de sadisme! Les deux violeurs "raccompagnent" leur victime et en profitent pour faire des... comment dire ça... des plaisanteries... (disons même des blagues à deux balles) sur ses mutilations...
C'est ignoble mais divinement écrit! D'une irrévérence hallucinante...
Et le second passage, c'est une citation que j'ai relevée parce qu'elle m'a fait rire (et ça marche encore). Vous allez être déçu, il m'en faut peu!
Titus apprend de la bouche du diabolique Aaron la mort de son frère...
« - Mon frère mort? Tu ne parles pas sérieusement; son épouse et lui sont vers le nord de la forêt, au rendez-vous de cette agréable chasse; il n'y a pas encore une heure que je l'y ai laissé. »
- Nous ne savons pas où vous l'avez laissé vivant, mais, hélas! nous l'avons trouvé mort ici. »
J'en ai encore fait une tartine!! Je crois que ça mérite un changement de catégorie, je le mets dans les urgences!
Je conclus: c'est diabolique, infâme, barbare et grandiose!
Lien : http://talememore.hautetfort..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de William Shakespeare (250)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Roméo et Juliette
"Roméo et Juliette" est une comédie.
Vrai
Faux
10 questions
1992 lecteurs ont répondu
Thème : Roméo et Juliette de
William ShakespeareCréer un quiz sur ce livre1992 lecteurs ont répondu