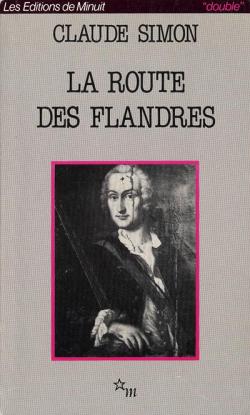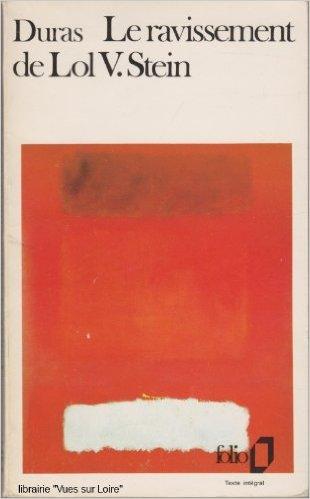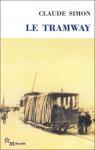Claude Simon
Lucien Dällenbach (Autre)/5 245 notes
Lucien Dällenbach (Autre)/5 245 notes
Résumé :
"Les peintres ont bien de la chance. Il suffit au passant d'un instant pour prendre conscience des différents éléments d'une toile." Claude Simon choisit donc pour "cadre", aussi limité que celui d'un tableau, quelques heures d'une nuit après la guerre, au cours de laquelle les époques et les événements se confondent dans la mémoire du cavalier Georges : "Le désastre de mai 1940, la mort de son capitaine à la tête d'un escadron de dragons, son temps de captivité, le... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La Route des FlandresVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (22)
Voir plus
Ajouter une critique
Une critique récente d'Henri l'Oiseleur avait attiré mon attention sur Claude Simon. Qu'il en soit remercié. J'avais eu le tort de passer à côté de Claude Simon. Comme - presque - tout le monde.
J'ai dévoré La route des Flandres sur deux après-midi. C'est probablement une bonne solution. Cette lecture plutôt ardue demande de l'attention mais elle devient nettement plus facile quand on s'immerge: une tension, un suspens, un hypnose s'installe. Une lecture plus fragmentée de ces trois longs chapitres qui se présentent à jet continu risque de perdre et de lasser. Avec La route des Flandres on goûte aux joies de l'apnée. Cela vous fait peur? Vous rebute? C'est assez naturel. Mais passons les préjugés. Déchirons les habitudes. Allons voir de l'autre côté de la montagne.
S'immerger dans quoi? Dans la fièvre. le chaos de la fièvre. L'esprit à sauts et à gambades. La fièvre qui abolit les distances et le temps. La fièvre qui replie les dimensions. La fièvre.
Tout cela est servi par un style déconcertant, syntaxiquement éclaté, une narration kaléidoscopique et attentive à la sensation (une touffe d'herbe au pied d'un mur au premier plan sera bien mieux décrite qu'une sentinelle allemande entraperçue furtivement.) Pour cet ouvrage de 1960 j'ai oui dire que c'était alors la période formaliste et Nouveau Roman de Claude Simon. Je sens déjà le lecteur potentiel engager la procédure de secours, la main sur la poignée d'éjection. C'est normal. Mais attendez. La forme est omniprésente (il y a tellement de travail que le travail ne se voit pas), mais elle est efficace et emportera celui qui acceptera de se laisser glisser. Je ne décris pas plus cette forme. Voyez éventuellement quelques citations. Mais en gardant à l'esprit que ce roman est probablement à peu près incitable, dès lors que - s'éloignant radicalement des critères du bon goût ordinaire (sujet, verbe, complément, une situation, des personnages, un temps un lieu, une action) - il se présente comme un écheveau narratif qui pourrait presque faire passer Proust pour Gérard de Villiers et Jacques le fataliste pour un rapport circonstancié de gendarmerie. La mer toujours recommencée: rouleaux, lames, vagues, vaguelettes, toujours au moins clapot.
Notons également que si dans cette histoire de fièvre il y a du drame, du sexe, mais aussi de l'humour (une fois le récit bien lancé). Un vrai humour de roman avec une gourmandise pour la narration et même les racontars.
Se laisser glisser dans quelle histoire exactement? C'est en gros l'histoire de jeunes hommes, à cheval, perdus dans la débâcle de mai ou plutôt juin 1940, puis prisonniers en Saxe, puis perdus dans les méandres de leur mémoire individuelle et familiale. C'est surtout l'exploration des mille et une manières d'être cocu. Cocu réel ou cocu métaphorique. Éventuellement cocu par atavisme aristocratique.
Rendus à ce point il faut sans doute convenir que ce roman est assez masculin dans le sens où il comporte (sans être une autofiction à trois sous) une part non négligeable d'éléments autobiographiques, dont la captivité en Allemagne, et porte les traces des rêveries, frustrations et phantasmes d'un homme né en 1913. Ce roman n'est donc pas un manifeste de l'égalité femmes-hommes qui revisite les études de genre. Ce n'est pas non plus un plaidoyer nostalgique de la société ancienne. Mais très ordinairement la fièvre du personnage principal lui renvoit devant les yeux une liliale princesse. du lait.
Roman de la mémoire et de la sensation. La route des Flandres peut sembler un roman très confus. La confusion est même dans les références et les allusions plus ou moins discrètes. La Liberté guidant le peuple: 1830? 1789? 2020? le paon: animal d'Héra ou de Léda? Mais ce n'est pas réellement de la confusion, jamais. C'est la marque de la folle ambition d'embrasser toute l'épaisseur de la réalité. En ce sens il y a lieu de croire que l'ensemble est très maîtrisé dans un récit tendu, mais pas dans un espace euclidien.
Bref La route des Flandres est une nourriture riche. Ce roman est à la fois très maîtrisé et en même temps une bonne partie des interprétations possibles échappent certainement à l'intention de l'auteur qui a dessiné pour le lecteur cet espace fictif et dégagé de morale. Si j'ai bien compris la règle du jeu romanesque, formulée en particulier par Kundera, c'est ce à quoi on doit pouvoir distinguer un chef-d'oeuvre.
Restent en ce qui me concerne deux questions :
- Pourquoi autant d'utilisations de l'adjectif "grumeleux"?
- Que veut dire, en 1960, l'utilisation de ce que je croyais être un simple smiley issu de la culture SMS: " :) "? ( deux points suivis d'une parenthèse de fermeture).
J'ai dévoré La route des Flandres sur deux après-midi. C'est probablement une bonne solution. Cette lecture plutôt ardue demande de l'attention mais elle devient nettement plus facile quand on s'immerge: une tension, un suspens, un hypnose s'installe. Une lecture plus fragmentée de ces trois longs chapitres qui se présentent à jet continu risque de perdre et de lasser. Avec La route des Flandres on goûte aux joies de l'apnée. Cela vous fait peur? Vous rebute? C'est assez naturel. Mais passons les préjugés. Déchirons les habitudes. Allons voir de l'autre côté de la montagne.
S'immerger dans quoi? Dans la fièvre. le chaos de la fièvre. L'esprit à sauts et à gambades. La fièvre qui abolit les distances et le temps. La fièvre qui replie les dimensions. La fièvre.
Tout cela est servi par un style déconcertant, syntaxiquement éclaté, une narration kaléidoscopique et attentive à la sensation (une touffe d'herbe au pied d'un mur au premier plan sera bien mieux décrite qu'une sentinelle allemande entraperçue furtivement.) Pour cet ouvrage de 1960 j'ai oui dire que c'était alors la période formaliste et Nouveau Roman de Claude Simon. Je sens déjà le lecteur potentiel engager la procédure de secours, la main sur la poignée d'éjection. C'est normal. Mais attendez. La forme est omniprésente (il y a tellement de travail que le travail ne se voit pas), mais elle est efficace et emportera celui qui acceptera de se laisser glisser. Je ne décris pas plus cette forme. Voyez éventuellement quelques citations. Mais en gardant à l'esprit que ce roman est probablement à peu près incitable, dès lors que - s'éloignant radicalement des critères du bon goût ordinaire (sujet, verbe, complément, une situation, des personnages, un temps un lieu, une action) - il se présente comme un écheveau narratif qui pourrait presque faire passer Proust pour Gérard de Villiers et Jacques le fataliste pour un rapport circonstancié de gendarmerie. La mer toujours recommencée: rouleaux, lames, vagues, vaguelettes, toujours au moins clapot.
Notons également que si dans cette histoire de fièvre il y a du drame, du sexe, mais aussi de l'humour (une fois le récit bien lancé). Un vrai humour de roman avec une gourmandise pour la narration et même les racontars.
Se laisser glisser dans quelle histoire exactement? C'est en gros l'histoire de jeunes hommes, à cheval, perdus dans la débâcle de mai ou plutôt juin 1940, puis prisonniers en Saxe, puis perdus dans les méandres de leur mémoire individuelle et familiale. C'est surtout l'exploration des mille et une manières d'être cocu. Cocu réel ou cocu métaphorique. Éventuellement cocu par atavisme aristocratique.
Rendus à ce point il faut sans doute convenir que ce roman est assez masculin dans le sens où il comporte (sans être une autofiction à trois sous) une part non négligeable d'éléments autobiographiques, dont la captivité en Allemagne, et porte les traces des rêveries, frustrations et phantasmes d'un homme né en 1913. Ce roman n'est donc pas un manifeste de l'égalité femmes-hommes qui revisite les études de genre. Ce n'est pas non plus un plaidoyer nostalgique de la société ancienne. Mais très ordinairement la fièvre du personnage principal lui renvoit devant les yeux une liliale princesse. du lait.
Roman de la mémoire et de la sensation. La route des Flandres peut sembler un roman très confus. La confusion est même dans les références et les allusions plus ou moins discrètes. La Liberté guidant le peuple: 1830? 1789? 2020? le paon: animal d'Héra ou de Léda? Mais ce n'est pas réellement de la confusion, jamais. C'est la marque de la folle ambition d'embrasser toute l'épaisseur de la réalité. En ce sens il y a lieu de croire que l'ensemble est très maîtrisé dans un récit tendu, mais pas dans un espace euclidien.
Bref La route des Flandres est une nourriture riche. Ce roman est à la fois très maîtrisé et en même temps une bonne partie des interprétations possibles échappent certainement à l'intention de l'auteur qui a dessiné pour le lecteur cet espace fictif et dégagé de morale. Si j'ai bien compris la règle du jeu romanesque, formulée en particulier par Kundera, c'est ce à quoi on doit pouvoir distinguer un chef-d'oeuvre.
Restent en ce qui me concerne deux questions :
- Pourquoi autant d'utilisations de l'adjectif "grumeleux"?
- Que veut dire, en 1960, l'utilisation de ce que je croyais être un simple smiley issu de la culture SMS: " :) "? ( deux points suivis d'une parenthèse de fermeture).
Claude Simon est un écrivain emblématique des Editions de Minuit, une figure de proue du Nouveau Roman, le roman expérimental des années 1950 à 1970, avec Beckett, Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, Robert Pinget, Michel Butor ou Marguerite Duras. A roman expérimental, nouvelle expérience de lecture, donc : si vous pouvez lire d'un trait 289 pages écrites presque sans pause, ni rupture, ni respiration, vous devriez aimer La Route des Flandres, publié en 1960. Mais n'est pas un lecteur de Claude Simon qui veut...
De quoi s'agit-il ? le protocole exige pourtant que je vous apporte les réponses, au lieu de vous poser des questions, mais voilà : si je l'ai bien lu jusqu'au bout, je suis bien en peine de vous le résumer. Heureusement, la 4e de couverture peut suppléer à mes déficiences : « le capitaine de Reixach [prononcer Reichac], abattu en mai 40 par un parachutiste allemand, a-t-il délibérément cherché cette mort ? Un de ses cousins. Georges, simple cavalier dans le même régiment, cherche à découvrir la vérité. Aidé de Blum, prisonnier dans le même camp, il interroge leur compagnon Iglésia qui fut jadis jockey de l'écurie Reixach. Après la guerre, il finit par retrouver Corinne, la jeune veuve du capitaine... »
L'auteur s'est orienté vers un long monologue intérieur qui cherche à reproduire les mécanismes de la mémoire (le « foisonnant et rigoureux désordre de la mémoire », disait Simon). La narration doit figurer le flux anarchique de nos pensées, ces images cérébrales qui nous animent. Elle se compose par collages, par associations d'idées, brossant un tableau confus où les époques et les évènements s'entrecroisent, s'entremêlent, se superposent et finissent par se confondre. On retrouve aussi ses influences majeures : ses lectures de Joyce et Faulkner, et l'impact de ses propres oeuvres de peintre dans son écriture faite de juxtapositions, ajouts, interpositions et superpositions. Comme un fleuve sans digues, la plume coule sur le papier, déversant souvenirs et émotions. C'est un peu comme dans la vie : un va-et-vient incessant, des flash-back constants, rien n'est donné définitivement au lecteur qui doit rester attentif et rechercher des points de repère. le procédé cherche pour ainsi dire à tutoyer l'essence même de l'homme : Je pense, donc je suis. Et Je suis ce que je pense.
A roman expérimental, nouvelle expérience de lecture : j'ai donc expérimenté le roman expérimental. Cette lecture fut tellement heurtée que je ne peux pas dire que j'ai aimé l'expérience. Mon attention s'est égarée cent fois et les incessantes interruptions dues aux contingences de la vie quotidienne compliquaient encore les choses : par où reprendre la lecture de ce récit sans début, ni fin ? Où cette histoire nous conduit-elle ? Il m'a bien fallu une centaine de pages de persévérance pour m'accoutumer un tant soit peu et entrer dans cette innovante sarabande langagière.
J'avoue quand même être impressionné, et même admiratif, devant une telle richesse de vocabulaire, devant un tel sommet de technicité littéraire et d'ingénierie stylistique où le temps s'efface sous la plume de l'auteur. Mais je n'ai pas eu de réel plaisir de lecture et n'ai guère réussi à me passionner pour cette histoire. le fond ne m'a pas plu, la forme m'a gêné: un rendez-vous manqué, hélas...
De quoi s'agit-il ? le protocole exige pourtant que je vous apporte les réponses, au lieu de vous poser des questions, mais voilà : si je l'ai bien lu jusqu'au bout, je suis bien en peine de vous le résumer. Heureusement, la 4e de couverture peut suppléer à mes déficiences : « le capitaine de Reixach [prononcer Reichac], abattu en mai 40 par un parachutiste allemand, a-t-il délibérément cherché cette mort ? Un de ses cousins. Georges, simple cavalier dans le même régiment, cherche à découvrir la vérité. Aidé de Blum, prisonnier dans le même camp, il interroge leur compagnon Iglésia qui fut jadis jockey de l'écurie Reixach. Après la guerre, il finit par retrouver Corinne, la jeune veuve du capitaine... »
L'auteur s'est orienté vers un long monologue intérieur qui cherche à reproduire les mécanismes de la mémoire (le « foisonnant et rigoureux désordre de la mémoire », disait Simon). La narration doit figurer le flux anarchique de nos pensées, ces images cérébrales qui nous animent. Elle se compose par collages, par associations d'idées, brossant un tableau confus où les époques et les évènements s'entrecroisent, s'entremêlent, se superposent et finissent par se confondre. On retrouve aussi ses influences majeures : ses lectures de Joyce et Faulkner, et l'impact de ses propres oeuvres de peintre dans son écriture faite de juxtapositions, ajouts, interpositions et superpositions. Comme un fleuve sans digues, la plume coule sur le papier, déversant souvenirs et émotions. C'est un peu comme dans la vie : un va-et-vient incessant, des flash-back constants, rien n'est donné définitivement au lecteur qui doit rester attentif et rechercher des points de repère. le procédé cherche pour ainsi dire à tutoyer l'essence même de l'homme : Je pense, donc je suis. Et Je suis ce que je pense.
A roman expérimental, nouvelle expérience de lecture : j'ai donc expérimenté le roman expérimental. Cette lecture fut tellement heurtée que je ne peux pas dire que j'ai aimé l'expérience. Mon attention s'est égarée cent fois et les incessantes interruptions dues aux contingences de la vie quotidienne compliquaient encore les choses : par où reprendre la lecture de ce récit sans début, ni fin ? Où cette histoire nous conduit-elle ? Il m'a bien fallu une centaine de pages de persévérance pour m'accoutumer un tant soit peu et entrer dans cette innovante sarabande langagière.
J'avoue quand même être impressionné, et même admiratif, devant une telle richesse de vocabulaire, devant un tel sommet de technicité littéraire et d'ingénierie stylistique où le temps s'efface sous la plume de l'auteur. Mais je n'ai pas eu de réel plaisir de lecture et n'ai guère réussi à me passionner pour cette histoire. le fond ne m'a pas plu, la forme m'a gêné: un rendez-vous manqué, hélas...
La Route des Flandres est un admirable et foisonnant roman de guerre, qui a intimidé les lecteurs français à cause des relations de l'auteur avec le mouvement théoricien du Nouveau Roman. L'ouvrage a été inscrit au programme de l'agrégation de lettres, ce qui a suscité une masse d'études critiques s'ajoutant à toute la science linguistique du mouvement néo-romanesque.
*
Pourtant Claude Simon n'écrit pas son livre à partir de théories savantes, ni ne met vraiment ses pas dans ceux de Robbe-Grillet, Sarraute, Ricardou ou Butor. Il puise dans son expérience personnelle d'ancien combattant de la guerre de 40, de la débâcle et de la captivité. Certes, le récit qu'il en fait n'est pas simple à lire, car il s'efforce de créer une forme romanesque adéquate à l'expérience qu'il a vécue. Autrement dit, il fuit les généralités, les idées toutes faites, les grands discours, pour lesquels son personnage, Georges, n'a que mépris (voir les passages hilarants contre Rousseau). Et de même, il tente de restituer l'expérience sensorielle de la guerre, fatigue, ivresse, captivité, danger, et aussi odeurs, sons et couleurs, qui prennent le dessus dans le récit et en chassent les pensées rationnelles et verbales. Aussi le monde est-il perçu par la chair et le sang, non pas conçu par l'esprit ou le "coeur". La mauvaise littérature se contente de nommer paresseusement les choses et se consacre aux clichés et aux sentiments. Quand Claude Simon décrit un talus herbeux tel que le voit un soldat couché au sol, un visage, un cheval mort, un mur de briques, la présence sensorielle des choses est extrêmement puissante.
*
Ce choix littéraire de la présence du monde n'aurait pas été possible sans une critique radicale des grands discours traditionnels. Ce qui la rend possible, c'est la guerre et la débâcle, qui donnent au narrateur et peut-être à l'auteur une impression de fin d'un monde, voire de fin du monde. Les "quatre cavaliers" sur les routes de Flandres, évoquent bien ceux de l'Apocalypse. Certaines métaphores de la nuit donnent à la guerre la dimension d'une catastrophe cosmique. Pourtant, les personnages, pendant leur captivité dans un Stalag allemand, s'efforcent de passer le temps en reconstruisant par la mémoire, les récits, les discussions, des événements du passé familial de Georges, des courses de chevaux, le suicide de plusieurs officiers, des histoires d'adultères démultipliées. Les hommes ne peuvent se passer de la magie du langage, qui les console ou les distrait dans cet univers menacé de sombrer dans le néant. On osera dire que ces prisonniers bavards du Stalag ressemblent un peu aux lecteurs que nous sommes, et aussi, qui sait ? à cette "humanité dans les chaînes" qu'imaginait Pascal dans les Pensées, se divertissant comme elle peut en attendant la mort. On a beaucoup évoqué Faulkner, celui d'Absalon Absalon, pour ce roman. On pourrait aussi penser au Malraux de L'Espoir et de la Condition Humaine, du moins dans ses tableaux de guerre, à condition d'en ignorer les bavardages idéologiques.
*
J'ajouterai pour finir que je n'ai jamais rien lu d'aussi beau sur les chevaux et les cavaliers.
*
Pourtant Claude Simon n'écrit pas son livre à partir de théories savantes, ni ne met vraiment ses pas dans ceux de Robbe-Grillet, Sarraute, Ricardou ou Butor. Il puise dans son expérience personnelle d'ancien combattant de la guerre de 40, de la débâcle et de la captivité. Certes, le récit qu'il en fait n'est pas simple à lire, car il s'efforce de créer une forme romanesque adéquate à l'expérience qu'il a vécue. Autrement dit, il fuit les généralités, les idées toutes faites, les grands discours, pour lesquels son personnage, Georges, n'a que mépris (voir les passages hilarants contre Rousseau). Et de même, il tente de restituer l'expérience sensorielle de la guerre, fatigue, ivresse, captivité, danger, et aussi odeurs, sons et couleurs, qui prennent le dessus dans le récit et en chassent les pensées rationnelles et verbales. Aussi le monde est-il perçu par la chair et le sang, non pas conçu par l'esprit ou le "coeur". La mauvaise littérature se contente de nommer paresseusement les choses et se consacre aux clichés et aux sentiments. Quand Claude Simon décrit un talus herbeux tel que le voit un soldat couché au sol, un visage, un cheval mort, un mur de briques, la présence sensorielle des choses est extrêmement puissante.
*
Ce choix littéraire de la présence du monde n'aurait pas été possible sans une critique radicale des grands discours traditionnels. Ce qui la rend possible, c'est la guerre et la débâcle, qui donnent au narrateur et peut-être à l'auteur une impression de fin d'un monde, voire de fin du monde. Les "quatre cavaliers" sur les routes de Flandres, évoquent bien ceux de l'Apocalypse. Certaines métaphores de la nuit donnent à la guerre la dimension d'une catastrophe cosmique. Pourtant, les personnages, pendant leur captivité dans un Stalag allemand, s'efforcent de passer le temps en reconstruisant par la mémoire, les récits, les discussions, des événements du passé familial de Georges, des courses de chevaux, le suicide de plusieurs officiers, des histoires d'adultères démultipliées. Les hommes ne peuvent se passer de la magie du langage, qui les console ou les distrait dans cet univers menacé de sombrer dans le néant. On osera dire que ces prisonniers bavards du Stalag ressemblent un peu aux lecteurs que nous sommes, et aussi, qui sait ? à cette "humanité dans les chaînes" qu'imaginait Pascal dans les Pensées, se divertissant comme elle peut en attendant la mort. On a beaucoup évoqué Faulkner, celui d'Absalon Absalon, pour ce roman. On pourrait aussi penser au Malraux de L'Espoir et de la Condition Humaine, du moins dans ses tableaux de guerre, à condition d'en ignorer les bavardages idéologiques.
*
J'ajouterai pour finir que je n'ai jamais rien lu d'aussi beau sur les chevaux et les cavaliers.
Comme toute l'oeuvre de Claude Simon, « La Route des Flandres » s'écrit dans l'après-guerreS –les deux guerres mondiales, la guerre d'Espagne, les guerres de l'Empire et de la Révolution-, c'est-à-dire dans ce moment d'une coïncidence traumatisante et aliénante de la mémoire de soi et de la mémoire historique : pour la génération née en 1910, l'histoire individuelle et l'Histoire se confondent, alors qu'elle se découvre non seulement promise à mourir en 1940 mais aussi à voir mourir en elle une deuxième fois ses pères tués en 14-18.
Confrontée à la monstruosité d'une apocalypse sans cesse réitérée, l'humanité voit alors s'anéantir sa foi dans le progrès tandis que se trouvent dénoncées la vanité des constructions humaines en même temps que l'inutilité de la littérature. Et pourtant, face à la débâcle, subsiste la pulsion d'une parole conjuratrice ; mise en tension avec la terrible certitude de la vacuité de l'entreprise, cette pulsion rythme l'ensemble des dialogues, toujours au bord de la rupture ; la voix humaine en effet est la dernière possibilité de résistance, comme « un enfant siffle en traversant un bois dans le noir » : « deux voix faussement assurées, faussement sarcastiques, se haussant, se forçant, comme s'ils cherchaient à s'accrocher à elles espéraient grâce à elles conjurer cette espèce de sortilège, de liquéfaction, de débâcle, de désastre aveugle » (121)…
Et donc, pour survivre, il faut parler ; mais parler à qui ? A la putain de «L'Acacia» ? Au journaliste du «Jardin des Plantes» ? A Corinne ? « En tous cas pas à [elle] » (p.90) « La Route des Flandres » se heurte sans cesse à cette interrogation, au problème de la réception du discours. Cette indécision est aussi celle du lecteur, placé face à une énonciation infixable, labile et subversive, détruisant sans cesse les fragiles certitudes que l'on croyait acquises, soumise au surgissement anarchique des souvenirs ; perdu, malmené, asphyxié, happé par les flux du temps et de la mémoire, ce lecteur devient alors le double du narrateur et accède à l'expérience même qui lui est racontée.
Une lecture difficile mais indispensable et inoubliable ; une oeuvre magistrale.
Confrontée à la monstruosité d'une apocalypse sans cesse réitérée, l'humanité voit alors s'anéantir sa foi dans le progrès tandis que se trouvent dénoncées la vanité des constructions humaines en même temps que l'inutilité de la littérature. Et pourtant, face à la débâcle, subsiste la pulsion d'une parole conjuratrice ; mise en tension avec la terrible certitude de la vacuité de l'entreprise, cette pulsion rythme l'ensemble des dialogues, toujours au bord de la rupture ; la voix humaine en effet est la dernière possibilité de résistance, comme « un enfant siffle en traversant un bois dans le noir » : « deux voix faussement assurées, faussement sarcastiques, se haussant, se forçant, comme s'ils cherchaient à s'accrocher à elles espéraient grâce à elles conjurer cette espèce de sortilège, de liquéfaction, de débâcle, de désastre aveugle » (121)…
Et donc, pour survivre, il faut parler ; mais parler à qui ? A la putain de «L'Acacia» ? Au journaliste du «Jardin des Plantes» ? A Corinne ? « En tous cas pas à [elle] » (p.90) « La Route des Flandres » se heurte sans cesse à cette interrogation, au problème de la réception du discours. Cette indécision est aussi celle du lecteur, placé face à une énonciation infixable, labile et subversive, détruisant sans cesse les fragiles certitudes que l'on croyait acquises, soumise au surgissement anarchique des souvenirs ; perdu, malmené, asphyxié, happé par les flux du temps et de la mémoire, ce lecteur devient alors le double du narrateur et accède à l'expérience même qui lui est racontée.
Une lecture difficile mais indispensable et inoubliable ; une oeuvre magistrale.
Etrange comme tout s'efface... Les souvenirs anciens, les rêves et le passé récent... Ceci est le deuxième commentaire sur La route des Flandres. J'y écrirai la même chose et autre chose que dans le premier, disparu à jamais dans les profondeurs de mon ordinateur. J'y retrouverai la longueur haletante, sans répis, assommante et fascinante de la phrase simonienne (l'impression qu'il n'y a (je veux dire "qu'il n'existe") qu'une seule prase, sans commencement, sans fin, toute pleine du monde passé, présent, à venir, à songer). Je retrouverai les temps indécis des histoires racontés par on ne sait pas toujours qui à un autre ou à lui-même, le cheval mort, le jockey qui chevauche Corinne, quatre rosses égarées dans la boue d'une guerre qui n'en est même plus une, une débâcle à laquelle on s'habitue, dont on ne sait pas si elle est plus vraie que le suicide de l'ancêtre, sur le tableau, héroïque ou cocu, jockey ou chevalier. Je me reposerai les mêmes questions : qu'est-ce qui tient en haleine ? J'évoquerai encore un Proust qui échoue, un temps spacialisé en un no man's land. Je ne saurai toujours pas l'impact de ce livre, avalanche de mots, d'images horribles ou charnelles (horribles et charnelles, plutôt), tableau flou (ou fou) d'un monde qui en est plusieurs et aucun, et comme Georges (ou Blum, ou de Reixach), je serai perdu au milieu d'un monde peut-être même pas absurde.
Citations et extraits (38)
Voir plus
Ajouter une citation
Et son père parlant toujours, comme pour lui-même, parlant de ce comment s'appelait-il philosophe qui a dit que l'homme ne connaissait que deux moyens de s'approprier ce qui appartient aux autres, la guerre et le commerce, et qu'il choisissait en général tout d'abord le premier parce qu'il lui paraissait le plus facile et le plus rapide et ensuite, mais seulement après avoir découvert les inconvénients et les dangers du premier, le second, c'est-à-dire le commerce qui était un moyen non loin déloyal et brutal mais plus confortable, et qu'au demeurant tous les peuples étaient obligatoirement passés par ces deux phases et avaient chacun à son tour mis l'Europe à feu et à sang avant de se transformer en sociétés anonymes de commis voyageurs comme les Anglais mais que guerre et commerce n'étaient jamais l'un comme l'autre que l'expression de leur rapacité et cette rapacité elle-même la conséquence de l'ancestrale terreur de la faim et de la mort, ce qui faisait que tuer voler piller et vendre n'étaient en réalité qu'une seule et même chose un simple besoin celui de se rassurer, comme les gamins qui sifflent ou chantent fort pour se donner du courage en traversant une forêt la nuit, ce qui expliquait pourquoi le chant en choeur faisait partie au même titre que le maniement d'armes ou les exercices de tir du programme d'instruction des troupes parce que rien n'est pire que le silence quand,...
(…) le bruit des bottes en train de monter quatre à quatre l’escalier (…) et elle – la virginale Agnès – debout, poussant par les épaules l’amant – le cocher, la palefrenier, le rustre ahuri – vers l’inévitable et providentiel placard ou cabinet des vaudevilles et des tragédies qui se trouve à chaque fois là à point nommé comme ces énigmatiques boîtes des farces et attrapes dont l’ouverture pourra provoquer tout à l’heure aussi bien une explosion de rire qu’un frisson d’horreur parce que le vaudeville n’est jamais que de la tragédie avortée et la tragédie une farce sans humour, les mains (toujours le corps, les muscles, pas le cerveau qui à ce moment se dégage à peine de la poisseuse brume du sommeil, les mains donc seules, voyant) ramassant au passage les pièces d’habit masculin éparpillées çà et là qu’elles jettent pêle-mêle aussi dans le placard, le bruit des bottes ayant cessé, se tenant (les bottes, ou plutôt l’absence, l’arrêt soudain et alarmant du bruit) immédiatement derrière la porte, la poignée secouée en tous sens, puis le poing frappant, et elle criant : « Voilà ! », refermant le placard, s’éloignant, se dirigeant vers la porte, apercevant encore alors un gilet, ou un soulier d’homme, le ramassant, criant de nouveau à l’adresse de la porte : « Voilà ! », tandis qu’elle revient en courant au placard, le rouvre, lance sauvagement à l’intérieur, sans regarder, ce qu’elle vient de ramasser, le panneau de la porte résonnant maintenant sous les terribles coups d’épaules (la porte que tu as entendue voler en éclats sous les furieux assauts d’un homme – mais ce n’était pas le valet !) puis elle, là, puérile, innocente, désarmante, se frottant les yeux, souriant, lui tendant les bras, lui expliquant qu’elle s’enferme à clef par crainte des voleurs tandis qu’elle se presse contre lui, l’enlace, l’enveloppe, la chemise glissant comme par hasard sur son épaule, dénudant ses seins dont elle presse, froisse des tendres bouts meurtris sur la tunique poussiéreuse qu’elle commence déjà à dégrafer de ses mains fébriles, lui parlant maintenant bouche à bouche pour qu’il ne puisse voir ses lèvres gonflées sous les baisers d’un autre, et lui se tenant là, dans ce désarroi, ce désespoir : défait, désorienté, désarçonné, dépossédé de tout et peut-être déjà détaché, et peut-être déjà à demi détruit…
... travaillant pendant les mois d'hiver à décharger des wagons de charbon, maniant les larges fourches, se relevant lorsque la sentinelle s'éloignait, minables et grotesques silhouettes, avec leur calot rabattu sur leurs oreilles, le col de leur capote relevé, tournant le dos au vent de pluie ou de neige et soufflant dans leurs doigts tandis qu'ils essayaient de se transporter par procuration (c'est-à-dire au moyen de leur imagination, c'est-à-dire en rassemblant et combinant tout ce qu'ils pouvaient trouver dans leur mémoire en fait de connaissances vues, entendues ou lues, de façon - là, au milieu des rails mouillés et luisants, des wagons noirs, des pins détrempés et noirs, dans la froide et blafarde journée d'un hiver saxon - à faire surgir les images chatoyantes et lumineuses au moyen de l'éphémère, l'incantatoire magie du langage, des mots inventés dans l'espoir de rendre comestible - comme ces pâtes vaguement sucrées sous lesquelles on dissimule aux enfants les médicaments amers - l'innommable réalité) dans cet univers futile, mystérieux et violent dans lequel, à défaut de leur corps, se mouvait leur esprit : quelque chose peut-être sans plus de réalité qu'un songe, que les paroles sorties de leurs lèvres : des sons, du bruit pour conjurer le froid, les rails, le ciel livide, les sombres pins :) ...
Pléiade p. 230.
Pléiade p. 230.
Et Blum : "Et alors ..." (mais cette fois Iglésia n'était plus là : tout l'été ils le passèrent une pioche (ou, quand ils avaient de la chance, une pelle) en main à des travaux de terrassement puis au début de l'automne ils furent envoyés dans une ferme arracher les pommes de terre et les betteraves, puis Georges essaya de s'évader, fut repris (par hasard, et non par des soldats ou des gendarmes envoyés à sa recherche mais - c'était un dimanche matin - dans un bois où il avait dormi, par de paisibles chasseurs), puis il fut ramené au camp et mis en cellule, puis Blum se fit porter malade et rentra lui aussi au camp, et ils y restèrent tous les deux, travaillant pendant les mois d'hiver à décharger des wagons de charbon, maniant les larges fourches, se relevant lorsque la sentinelle s'éloignait, minables et grotesques silhouettes, avec leurs calots rabattus sur leurs oreilles, le col de leurs capotes relevé, tournant le dos au vent de pluie ou de neige et soufflant dans leurs doigts tandis qu'ils essayaient de se transporter par procuration c'est-à-dire au moyen de leur imagination, c'est-à-dire en rassemblant et combinant tout ce qu'ils pouvaient trouver dans leur mémoire en fait de connaissances vues, entendues ou lues, de façon-là, au milieu des rails mouillés et luisants, des wagons noirs, des pins détrempés et noirs, dans la froide et blafarde journée d'un hiver saxon - à faire surgir les images chatoyantes et lumineuses au moyen de l'éphémère, l'incantatoire magie du langage, des mots inventés dans l'espoir de rendre comestible - comme ces pâtes vaguement sucrées sous lesquelles on dissimule aux enfants les médicaments amers - l'innommable réalité dans cet univers futile, mystérieux et violent dans lequel, à défaut de leur corps, se mouvaient leur esprit: quelque chose peut-être sans plus de réalité qu'un songe, que les paroles sorties de leurs lèvres: des sons, du bruit pour conjurer le froid, les rails, le ciel livide, les sombres pins".
Il me semblait de nouveau que cela n’aurait pas ne pouvait pas avoir de fin mes mains posées, appuyées sur ses hanches écartant je pouvais le voir brun fauve dans la nuit et sa bouche faisant Aaah aaaaaaaah m’enfonçant tout entier dans cette mousse ces mauves pétales j’étais un chien je galopais à quatre pattes dans les fourrés exactement comme une bête comme seule une bête pouvait le faire insensible à la fatigue à mes mains déchirées j’étais cet âne de la légende grecque raidi comme un âne idole d’or enfoncée dans sa délicate et tendre chair un membre d’âne je pouvais le voir allant et venant luisant oint de ce qui ruisselait d’elle je me penchai glissai ma main mon bras serpent sous son ventre atteignant le nid la toison bouclée que mon doigt démêlait jusqu’à ce que je le trouve rose mouillé comme la langue d’un petit chien frétillant jappant de plaisir sous laquelle l’arbre sortant de moi était enfoncé sa gorge étouffée gémissant maintenant régulièrement à chaque élan de mes reins combien l’avaient combien d’hommes emmanchée seulement je n’étais plus un homme mais un animal un chien plus qu’un homme une bête si je pouvais y atteindre connaître l’âne d’Apulée poussant sans trêve en elle fondant maintenant ouverte comme un fruit une pêche jusqu’à ce que ma nuque éclate le bourgeon éclatant tout au fond d’elle l’inondant encore et encore l’inondant, inondant sa blancheur jaillissant l’inondant, inondant sa blancheur jaillissant l’inondant, pourpre, la noire fontaine n’en finissant plus de jaillir le cri jaillissant sans fin de sa bouche jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien sourds tous les deux tombés inanimés sur le côté mes bras l’enserrant toujours...
Videos de Claude Simon (42)
Voir plusAjouter une vidéo
Avec Marc Graciano, Maylis de Kerangal, Christine Montalbetti & Martin Rueff
Table ronde animée par Alastair Duncan
Projection du film d'Alain Fleischer
Claude Simon, prix Nobel de Littérature 1985, est plus que jamais présent dans la littérature d'aujourd'hui. Ses thèmes – la sensation, la nature, la mémoire, l'Histoire… – et sa manière profondément originale d'écrire « à base de vécu » rencontrent les préoccupations de nombreux écrivains contemporains.
L'Association des lecteurs de Claude Simon, en partenariat avec la Maison de la Poésie, fête ses vingt ans d'existence en invitant quatre d'entre eux, Marc Graciano, Maylis de Kerangal, Christine Montalbetti et Martin Rueff, à échanger autour de cette grande oeuvre. La table ronde sera suivie de la projection du film d'Alain Fleischer Claude Simon, l'inépuisable chaos du monde.
« Je ne connais pour ma part d'autres sentiers de la création que ceux ouverts pas à pas, c'est à dire mot après mot, par le cheminement même de l'écriture. » Claude Simon, Orion aveugle
À lire – L'oeuvre de Claude Simon est publiée aux éditions de Minuit et dans la collection « La Pléiade », Gallimard. Claude Simon, l'inépuisable chaos du monde (colloques du centenaire), sous la direction de Dominique Viart, Presses Universitaires du Septentrion, 2024.
Claude Simon, prix Nobel de Littérature 1985, est plus que jamais présent dans la littérature d'aujourd'hui. Ses thèmes – la sensation, la nature, la mémoire, l'Histoire… – et sa manière profondément originale d'écrire « à base de vécu » rencontrent les préoccupations de nombreux écrivains contemporains.
L'Association des lecteurs de Claude Simon, en partenariat avec la Maison de la Poésie, fête ses vingt ans d'existence en invitant quatre d'entre eux, Marc Graciano, Maylis de Kerangal, Christine Montalbetti et Martin Rueff, à échanger autour de cette grande oeuvre. La table ronde sera suivie de la projection du film d'Alain Fleischer Claude Simon, l'inépuisable chaos du monde.
« Je ne connais pour ma part d'autres sentiers de la création que ceux ouverts pas à pas, c'est à dire mot après mot, par le cheminement même de l'écriture. » Claude Simon, Orion aveugle
À lire – L'oeuvre de Claude Simon est publiée aux éditions de Minuit et dans la collection « La Pléiade », Gallimard. Claude Simon, l'inépuisable chaos du monde (colloques du centenaire), sous la direction de Dominique Viart, Presses Universitaires du Septentrion, 2024.
+ Lire la suite
autres livres classés : nouveau romanVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Claude Simon (34)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Claude Simon
Quel prix littéraire Claude Simon a-t-il reçu en 1985 ?
Prix Nobel de littérature
Prix Goncourt
Prix Femina
Prix Victor-Rossel
10 questions
18 lecteurs ont répondu
Thème :
Claude SimonCréer un quiz sur ce livre18 lecteurs ont répondu