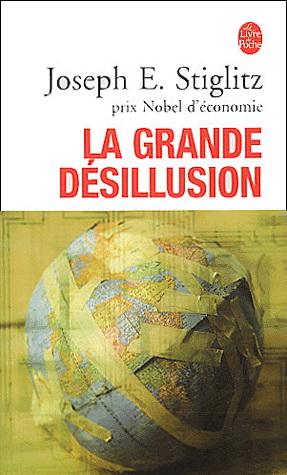Paru en 2010 sous le titre original "Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy". Cette traduction française, parue chez l'excellent éditeur Les Liens qui Libèrent, se fit remarquer par son titre, "Le triomphe de la cupidité", assurément bien plus évocateur que l'original et dont on parla même dans le monde anglo-saxon.
Cet ouvrage, d'un accès facile, devrait être lu par tous ceux qui souhaitent finalement comprendre la genèse de la dernière grande crise des années 2007-2008, dont nous ne nous sommes toujours pas relevés aujourd'hui. L'ordre économique mondial que nous avons connu depuis la grande crise des années 30, sorti renforcé de la seconde guerre mondiale, était fondé sur une politique dite "keynésienne", fondant un Etat-Providence voyant ce dernier s'investir activement, par une politique dite de la demande, dans le pilotage de l'économie. Bien sûr les années 30 avaient enseigné qu'une internationalisation trop poussée de l'économie entraînait des catastrophes et, en tout cas, une instabilité chronique de l'économie mondiale. Par conséquent le monde d'après-guerre était un monde cloisonné, fondé sur des barrières protectionnistes et sur un contrôle serré de la circulation des capitaux. L'auteur montre qu'entre la seconde guerre mondiale et le courant des années 80 cet ordre économique produisit des marchés financiers stables, même si peu dynamiques, l'économie étant financée, à l'exception très notable des USA, par des banques elles-mêmes étroitement surveillées (séparation de la banque commerciale et de la banque d'affaires) et limitées dans leur expansion. Au niveau des grandes sociétés commerciales l'on croyait ferme en une politique dite "managériale" où la rémunération des dirigeants dépendait de facteurs de performance d'ordre essentiellement non financier (rendement, expansion du chiffre d'affaires...). Bien sûr on pouvait reprocher à ces politiques leur caractère relativement peu dynamique, l'encadrement étatique et le cloisonnement des marchés incitant les géants locaux à vivre sur leurs lauriers dans une certaine léthargie, se sachant protégés d'OPA hostiles lancées par des investisseurs étrangers.
On sait que le changement fut initié par une école qui s'organisa au cours des années 70 en tant que grande rivale de la politique keynésienne, alors affublée du parfum suranné de "politique de papa". Cette politque, accusée d'être trop socialiste - un vocable qui sent le soufre aux Etats unis - et de n'être plus adaptée à l'époque moderne, les économistes de cette époque croyant fermement avoir développé des outils permettant de ne plus reproduire les erreurs des aînés. Stiglitz révèle ainsi que peu avant la crise les économistes relevant de la nouvelle orthodoxie avaient développé des modèles selon lesquels une crise de l'ampleur de celle-ci n'avait de chance de se produire que... tous les 2000 ans. Cette nouvelle orthodoxie, qui n'est en fait qu'une resucée de la théorie économique dite "classique" (Adam Smith et sa fameuse "main invisible") et donc baptisée "néo-classique" fut bâtie par la fameuse école de Chicago. Fondée sur le postulat de l'interférence négative de toute intervention de l'Etat dans une économie de marché qui, laissée à elle-même, s'adapterait naturellement et harmonieusement aux besoins, le "marché", érigé en sorte de divinité tutélaire, se chargeant d'opérer les adaptations nécessaires et parfaitement efficientes. Cette théorie avait à vrai dire non seulement l'avantage d'une relative nouveauté, du fait de la rupture radicale par rapport aux politiques issues des années 30, mais aussi celui d'une apparente simplicité face à la technicité d'obédiences keynésiennes pas toujours compréhensibles du commun. Le regain du libéralisme sous sa forme "néo" fut à vrai dire favorisé par une série de chocs, dont le choc pétrolier et aussi, accessoirement par la formation de blocs régionaux, dont l'Union européenne (d'abord CEE, communauté économique européenne) également fondés un postulat de libéralisme (même si la future UE limitait au départ la liberté de circulation des capitaux à peau de chagrin, son paradigme de départ étant plutôt l'ordolibéralisme - préservant l'intervention de l'Etat - que le néo-libéralisme). On sait que l'expérimentation du remède néo-libéral fut menée avec des résultats pourtant pas très probants, par certains régimes dictatoriaux latino américains (souvent installés avec la complicité active des USA) et dans d'autres régions du monde traversant des chocs, comme l'Afrique du Sud post apartheid et les pays de l'ancien bloc de l'est. En Europe les choses s'accélèrent avec l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne (alors CEE) au cours des années 70. Le Royaume-Uni partageait avec les USA un marché financier d'importance mondiale et n'eut donc de cesse, par un lobbying incessant, de favoriser la libération des capitaux et de libéraliser les législations dépendant de l'UE, comme celles relatives aux sociétés commerciales. Le relais politique fut assuré par les règnes concomitants de Ronald Reagan, aux USA, et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Les barrières érigées à l'encontre de la circulation des capitaux furent donc progressivement levées au plan mondial - du moins au sein des économies dites occidentales - et la séparation entre la banque commerciale et la banque d'affaires fut également en grande partie supprimée. Les banques et les sociétés multinationales connurent une croissance exponentielle, les banques devenant, selon l'expression consacrée, "too big to fail", d'autant plus que le président Roosevelt, répondant à la crise des années 30 qui avait vu les petits épargnants perdre leurs avoirs en banque, avait instauré la garantie des dépôts par l'Etat. Roosevelt avait d'ailleurs hésité à le faire, pressentant ce qui allait se passer ensuite, les banques, assurées que quoiqu'elles fassent c'est l'Etat et donc le contribuable qui passerait à la caisse, se lançant dans des spéculations financières de plus en plus risquées.
Quant à la genèse de la dernière "grande" crise, celle de 2007-2008, ce fut paradoxalement un gouvernement démocrate qui fut à son origine, l'administration Clinton imposant aux banques d'assister financièrement des ménages pauvres traditionnellement exclus de l'accès à la propriété immobilière. Le nouveau credo de libéralisme n'autorisait évidemment pas l'Etat à contrôler la manière dont cela se ferait et les banques, faisant oeuvre d'un cynisme parfaitement assumé, développèrent la fameuse technique dite des "subprime". En très bref les banques instaurèrent des plans de remboursement d'emprunts apparaissant accessibles au départ mais qui étaient appelés à se durcir ensuite, les banques sachant que leurs emprunteurs feraient nécessairement défaut ce qui leur permettrait de mettre la main sur leur biens immobiliers hypothéqués qu'elles pourraient revendre à profit, le marché immobilier connaissant alors un boom dont on pensait qu'il durerait alors de nombreuses années encore. Evidemment le grain de sable dans la machine fut la crise du marché immobilier vers la moitié de la première décade des années 2000. Cette crise se serait, dans "l'ancien monde", limitée aux USA si les marchés de capitaux ne s'étaient internationalisés, les banques américaines ayant eu recours à la technique de titrisation pour découper en tranches de risques les fameux prêts subprime et ayant par la suite inondé le monde occidental de ces produits réputés peu risqués. Bien entendu l'effondrement du château de cartes aux USA produisit un effet de contagion qui se répandit partout où ces produits financiers avaient été répandus. On ajoute à cela les risques de plus en plus inconsidérés pris par les banques dans leurs activités de trading et un changement de paradigme au niveau des grands entreprises, dont la gestion est désormais rémunérée en fonction de facteurs essentiellement financiers, encourageant la prise de risques, et l'on obtient les ingrédients de cette fameuse crise "in a nutshell", comme diraient les étasuniens.
Stiglitz, même s'il fut couronné du prix Nobel d'économie en 2001, est apparu, depuis la montée en puissance de l'école de Chicago à la fin des années 70, sous les traits d'un franc-tireur, d'abord comme une sorte de nostalgique prêchant dans le désert, son obédience keynésienne étant toujours demeurée claire, et ensuite, crise(s) aidant, comme celui qui avait annoncé "tout ça". Ses orientations politiques, du moins économique, sont claires et donc forcément amènent à le lire avec un certain grain de sel. D'aucuns lui ont d'ailleurs reproché de ne pas avoir suffisamment mis en évidence le lien entre entre le déclenchement de la crise des subprime et la politique sociale imposée par le gouvernement Clinton. A cela évidemment Stiglitz répond que si le gouvernement Clinton n'entoura pas l'action des banques de davantage de contrôles ce fut précisément parce qu'il en fut empêché par le nouveau credo libéral alors en vogue...
On ne saurait donc se limiter à la lecture du seul Stiglitz. Néanmoins on ne saurait que conseiller la lecture de cet ouvrage passionnant à toute personne souhaitant s'initier aux grandes problématiques économiques de notre temps, lesquelles, on s'en rend compte chaque jour davantage, ont une répercussion indéniable sur l'évolution voire le maintien de régimes démocratiques...
Cet ouvrage, d'un accès facile, devrait être lu par tous ceux qui souhaitent finalement comprendre la genèse de la dernière grande crise des années 2007-2008, dont nous ne nous sommes toujours pas relevés aujourd'hui. L'ordre économique mondial que nous avons connu depuis la grande crise des années 30, sorti renforcé de la seconde guerre mondiale, était fondé sur une politique dite "keynésienne", fondant un Etat-Providence voyant ce dernier s'investir activement, par une politique dite de la demande, dans le pilotage de l'économie. Bien sûr les années 30 avaient enseigné qu'une internationalisation trop poussée de l'économie entraînait des catastrophes et, en tout cas, une instabilité chronique de l'économie mondiale. Par conséquent le monde d'après-guerre était un monde cloisonné, fondé sur des barrières protectionnistes et sur un contrôle serré de la circulation des capitaux. L'auteur montre qu'entre la seconde guerre mondiale et le courant des années 80 cet ordre économique produisit des marchés financiers stables, même si peu dynamiques, l'économie étant financée, à l'exception très notable des USA, par des banques elles-mêmes étroitement surveillées (séparation de la banque commerciale et de la banque d'affaires) et limitées dans leur expansion. Au niveau des grandes sociétés commerciales l'on croyait ferme en une politique dite "managériale" où la rémunération des dirigeants dépendait de facteurs de performance d'ordre essentiellement non financier (rendement, expansion du chiffre d'affaires...). Bien sûr on pouvait reprocher à ces politiques leur caractère relativement peu dynamique, l'encadrement étatique et le cloisonnement des marchés incitant les géants locaux à vivre sur leurs lauriers dans une certaine léthargie, se sachant protégés d'OPA hostiles lancées par des investisseurs étrangers.
On sait que le changement fut initié par une école qui s'organisa au cours des années 70 en tant que grande rivale de la politique keynésienne, alors affublée du parfum suranné de "politique de papa". Cette politque, accusée d'être trop socialiste - un vocable qui sent le soufre aux Etats unis - et de n'être plus adaptée à l'époque moderne, les économistes de cette époque croyant fermement avoir développé des outils permettant de ne plus reproduire les erreurs des aînés. Stiglitz révèle ainsi que peu avant la crise les économistes relevant de la nouvelle orthodoxie avaient développé des modèles selon lesquels une crise de l'ampleur de celle-ci n'avait de chance de se produire que... tous les 2000 ans. Cette nouvelle orthodoxie, qui n'est en fait qu'une resucée de la théorie économique dite "classique" (Adam Smith et sa fameuse "main invisible") et donc baptisée "néo-classique" fut bâtie par la fameuse école de Chicago. Fondée sur le postulat de l'interférence négative de toute intervention de l'Etat dans une économie de marché qui, laissée à elle-même, s'adapterait naturellement et harmonieusement aux besoins, le "marché", érigé en sorte de divinité tutélaire, se chargeant d'opérer les adaptations nécessaires et parfaitement efficientes. Cette théorie avait à vrai dire non seulement l'avantage d'une relative nouveauté, du fait de la rupture radicale par rapport aux politiques issues des années 30, mais aussi celui d'une apparente simplicité face à la technicité d'obédiences keynésiennes pas toujours compréhensibles du commun. Le regain du libéralisme sous sa forme "néo" fut à vrai dire favorisé par une série de chocs, dont le choc pétrolier et aussi, accessoirement par la formation de blocs régionaux, dont l'Union européenne (d'abord CEE, communauté économique européenne) également fondés un postulat de libéralisme (même si la future UE limitait au départ la liberté de circulation des capitaux à peau de chagrin, son paradigme de départ étant plutôt l'ordolibéralisme - préservant l'intervention de l'Etat - que le néo-libéralisme). On sait que l'expérimentation du remède néo-libéral fut menée avec des résultats pourtant pas très probants, par certains régimes dictatoriaux latino américains (souvent installés avec la complicité active des USA) et dans d'autres régions du monde traversant des chocs, comme l'Afrique du Sud post apartheid et les pays de l'ancien bloc de l'est. En Europe les choses s'accélèrent avec l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne (alors CEE) au cours des années 70. Le Royaume-Uni partageait avec les USA un marché financier d'importance mondiale et n'eut donc de cesse, par un lobbying incessant, de favoriser la libération des capitaux et de libéraliser les législations dépendant de l'UE, comme celles relatives aux sociétés commerciales. Le relais politique fut assuré par les règnes concomitants de Ronald Reagan, aux USA, et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Les barrières érigées à l'encontre de la circulation des capitaux furent donc progressivement levées au plan mondial - du moins au sein des économies dites occidentales - et la séparation entre la banque commerciale et la banque d'affaires fut également en grande partie supprimée. Les banques et les sociétés multinationales connurent une croissance exponentielle, les banques devenant, selon l'expression consacrée, "too big to fail", d'autant plus que le président Roosevelt, répondant à la crise des années 30 qui avait vu les petits épargnants perdre leurs avoirs en banque, avait instauré la garantie des dépôts par l'Etat. Roosevelt avait d'ailleurs hésité à le faire, pressentant ce qui allait se passer ensuite, les banques, assurées que quoiqu'elles fassent c'est l'Etat et donc le contribuable qui passerait à la caisse, se lançant dans des spéculations financières de plus en plus risquées.
Quant à la genèse de la dernière "grande" crise, celle de 2007-2008, ce fut paradoxalement un gouvernement démocrate qui fut à son origine, l'administration Clinton imposant aux banques d'assister financièrement des ménages pauvres traditionnellement exclus de l'accès à la propriété immobilière. Le nouveau credo de libéralisme n'autorisait évidemment pas l'Etat à contrôler la manière dont cela se ferait et les banques, faisant oeuvre d'un cynisme parfaitement assumé, développèrent la fameuse technique dite des "subprime". En très bref les banques instaurèrent des plans de remboursement d'emprunts apparaissant accessibles au départ mais qui étaient appelés à se durcir ensuite, les banques sachant que leurs emprunteurs feraient nécessairement défaut ce qui leur permettrait de mettre la main sur leur biens immobiliers hypothéqués qu'elles pourraient revendre à profit, le marché immobilier connaissant alors un boom dont on pensait qu'il durerait alors de nombreuses années encore. Evidemment le grain de sable dans la machine fut la crise du marché immobilier vers la moitié de la première décade des années 2000. Cette crise se serait, dans "l'ancien monde", limitée aux USA si les marchés de capitaux ne s'étaient internationalisés, les banques américaines ayant eu recours à la technique de titrisation pour découper en tranches de risques les fameux prêts subprime et ayant par la suite inondé le monde occidental de ces produits réputés peu risqués. Bien entendu l'effondrement du château de cartes aux USA produisit un effet de contagion qui se répandit partout où ces produits financiers avaient été répandus. On ajoute à cela les risques de plus en plus inconsidérés pris par les banques dans leurs activités de trading et un changement de paradigme au niveau des grands entreprises, dont la gestion est désormais rémunérée en fonction de facteurs essentiellement financiers, encourageant la prise de risques, et l'on obtient les ingrédients de cette fameuse crise "in a nutshell", comme diraient les étasuniens.
Stiglitz, même s'il fut couronné du prix Nobel d'économie en 2001, est apparu, depuis la montée en puissance de l'école de Chicago à la fin des années 70, sous les traits d'un franc-tireur, d'abord comme une sorte de nostalgique prêchant dans le désert, son obédience keynésienne étant toujours demeurée claire, et ensuite, crise(s) aidant, comme celui qui avait annoncé "tout ça". Ses orientations politiques, du moins économique, sont claires et donc forcément amènent à le lire avec un certain grain de sel. D'aucuns lui ont d'ailleurs reproché de ne pas avoir suffisamment mis en évidence le lien entre entre le déclenchement de la crise des subprime et la politique sociale imposée par le gouvernement Clinton. A cela évidemment Stiglitz répond que si le gouvernement Clinton n'entoura pas l'action des banques de davantage de contrôles ce fut précisément parce qu'il en fut empêché par le nouveau credo libéral alors en vogue...
On ne saurait donc se limiter à la lecture du seul Stiglitz. Néanmoins on ne saurait que conseiller la lecture de cet ouvrage passionnant à toute personne souhaitant s'initier aux grandes problématiques économiques de notre temps, lesquelles, on s'en rend compte chaque jour davantage, ont une répercussion indéniable sur l'évolution voire le maintien de régimes démocratiques...
Il est prêté à Confucius l'intention de faire procéder par le souverain, en première mesure, à la « rectification des noms » (cf. entretiens XIII 3)
Dans notre société contemporaine occidentale, Confucius aurait un immense chantier avec le vocabulaire utilisé par les économistes et les politiques.
Pour réaliser à bien cette quête, le sage pourrait irriguer sa réflexion avec ce livre de Stiglitz, « le triomphe de la cupidité », l'auteur, expert de grande renommée notamment par ses missions à la Banque Mondiale, avait déjà largement décrypté dans « La Grande Désillusion » la faillite et les risques insensés du modèle ultra libéral en 2002, bien avant la chute de Lehmann Brothers
Il y a eu la « Grande dépression » de 1929, il y a la « Grande récession » de 2008, dont on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom ainsi que ceux des faits, pratiques, responsables divers (institutions, personnes morales et physiques) liés à cette crise existentielle.
Comme dans le mythe de la caverne de Platon de « La République », un petit théâtre d'ombres est projeté sur les parois des esprits pour travestir la réalité et maintenir les pensées dans les apparences et l'obscurité.
Dans son essai, Stiglitz constate le grand écart entre ce qui devraient être les missions essentielles du système bancaire : le financement de l'économie réelle, de ses acteurs économiques, états, entreprises et particuliers, la fourniture des moyens de paiement efficaces et enfin la gestion responsable des risques de ce secteur d'activité.
Or depuis les années 90, il est apparu que les rémunérations des établissements financiers, pour ces missions traditionnelles ne satisfaisaient plus les appétits de ces professionnels, tout au moins de ceux possédés par la fièvre de la richesse. En revanche, les rémunérations des transactions des nouveaux produits financiers spéculatifs garantissaient des niveaux beaucoup plus substantiels et ce sans risque.
Ce monde de la finance a ainsi développé des armes de destruction massive faisant prendre à l'ensemble de la société des risques insensés.
La titrisation est l'une d'entre elle, le principe étant que celui qui met sur le marché le produit financier et le premier acheteur n'assument pas le risque que l'on s'empresse de revendre à son voisin. C'est une nouvelle version du jeu de la dame de pique ou plutôt de la roulette russe car très rapidement la diffusion massive de ces produits toxiques, conjuguée avec leur dissimulation dans les comptabilités annexes ou complètement off shore, via des filiales exotiques, rendent extrêmement difficiles la connaissance de l'état de la toxicité des produits financiers détenus par un acteur. Force est de constater, au moins sur ce point-là, que l'analyse de Stiglitz demeure d'actualité, C'est ainsi qu'aujourd'hui la Deutsche Bank, neuf ans après le déclenchement de la crise, fait toujours courir un risque majeur au systême comme Lehmann Brothers et d'autres en son temps.
Un autre effet pervers repose sur le principe « too big to fail ». Autrement dit, la banque est trop importante et sa faillite déclencherait une sorte de tsunami ; l'Etat doit intervenir pour sauver la banque. Cette socialisation du risque pour rattraper les erreurs des fanatiques du marché et de l'individualisme forcené ne manque pas de piquant.
Il reste que pour le citoyen la facture est salée et scandaleuse. Aux Etats Unis, neuf établissements financiers ont perçu 175 milliards de $ dont 33 immédiatement reversés sous forme de primes aux dirigeants de ces établissements.
Pour Stiglitz deux mesures, entre autre, s'imposeraient.
En premier lieu, il conviendrait de procéder au démembrement de ces établissements « trop grands » pour faire faillite et pour être restructurés, c'est-à-dire revenir à l'esprit du Glass Steagall Still Act abrogé en 1999. Cette loi fut mise en place en 1933 lors de la grande dépression pour séparer l'activité de banque de dépôt et d'affaires et ce afin d' empêcher que la faillite d'une banque d'affaire, à la suite d'activité spéculative, ne gangrène l'économie réelle par un effet de domino infernal.
Une autre mesure consisterait à instaurer des systêmes de rémunération à plus long terme et d'indexer le montant des bonus aux véritables résultats des prestations. Ce principe serait un garde-fou contre la prise de risque irrationnelle.
L'ouvrage est d'une lecture facile, eu égard au sujet, abstraction faite de sa densité ; le propos est très argumenté et très stimulant.
Il était question de théâtre en introduction ; cette pièce-là relève de la tragédie grecque et aussi du roman de Georges Orwell « 1984 ». Dans ce roman, le héros travaille au « ministère de la Vérité » avec comme mission de participer à la réécriture permanente de l'histoire, afin qu'elle corresponde au discours du Pouvoir.
Actuellement, les économistes de la pensée dominante refusent le débat historique, sont dans le déni et s'arcboutent sur leurs modèles mathématiques, oubliant au passage que lesdits modèles excluaient la possibilité de crise majeure.
Tragédie grecque également, comme dans Euripide, afin que les vents soient cléments à la flotte de la coalition contre Troie il faut sacrifier Iphigénie….Aujourd'hui pour obtenir les vents cléments des « marchés », de Bruxelles, il faut aussi des « sacrifices »…
C'est tout le mérite de Stiglitz au-delà de la présentation factuelle et détaillée de cette crise, de (re)donner une dimension historique aux enjeux actuels, d'apporter une contribution puissante à la démystification des idéologies
Dans notre société contemporaine occidentale, Confucius aurait un immense chantier avec le vocabulaire utilisé par les économistes et les politiques.
Pour réaliser à bien cette quête, le sage pourrait irriguer sa réflexion avec ce livre de Stiglitz, « le triomphe de la cupidité », l'auteur, expert de grande renommée notamment par ses missions à la Banque Mondiale, avait déjà largement décrypté dans « La Grande Désillusion » la faillite et les risques insensés du modèle ultra libéral en 2002, bien avant la chute de Lehmann Brothers
Il y a eu la « Grande dépression » de 1929, il y a la « Grande récession » de 2008, dont on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom ainsi que ceux des faits, pratiques, responsables divers (institutions, personnes morales et physiques) liés à cette crise existentielle.
Comme dans le mythe de la caverne de Platon de « La République », un petit théâtre d'ombres est projeté sur les parois des esprits pour travestir la réalité et maintenir les pensées dans les apparences et l'obscurité.
Dans son essai, Stiglitz constate le grand écart entre ce qui devraient être les missions essentielles du système bancaire : le financement de l'économie réelle, de ses acteurs économiques, états, entreprises et particuliers, la fourniture des moyens de paiement efficaces et enfin la gestion responsable des risques de ce secteur d'activité.
Or depuis les années 90, il est apparu que les rémunérations des établissements financiers, pour ces missions traditionnelles ne satisfaisaient plus les appétits de ces professionnels, tout au moins de ceux possédés par la fièvre de la richesse. En revanche, les rémunérations des transactions des nouveaux produits financiers spéculatifs garantissaient des niveaux beaucoup plus substantiels et ce sans risque.
Ce monde de la finance a ainsi développé des armes de destruction massive faisant prendre à l'ensemble de la société des risques insensés.
La titrisation est l'une d'entre elle, le principe étant que celui qui met sur le marché le produit financier et le premier acheteur n'assument pas le risque que l'on s'empresse de revendre à son voisin. C'est une nouvelle version du jeu de la dame de pique ou plutôt de la roulette russe car très rapidement la diffusion massive de ces produits toxiques, conjuguée avec leur dissimulation dans les comptabilités annexes ou complètement off shore, via des filiales exotiques, rendent extrêmement difficiles la connaissance de l'état de la toxicité des produits financiers détenus par un acteur. Force est de constater, au moins sur ce point-là, que l'analyse de Stiglitz demeure d'actualité, C'est ainsi qu'aujourd'hui la Deutsche Bank, neuf ans après le déclenchement de la crise, fait toujours courir un risque majeur au systême comme Lehmann Brothers et d'autres en son temps.
Un autre effet pervers repose sur le principe « too big to fail ». Autrement dit, la banque est trop importante et sa faillite déclencherait une sorte de tsunami ; l'Etat doit intervenir pour sauver la banque. Cette socialisation du risque pour rattraper les erreurs des fanatiques du marché et de l'individualisme forcené ne manque pas de piquant.
Il reste que pour le citoyen la facture est salée et scandaleuse. Aux Etats Unis, neuf établissements financiers ont perçu 175 milliards de $ dont 33 immédiatement reversés sous forme de primes aux dirigeants de ces établissements.
Pour Stiglitz deux mesures, entre autre, s'imposeraient.
En premier lieu, il conviendrait de procéder au démembrement de ces établissements « trop grands » pour faire faillite et pour être restructurés, c'est-à-dire revenir à l'esprit du Glass Steagall Still Act abrogé en 1999. Cette loi fut mise en place en 1933 lors de la grande dépression pour séparer l'activité de banque de dépôt et d'affaires et ce afin d' empêcher que la faillite d'une banque d'affaire, à la suite d'activité spéculative, ne gangrène l'économie réelle par un effet de domino infernal.
Une autre mesure consisterait à instaurer des systêmes de rémunération à plus long terme et d'indexer le montant des bonus aux véritables résultats des prestations. Ce principe serait un garde-fou contre la prise de risque irrationnelle.
L'ouvrage est d'une lecture facile, eu égard au sujet, abstraction faite de sa densité ; le propos est très argumenté et très stimulant.
Il était question de théâtre en introduction ; cette pièce-là relève de la tragédie grecque et aussi du roman de Georges Orwell « 1984 ». Dans ce roman, le héros travaille au « ministère de la Vérité » avec comme mission de participer à la réécriture permanente de l'histoire, afin qu'elle corresponde au discours du Pouvoir.
Actuellement, les économistes de la pensée dominante refusent le débat historique, sont dans le déni et s'arcboutent sur leurs modèles mathématiques, oubliant au passage que lesdits modèles excluaient la possibilité de crise majeure.
Tragédie grecque également, comme dans Euripide, afin que les vents soient cléments à la flotte de la coalition contre Troie il faut sacrifier Iphigénie….Aujourd'hui pour obtenir les vents cléments des « marchés », de Bruxelles, il faut aussi des « sacrifices »…
C'est tout le mérite de Stiglitz au-delà de la présentation factuelle et détaillée de cette crise, de (re)donner une dimension historique aux enjeux actuels, d'apporter une contribution puissante à la démystification des idéologies
Pour qui aime l'economie et les raisons de la crise ...Mais monsieur le prix nobel d'économie ne s'adresse pas à tout le monde ...
J'ai trouver quelques longueurs et il faut s'accrocher ne pas hésiter à remonter de quelques page pour reprendre le fil. Car n'est pas prix nobel d'économie qui veut.
Armez vous de patience et de courage
J'ai trouver quelques longueurs et il faut s'accrocher ne pas hésiter à remonter de quelques page pour reprendre le fil. Car n'est pas prix nobel d'économie qui veut.
Armez vous de patience et de courage
En soi, il est plutôt réconfortant de voir un prix Nobel (2001) se mettre à critiquer la "science" économique, et en découvrir les aspects idéologiques. C'est aussi très inquiétant de voir qu'un esprit jugé par tous comme brillant et éclairé, découvre à 69 ans, que l'homme n'est pas toujours "rationnel", ni toujours égoïste, que les marchés ne sont pas parfaits, que l'information y est inégalement répartie, que la théorie des jeux est une abstraction mathématique qui ne s'applique pas directement aux situations concrètes réelles, et tenir des raisonnements qu'un enfant de sixième hésiterait à soutenir de peur de passer pour un imbécile ! Mieux vaut tard que jamais, certainement. Critiquer les fondements de l'économie classique, c'est bien, mais j'aurais attendu d'un homme d'une telle réputation une vision un peu plus profonde et moins naïve.
En quelques 500 pages Joseph Stiglitz propose un tour de la question de la crise que nous traversons et qui est née en 2008 aux USA à partir de la crise de subrpimes.
Si elle part d'une crise massive des crédits hypothécaires (en 2008 30 % des crédits hypothécaires étaient susceptible de n'être pas remboursés et d'entrainer la saisie des habitations fiancées) cette crise révèle aussi une difficulté plus profonde du capitalisme américain à trouver un nouveau souffle après effondrement du mur de Berlin et la diminution de la production industrielle transférée largement dans les pays émergents - surtout la chine.
Et au-delà c'est une véritable crise morale et politique que nous devons affronter.
Saurons-nous retrouver la voie d'une économie visant le dé&développement du bien-être du plus grand nombre ? Selon Joseph Stiglitz, ce pari est loin d'être gagné.
Si elle part d'une crise massive des crédits hypothécaires (en 2008 30 % des crédits hypothécaires étaient susceptible de n'être pas remboursés et d'entrainer la saisie des habitations fiancées) cette crise révèle aussi une difficulté plus profonde du capitalisme américain à trouver un nouveau souffle après effondrement du mur de Berlin et la diminution de la production industrielle transférée largement dans les pays émergents - surtout la chine.
Et au-delà c'est une véritable crise morale et politique que nous devons affronter.
Saurons-nous retrouver la voie d'une économie visant le dé&développement du bien-être du plus grand nombre ? Selon Joseph Stiglitz, ce pari est loin d'être gagné.
En soi, il est plutôt réconfortant de voir un prix Nobel (2001) se mettre à critiquer la "science" économique, et en découvrir les aspects idéologiques. C'est aussi très inquiétant de voir qu'un esprit jugé par tous comme brillant et éclairé, découvre à 69 ans, que l'homme n'est pas toujours "rationnel", ni toujours égoïste, que les marchés ne sont pas parfaits, que l'information y est inégalement répartie, que la théorie des jeux est une abstraction mathématique qui ne s'applique pas directement aux situations concrètes réelles, et tenir des raisonnements qu'un enfant de sixième hésiterait à soutenir de peur de passer pour un imbécile ! Mieux vaut tard que jamais, certainement. Critiquer les fondements de l'économie classique, c'est bien, mais j'aurais attendu d'un homme d'une telle réputation une vision un peu plus profonde et moins naïve.
Cela remet les points sur I concernant l'origine de la crise financière. Néanmoins,avec tout ce qu'on a déjà lu dans la presse c 'est presque une redite plus cultivée et sortie tout droit du cerveau d'un prix Nobel.
Ouvrage un peu technique qui se veut pédagogique. Je suis effaré par ce que je lis sur l'état d'esprit qui règne dans la finance US. Nos banquiers sont des anges à côté de ces prédateurs. J'en suis à la moitié de ma lecture, j'en sais dé jà assez pour ne plus écouter les rubriques économie de la même oreille. L'expression "marché financier" perd toute connotation conceptuelle pour prendre forme humaine. Si vous cherchez des exemples de parfait salaud, ne cherchez plus. J'en reparlerai dans une prochaine rubrique.
Le capitalisme perd la tête ? Mais en a-t-il seulement une ? Ce qui caractérise le capitalisme, c'est l'anarchie de la production qui serait régulée selon les classiques par "une main invisible" qui serait celle du marché. Il n'est nul part question de tête ! A moins qu'il ne s'agisse des économiste. Ironie de l'Histoire, la crise à démontré leur vacuité, quand bien même certain sont moins vide que d'autres. Quoi qu'il en soit, elle a couté à l'humanité des tombereaux de maccabés: esclavage, guerres européennes et coloniales etc.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Joseph E. Stiglitz (20)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Histoire et généralités sur la Normandie
TOUS CONNAISSENT LA TAPISSERIE DE BAYEUX, QUI EN EST LE HÉROS ?
RICHARD COEUR DE LION
ROLLON
MATHILDE
GUILLAUME LE CONQUERANT
GUILLAUME LE ROUX
20 questions
70 lecteurs ont répondu
Thèmes :
histoire
, célébrité
, économieCréer un quiz sur ce livre70 lecteurs ont répondu