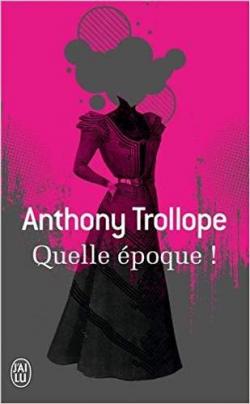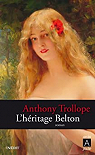Critiques filtrées sur 4 étoiles
Quelle époque et quel pavé !
807 pages ...Il m'aura fallu une semaine pour venir à bout de ce roman, autant dire que j'ai été en totale immersion dans le monde que nous décrit Anthony Trollope.
Dans le Londres des années 1870, débarque un personnage mystérieux et sulfureux affublé d'une épouse et d'une fille unique . On croit savoir qu'il viendrait de Paris et qu'il est très riche mais il y a un hic : sa fortune soudaine ne serait pas acquise honnêtement.
Qu'importe ! Immédiatement, des hommes de la bonne société désirent s'associer avec lui, pressentant qu'il y a de l'argent à se faire sans rien faire ...
Car les jeunes gens que nous présente l'auteur, sont des héritiers, des rentiers , qui n'en "foutent" pas une, mais qui sont très doués pour dilapider le peu de fortune qu'ils ont , à leur Club, entre alcool et parties de cartes . Presque ruinés , ne pouvant payer leurs dettes de jeux, ils n' auront de salut que dans le mariage , à condition de tomber sur la bonne poire dotée d'une dot conséquente ...
Quelle drôle d'époque que celle-ci, et ses jeunes gens obligés de se marier pour maintenir leur train de vie , n'envisageant jamais le travail comme source de revenus .
Quelle drôle d' époque qui voit leurs pères préférant s'acoquiner avec ce Monsieur Melmotte, parce qu'incompétents en affaires, ils n'ont pas vu venir le piège de celui qui achète sans jamais payer , emberlificotant son monde par de belles paroles.
Quelle époque aussi, qui permettait à un écrivain d'écrire ceci : " Sa femme était grosse et blonde, une couleur qui n'était pas celle de nos juives traditionnelles ; mais elle avait le nez juif et les yeux resserrés des juifs".
[ J'avais déjà un truc identique dans un roman d'Agatha Christie ... ] .
Et même si après , il se fait pardonner, en dénonçant un homme qui refuse d'accorder la main de sa fille à un monsieur juif et qu'il dit de jolies choses sur la tolérance et le monde qui change , c'est choquant pour la lectrice du 21 ° siècle que je suis.
Bien sûr, il y a quelques longueurs , notamment sur les passages concernant les affaires et la politique ; bien sûr il y a quelques longueurs autours des histoires d'amours et d'argent , mais dans l'ensemble, c'est extrêmement plaisant et instructif.
J'ajouterais , que la langue est belle et les réflexions pertinentes dont une en particulier m' a fait sourire tant elle colle parfaitement à notre actualité "people/héritage ":
" Là-bas, la femme peut prétendre à avoir sa part des biens de son mari, mais ses biens à elle n'appartiennent qu'à elle. L'Amérique est assurément le pays des femmes... et , tout particulièrement, la Californie."
A QUE ... certaines personnes auraient été bien avisées de lire "Quelle époque !" Ils se trouveraient moins "démunis" aujourd'hui ...
Quand à moi, en refermant ce roman, je me suis demandé ce que Monsieur Anthony Trollope penserait de la notre, d'époque ...
807 pages ...Il m'aura fallu une semaine pour venir à bout de ce roman, autant dire que j'ai été en totale immersion dans le monde que nous décrit Anthony Trollope.
Dans le Londres des années 1870, débarque un personnage mystérieux et sulfureux affublé d'une épouse et d'une fille unique . On croit savoir qu'il viendrait de Paris et qu'il est très riche mais il y a un hic : sa fortune soudaine ne serait pas acquise honnêtement.
Qu'importe ! Immédiatement, des hommes de la bonne société désirent s'associer avec lui, pressentant qu'il y a de l'argent à se faire sans rien faire ...
Car les jeunes gens que nous présente l'auteur, sont des héritiers, des rentiers , qui n'en "foutent" pas une, mais qui sont très doués pour dilapider le peu de fortune qu'ils ont , à leur Club, entre alcool et parties de cartes . Presque ruinés , ne pouvant payer leurs dettes de jeux, ils n' auront de salut que dans le mariage , à condition de tomber sur la bonne poire dotée d'une dot conséquente ...
Quelle drôle d'époque que celle-ci, et ses jeunes gens obligés de se marier pour maintenir leur train de vie , n'envisageant jamais le travail comme source de revenus .
Quelle drôle d' époque qui voit leurs pères préférant s'acoquiner avec ce Monsieur Melmotte, parce qu'incompétents en affaires, ils n'ont pas vu venir le piège de celui qui achète sans jamais payer , emberlificotant son monde par de belles paroles.
Quelle époque aussi, qui permettait à un écrivain d'écrire ceci : " Sa femme était grosse et blonde, une couleur qui n'était pas celle de nos juives traditionnelles ; mais elle avait le nez juif et les yeux resserrés des juifs".
[ J'avais déjà un truc identique dans un roman d'Agatha Christie ... ] .
Et même si après , il se fait pardonner, en dénonçant un homme qui refuse d'accorder la main de sa fille à un monsieur juif et qu'il dit de jolies choses sur la tolérance et le monde qui change , c'est choquant pour la lectrice du 21 ° siècle que je suis.
Bien sûr, il y a quelques longueurs , notamment sur les passages concernant les affaires et la politique ; bien sûr il y a quelques longueurs autours des histoires d'amours et d'argent , mais dans l'ensemble, c'est extrêmement plaisant et instructif.
J'ajouterais , que la langue est belle et les réflexions pertinentes dont une en particulier m' a fait sourire tant elle colle parfaitement à notre actualité "people/héritage ":
" Là-bas, la femme peut prétendre à avoir sa part des biens de son mari, mais ses biens à elle n'appartiennent qu'à elle. L'Amérique est assurément le pays des femmes... et , tout particulièrement, la Californie."
A QUE ... certaines personnes auraient été bien avisées de lire "Quelle époque !" Ils se trouveraient moins "démunis" aujourd'hui ...
Quand à moi, en refermant ce roman, je me suis demandé ce que Monsieur Anthony Trollope penserait de la notre, d'époque ...
En anglais « The way we live now », ce roman présente sur une période d'environ six mois des spécimens de la « bonne société » londonienne. Il y a Lady Carbury sur laquelle s'ouvre le roman, veuve mal mariée qui a gardé de son expérience matrimoniale l'idée que l'amour est un objet de luxe que seuls quelques-uns peuvent s'offrir. Elle fait donc preuve d'une grande dureté envers sa fille Henrietta qui souhaite épouser le jeune homme dont elle est éprise. D'un autre côté tout en étant coupablement indulgente avec son fils Félix, joueur et buveur, et qui l'entraine à la ruine, elle le pousse à épouser une jeune fille dont la famille est douteuse mais très riche, quitte à en passer par l'enlèvement. Cette jeune fille c'est Marie Melmotte dont le père arrivé depuis peu en Angleterre brasse beaucoup d'affaires assez nébuleuses. Mais Melmotte entend bien donner sa fille selon ses intérêts à lui. Autour de ce financier gravitent des lords désargentés mais imbus d'eux-mêmes, prêt à vendre leur nom pour « respectabiliser » le lancement d'actions assises sur du vent ou presque.
Le monde littéraire et celui de la presse ne valant pas mieux. Lady Carbury qui s'est lancée dans l'écriture pour gagner un peu d'argent, n'hésite pas à jouer de son charme pour essayer d'obtenir de bons papiers, plutôt immérités, dans les journaux, avec plus ou moins de succès, car de toute façon, certains éreintent les livres dont ils font la chronique parce que cela fait vendre.
Le monde financier dans lequel on met ses opinions et scrupules de côté afin de participer aux bénéfices, le monde des jeunes aristocrates joueurs, buveurs, en quête d'une héritière, tous assez inconsistants, le monde journalistique peu respectueux de la vérité, peu sont épargnés.
Les femmes me semble-t-il s'en tirent un peu mieux. L'énergie n'est niée ni à Mrs Hurtle, américaine venue rappeler à un jeune anglais sa promesse de mariage, ni à Lady Carbury. Les jeunes filles telles Mary Melmotte ou Henriette Carbury sont droites. Les soeurs Longestaffe sont un peu moins bien traitées, mais dans l'ensemble face aux frères auxquels tout est permis, leurs personnalités sont plus riches.
Autre sujet traité, les préjugés à l'encontre des juifs, tolérés dans la finance, mais dont on ne veut pas dans sa famille malgré un début d'évolution. Bref, une peinture peu reluisante de la société de la deuxième moitié du 19ème comme le laissant entendre le titre.
Je me suis aperçue que je jugeais l'un des protagonistes différemment que les personnages du livre le font. Roger Carbury est considéré par tous comme un modèle de vertu, mais je l'ai trouvé particulièrement hypocrite, sans qu'il s'en rendre compte apparemment. Parce qu'il est parfait tant que ses intérêts ne sont pas en cause, mais lorsqu'ils le sont, il se révèle impitoyable et surtout sûr de son bon droit au-delà de la réalité. Tandis que j'ai été plus indulgente que prévu apparemment pour son rival Paul Montague. Preuve encore que la lecture n'est pas un acte neutre.
Publié en 1875, se passant dans les années 1870, il semble que ce soit à cette période qu'Anthony Trollope situe le début du règne inconditionnel de l'argent. C'est à quelques années près, celle que Zola juge aussi à l'origine du même changement.
Je me suis demandé si Trollope était puritain, car si ces jeunes gens jouent, boivent, courtisent sans amour, ils ne semblent pas vivre d'aventures amoureuses. Si sir Félix s'intéresse à une jeune villageoise qui le rejoint à Londres où elle s'installe chez une tante, il se contente de l'inviter au music-hall ou au restaurant. La seule fois où Félix tente d'en avoir un peu plus se termine mal pour lui ; la morale est sauve. .
Dans l'ensemble, ce livre trouve de nombreux échos dans notre époque.
Peut-être quelques longueurs, et quelques redites en début de chapitres qui laissent à penser qu'il a été publié d'abord en roman feuilleton, mais un roman qui vaut la peine d'être lu. D'ailleurs j'y reviendrai, la grande production de monsieur Trollope laisse un large choix. Je serai assez tentée par la série Les chroniques du Barsetshire.
Challenge ABC 2015-2016
Challenge 19ème siècle
Le monde littéraire et celui de la presse ne valant pas mieux. Lady Carbury qui s'est lancée dans l'écriture pour gagner un peu d'argent, n'hésite pas à jouer de son charme pour essayer d'obtenir de bons papiers, plutôt immérités, dans les journaux, avec plus ou moins de succès, car de toute façon, certains éreintent les livres dont ils font la chronique parce que cela fait vendre.
Le monde financier dans lequel on met ses opinions et scrupules de côté afin de participer aux bénéfices, le monde des jeunes aristocrates joueurs, buveurs, en quête d'une héritière, tous assez inconsistants, le monde journalistique peu respectueux de la vérité, peu sont épargnés.
Les femmes me semble-t-il s'en tirent un peu mieux. L'énergie n'est niée ni à Mrs Hurtle, américaine venue rappeler à un jeune anglais sa promesse de mariage, ni à Lady Carbury. Les jeunes filles telles Mary Melmotte ou Henriette Carbury sont droites. Les soeurs Longestaffe sont un peu moins bien traitées, mais dans l'ensemble face aux frères auxquels tout est permis, leurs personnalités sont plus riches.
Autre sujet traité, les préjugés à l'encontre des juifs, tolérés dans la finance, mais dont on ne veut pas dans sa famille malgré un début d'évolution. Bref, une peinture peu reluisante de la société de la deuxième moitié du 19ème comme le laissant entendre le titre.
Je me suis aperçue que je jugeais l'un des protagonistes différemment que les personnages du livre le font. Roger Carbury est considéré par tous comme un modèle de vertu, mais je l'ai trouvé particulièrement hypocrite, sans qu'il s'en rendre compte apparemment. Parce qu'il est parfait tant que ses intérêts ne sont pas en cause, mais lorsqu'ils le sont, il se révèle impitoyable et surtout sûr de son bon droit au-delà de la réalité. Tandis que j'ai été plus indulgente que prévu apparemment pour son rival Paul Montague. Preuve encore que la lecture n'est pas un acte neutre.
Publié en 1875, se passant dans les années 1870, il semble que ce soit à cette période qu'Anthony Trollope situe le début du règne inconditionnel de l'argent. C'est à quelques années près, celle que Zola juge aussi à l'origine du même changement.
Je me suis demandé si Trollope était puritain, car si ces jeunes gens jouent, boivent, courtisent sans amour, ils ne semblent pas vivre d'aventures amoureuses. Si sir Félix s'intéresse à une jeune villageoise qui le rejoint à Londres où elle s'installe chez une tante, il se contente de l'inviter au music-hall ou au restaurant. La seule fois où Félix tente d'en avoir un peu plus se termine mal pour lui ; la morale est sauve. .
Dans l'ensemble, ce livre trouve de nombreux échos dans notre époque.
Peut-être quelques longueurs, et quelques redites en début de chapitres qui laissent à penser qu'il a été publié d'abord en roman feuilleton, mais un roman qui vaut la peine d'être lu. D'ailleurs j'y reviendrai, la grande production de monsieur Trollope laisse un large choix. Je serai assez tentée par la série Les chroniques du Barsetshire.
Challenge ABC 2015-2016
Challenge 19ème siècle
Le roman s'ouvre sur trois lettres cajoleuses écrites par Lady Carbury aux rédacteurs en chef des journaux les plus en vue de Londres pour demander un bon accueil à son roman, implorant l'indulgence de l'un, flirtant avec l'autre…. Dès le départ, Trollope place ainsi cette grande saga victorienne sous le signe des tromperies et des manipulations. Si Lady Carbury en est réduite à écrire des romans et à convoiter avidement une carrière de femme de lettres, c'est qu'elle est ruinée par la conduite insouciante de son fils, Sir Felix. Ce dernier passe ses journées à s'endetter aux cartes dans un club londonien sans prestige avec quelques autres jeunes hommes. Pour lui, seul un mariage avec une héritière pourra lui assurer le train de vie dont il a besoin pour subsister. Cette héritière pourrait bien être Miss Marie Melmotte, la fille du grand financier Augustus Melmotte, nouveau génie de la City. Melmotte n'a ni titre ni distinction, mais assez d'argent pour s'acheter des duchesses à ses bals et faire des scandales aux secrétaires d'Etat. Grâce à sa fortune, toutes les portes lui sont ouvertes… Sur cette intrigue principale se greffent d'autres couples, Hetta Carbury déchirée entre son cousin plus âgé, Roger Carbury, et Paul Montague, jeune homme à l'allure bien plus engageante, mais lui-même pris aux griffes d'une “tigresse” américaine venue exiger de lui le respect d'une ancienne promesse de mariage. On trouvera aussi Lord Grendall et son fils, devenus laquais de Melmotte pour grappiller quelques sous de sa fortune, le jeune Dolly Longestaffe, que la seule pensée d'écrire une lettre fatigue et sa soeur, qui se débat pour obtenir une certaine indépendance, ou encore la jeune Ruby Rugles, petite paysanne qui se pâme devant son amoureux londonien au détriment de l'honnête fermier qu'elle doit épouser. Une galerie de personnages haute en couleurs que l'auteur entrecroise avec une maîtrise et une facilité déconcertante, ajoutant à tout cela la “grande affaire” de Melmotte, la Société de Chemin de Fer du Pacifique Centre et Sud et du Mexique, dont on ne voit durant tout le roman pas le premier mètre de rails.
Dans ce tumulte, certains personnages révèlent avec surprise un caractère plus ferme que ce qu'on croyait quand d'autres ne se relèvent jamais alors qu'on l'espérait toujours. le titre original du roman “The Way We Live Now” montre bien le parti pris de Trollope qui sous-tend tout le roman : “cette” époque a perverti la bonne vieille Angleterre. L'argent achète tout, les bonnes manières n'y sont plus respectées et la noblesse n'a plus le panache de l'ancienne époque. Si Trollope ne peut empêcher le monde d'avancer et les idées d'évoluer, il ne se retient pas de donner son avis à travers deux personnages : Roger Carbury, effaré devant la conduite de Sir Felix et Mrs Pumpkin, la tante de Ruby.
Ce livre pourrait s'intituler Grandeur et décadence d'Augustus Melmotte, tant il m'a fait penser à Balzac dans la description des affaires financières, des combines politiques, de ces caractères si forts (la mère se sacrifiant pour son fils, le journaliste jouant avec son pouvoir, l'héritier désargenté, la fille rebelle, etc.) et cette opposition permanente entre la campagne et la Ville… La différence réside cependant dans l'analyse psychologique beaucoup plus fine, parfois un peu longue, que fait Trollope des ressorts des actions de ses personnages.
Dans ce tumulte, certains personnages révèlent avec surprise un caractère plus ferme que ce qu'on croyait quand d'autres ne se relèvent jamais alors qu'on l'espérait toujours. le titre original du roman “The Way We Live Now” montre bien le parti pris de Trollope qui sous-tend tout le roman : “cette” époque a perverti la bonne vieille Angleterre. L'argent achète tout, les bonnes manières n'y sont plus respectées et la noblesse n'a plus le panache de l'ancienne époque. Si Trollope ne peut empêcher le monde d'avancer et les idées d'évoluer, il ne se retient pas de donner son avis à travers deux personnages : Roger Carbury, effaré devant la conduite de Sir Felix et Mrs Pumpkin, la tante de Ruby.
Ce livre pourrait s'intituler Grandeur et décadence d'Augustus Melmotte, tant il m'a fait penser à Balzac dans la description des affaires financières, des combines politiques, de ces caractères si forts (la mère se sacrifiant pour son fils, le journaliste jouant avec son pouvoir, l'héritier désargenté, la fille rebelle, etc.) et cette opposition permanente entre la campagne et la Ville… La différence réside cependant dans l'analyse psychologique beaucoup plus fine, parfois un peu longue, que fait Trollope des ressorts des actions de ses personnages.
On va encore dire que je le fais exprès, on va de nouveau m'accuser d'être volontiers dénigrant, me reprocher mes blâmes et ma désinvolture comme autant d'excès répétés : n'empêche, il faut admettre ce qui est, l'éditeur J'ai lu, avec ce roman de Trollope, a véritablement réalisé un travail de merde. Son seul mérite à peu près aura été d'empêcher le fabricant d'imprimer les pages de travers, défaut, certes, que les prestataires de chez Folio, payés probablement avec des restes de papier utilisables aux toilettes, n'évitent pas toujours.
D'abord, ce livre ne s'intitule pas du tout « Quelle époque ! » Non : ce titre en français est une « traduction » racoleuse et des plus approximatives pour The way we live now. Pour moi, je ne vois pas du tout quel inconvénient il y aurait, chaque fois que c'est possible, ou bien de conserver l'appellation d'origine – et, pour tout dire, je trouve tout aussi singulier d'aller à Londres et non à London, quand des anglophones vont à Pariss et non à Paris (J'imagine que pour aller jusqu'au bout de cette logique il eût fallu intituler Spoon River Anthology par « Anthologie de la Rivière Cuillère » !) – ou bien de la traduire aussi littéralement que possible – et quel problème majeur eût résulté par exemple d'un Comment nous vivons à présent (sans point d'exclamation) ? Car mon avis est que si l'on n'aime pas le titre d'une oeuvre dans la langue où elle a été écrite, il ne faut qu'en blâmer l'auteur, et ne pas faire accroire que celui-ci a été mieux inspiré que dans sa langue natale.
Ensuite, la couverture, pour toute colorée qu'elle est aux éditions J'ai Lu– et attirante peut-être à de très jeunes enfants – est encore une de ces horreurs de composition de studio sans le moindre rapport avec le roman : j'ignore pourquoi il faut qu'une femme en tenue victorienne y figure ainsi décapitée par une tache d'encre grise sur un fond d'hallucination rose bonbon (c'est peut-être ce qu'on appelle : « Art contemporain », c'est ma faute certainement d'être si handicapé à comprendre ce qui, du point de vue du créateur même, n'a jamais d'explication – bizarrement, je n'essaie pourtant pas de me soigner, estimant mon mal légitime, salutaire et mon cas désespéré) ; c'en est à regretter l'époque bénie où des artistes avaient lu l'oeuvre qu'ils avaient mission d'illustrer. Mais on peut penser que l'entreprise qui s'en est chargée était à son quinzième travail ce jour-ci, qu'elle rencontrait alors un cruel manque de personnel lié par exemple à une épidémie fulgurante de gastro-entérite, c'est pourquoi on peut la pardonner en cette circonstance, quoiqu'il y ait en l'occurrence quelque importunité, je crois, qu'une telle maladie paraisse si malencontreusement devenue contagieuse par les yeux.
Enfin, je suppose qu'il se trouve financièrement un vice rédhibitoire à proposer un ouvrage excédant 800 pages : c'est certainement un seuil inadmissible pour un éditeur, quelque chose comme une limite infranchissable et maudite susceptible de vous attirer les pires ennuis ou une déveine pas possible, c'est peut-être comme prononcer le mot « lapin » sur un bateau ou « corde » dans un théâtre. Or, ceci considéré et admis, comment faire pour qu'un livre de plus de mille pages « tienne » en seulement huit cents ? Des ingénieurs, je pense, ont sérieusement réfléchi au problème, et ils ont conclu qu'en réduisant la police d'écriture on doit mécaniquement être en mesure de diminuer le volume de l'ouvrage ; les ingénieurs, dit-on, sont des gens très intelligents ; eh sans doute ! mais ils ne lisent guère apparemment, et donc ils n'entendent point que faire tenir 43 lignes (quarante-trois !) sur une seule page de livre de poche est un supplice pour n'importe quel lecteur humain aux capacités oculaires normales.
Pour autant, si vous pouvez passer outre à la fois : le titre, la couverture et la taille des caractères, c'est-à-dire si vous ne faites aucun cas de traduction, d'esthétique ou de confort quand il s'agit d'élire un livre, alors peut-être prendrez-vous la peine d'essayer celui dont je propose aujourd'hui la critique, malgré, évidemment, mon tempérament si « ombrageusement négatif ».
Anthony Trollope, à ce que j'ai compris, est un britannique contemporain de Jane Austen et un auteur d'une certaine importance à l'époque, du moins d'une certaine prolificité – si l'expression n'est pas encore galvaudée. The way we live now passe, dit-on (ou plutôt « dit Alain Jumeau » : compte tenu de la compétence de l'illustrateur, je ne veux présumer de rien quant à celle du préfacier), pour l'un des meilleurs et des plus satiriques ouvrages du romancier.
Le livre relate, comme chez Austen qui feint seulement de ne pas s'en rendre compte, la quête frénétique et absolument nécessaire d'un mari ou d'une épouse, mais dans ce livre c'est à l'exclusion, en général, de la dimension mièvre et douceâtre de la romancière où l'étalage de sentiments nobles rencontre, curieusement (mais on vous fait comprendre que c'est absolument une coïncidence !), le besoin impératif d'entretenir des jeunes femmes désargentées ; or, là, chez Trollope, pas d'illusion : les couples se recherchent premièrement par intérêt, et Lady Carbury notamment ne désire « placer » son fils Félix auprès de Marie Melmotte que dans l'optique d'en obtenir pour lui la dot considérable – le père Melmotte, quoique d'une réputation très douteuse, passe pour un investisseur extrêmement riche –, à charge pour Félix de donner assez bien l'illusion d'être amoureux de la fille, une personne inconsistante et plein de préjugés évanescents et romanesques sur l'amour.
Et c'est tout l'attrait du roman, à mon sens, de plonger le lecteur dans un univers cynique d'intentions programmées, d'hypocrisies inassumées et de compromissions mondaines, dans une société londonienne d'aspect fort policé mais où les apparences les plus ordinaires et courtoises ont toujours des fondements dérisoires et turpides. Sur ce thème, d'ailleurs, on traverse avec une certaine curiosité bien des mondes, celui du journalisme, de la finance, de la religion, de la justice ou de la politique, mais quoique, certes, sans jamais y entrer vraiment, sans en pousser l'exploration jusqu'à un certain degré de connaissance approfondie, ce qui est inévitablement un défaut dans un roman de cette dimension qui prétend justement à dénoncer le superficiel.
On distingue aussi, dans cette oeuvre, une galerie réjouissante de personnages secondaires, des créatures aussi truculentes que vraisemblablement impossibles : des jeunes hommes comiques et d'une incroyable indolence, des avocats incompétents ou au contraire d'une rapacité active, des femmes étonnamment avides de mondanités à n'importe quel prix… Et, face à cela, les principaux jouent une partition de noblesse assez disparate et grandiloquente, avec leurs élans sincères, leurs sacrifices tragiques, leurs discours rationnels et leur dignité héroïque, au point de sembler appartenir tout à fait, eux et les premiers, à deux humanités distinctes. C'est, je trouve, un inconvénient que ces figures cohabitent si mal au sein d'une même intrigue, il y faut des tours de force littéraires et des ficelles trop sensibles, d'autant que l'auteur ne se départit pas d'accompagner sa critique sociale de bons sentiments trop tendres, et cela fait un mélange curieux où les ingrédients individuellement sapides font en tout une saveur bizarre et désunie. Et, au milieu de cela, le lecteur attentif devine et distingue des façons d'assaisonnement nécessaires à lier ces goûts : bien des transitions sont longues et forcées comme certains développements intérieurs – on pressent que le romancier s'est ennuyé à les écrire –, la fin est presque importune d'atermoiements et de facilités, et je soupçonne même l'auteur d'avoir accumulé des recettes comme on rédige un devoir de vacances, avec un sens consommé du style qui ne fait pas disparaître totalement l'ennui des passages obligés. On se retrouve avec un nombre considérable de personnages qu'il faut accorder au moyen d'astuces et de coïncidences étranges, et puis, pour chacun d'eux, trouver des péripéties qui les rapprochent et les éloignent tour à tour de leurs desseins particuliers, et, enfin, leur imaginer un dénouement éloquent correspondant à leur caractère – sans, par ailleurs, que ce caractère ait vraiment changé (il n'y a que Marie Melmotte qui va évoluer au cours du récit, mais c'est loin d'être, dans l'intrigue générale, une figure de premier plan). Ce que je décrie ici est peut-être, au fond, le vice foncier d'une certaine littérature britannique qu'une mode plus que temporaire a obligée à relater des sentimentalités mièvres mêlées de mondanités plus ou moins féroces : cette spécialité est à l'origine de nombreuses variations originales mais sans innovations impressionnantes, pour ce que j'ai lu ; on y perçoit toujours une certaine « parentalité nationale », mais sans identités nettement distinctes ; ces auteurs appartiennent tout à des traditions et à des courants plutôt qu'à eux-mêmes, ils font ce qu'on attend d'eux, et, dans ce Trollope, on distingue l'habitude et les trucs littéraires qu'il faut et qui servent à « vivre de sa plume ».
Il ne faut cependant rien exagérer, le roman est d'une grande élégance, un peu académique souvent – les délibérations des personnages « bons » sont notamment des modèles trop sagement caractérisés de dialectique organisée en trois parties –, mais aussi d'autres fois pittoresque et mordant, notamment à travers de vifs dialogues ironiques ou cruels (comme celui que je fais figurer en exemple ci-après) ou au moyen ponctuel d'aphorismes bien sentis sur la société et les gens. C'est seulement un peu long, peut-être, pour ce que ça raconte ou plutôt pour ce que ça « révèle », on en sort divertit mais sans beaucoup de surprises, la satire n'y est même pas si féroce puisque les mauvais hommes sont tous finalement punis ; c'est néanmoins soigneusement et rigoureusement construit, on suit avec intérêt ces mannequins guindés qui ne sont à peu près rien pour l'homme normal, c'est un film élaboré qui se laisse voir sans trop d'impatience mais à distance, pas du tout si vigoureux ni sagace ni précis ni intelligent ni drôle que Télérama l'annonce sur la quatrième de couverture (et « tout cela à haute dose » : dixit Télérama qui semble ainsi considérer des vertus par quantités mesurables un peu comme des bouchons ou des cuillerées ; à coup sûr, le critique qui s'est chargé d'un tel article a aimé Trollope « à haute dose », il faudrait du moins le lui demander !), mais toujours assez bien fait pour servir d'exemple de prose et de construction sérieuses aux professionnels médiocres d'aujourd'hui. On n'en lira certainement pas un second du même auteur – c'est qu'il nous faudrait, à nous autres passionnés et esthètes, un récit avec justement plus de vigueur, plus de sagacité etc. que ces doses qu'on y trouve « instillées » dans cet ouvrage –, mais on n'aura pas pris trop de déplaisir à celui-ci, ne serait-ce que dans son style élevé et sa manière plutôt aristocratique et désuète. Ce n'est pas que l'intrigue ait eu beaucoup d'intérêt pour moi, mais ne l'ai-je pas déjà dit ailleurs ? je me moque généralement des histoires, n'ayant pas eu le bonheur en ma vie d'en lire seulement une vingtaine qui m'aient véritablement surpris, encore moins épaté.
Lien : http://henrywar.canalblog.com
D'abord, ce livre ne s'intitule pas du tout « Quelle époque ! » Non : ce titre en français est une « traduction » racoleuse et des plus approximatives pour The way we live now. Pour moi, je ne vois pas du tout quel inconvénient il y aurait, chaque fois que c'est possible, ou bien de conserver l'appellation d'origine – et, pour tout dire, je trouve tout aussi singulier d'aller à Londres et non à London, quand des anglophones vont à Pariss et non à Paris (J'imagine que pour aller jusqu'au bout de cette logique il eût fallu intituler Spoon River Anthology par « Anthologie de la Rivière Cuillère » !) – ou bien de la traduire aussi littéralement que possible – et quel problème majeur eût résulté par exemple d'un Comment nous vivons à présent (sans point d'exclamation) ? Car mon avis est que si l'on n'aime pas le titre d'une oeuvre dans la langue où elle a été écrite, il ne faut qu'en blâmer l'auteur, et ne pas faire accroire que celui-ci a été mieux inspiré que dans sa langue natale.
Ensuite, la couverture, pour toute colorée qu'elle est aux éditions J'ai Lu– et attirante peut-être à de très jeunes enfants – est encore une de ces horreurs de composition de studio sans le moindre rapport avec le roman : j'ignore pourquoi il faut qu'une femme en tenue victorienne y figure ainsi décapitée par une tache d'encre grise sur un fond d'hallucination rose bonbon (c'est peut-être ce qu'on appelle : « Art contemporain », c'est ma faute certainement d'être si handicapé à comprendre ce qui, du point de vue du créateur même, n'a jamais d'explication – bizarrement, je n'essaie pourtant pas de me soigner, estimant mon mal légitime, salutaire et mon cas désespéré) ; c'en est à regretter l'époque bénie où des artistes avaient lu l'oeuvre qu'ils avaient mission d'illustrer. Mais on peut penser que l'entreprise qui s'en est chargée était à son quinzième travail ce jour-ci, qu'elle rencontrait alors un cruel manque de personnel lié par exemple à une épidémie fulgurante de gastro-entérite, c'est pourquoi on peut la pardonner en cette circonstance, quoiqu'il y ait en l'occurrence quelque importunité, je crois, qu'une telle maladie paraisse si malencontreusement devenue contagieuse par les yeux.
Enfin, je suppose qu'il se trouve financièrement un vice rédhibitoire à proposer un ouvrage excédant 800 pages : c'est certainement un seuil inadmissible pour un éditeur, quelque chose comme une limite infranchissable et maudite susceptible de vous attirer les pires ennuis ou une déveine pas possible, c'est peut-être comme prononcer le mot « lapin » sur un bateau ou « corde » dans un théâtre. Or, ceci considéré et admis, comment faire pour qu'un livre de plus de mille pages « tienne » en seulement huit cents ? Des ingénieurs, je pense, ont sérieusement réfléchi au problème, et ils ont conclu qu'en réduisant la police d'écriture on doit mécaniquement être en mesure de diminuer le volume de l'ouvrage ; les ingénieurs, dit-on, sont des gens très intelligents ; eh sans doute ! mais ils ne lisent guère apparemment, et donc ils n'entendent point que faire tenir 43 lignes (quarante-trois !) sur une seule page de livre de poche est un supplice pour n'importe quel lecteur humain aux capacités oculaires normales.
Pour autant, si vous pouvez passer outre à la fois : le titre, la couverture et la taille des caractères, c'est-à-dire si vous ne faites aucun cas de traduction, d'esthétique ou de confort quand il s'agit d'élire un livre, alors peut-être prendrez-vous la peine d'essayer celui dont je propose aujourd'hui la critique, malgré, évidemment, mon tempérament si « ombrageusement négatif ».
Anthony Trollope, à ce que j'ai compris, est un britannique contemporain de Jane Austen et un auteur d'une certaine importance à l'époque, du moins d'une certaine prolificité – si l'expression n'est pas encore galvaudée. The way we live now passe, dit-on (ou plutôt « dit Alain Jumeau » : compte tenu de la compétence de l'illustrateur, je ne veux présumer de rien quant à celle du préfacier), pour l'un des meilleurs et des plus satiriques ouvrages du romancier.
Le livre relate, comme chez Austen qui feint seulement de ne pas s'en rendre compte, la quête frénétique et absolument nécessaire d'un mari ou d'une épouse, mais dans ce livre c'est à l'exclusion, en général, de la dimension mièvre et douceâtre de la romancière où l'étalage de sentiments nobles rencontre, curieusement (mais on vous fait comprendre que c'est absolument une coïncidence !), le besoin impératif d'entretenir des jeunes femmes désargentées ; or, là, chez Trollope, pas d'illusion : les couples se recherchent premièrement par intérêt, et Lady Carbury notamment ne désire « placer » son fils Félix auprès de Marie Melmotte que dans l'optique d'en obtenir pour lui la dot considérable – le père Melmotte, quoique d'une réputation très douteuse, passe pour un investisseur extrêmement riche –, à charge pour Félix de donner assez bien l'illusion d'être amoureux de la fille, une personne inconsistante et plein de préjugés évanescents et romanesques sur l'amour.
Et c'est tout l'attrait du roman, à mon sens, de plonger le lecteur dans un univers cynique d'intentions programmées, d'hypocrisies inassumées et de compromissions mondaines, dans une société londonienne d'aspect fort policé mais où les apparences les plus ordinaires et courtoises ont toujours des fondements dérisoires et turpides. Sur ce thème, d'ailleurs, on traverse avec une certaine curiosité bien des mondes, celui du journalisme, de la finance, de la religion, de la justice ou de la politique, mais quoique, certes, sans jamais y entrer vraiment, sans en pousser l'exploration jusqu'à un certain degré de connaissance approfondie, ce qui est inévitablement un défaut dans un roman de cette dimension qui prétend justement à dénoncer le superficiel.
On distingue aussi, dans cette oeuvre, une galerie réjouissante de personnages secondaires, des créatures aussi truculentes que vraisemblablement impossibles : des jeunes hommes comiques et d'une incroyable indolence, des avocats incompétents ou au contraire d'une rapacité active, des femmes étonnamment avides de mondanités à n'importe quel prix… Et, face à cela, les principaux jouent une partition de noblesse assez disparate et grandiloquente, avec leurs élans sincères, leurs sacrifices tragiques, leurs discours rationnels et leur dignité héroïque, au point de sembler appartenir tout à fait, eux et les premiers, à deux humanités distinctes. C'est, je trouve, un inconvénient que ces figures cohabitent si mal au sein d'une même intrigue, il y faut des tours de force littéraires et des ficelles trop sensibles, d'autant que l'auteur ne se départit pas d'accompagner sa critique sociale de bons sentiments trop tendres, et cela fait un mélange curieux où les ingrédients individuellement sapides font en tout une saveur bizarre et désunie. Et, au milieu de cela, le lecteur attentif devine et distingue des façons d'assaisonnement nécessaires à lier ces goûts : bien des transitions sont longues et forcées comme certains développements intérieurs – on pressent que le romancier s'est ennuyé à les écrire –, la fin est presque importune d'atermoiements et de facilités, et je soupçonne même l'auteur d'avoir accumulé des recettes comme on rédige un devoir de vacances, avec un sens consommé du style qui ne fait pas disparaître totalement l'ennui des passages obligés. On se retrouve avec un nombre considérable de personnages qu'il faut accorder au moyen d'astuces et de coïncidences étranges, et puis, pour chacun d'eux, trouver des péripéties qui les rapprochent et les éloignent tour à tour de leurs desseins particuliers, et, enfin, leur imaginer un dénouement éloquent correspondant à leur caractère – sans, par ailleurs, que ce caractère ait vraiment changé (il n'y a que Marie Melmotte qui va évoluer au cours du récit, mais c'est loin d'être, dans l'intrigue générale, une figure de premier plan). Ce que je décrie ici est peut-être, au fond, le vice foncier d'une certaine littérature britannique qu'une mode plus que temporaire a obligée à relater des sentimentalités mièvres mêlées de mondanités plus ou moins féroces : cette spécialité est à l'origine de nombreuses variations originales mais sans innovations impressionnantes, pour ce que j'ai lu ; on y perçoit toujours une certaine « parentalité nationale », mais sans identités nettement distinctes ; ces auteurs appartiennent tout à des traditions et à des courants plutôt qu'à eux-mêmes, ils font ce qu'on attend d'eux, et, dans ce Trollope, on distingue l'habitude et les trucs littéraires qu'il faut et qui servent à « vivre de sa plume ».
Il ne faut cependant rien exagérer, le roman est d'une grande élégance, un peu académique souvent – les délibérations des personnages « bons » sont notamment des modèles trop sagement caractérisés de dialectique organisée en trois parties –, mais aussi d'autres fois pittoresque et mordant, notamment à travers de vifs dialogues ironiques ou cruels (comme celui que je fais figurer en exemple ci-après) ou au moyen ponctuel d'aphorismes bien sentis sur la société et les gens. C'est seulement un peu long, peut-être, pour ce que ça raconte ou plutôt pour ce que ça « révèle », on en sort divertit mais sans beaucoup de surprises, la satire n'y est même pas si féroce puisque les mauvais hommes sont tous finalement punis ; c'est néanmoins soigneusement et rigoureusement construit, on suit avec intérêt ces mannequins guindés qui ne sont à peu près rien pour l'homme normal, c'est un film élaboré qui se laisse voir sans trop d'impatience mais à distance, pas du tout si vigoureux ni sagace ni précis ni intelligent ni drôle que Télérama l'annonce sur la quatrième de couverture (et « tout cela à haute dose » : dixit Télérama qui semble ainsi considérer des vertus par quantités mesurables un peu comme des bouchons ou des cuillerées ; à coup sûr, le critique qui s'est chargé d'un tel article a aimé Trollope « à haute dose », il faudrait du moins le lui demander !), mais toujours assez bien fait pour servir d'exemple de prose et de construction sérieuses aux professionnels médiocres d'aujourd'hui. On n'en lira certainement pas un second du même auteur – c'est qu'il nous faudrait, à nous autres passionnés et esthètes, un récit avec justement plus de vigueur, plus de sagacité etc. que ces doses qu'on y trouve « instillées » dans cet ouvrage –, mais on n'aura pas pris trop de déplaisir à celui-ci, ne serait-ce que dans son style élevé et sa manière plutôt aristocratique et désuète. Ce n'est pas que l'intrigue ait eu beaucoup d'intérêt pour moi, mais ne l'ai-je pas déjà dit ailleurs ? je me moque généralement des histoires, n'ayant pas eu le bonheur en ma vie d'en lire seulement une vingtaine qui m'aient véritablement surpris, encore moins épaté.
Lien : http://henrywar.canalblog.com
L'expérience était la suivante : Au 1er semestre de cette année, pour mon M2, je suis partie en Erasmus à Londres, et j'ai dû lire ce livre pour l'un de mes cours qui s'intitulait « On speed : accelerating culture since the 19th century ». le but de ce séminaire était d'étudier comment les nouvelles technologies, et le nouveau rapport à la vitesse et au temps depuis le 19ème siècle a influencé l'art et l'esthétique, ainsi que la littérature et toute la société. Dans le programme, chaque semaine il y avait une liste de lecture en fonction d'un thème précis (de l'impact du train, à l'impact de la télévision, en passant par le télégraphe, le téléphone, la voiture, etc…)
En ce qui concerne The way we live now,(Quelle époque ! en français) il s'agissait de le lire tel qu'il a été publié à la fin du XIXème siècle, c'est à dire, sérialisé. On n'avait le droit de lire que dix chapitres par semaine, pas plus. Ça peut sembler peu, mais en fait je me suis vite rendue compte que je ne lisais pas du tout au même rythme que n'importe quel anglais… et que donc dix chapitres par semaine c'était beaucoup (sachant que pour mes deux autres séminaires j'avais entre 1 et 2 livres par semaine à lire chacun, plus les lectures critiques…)!
L'expérience en elle-même était géniale, c'était vraiment une super idée, le but étant de faire une réelle expérience du temps par rapport à la lecture et d'essayer de s'imaginer comment les gens lisaient au 19ème siècle. On se rend compte au bout d'un moment que nos séries télévisées d'aujourd'hui sont peut-être l'équivalent de beaucoup de romans à l'époque qui étaient publiés dans des journaux, donc en série. C'est quelque chose qu'on peut carrément voir dans l'écriture avec les techniques pour tenir le lecteur en haleine, le faire passer au chapitre suivant et continuer à lire, les différentes scènes, comme dans un film ou série : le découpage des « épisodes » (multi-plot) ressemble vraiment à celui de n'importe quelle série aujourd'hui et c'est assez drôle quand on se rend compte.
Mais pour tout avouer, je n'ai pas fini ce livre. C'était un rythme de lecture qui allait quand même trop vite pour moi, et en essayant de rattraper mon retard, j'ai trop lu de pages d'un coup en une journée et j'en ai eu une overdose. Je ne pouvais avaler une page de plus au risque d'être malade. C'est fou quand même, parce que au début l'histoire m'intéressait vraiment et dès la première page on se sent happé par le style et les personnages – c'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi ce cours, justement parce que ce livre était dans la liste au programme et que l'idée d'étudier les notions de temps, et de vitesse et de progrès technologique et industriel en littérature et en art m'intéressait beaucoup aussi – mais, visiblement, la vitesse et moi ne faisons pas bon ménage !
Donc voilà, l'expérience était un échec, au moins en partie, parce que c'est assez difficile de caser un livre qui a été publié en série sous une période d'environ 20 mois en seulement 3… J'essayerai de le relire dans le futur, peut-être dans un an ou deux, plus calmement, parce que ça reste quand même un livre qui m'intéresse beaucoup, et que je conseille vivement. En ce qui concerne l'histoire, on y entre très vite, et on est très vite pris dans les intrigues politiques, amoureuses et sociales de ce roman. La place qui est donnée à l'argent est aussi très intéressante : tout se déroule dans les années 1870, mais entre le 19ème siècle et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de changé à ce niveau là…
En ce qui concerne The way we live now,(Quelle époque ! en français) il s'agissait de le lire tel qu'il a été publié à la fin du XIXème siècle, c'est à dire, sérialisé. On n'avait le droit de lire que dix chapitres par semaine, pas plus. Ça peut sembler peu, mais en fait je me suis vite rendue compte que je ne lisais pas du tout au même rythme que n'importe quel anglais… et que donc dix chapitres par semaine c'était beaucoup (sachant que pour mes deux autres séminaires j'avais entre 1 et 2 livres par semaine à lire chacun, plus les lectures critiques…)!
L'expérience en elle-même était géniale, c'était vraiment une super idée, le but étant de faire une réelle expérience du temps par rapport à la lecture et d'essayer de s'imaginer comment les gens lisaient au 19ème siècle. On se rend compte au bout d'un moment que nos séries télévisées d'aujourd'hui sont peut-être l'équivalent de beaucoup de romans à l'époque qui étaient publiés dans des journaux, donc en série. C'est quelque chose qu'on peut carrément voir dans l'écriture avec les techniques pour tenir le lecteur en haleine, le faire passer au chapitre suivant et continuer à lire, les différentes scènes, comme dans un film ou série : le découpage des « épisodes » (multi-plot) ressemble vraiment à celui de n'importe quelle série aujourd'hui et c'est assez drôle quand on se rend compte.
Mais pour tout avouer, je n'ai pas fini ce livre. C'était un rythme de lecture qui allait quand même trop vite pour moi, et en essayant de rattraper mon retard, j'ai trop lu de pages d'un coup en une journée et j'en ai eu une overdose. Je ne pouvais avaler une page de plus au risque d'être malade. C'est fou quand même, parce que au début l'histoire m'intéressait vraiment et dès la première page on se sent happé par le style et les personnages – c'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi ce cours, justement parce que ce livre était dans la liste au programme et que l'idée d'étudier les notions de temps, et de vitesse et de progrès technologique et industriel en littérature et en art m'intéressait beaucoup aussi – mais, visiblement, la vitesse et moi ne faisons pas bon ménage !
Donc voilà, l'expérience était un échec, au moins en partie, parce que c'est assez difficile de caser un livre qui a été publié en série sous une période d'environ 20 mois en seulement 3… J'essayerai de le relire dans le futur, peut-être dans un an ou deux, plus calmement, parce que ça reste quand même un livre qui m'intéresse beaucoup, et que je conseille vivement. En ce qui concerne l'histoire, on y entre très vite, et on est très vite pris dans les intrigues politiques, amoureuses et sociales de ce roman. La place qui est donnée à l'argent est aussi très intéressante : tout se déroule dans les années 1870, mais entre le 19ème siècle et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de changé à ce niveau là…
Ce roman fleuve victorien est une satire de la société londonienne de cette époque. Plein de rebondissements, d'humour, d'intrigues, il offre quelques heures de lecture divertissante et pleine de suspense.
A été porté à l'écran sous le titre anglais "The way we live now" sur un scénario d'Andrew Davies avec Matyhew Macfadyen, Cillian Murphy, David Suchet,...
A voir absolument, mais à condition de comprendre l'anglais, car pas de version ni de sous-titres français à ma connaissance.
A été porté à l'écran sous le titre anglais "The way we live now" sur un scénario d'Andrew Davies avec Matyhew Macfadyen, Cillian Murphy, David Suchet,...
A voir absolument, mais à condition de comprendre l'anglais, car pas de version ni de sous-titres français à ma connaissance.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Anthony Trollope (41)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Londres et la littérature
Dans quelle rue de Londres vit Sherlock Holmes, le célèbre détective ?
Oxford Street
Baker Street
Margaret Street
Glasshouse Street
10 questions
1048 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature anglaise
, londresCréer un quiz sur ce livre1048 lecteurs ont répondu