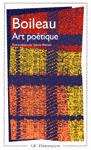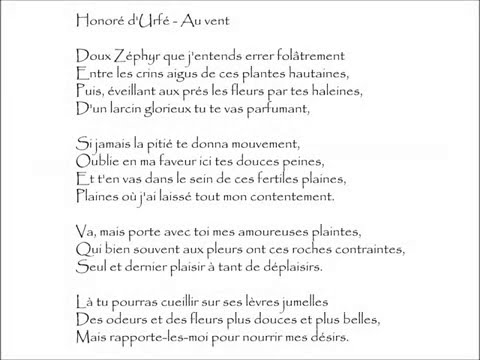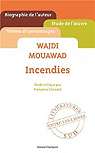Honoré d' Urfé
Delphine Denis (Éditeur scientifique)/5 5 notes
Edition critique établie sous la direction de Delphine Denis. Un siècle après l'Arcadia de Sannazar (1504), L'Astrée marque l'achèvement de la conquête de l'antique fable pastorale par les littératures européennes en langues vulgaires : paru entre 1607 et 1628, le roman d'Honoré d'Urfé est le dernier des grands chefs-d'oeuvre nourris de la veine des histoires de bergers. Mais la narration des amours de C&#... >Voir plus
Delphine Denis (Éditeur scientifique)/5 5 notes
Résumé :
Edition critique établie sous la direction de Delphine Denis. Un siècle après l'Arcadia de Sannazar (1504), L'Astrée marque l'achèvement de la conquête de l'antique fable pastorale par les littératures européennes en langues vulgaires : paru entre 1607 et 1628, le roman d'Honoré d'Urfé est le dernier des grands chefs-d'oeuvre nourris de la veine des histoires de bergers. Mais la narration des amours de C&#... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'Astrée - Partie 1Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
J'ignore au juste quelle aventure éditoriale ce fut de proposer dans son français d'origine une édition complète de L'Astrée qu'à peu près personne ne peut spontanément lire aujourd'hui et dont chaque partie – il y en a cinq – compte environ huit cents pages, mais il ne fait aucun doute que les éditions Champion se sont garanti un certain tirage en s'arrangeant pour que le premier volume soit inscrit parmi les oeuvres imposées de l'agrégation de Lettres modernes. Il faut songer que cette manoeuvre constitue la certitude d'un millier d'exemplaires vendus, après quoi il n'est même pas nécessaire de favoriser les ventes, et pour preuve : la première partie de 720 pages coûte quinze euros, la deuxième aussi longue vingt-deux, la troisième de 883 pages vingt-neuf, etc. : on attend donc avec impatience la sortie des quatrième et cinquième parties à une trentaine ou une quarantaine d'euros !
Évidemment, en pareille occasion – la programmation de l'oeuvre au concours national –, il faut un appareillage critique conséquent qui ne saurait réclamer moins de… cent pages de préface, sans parler de l'abondance des notes. Or, tout l'esprit de notre époque universitarienne – tout son état – est contenue dans une telle préface ; c'est, pour le dire compendieusement, l'étalage extrêmement érudit d'une taxonomie thématique, sur le modèle de centaines d'autres, exprimée en un style impersonnel empli de « on voit » et « il est clair que », et qui ne s'intéresse jamais à la question essentielle de n'importe quel ouvrage de littérature, à savoir : Quel intérêt son auteur a-t-il trouvé à l'écrire ?
Cette question est le fondement de la philologie, si l'on y pense : comment ne pas avoir compris après des années d'études de Lettres qu'un auteur dispose d'intentions et que la réussite de l'oeuvre se mesure à l'adéquation avec elles, en sorte que si on ne les circonscrit pas, sur quel critère prétendra-t-on évaluer l'oeuvre ? de toute évidence, on la jugera alors uniquement sur la conformité à un certain nombre de paramètres qu'on suppose universels et qu'on est censé retrouver dans tous les livres d'un même genre : c'est malheureusement le travail de la plupart des universitaires, sans chercher à savoir ce qu'a souhaité accomplir l'auteur, de considérer un ouvrage selon sa conformité avec les normes en vigueur, indépendamment d'une volonté. Ainsi le commentaire de l'oeuvre manque-il trop d'individu c'est-à-dire de l'effort de l'individu : sitôt que cet effort est considéré fruit collectif, il perd largement sa personnalité, cesse d'être produit d'un être, devient la création intéressée d'une foule, et quoiqu'en puisse dire l'être s'il est encore en vie ou s'il a laissé des explications, c'est alors la foule qui sait l'intérêt de l'oeuvre, et l'auteur en est dépossédé, il ne compte plus, sa subjectivité passe hors du jugement de l'oeuvre. C'est ainsi que nos professeurs se contentent de répéter « ce qu'on doit penser » d'un livre, à la fois suivant telles catégorisations considérées universelles et selon le présupposé que les oeuvres du patrimoine sont nécessairement vertueuses, ayant été estimées par un peuple dont il ne faut pas douter, et que, pour les présenter, il faut commencer par les vanter, du moins les commenter en un esprit d'élogieuse distance. En cela, l'universitaire n'est plus de longtemps un critique : c'est une machine à répondre en formes congruentes à une commande de pairs, c'est un oiseux qui tire sa profession hors du domaine de la vérité, c'est un homme à la fois négligent au fondement et fort appliqué aux questions qui ne concernent ni l'auteur ni le livre mais une propagande, une image, une conformité, travail concentré de fourmi cependant très balisé et donc confortable.
Je n'ai presque jamais lu une critique universitaire : ces deux termes sont antithétiques. Les universitaires étudient beaucoup, font quantité de relevés et apprennent par coeur, mais ils n'ont avec la littérature qu'un rapport neutre et policé, un rapport bureaucratique de classement, et même je crois qu'ils ont un peu peur de ce que la considération d'une attitude véritablement créatrice pourrait révéler sur eux, sur leur stérilité, sur leur inutilité. Il faut être un psychologue pour être un critique : eux ne sont pas des critiques, ils vivent justement leur profession pour ce qu'elle a d'éloigné de l'empathie réelle ; ils goûtent l'esprit-de-système, ces examens sans génie ni solution, constitués de pure méthode, qui pourtant permettent d'acquérir une position et du prestige. Un universitaire est presque par définition le contraire d'un créateur. Un universitaire n'écrit pas, ne sait pas ce qu'est écrire : il glose de l'écrit, c'est à peine un imitateur. Quand on écrit pour de vrai, on fonde parfois une université populaire comme Onfray, mais on n'intègre pas une université publique. Un écrivain jamais ne passe l'agrégation : les vices qu'il trouve à cet examen humilient à son sentiment tous ceux qui s'y livrent, parce que toutes les « qualités » d'orthodoxie nécessaires à y réussir sont basses et frustrantes à celui qui fait du véritable esprit une fonction motrice cardinale. Tous les agrégés sont des anti-écrivains, et peu s'en faut qu'il en aille ainsi des certifiés. Ces universitaires sont pourtant les formateurs des enseignants, ceux qui déterminent les règles d'obtention des concours, qui titularisent et qui moulent. On ne doit pas s'étonner que le professorat – particulièrement quand on monte en spécialité et en salaire – n'est empli que de mentalités consensuelles, que la personnalité y soit chassée pour perturbante et iconoclaste. Un universitaire, en son académisme insu, admet la pénétration individuelle une façon d'irrespect. Et comme l'université se constitue en système de cooptation perpétuelle où l'on n'entre qu'à l'approbation des anciens, l'université, depuis Nietzsche, n'a pas évolué : elle est faite de gens qui, pour disposer d'une mémoire redoutable et pour maîtriser des codes d'une forte difficulté, n'ont pas commencé professionnellement à être des individus (on peut vérifier que depuis Nietzsche et peut-être à des exceptions que j'ignore, aucun universitaire n'a critiqué ses confrères : c'est manifestement défendu). Ils sont en grande majorité, pour ce qui est de leur travail, intellectuellement d'ennuyeux copistes. Mais ils vous donnent tort avec une jactance et une pédanterie impressionnantes : c'est le propre des académies de consister à surtout rejeter tout en s'imaginant que ce n'est pas leur fonction essentielle. Une académie se figure qu'elle « sélectionne » : le mot est heureux et fait l'illusion d'une sélection brave. Mais cette sélection est tout de conformisme : on attend alors d'un être qu'il abandonne ses vertus propres et rallie les compétences certificatrices du groupe. La plupart des professeurs qui parlent de littérature sont ainsi des imposteurs et des poseurs, probablement à leur insu : ils sont où ils sont justement par défaut de savoir écrire ; alors ils écrivent sur des écrits, et leurs péroraisons ne proposent nulle vérité sur les livres parce qu'il n'y a rien d'éprouvé, partant rien de réel, en leur conception de la littérature. Les bons universitaires sont rares et je m'attache à les mentionner toujours dans mes critiques quand j'en trouve : souvenir de Guy Ducret notamment, qui réussit parfois à dire dans ses préfaces qu'il n'aime pas absolument ce qu'il présente. Il y a des préfaciers qui osent l'art dans leur travail, mais c'est presque disparate : impression d'agréable anomalie. Il y a ceux qui osent et qui échouent, qui ont l'intention d'un auteur, la prétention, mais pas la technique : c'est alors pathétique d'autre manière ; c'est pathétique par défaut de faculté mais avec un élan. Les universitaires ont généralement la faculté mais sans l'élan (sauf peut-être au Canada !). Et en général leurs conférences vérifient que plus les auteurs qu'ils présentent sont anciens, moins on sait d'eux quelque chose de ferme et d'intérieur, parce que les préfaces se font respectueuses et convenues, développées suivant le même ordre craintif, paraissent redouter l'objection d'un lecteur qui s'y connaîtrait vraiment, comme si le respect phagocytait la personnalité au lieu de pousser à atteindre celui qu'on admire ; plus l'objet est grand, plus le sujet qui disserte se fait petit, c'est ce qu'ils appellent leur « humilité » : fait de devenir subalterne quand on devrait au contraire s'efforcer d'égaler. Ils s'effacent alors jusqu'à disparaître, de sorte que leur maître les trouverait indignes de lécher ses pieds.
Or, cette publication se situant au coeur d'études supérieures dites « d'élite » (j'en profite pour pronostiquer sans grands risques que, parmi les oeuvres au programme de l'agrégation, l'écrit portera cette année sur celle-ci), et d'Urfé appartenant au XVIIe siècle et au panthéon des auteurs que la doctrine vénère, on y trouve le parangon des préfaces universitariennes, tout ce déversement d'intentions serviles, savantes et insapides. J'ai lu celle-ci en entier, mais sautant des passages verbeux et techniques, croyant alors encore que peut-être je tenterais l'agrégation et devrais m'en servir – j'ai renoncé depuis à un tel exercice où ma verve, quel que soit ce qu'on pense de sa pertinence, sera évidemment mal reçue, où il faudrait travestir ma pensée pour me faire accepter, exercice aussi où il me faudrait composer les éternelles « fiches » qui me sont une agonie et un gâchis insupportable, une mascarade surtout puisque je ne crois nullement en l'intelligence de pareils procédés ; cependant je lirai par curiosité les oeuvres au programme que j'ai déjà acquises et en livrerais mes habituels comptes rendus, sans préjugé. Je ne reviendrai pas en détails sur ces présentations dont le lecteur normal ne réclame qu'une vingtaine de pages pour décrire l'oeuvre, l'auteur et expliquer son contexte nécessaire (écriture, édition, réception) ou dont, s'il exige davantage d'informations, il se détourne au profit d'amples biographies ; il me suffit de signaler qu'on rencontre ici tous les passages obligés d'une étude « sérieuse » c'est-à-dire elle-même chargée de rendre « sérieux » un ouvrage, à savoir l'éternel examen référencé et symbolique : du genre, des lieux, du roman, de l'intrigue, de la composition, du rapport à son histoire contemporaine, de la philosophie, de l'amour, plus clés de compréhension (mais on peut imaginer des préfaces qui ne correspondent pas à une « présentation » à visée informative et qui offre à son auteur une part de créativité et de franchise, une littérarité libre et personnelle). Ce que je trouve ici d'à la fois comique et consternant, c'est qu'on pourrait pasticher cet effort et l'appliquer à des livres mineurs, à du Nothomb, du Vargas ou Dicker, et, avec une ponctualité au moins aussi déférente, en cent pages aussi suivant une pareille progression, proposer l'éloge de la puissante « nécessité » de leur oeuvre dans le paysage français – je jure que c'est faisable en allant quêter des renseignements, et même que, sans hypocrisie, on s'y livrerait avec intérêt comme n'importe quel travail consciencieux et professionnel mené sans implication propre, ainsi que comme l'autobiographie sur gage que vous réclame celui qui ne sait pas raconter, et sur la ressource de documents à consulter dans le silence obséquieux et tamisé de l'abondante bibliothèque de la faculté. Il n'est en effet point utile que l'auteur soit bon pour traiter son livre à la manière d'un bon ouvrage, en multipliant les interprétations et les insignes de haut respect : il suffit d'être disert et de suivre méticuleusement les thèmes dont on a l'habitude, sans perdre de vue qu'il s'agit de complaire à une société de confrères neutres et conventionnels. Il s'agit de s'enfermer dans l'accomplissement d'une commande institutionnalisée, au même titre que des ministres s'efforcent, sans zèle ni intégrité je veux dire non sans capacité mais sans y inclure leur matière particulière sinon l'espèce de méthode objective dont je parle justement, de remplir une charge qu'on leur a confiée, et d'en rendre le résultat à l'heure dite dans la forme attendue, en jouant avec parcimonie de marques d'identité qui doivent servir seulement à établir quelque agrément distingué, comme fait en principe le rapport-de-sécurité d'une entreprise ou un bureau de conseil à la McKinsey – on peut même, dans cet exercice, s'illusionner suffisamment pour, avec l'habitude, en tirer l'impression d'un investissement personnel. En revanche, on n'a à peu près rien dit sur une oeuvre littéraire en écrivant cela, on n'en a surtout rien dit d'humain, on s'est contenté de disserter à sa superficie, en généralités sans s'en apercevoir, en pure tradition, traitant le livre en objet, en quoi un universitaire de Lettres peut aussi bien dresser la description d'un tableau ou d'une table. On a attiré l'attention du lecteur sur les épiphénomènes du livre et sur rien de ce qui lie intrinsèquement, par exemple, l'auteur et l'oeuvre, ou la société et l'oeuvre.
Une question incontournable d'un livre – je dois y revenir, il faut toujours s'y attacher d'abord – est : Pourquoi l'auteur l'a écrite ? ce qui doit s'entendre psychologiquement non pas comme : Pour quel profit universel l'a-t-il écrite ? mais : Dans l'espoir de quel avantage privé ? Il est essentiel de comprendre qu'un auteur n'écrit pas un livre, n'a certainement jamais écrit un livre, dans un autre espoir que d'en tirer un certain bénéfice personnel, fût-ce le sentiment de son devoir accompli, et c'est pourquoi, comme ici, la plupart des études jugent à faux, en ce que l'exégète se propose toujours en tout premier lieu d'indiquer en quoi l'oeuvre fut un apport pour l'humanité. C'est toujours à travers une inversion de la problématique pragmatique d'une oeuvre qu'on l'analyse, en partant de ce que son contenu a délivré comme messages et rendu de bienfaits, plutôt qu'en se fondant sur la pensée de celui qui l'a écrite au commencement c'est-à-dire à l'heure où le livre n'existait pas : on fait comme si l'énoncé existait indépendamment du locuteur, et comme on focalise d'abord sur l'énoncé, on finit par induire la confusion de la généalogie et emmêler les relations, et par se servir antérieurement de l'énoncé pour déduire le locuteur, ce qui est contraire à la psychologie. Dans un ouvrage comme celui-ci, le critique est décidé à indiquer d'emblée l'admirable du livre donc il faut qu'il ait été écrit avec une pensée admirable ; le livre même, par l'image qu'on lui attribue, induit une déformation de la réalité de l'écrivain, et l'on finit par forger l'auteur à l'image du livre tel qu'on espère le décrire – livre qu'on analyse souvent, qui plus est, suivant un quadrillage de tradition universitaire : c'est dire de combien on s'écarte de l'auteur ! On n'ose plus s'interroger d'un regard simple et plausible, sans préconception et traçant une page vierge des sciences interprétatives, sur ce qui pourrait à l'origine avoir motivé l'oeuvre ; on ne se dit pas par exemple, avec une connaissance générale du contexte et avant d'avoir exploré maints documents : « Tiens ! si j'étais d'Urfé, quelle raison aurais-je eu de commencer l'écriture de cette oeuvre ? » – on relègue ce questionnement au rang de naïvetés pour la raison spécieuse qu'il serait impossible de porter sa réflexion à la mesure de celui que la postérité a consacré comme demi-dieu d'écrivain. On discerne l'aura formidable, on tremble d'y aventurer le doigt en dilettante, on préfère s'appuyer sur une somme énorme de documents, comme autant d'alliés qui ne peuvent ensemble se tromper, avant d'essayer rien qu'une hypothèse. On a chez nous la crainte incommensurable des auteurs, qui empêche d'en parler non seulement avec réalité mais avec vraisemblance. On ignore décidément, presque par décision, ce qu'est l'auteur, l'idéalisant parce qu'on suppose que le triomphe social signale le génie inaccessible. On ne comprend rien au génie, on l'élève en piédestal, c'est pour l'éloigner justement du devoir de le comprendre. L'homme à succès, préfère-t-on savoir, n'est pas un homme : voici pourquoi les motifs qu'on lui prête sont rarement crédibles. Mais c'est surtout qu'en voulant commenter des textes on n'a pas le souci de la psychologie : on fait uniquement de la ligne, sans y réfléchir, voire sans réfléchir tout court, bureaucratiquement.
de ce point de vue, je l'ai expliqué dans un autre article, c'est une grande naïveté, quand on s'attache à la réception d'une oeuvre, de se demander, comme ils font tous : Quelles qualités élevées de l'oeuvre l'ont rendue appréciable à sa société ? ou bien : Quelle avance intellectuelle a permis à l'oeuvre de se placer en tête des sollicitations de son époque ? car en effet, ce n'est presque jamais pour des qualités élevées ou pour quelque avance intellectuelle qu'une société de lecteurs a apprécié et sollicité une oeuvre, mais c'est seulement que l'oeuvre lui correspondait et la confirmait. En somme, il faut plutôt interroger ainsi : Par quelle complaisance, volontaire ou fortuite, l'auteur a-t-il plu à ses moeurs ? autrement dit, la question : Pourquoi une société a-t-elle aimé ou rejeté l'oeuvre ? ne doit jamais trouver sa réponse dans le préjugé que le succès ou l'échec d'une oeuvre dépend d'autre chose que de la propension d'une société à rechercher ce qui lui plaît plutôt que ce qui l'édifie : l'édification étant largement déplaisante aux hommes – on n'accepte à présent la leçon des « anciens » que parce qu'on la « sait » issue d'individus que l'histoire a distingués, mais en synchronie ce respect n'existe point car on ne dispose guère de critères pour identifier des grandeurs, de sorte qu'une oeuvre de Henry War aujourd'hui qui incommode tant parce qu'il s'agit d'un inconnu, dans une décennie ou un siècle peut devenir celui que chacun considère, après jugement favorable de la postérité – croit-on que Victor Hugo ne fut pas très abondamment décrié de son vivant ? Il n'y a point à supposer qu'un texte a jamais plu à une multitude parce qu'il était difficile ou parce qu'il a appris quelque chose que cette multitude ignorait et dont elle fut évidemment par là-même humiliée. Nulle humanité n'aime un livre parce qu'il la dépasse, mais tout au contraire parce qu'il exprime ce qu'elle pense sans outrepasser ce stade : s'il l'outrepasse, c'est alors elle qu'il l'outre – on n'a jamais connu un succès ayant procédé d'une vexation.
Pour revenir à d'Urfé, on prétendra ainsi d'autorité qu'il a, par exemple, voulu instruire la société sur les usages de l'amour courtois, qu'il y était personnellement attaché, et cependant on trouvera qu'il était militaire, qu'il eut une relation avec la fiancée de son frère qu'il épousa puis abandonna, et qu'il trahit le roi de France, dont il fait ici un si « généreux » envoi, en faveur de la Ligue et au profit du duc de Nemours, qu'en somme il n'existe a priori aucune raison de supposer qu'il eut la vie chevaleresque, très-fidèle et honorable, qu'il décrit dans son roman et dont la doctrine universitaire tient à ce qu'il aspira surtout à en montrer l'exemple : on se hâte d'oublier ce qu'est un homme de noblesse d'épée au XVIIe siècle, itinérant et peu sentimental par profession, dont on ne se plaît à rete
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Évidemment, en pareille occasion – la programmation de l'oeuvre au concours national –, il faut un appareillage critique conséquent qui ne saurait réclamer moins de… cent pages de préface, sans parler de l'abondance des notes. Or, tout l'esprit de notre époque universitarienne – tout son état – est contenue dans une telle préface ; c'est, pour le dire compendieusement, l'étalage extrêmement érudit d'une taxonomie thématique, sur le modèle de centaines d'autres, exprimée en un style impersonnel empli de « on voit » et « il est clair que », et qui ne s'intéresse jamais à la question essentielle de n'importe quel ouvrage de littérature, à savoir : Quel intérêt son auteur a-t-il trouvé à l'écrire ?
Cette question est le fondement de la philologie, si l'on y pense : comment ne pas avoir compris après des années d'études de Lettres qu'un auteur dispose d'intentions et que la réussite de l'oeuvre se mesure à l'adéquation avec elles, en sorte que si on ne les circonscrit pas, sur quel critère prétendra-t-on évaluer l'oeuvre ? de toute évidence, on la jugera alors uniquement sur la conformité à un certain nombre de paramètres qu'on suppose universels et qu'on est censé retrouver dans tous les livres d'un même genre : c'est malheureusement le travail de la plupart des universitaires, sans chercher à savoir ce qu'a souhaité accomplir l'auteur, de considérer un ouvrage selon sa conformité avec les normes en vigueur, indépendamment d'une volonté. Ainsi le commentaire de l'oeuvre manque-il trop d'individu c'est-à-dire de l'effort de l'individu : sitôt que cet effort est considéré fruit collectif, il perd largement sa personnalité, cesse d'être produit d'un être, devient la création intéressée d'une foule, et quoiqu'en puisse dire l'être s'il est encore en vie ou s'il a laissé des explications, c'est alors la foule qui sait l'intérêt de l'oeuvre, et l'auteur en est dépossédé, il ne compte plus, sa subjectivité passe hors du jugement de l'oeuvre. C'est ainsi que nos professeurs se contentent de répéter « ce qu'on doit penser » d'un livre, à la fois suivant telles catégorisations considérées universelles et selon le présupposé que les oeuvres du patrimoine sont nécessairement vertueuses, ayant été estimées par un peuple dont il ne faut pas douter, et que, pour les présenter, il faut commencer par les vanter, du moins les commenter en un esprit d'élogieuse distance. En cela, l'universitaire n'est plus de longtemps un critique : c'est une machine à répondre en formes congruentes à une commande de pairs, c'est un oiseux qui tire sa profession hors du domaine de la vérité, c'est un homme à la fois négligent au fondement et fort appliqué aux questions qui ne concernent ni l'auteur ni le livre mais une propagande, une image, une conformité, travail concentré de fourmi cependant très balisé et donc confortable.
Je n'ai presque jamais lu une critique universitaire : ces deux termes sont antithétiques. Les universitaires étudient beaucoup, font quantité de relevés et apprennent par coeur, mais ils n'ont avec la littérature qu'un rapport neutre et policé, un rapport bureaucratique de classement, et même je crois qu'ils ont un peu peur de ce que la considération d'une attitude véritablement créatrice pourrait révéler sur eux, sur leur stérilité, sur leur inutilité. Il faut être un psychologue pour être un critique : eux ne sont pas des critiques, ils vivent justement leur profession pour ce qu'elle a d'éloigné de l'empathie réelle ; ils goûtent l'esprit-de-système, ces examens sans génie ni solution, constitués de pure méthode, qui pourtant permettent d'acquérir une position et du prestige. Un universitaire est presque par définition le contraire d'un créateur. Un universitaire n'écrit pas, ne sait pas ce qu'est écrire : il glose de l'écrit, c'est à peine un imitateur. Quand on écrit pour de vrai, on fonde parfois une université populaire comme Onfray, mais on n'intègre pas une université publique. Un écrivain jamais ne passe l'agrégation : les vices qu'il trouve à cet examen humilient à son sentiment tous ceux qui s'y livrent, parce que toutes les « qualités » d'orthodoxie nécessaires à y réussir sont basses et frustrantes à celui qui fait du véritable esprit une fonction motrice cardinale. Tous les agrégés sont des anti-écrivains, et peu s'en faut qu'il en aille ainsi des certifiés. Ces universitaires sont pourtant les formateurs des enseignants, ceux qui déterminent les règles d'obtention des concours, qui titularisent et qui moulent. On ne doit pas s'étonner que le professorat – particulièrement quand on monte en spécialité et en salaire – n'est empli que de mentalités consensuelles, que la personnalité y soit chassée pour perturbante et iconoclaste. Un universitaire, en son académisme insu, admet la pénétration individuelle une façon d'irrespect. Et comme l'université se constitue en système de cooptation perpétuelle où l'on n'entre qu'à l'approbation des anciens, l'université, depuis Nietzsche, n'a pas évolué : elle est faite de gens qui, pour disposer d'une mémoire redoutable et pour maîtriser des codes d'une forte difficulté, n'ont pas commencé professionnellement à être des individus (on peut vérifier que depuis Nietzsche et peut-être à des exceptions que j'ignore, aucun universitaire n'a critiqué ses confrères : c'est manifestement défendu). Ils sont en grande majorité, pour ce qui est de leur travail, intellectuellement d'ennuyeux copistes. Mais ils vous donnent tort avec une jactance et une pédanterie impressionnantes : c'est le propre des académies de consister à surtout rejeter tout en s'imaginant que ce n'est pas leur fonction essentielle. Une académie se figure qu'elle « sélectionne » : le mot est heureux et fait l'illusion d'une sélection brave. Mais cette sélection est tout de conformisme : on attend alors d'un être qu'il abandonne ses vertus propres et rallie les compétences certificatrices du groupe. La plupart des professeurs qui parlent de littérature sont ainsi des imposteurs et des poseurs, probablement à leur insu : ils sont où ils sont justement par défaut de savoir écrire ; alors ils écrivent sur des écrits, et leurs péroraisons ne proposent nulle vérité sur les livres parce qu'il n'y a rien d'éprouvé, partant rien de réel, en leur conception de la littérature. Les bons universitaires sont rares et je m'attache à les mentionner toujours dans mes critiques quand j'en trouve : souvenir de Guy Ducret notamment, qui réussit parfois à dire dans ses préfaces qu'il n'aime pas absolument ce qu'il présente. Il y a des préfaciers qui osent l'art dans leur travail, mais c'est presque disparate : impression d'agréable anomalie. Il y a ceux qui osent et qui échouent, qui ont l'intention d'un auteur, la prétention, mais pas la technique : c'est alors pathétique d'autre manière ; c'est pathétique par défaut de faculté mais avec un élan. Les universitaires ont généralement la faculté mais sans l'élan (sauf peut-être au Canada !). Et en général leurs conférences vérifient que plus les auteurs qu'ils présentent sont anciens, moins on sait d'eux quelque chose de ferme et d'intérieur, parce que les préfaces se font respectueuses et convenues, développées suivant le même ordre craintif, paraissent redouter l'objection d'un lecteur qui s'y connaîtrait vraiment, comme si le respect phagocytait la personnalité au lieu de pousser à atteindre celui qu'on admire ; plus l'objet est grand, plus le sujet qui disserte se fait petit, c'est ce qu'ils appellent leur « humilité » : fait de devenir subalterne quand on devrait au contraire s'efforcer d'égaler. Ils s'effacent alors jusqu'à disparaître, de sorte que leur maître les trouverait indignes de lécher ses pieds.
Or, cette publication se situant au coeur d'études supérieures dites « d'élite » (j'en profite pour pronostiquer sans grands risques que, parmi les oeuvres au programme de l'agrégation, l'écrit portera cette année sur celle-ci), et d'Urfé appartenant au XVIIe siècle et au panthéon des auteurs que la doctrine vénère, on y trouve le parangon des préfaces universitariennes, tout ce déversement d'intentions serviles, savantes et insapides. J'ai lu celle-ci en entier, mais sautant des passages verbeux et techniques, croyant alors encore que peut-être je tenterais l'agrégation et devrais m'en servir – j'ai renoncé depuis à un tel exercice où ma verve, quel que soit ce qu'on pense de sa pertinence, sera évidemment mal reçue, où il faudrait travestir ma pensée pour me faire accepter, exercice aussi où il me faudrait composer les éternelles « fiches » qui me sont une agonie et un gâchis insupportable, une mascarade surtout puisque je ne crois nullement en l'intelligence de pareils procédés ; cependant je lirai par curiosité les oeuvres au programme que j'ai déjà acquises et en livrerais mes habituels comptes rendus, sans préjugé. Je ne reviendrai pas en détails sur ces présentations dont le lecteur normal ne réclame qu'une vingtaine de pages pour décrire l'oeuvre, l'auteur et expliquer son contexte nécessaire (écriture, édition, réception) ou dont, s'il exige davantage d'informations, il se détourne au profit d'amples biographies ; il me suffit de signaler qu'on rencontre ici tous les passages obligés d'une étude « sérieuse » c'est-à-dire elle-même chargée de rendre « sérieux » un ouvrage, à savoir l'éternel examen référencé et symbolique : du genre, des lieux, du roman, de l'intrigue, de la composition, du rapport à son histoire contemporaine, de la philosophie, de l'amour, plus clés de compréhension (mais on peut imaginer des préfaces qui ne correspondent pas à une « présentation » à visée informative et qui offre à son auteur une part de créativité et de franchise, une littérarité libre et personnelle). Ce que je trouve ici d'à la fois comique et consternant, c'est qu'on pourrait pasticher cet effort et l'appliquer à des livres mineurs, à du Nothomb, du Vargas ou Dicker, et, avec une ponctualité au moins aussi déférente, en cent pages aussi suivant une pareille progression, proposer l'éloge de la puissante « nécessité » de leur oeuvre dans le paysage français – je jure que c'est faisable en allant quêter des renseignements, et même que, sans hypocrisie, on s'y livrerait avec intérêt comme n'importe quel travail consciencieux et professionnel mené sans implication propre, ainsi que comme l'autobiographie sur gage que vous réclame celui qui ne sait pas raconter, et sur la ressource de documents à consulter dans le silence obséquieux et tamisé de l'abondante bibliothèque de la faculté. Il n'est en effet point utile que l'auteur soit bon pour traiter son livre à la manière d'un bon ouvrage, en multipliant les interprétations et les insignes de haut respect : il suffit d'être disert et de suivre méticuleusement les thèmes dont on a l'habitude, sans perdre de vue qu'il s'agit de complaire à une société de confrères neutres et conventionnels. Il s'agit de s'enfermer dans l'accomplissement d'une commande institutionnalisée, au même titre que des ministres s'efforcent, sans zèle ni intégrité je veux dire non sans capacité mais sans y inclure leur matière particulière sinon l'espèce de méthode objective dont je parle justement, de remplir une charge qu'on leur a confiée, et d'en rendre le résultat à l'heure dite dans la forme attendue, en jouant avec parcimonie de marques d'identité qui doivent servir seulement à établir quelque agrément distingué, comme fait en principe le rapport-de-sécurité d'une entreprise ou un bureau de conseil à la McKinsey – on peut même, dans cet exercice, s'illusionner suffisamment pour, avec l'habitude, en tirer l'impression d'un investissement personnel. En revanche, on n'a à peu près rien dit sur une oeuvre littéraire en écrivant cela, on n'en a surtout rien dit d'humain, on s'est contenté de disserter à sa superficie, en généralités sans s'en apercevoir, en pure tradition, traitant le livre en objet, en quoi un universitaire de Lettres peut aussi bien dresser la description d'un tableau ou d'une table. On a attiré l'attention du lecteur sur les épiphénomènes du livre et sur rien de ce qui lie intrinsèquement, par exemple, l'auteur et l'oeuvre, ou la société et l'oeuvre.
Une question incontournable d'un livre – je dois y revenir, il faut toujours s'y attacher d'abord – est : Pourquoi l'auteur l'a écrite ? ce qui doit s'entendre psychologiquement non pas comme : Pour quel profit universel l'a-t-il écrite ? mais : Dans l'espoir de quel avantage privé ? Il est essentiel de comprendre qu'un auteur n'écrit pas un livre, n'a certainement jamais écrit un livre, dans un autre espoir que d'en tirer un certain bénéfice personnel, fût-ce le sentiment de son devoir accompli, et c'est pourquoi, comme ici, la plupart des études jugent à faux, en ce que l'exégète se propose toujours en tout premier lieu d'indiquer en quoi l'oeuvre fut un apport pour l'humanité. C'est toujours à travers une inversion de la problématique pragmatique d'une oeuvre qu'on l'analyse, en partant de ce que son contenu a délivré comme messages et rendu de bienfaits, plutôt qu'en se fondant sur la pensée de celui qui l'a écrite au commencement c'est-à-dire à l'heure où le livre n'existait pas : on fait comme si l'énoncé existait indépendamment du locuteur, et comme on focalise d'abord sur l'énoncé, on finit par induire la confusion de la généalogie et emmêler les relations, et par se servir antérieurement de l'énoncé pour déduire le locuteur, ce qui est contraire à la psychologie. Dans un ouvrage comme celui-ci, le critique est décidé à indiquer d'emblée l'admirable du livre donc il faut qu'il ait été écrit avec une pensée admirable ; le livre même, par l'image qu'on lui attribue, induit une déformation de la réalité de l'écrivain, et l'on finit par forger l'auteur à l'image du livre tel qu'on espère le décrire – livre qu'on analyse souvent, qui plus est, suivant un quadrillage de tradition universitaire : c'est dire de combien on s'écarte de l'auteur ! On n'ose plus s'interroger d'un regard simple et plausible, sans préconception et traçant une page vierge des sciences interprétatives, sur ce qui pourrait à l'origine avoir motivé l'oeuvre ; on ne se dit pas par exemple, avec une connaissance générale du contexte et avant d'avoir exploré maints documents : « Tiens ! si j'étais d'Urfé, quelle raison aurais-je eu de commencer l'écriture de cette oeuvre ? » – on relègue ce questionnement au rang de naïvetés pour la raison spécieuse qu'il serait impossible de porter sa réflexion à la mesure de celui que la postérité a consacré comme demi-dieu d'écrivain. On discerne l'aura formidable, on tremble d'y aventurer le doigt en dilettante, on préfère s'appuyer sur une somme énorme de documents, comme autant d'alliés qui ne peuvent ensemble se tromper, avant d'essayer rien qu'une hypothèse. On a chez nous la crainte incommensurable des auteurs, qui empêche d'en parler non seulement avec réalité mais avec vraisemblance. On ignore décidément, presque par décision, ce qu'est l'auteur, l'idéalisant parce qu'on suppose que le triomphe social signale le génie inaccessible. On ne comprend rien au génie, on l'élève en piédestal, c'est pour l'éloigner justement du devoir de le comprendre. L'homme à succès, préfère-t-on savoir, n'est pas un homme : voici pourquoi les motifs qu'on lui prête sont rarement crédibles. Mais c'est surtout qu'en voulant commenter des textes on n'a pas le souci de la psychologie : on fait uniquement de la ligne, sans y réfléchir, voire sans réfléchir tout court, bureaucratiquement.
de ce point de vue, je l'ai expliqué dans un autre article, c'est une grande naïveté, quand on s'attache à la réception d'une oeuvre, de se demander, comme ils font tous : Quelles qualités élevées de l'oeuvre l'ont rendue appréciable à sa société ? ou bien : Quelle avance intellectuelle a permis à l'oeuvre de se placer en tête des sollicitations de son époque ? car en effet, ce n'est presque jamais pour des qualités élevées ou pour quelque avance intellectuelle qu'une société de lecteurs a apprécié et sollicité une oeuvre, mais c'est seulement que l'oeuvre lui correspondait et la confirmait. En somme, il faut plutôt interroger ainsi : Par quelle complaisance, volontaire ou fortuite, l'auteur a-t-il plu à ses moeurs ? autrement dit, la question : Pourquoi une société a-t-elle aimé ou rejeté l'oeuvre ? ne doit jamais trouver sa réponse dans le préjugé que le succès ou l'échec d'une oeuvre dépend d'autre chose que de la propension d'une société à rechercher ce qui lui plaît plutôt que ce qui l'édifie : l'édification étant largement déplaisante aux hommes – on n'accepte à présent la leçon des « anciens » que parce qu'on la « sait » issue d'individus que l'histoire a distingués, mais en synchronie ce respect n'existe point car on ne dispose guère de critères pour identifier des grandeurs, de sorte qu'une oeuvre de Henry War aujourd'hui qui incommode tant parce qu'il s'agit d'un inconnu, dans une décennie ou un siècle peut devenir celui que chacun considère, après jugement favorable de la postérité – croit-on que Victor Hugo ne fut pas très abondamment décrié de son vivant ? Il n'y a point à supposer qu'un texte a jamais plu à une multitude parce qu'il était difficile ou parce qu'il a appris quelque chose que cette multitude ignorait et dont elle fut évidemment par là-même humiliée. Nulle humanité n'aime un livre parce qu'il la dépasse, mais tout au contraire parce qu'il exprime ce qu'elle pense sans outrepasser ce stade : s'il l'outrepasse, c'est alors elle qu'il l'outre – on n'a jamais connu un succès ayant procédé d'une vexation.
Pour revenir à d'Urfé, on prétendra ainsi d'autorité qu'il a, par exemple, voulu instruire la société sur les usages de l'amour courtois, qu'il y était personnellement attaché, et cependant on trouvera qu'il était militaire, qu'il eut une relation avec la fiancée de son frère qu'il épousa puis abandonna, et qu'il trahit le roi de France, dont il fait ici un si « généreux » envoi, en faveur de la Ligue et au profit du duc de Nemours, qu'en somme il n'existe a priori aucune raison de supposer qu'il eut la vie chevaleresque, très-fidèle et honorable, qu'il décrit dans son roman et dont la doctrine universitaire tient à ce qu'il aspira surtout à en montrer l'exemple : on se hâte d'oublier ce qu'est un homme de noblesse d'épée au XVIIe siècle, itinérant et peu sentimental par profession, dont on ne se plaît à rete
Lien : http://henrywar.canalblog.com
très franchement, c'est pas le chef d'oeuvre du XVIIe qui me marquera le plus. néanmoins, une fois qu'on a pris le pli de lire une orthographe étrange, on a un certain plaisir à lire les histoires abracadabrantes de tous les personnages de l'Astrée. ils sont tous soit débiles, soit jaloux, soit déguisés, soit complétement à côté de la plaque. il est possible que je développe un syndrome de stockholm et que je me prenne à apprécier mon bourreau, mais il est plus probable qu'Urfé a vraiment réussi à créer la telenovela avant l'Amérique latine. on suit leurs histoires avec une joie régressive en les voyant si idiots, prudes et lubriques. "faut que je vous fasse rire, de la façon dont il parloit à moy"
j'avoue, je me marre.
j'avoue, je me marre.
Video de Honoré d' Urfé (1)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Honoré d' Urfé (5)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les Chefs-d'oeuvre de la littérature
Quel écrivain est l'auteur de Madame Bovary ?
Honoré de Balzac
Stendhal
Gustave Flaubert
Guy de Maupassant
8 questions
11105 lecteurs ont répondu
Thèmes :
chef d'oeuvre intemporels
, classiqueCréer un quiz sur ce livre11105 lecteurs ont répondu