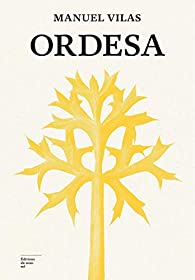Manuel Vilas/5
150 notes
“Mon cœur ressemble à un arbre noir couvert d’oiseaux jaunes qui piaillent et me perforent la chair.” Tel est l’autoportrait brut et sans tabou d’un écrivain confronté à la disparition de ses parents. Assailli par les fantômes de son passé, il retrouve espoir dans le souvenir baigné de lumière jaune de leur amour et de la beauté d’antan. À travers l’évocation d’une famille modeste, c’est alors la peinture d’une certaine Espagne qui se révèle à nous dans tout... >Voir plus
Résumé :
“Mon cœur ressemble à un arbre noir couvert d’oiseaux jaunes qui piaillent et me perforent la chair.” Tel est l’autoportrait brut et sans tabou d’un écrivain confronté à la disparition de ses parents. Assailli par les fantômes de son passé, il retrouve espoir dans le souvenir baigné de lumière jaune de leur amour et de la beauté d’antan. À travers l’évocation d’une famille modeste, c’est alors la peinture d’une certaine Espagne qui se révèle à nous dans tout... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après OrdesaVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (36)
Voir plus
Ajouter une critique
°°° Rentrée littéraire 2019 #24 °°°
Comment puis-je autant aimer un livre qui semble tout faire pour se rendre mal aimable ? Un chaos narratif assumé où les digressions semblent divaguer erratiquement en faisant fi de toute chronologie ... Un narrateur dépressif, embourbé dans sa solitude, quinqua bourré d'alcool et de cachetons, au désespoir si profond que toute empathie immédiate est impossible alors qu'il pleure la mort de ses vieux parents dont il ne se remet pas.
Ce texte très singulier ne se laisse pas facilement apprivoiser, il exige dès les premières pages une lecture concentrée et surtout un lâcher prise total. Très rapidement, j'ai été happée par le flot des mots qui construisent une cathédrale élégiaque dans laquelle l'auteur déverse toute sa rage intranquille et la douleur dévorante de son deuil, comme si j'étais directement plongée dans cet esprit en pleine tempête.
Son impudeur est saisissante : « Mon coeur ressemble à un arbre noir couvert d'oiseaux jaunes qui piaillent et me perforent la chair dans une sorte de martyre. Je comprends le martyre qui consiste à s'arracher sa chair pour être plus nu ; le martyre est un désir de nudité catastrophique. »
Ici aucun désir de polissage ou de retenue. Manuel Vilas s'abandonne totalement au sentiment de désastre. Il livre ses tripes en offrandes au lecteur sans se soucier de l'image qu'il renvoie, ruminant le drame en toute anarchie dans l'espoir d'une catharsis apaisante qui n'arrive jamais. le moindre détail, la moindre photographie, un lieu, un simple objet peuvent faire surgir un souvenir à la fois banal et poignant sur ses parents et sa famille : l'odeur de l'huile d'olive, une cigarettes blondes fumée jusqu'au filtre, la vallée pyrénéenne d'Ordesa. Il sait trouver les mots, entre amertume exaltée et humour féroce, sans que la lecture ne soit plombée de désespérance, magie de l'écriture.. Certaines pages sont absolument splendides et sondent dans nos coeurs notre propre histoire.
« Je suis dans la salle de bains, je me brosse les dents et sens derrière moi un être qui marche dans mes pas. Ce sont les restes de mon père et de ma mère défunts, ils s'accrochent à ma solitude, s'incrustent dans mes cheveux, leurs minuscules molécules fantomatiques suivent le parcours de mes mains et de mes pieds dans la salle de bains, tiennent à mes côtés la brosse à dents, me regardent en faire usage, lisent la marque du dentifrice, observent la serviette, touchent mon reflet dans le miroir ; quand je me mets au lit ils 'allongent près de moi, quand j'éteins la lumière, je les entends murmurer. Ce ne sont pas toujours eux ; ils sont parfois accompagnés de fantômes malades, de fantômes sales, horribles, furieux, malins ou bénins, peu importe, la condition de fantôme transcende le bien et le mal. Des fantômes de l'histoire de l'Espagne, qui est elle aussi un fantôme. Ils me caressent les cheveux pendant que je dors. »
Mais si ce récit est devenu un best-seller en Espagne, s'il y a été sacré Meilleur roman 2018, c'est aussi qu'à travers cette intimité rageusement dévoilée, c'est toute une époque qui revit, celle d'une province espagnole ( Huesca ) dans les années 1960 – 1970, à l'heure du franquisme déclinant, celle d'une famille de « classe moyenne basse » , de parents nés après la Guerre d'Espagne, hantés par la peur du déclassement. Celle des oubliés, des invisibles, des aliénés au système, de ceux dont on ne parle pas : « l'Espagne n'a rien donné à mes parents. Ni l'Espagne franquiste, ni l'Espagne monarchique. Au moins sous le franquisme, ils étaient jeunes, c'était au moins ça. »
Se dessine ainsi une oeuvre inclassable, profonde, d'une sincérité totale, un hommage bouleversant à des parents qui deviennent au fil de la lecture les tiens. Un livre difficile d'accès, qui ne plaira pas à tous, mais qui moi m'a profondément plu.
Lu dans le cadre du jury Grand Prix des Lectrices Elle 2020 ( n°9 )
Comment puis-je autant aimer un livre qui semble tout faire pour se rendre mal aimable ? Un chaos narratif assumé où les digressions semblent divaguer erratiquement en faisant fi de toute chronologie ... Un narrateur dépressif, embourbé dans sa solitude, quinqua bourré d'alcool et de cachetons, au désespoir si profond que toute empathie immédiate est impossible alors qu'il pleure la mort de ses vieux parents dont il ne se remet pas.
Ce texte très singulier ne se laisse pas facilement apprivoiser, il exige dès les premières pages une lecture concentrée et surtout un lâcher prise total. Très rapidement, j'ai été happée par le flot des mots qui construisent une cathédrale élégiaque dans laquelle l'auteur déverse toute sa rage intranquille et la douleur dévorante de son deuil, comme si j'étais directement plongée dans cet esprit en pleine tempête.
Son impudeur est saisissante : « Mon coeur ressemble à un arbre noir couvert d'oiseaux jaunes qui piaillent et me perforent la chair dans une sorte de martyre. Je comprends le martyre qui consiste à s'arracher sa chair pour être plus nu ; le martyre est un désir de nudité catastrophique. »
Ici aucun désir de polissage ou de retenue. Manuel Vilas s'abandonne totalement au sentiment de désastre. Il livre ses tripes en offrandes au lecteur sans se soucier de l'image qu'il renvoie, ruminant le drame en toute anarchie dans l'espoir d'une catharsis apaisante qui n'arrive jamais. le moindre détail, la moindre photographie, un lieu, un simple objet peuvent faire surgir un souvenir à la fois banal et poignant sur ses parents et sa famille : l'odeur de l'huile d'olive, une cigarettes blondes fumée jusqu'au filtre, la vallée pyrénéenne d'Ordesa. Il sait trouver les mots, entre amertume exaltée et humour féroce, sans que la lecture ne soit plombée de désespérance, magie de l'écriture.. Certaines pages sont absolument splendides et sondent dans nos coeurs notre propre histoire.
« Je suis dans la salle de bains, je me brosse les dents et sens derrière moi un être qui marche dans mes pas. Ce sont les restes de mon père et de ma mère défunts, ils s'accrochent à ma solitude, s'incrustent dans mes cheveux, leurs minuscules molécules fantomatiques suivent le parcours de mes mains et de mes pieds dans la salle de bains, tiennent à mes côtés la brosse à dents, me regardent en faire usage, lisent la marque du dentifrice, observent la serviette, touchent mon reflet dans le miroir ; quand je me mets au lit ils 'allongent près de moi, quand j'éteins la lumière, je les entends murmurer. Ce ne sont pas toujours eux ; ils sont parfois accompagnés de fantômes malades, de fantômes sales, horribles, furieux, malins ou bénins, peu importe, la condition de fantôme transcende le bien et le mal. Des fantômes de l'histoire de l'Espagne, qui est elle aussi un fantôme. Ils me caressent les cheveux pendant que je dors. »
Mais si ce récit est devenu un best-seller en Espagne, s'il y a été sacré Meilleur roman 2018, c'est aussi qu'à travers cette intimité rageusement dévoilée, c'est toute une époque qui revit, celle d'une province espagnole ( Huesca ) dans les années 1960 – 1970, à l'heure du franquisme déclinant, celle d'une famille de « classe moyenne basse » , de parents nés après la Guerre d'Espagne, hantés par la peur du déclassement. Celle des oubliés, des invisibles, des aliénés au système, de ceux dont on ne parle pas : « l'Espagne n'a rien donné à mes parents. Ni l'Espagne franquiste, ni l'Espagne monarchique. Au moins sous le franquisme, ils étaient jeunes, c'était au moins ça. »
Se dessine ainsi une oeuvre inclassable, profonde, d'une sincérité totale, un hommage bouleversant à des parents qui deviennent au fil de la lecture les tiens. Un livre difficile d'accès, qui ne plaira pas à tous, mais qui moi m'a profondément plu.
Lu dans le cadre du jury Grand Prix des Lectrices Elle 2020 ( n°9 )
« Ma mère était infinie, ma mère était le présent » .
« Mon père était un artiste . Il avait du style. »
« le passé est porteur de joie. le passé est un ouragan » .
Trois courts extraits de cet autoportrait brut sans fard, ni tabou, pétri d'humour et d'ironie d'un écrivain confronté à la douleur de la disparition de ses parents : véritable LETTRE D'AMOUR .
Un ouvrage difficile d'accès quelque part : un chaos narratif marquant pour le lecteur obligé de se concentrer, chaos aux souvenirs multiples , ravivés par une tendresse intense doublée d'une terrible culpabilité d'avoir fait incinérer son père le 19 décembre 2005.
« À la mort de mes parents ,ma mémoire est devenue un fantôme irritable , effrayé , enragé » .
L'auteur a hérité de quelques rares photos jaunies de ses défunts parents.
Souvenirs anciens , enchanteurs de l'eau de Cologne de sa mère , « Une femme drame » , des volutes formées en coeur par les cigarettes de ses géniteurs , des originaux pour l'époque , ils n'allaient jamais à la messe ….ce qui ne convenait guère , il faut l'avouer , en Espagne dans les années 60 et 70.
Souvenir ému de la Siat 600 : «Motif d'espoir athée et matériel » , des costumes de représentant de son père , de la silhouette paternelle au cours de l'été 69 : Ordesa, Ordesa, la couleur jaune , d'une vallée des Pyrénées où l'auteur passait enfant , ses vacances .
En 2015 , assailli par la nostalgie ,la culpabilité l'auteur décide de passer un scanner cérébral, et sans résultats , tout était normal, entame donc la rédaction de ces pages ,magnifiques , tantôt désespérées, tantôt amères , impudiques parfois, déchirantes , prenant aux tripes , incroyablement poétiques , une magie de mots qui peuvent désarmer , bien sûr .
« Puisque j'ai fait brûler le corps de mon père, je n'ai pas d'endroit où le retrouver , si bien que j'en ai inventé un ; l'écran de cet ordinateur » .
De réminiscences en odeurs différentes , multiples contextes , de notes , de degrés , de sensations nombreuses, le lecteur remonte le temps jusqu'aux années 60 , de l'Espagne franquiste à la monarchie actuelle , partage le vécu d'une famille de « classe moyenne basse » profondément marquée par la guerre civile , tentant bien sûr d'aspirer à un confort évident , souvent oubliée par la prospérité .
Une Espagne cachée , enfouie ,à l'image de la vie de ses parents que l'auteur convoque au fil des pages , comme un tout petit enfant lâcherait la main des êtres qui l'ont vraiment aimé !
Cri de détresse. , archives encombrées de la mémoire ou des mémoires d'un homme assailli par ses souvenirs , ses regrets , son passé, ses perceptions sincères .
Cet ouvrage trouble , désarme par sa dignité , sa vérité , sa profondeur à l'aide d'une prose débridée , un chaos narratif , une langue acide mêlant colère , amour , intime et universel à travers le destin de toute une génération sacrifiée .
Un livre « LETTRE D'AMOUR » , archives , mémoire, lumineux , foisonnant , riche , très complexe bouleversant , touchant par sa vérité ,et sa détresse , à la beauté mélancolique .
Assez difficile à lire mais passionnant de bout en bout ….
« Mon père était un artiste . Il avait du style. »
« le passé est porteur de joie. le passé est un ouragan » .
Trois courts extraits de cet autoportrait brut sans fard, ni tabou, pétri d'humour et d'ironie d'un écrivain confronté à la douleur de la disparition de ses parents : véritable LETTRE D'AMOUR .
Un ouvrage difficile d'accès quelque part : un chaos narratif marquant pour le lecteur obligé de se concentrer, chaos aux souvenirs multiples , ravivés par une tendresse intense doublée d'une terrible culpabilité d'avoir fait incinérer son père le 19 décembre 2005.
« À la mort de mes parents ,ma mémoire est devenue un fantôme irritable , effrayé , enragé » .
L'auteur a hérité de quelques rares photos jaunies de ses défunts parents.
Souvenirs anciens , enchanteurs de l'eau de Cologne de sa mère , « Une femme drame » , des volutes formées en coeur par les cigarettes de ses géniteurs , des originaux pour l'époque , ils n'allaient jamais à la messe ….ce qui ne convenait guère , il faut l'avouer , en Espagne dans les années 60 et 70.
Souvenir ému de la Siat 600 : «Motif d'espoir athée et matériel » , des costumes de représentant de son père , de la silhouette paternelle au cours de l'été 69 : Ordesa, Ordesa, la couleur jaune , d'une vallée des Pyrénées où l'auteur passait enfant , ses vacances .
En 2015 , assailli par la nostalgie ,la culpabilité l'auteur décide de passer un scanner cérébral, et sans résultats , tout était normal, entame donc la rédaction de ces pages ,magnifiques , tantôt désespérées, tantôt amères , impudiques parfois, déchirantes , prenant aux tripes , incroyablement poétiques , une magie de mots qui peuvent désarmer , bien sûr .
« Puisque j'ai fait brûler le corps de mon père, je n'ai pas d'endroit où le retrouver , si bien que j'en ai inventé un ; l'écran de cet ordinateur » .
De réminiscences en odeurs différentes , multiples contextes , de notes , de degrés , de sensations nombreuses, le lecteur remonte le temps jusqu'aux années 60 , de l'Espagne franquiste à la monarchie actuelle , partage le vécu d'une famille de « classe moyenne basse » profondément marquée par la guerre civile , tentant bien sûr d'aspirer à un confort évident , souvent oubliée par la prospérité .
Une Espagne cachée , enfouie ,à l'image de la vie de ses parents que l'auteur convoque au fil des pages , comme un tout petit enfant lâcherait la main des êtres qui l'ont vraiment aimé !
Cri de détresse. , archives encombrées de la mémoire ou des mémoires d'un homme assailli par ses souvenirs , ses regrets , son passé, ses perceptions sincères .
Cet ouvrage trouble , désarme par sa dignité , sa vérité , sa profondeur à l'aide d'une prose débridée , un chaos narratif , une langue acide mêlant colère , amour , intime et universel à travers le destin de toute une génération sacrifiée .
Un livre « LETTRE D'AMOUR » , archives , mémoire, lumineux , foisonnant , riche , très complexe bouleversant , touchant par sa vérité ,et sa détresse , à la beauté mélancolique .
Assez difficile à lire mais passionnant de bout en bout ….
Vrai phénomène éditorial en Espagne, en France prix Femina du meilleur roman étranger en 2019, ORDESA est un récit autobiographique dont la simplicité et la portée poétique sont de mon point de vue tout à fait exceptionnelles et m'ont tout particulièrement touché.
Dans un genre littéraire qu'on a pris l'habitude depuis quelques décennies déjà de qualifier d' «autofiction», toujours très à la mode de nos jours, mais que d'habitude je n'apprécie pas spécialement, j'ai pourtant éprouvé en lisant ORDESA un sentiment rare que peu de lectures ont le pouvoir de susciter. Amis lecteurs, je ne parle pas tout à fait de ce sentiment très agréable d'être tombé sur un livre dont on dit qu'il est ou sera «inoubliable», même si on sait qu'en fin de compte tout s'oublie avec le temps, n'est-ce pas, les histoires, les intrigues elles-mêmes s'effacent peu à peu de notre mémoire encombrée, ce qui reste pour nous en vérité, c'est la trace, le souvenir du plaisir particulier qu'on avait éprouvé pendant cette lecture qui nous avait transportés, émus, ouverts à des zones nouvelles de pensée et de sensation, inouïes et surprenantes, non, je parle ici plutôt d'un sentiment d'avoir littéralement «incorporé» un livre, j'évoque ici ce pouvoir exceptionnel d'une lecture plutôt de nature -excusez-moi l'expression barbare- anthropobibliophagique, sorte de cannibalisme littéraire qui vous fait métaboliser un récit à un niveau concret, intime, quasi organique. On ne peut donc plus juste le qualifier d'«inoubliable»; on ne dirait pas par rapport à un mécanisme interne qu'il s'oublie ou pas : une fois mis au point, ce dernier se déclenche automatiquement à l'occasion et au besoin!
En lisant ORDESA, je me suis mis moi-même, spontanément, à «ordeser». (Aïe! Je suis conscient du fait que là vous risquez de ne plus me suivre tout à fait..!). Au-delà des impressions qu'une lecture peut susciter habituellement, au-delà des remarques qu'on se fait tous silencieusement en lisant, qui nous conduisent à apprécier ou pas le livre qu'on est de train de lire, de nous dire au bout d'un moment « j'adore », ou bien « je n'aime pas », ou encore «j'aime ceci, mais pas cela» (...), comment en l'occurrence, décrire exactement le fait qu'une lecture vous imprime une sorte de reflexe nouveau, une manière inédite d'approcher votre propre histoire : en lisant, en quelque sorte on se mettrait à "se relire" soi-même.
Peut-être vous dites-vous à ce stade : «OK, ce Creisifiction doit être en pleine «crazyfication», il n'a rien compris, le pauvre, il vient de lire une autofiction doublée d'un ouvrage de développement personnel, et il s'imagine être tombé sur «la révélation», «the Book»! ». Non ! Faites-moi confiance, s'il vous plaît, ce n'est pas ça : je n'aime pas beaucoup les autofictions, je ne supporte pas les ouvrages dits de développement personnel, le « feel-good » me fait en général l'effet inverse escompté...
Non, ORDESA est loin d'être tout rose et gentillet. ORDESA est à vrai dire jaune : «amarillo», ce joli mot espagnol pour une couleur à la fois amère («amaro») et solaire : couleur faite d'amertume et de lumière. Quand il est éclatant, le jaune c'est la couleur des dieux. Quand il est mat, c'est l'enfer, la perfidie. Rire jaune, étoile jaune. «Le jaune est la couleur qui parle du passé, de la désagrégation des familles, de la pénurie». ORDESA est ainsi dosé à la fois de chagrin et de désolation, d'espoir et de poésie, le tout conjugué en nuances de jaune. «Un endroit très montagneux appelé Ordesa, un souvenir jaune, la couleur jaune envahissait le nom d'Ordesa, et derrière Ordesa se dessinait la silhouette de mon père au cours d'un été, en 1969. Un état mental qui est un lieu : Ordesa. Et aussi une couleur : le jaune».
Issu d'une famille de «classe moyenne-basse» espagnole qu'on pourrait aisément identifier, selon les mots de l'auteur lui-même, comme étant « dysfonctionnelle», Manuel Vilas égrène dans ORDESA les souvenirs de ses parents morts et de son enfance à Barbastro, petite ville de l'Aragon, alors qu'il vient lui-même de divorcer et qu'il livre seul un douloureux combat contre la dépression et l'alcoolisme.
Par l'évocation de souvenirs en apparence tout à fait banals, souvent reliés au quotidien et d'une simplicité à toute épreuve, tant sur le fond que sur la forme, Manuel Vilas se sert de toute sa palette de jaunes au fil de petits chapitres empreints d'une poésie et d'un lyrisme d'autant plus percutants qu'ils s'appuient justement sur ce qu'il y a de plus ordinaire et universel, nous renvoyant en même temps directement à notre propre famille et à notre enfance.
Face au déroulement de l'existence humaine, vouée par principe au même néant d'où elle provient et vers lequel elle s'achemine, s'en affranchissant grâce à un langage purement intuitif et poétique, libre du carcan où nous risquons sans cesse de nous enserrer avec nos manques, nos blessures, nos récriminations, dépassant les limitations, qu'elles soient temporelles, entre passé, présent et avenir, ou bien existentielles, entre vivants et morts, Manuel Vilas nous invite nous aussi à «ordeser», c'est-à-dire à adopter un point de vue extrapolé et océanique de notre existence que seules l'imagination associée à la mémoire, l'intuition et la poésie peuvent nous révéler dans sa dimension d'épopée unique et singulière. Toute vie, même la plus ordinaire, nous glisse furtivement l'auteur, «réclame un destin légendaire».
Quand Manuel Vilas évoque par exemple le fait que sa mère ne cultivait absolument aucune forme de mémoire, qu'elle oubliait rapidement les morts, ne prenait jamais de photos de ses proches, jetait tout ce qui n'était pas utile (y compris ses livres à lui, puisque comme elle lui expliquait «il les avait déjà lus »), il conclut : «Ma mère n'a été que nature, si bien qu'elle n'avait pas de mémoire, elle vivait uniquement dans le présent, comme la nature (...) Ma mère était le présent. La force de ses instincts la conduit vers ma présence. Sa présence au travers de la mienne se change en présence dans mes fils présents, et en cela elle prévient de sa présence les fils de mes fils quand ceux-ci s'installeront dans le présent».
A voir les choses de la sorte, il y a sans doute une forme de «mystique», qui n'est absolument pas de nature religieuse, mais ancrée dans un sentiment vivant de gratitude et d'amour inconditionnel. Ceci pourra sans doute, je peux tout à fait le concevoir, déplaire à certains lecteurs. Moi, j'avoue, j'en ai été, à ma grande surprise, complètement subjugué.
En exergue d'ORDESA, Manuel Vilas cite ces vers merveilleux de Violeta Parra :
« Merci à la vie, qui m'a tellement donné
Elle m'a donné le rire, elle m'a donné les pleurs
Ainsi je distingue le bonheur du malheur,
Les deux matériaux qui constituent mon chant,
Et votre chant à vous, qui est le même chant,
Et le chant de nous tous, qui est mon propre chant. »
Dans un genre littéraire qu'on a pris l'habitude depuis quelques décennies déjà de qualifier d' «autofiction», toujours très à la mode de nos jours, mais que d'habitude je n'apprécie pas spécialement, j'ai pourtant éprouvé en lisant ORDESA un sentiment rare que peu de lectures ont le pouvoir de susciter. Amis lecteurs, je ne parle pas tout à fait de ce sentiment très agréable d'être tombé sur un livre dont on dit qu'il est ou sera «inoubliable», même si on sait qu'en fin de compte tout s'oublie avec le temps, n'est-ce pas, les histoires, les intrigues elles-mêmes s'effacent peu à peu de notre mémoire encombrée, ce qui reste pour nous en vérité, c'est la trace, le souvenir du plaisir particulier qu'on avait éprouvé pendant cette lecture qui nous avait transportés, émus, ouverts à des zones nouvelles de pensée et de sensation, inouïes et surprenantes, non, je parle ici plutôt d'un sentiment d'avoir littéralement «incorporé» un livre, j'évoque ici ce pouvoir exceptionnel d'une lecture plutôt de nature -excusez-moi l'expression barbare- anthropobibliophagique, sorte de cannibalisme littéraire qui vous fait métaboliser un récit à un niveau concret, intime, quasi organique. On ne peut donc plus juste le qualifier d'«inoubliable»; on ne dirait pas par rapport à un mécanisme interne qu'il s'oublie ou pas : une fois mis au point, ce dernier se déclenche automatiquement à l'occasion et au besoin!
En lisant ORDESA, je me suis mis moi-même, spontanément, à «ordeser». (Aïe! Je suis conscient du fait que là vous risquez de ne plus me suivre tout à fait..!). Au-delà des impressions qu'une lecture peut susciter habituellement, au-delà des remarques qu'on se fait tous silencieusement en lisant, qui nous conduisent à apprécier ou pas le livre qu'on est de train de lire, de nous dire au bout d'un moment « j'adore », ou bien « je n'aime pas », ou encore «j'aime ceci, mais pas cela» (...), comment en l'occurrence, décrire exactement le fait qu'une lecture vous imprime une sorte de reflexe nouveau, une manière inédite d'approcher votre propre histoire : en lisant, en quelque sorte on se mettrait à "se relire" soi-même.
Peut-être vous dites-vous à ce stade : «OK, ce Creisifiction doit être en pleine «crazyfication», il n'a rien compris, le pauvre, il vient de lire une autofiction doublée d'un ouvrage de développement personnel, et il s'imagine être tombé sur «la révélation», «the Book»! ». Non ! Faites-moi confiance, s'il vous plaît, ce n'est pas ça : je n'aime pas beaucoup les autofictions, je ne supporte pas les ouvrages dits de développement personnel, le « feel-good » me fait en général l'effet inverse escompté...
Non, ORDESA est loin d'être tout rose et gentillet. ORDESA est à vrai dire jaune : «amarillo», ce joli mot espagnol pour une couleur à la fois amère («amaro») et solaire : couleur faite d'amertume et de lumière. Quand il est éclatant, le jaune c'est la couleur des dieux. Quand il est mat, c'est l'enfer, la perfidie. Rire jaune, étoile jaune. «Le jaune est la couleur qui parle du passé, de la désagrégation des familles, de la pénurie». ORDESA est ainsi dosé à la fois de chagrin et de désolation, d'espoir et de poésie, le tout conjugué en nuances de jaune. «Un endroit très montagneux appelé Ordesa, un souvenir jaune, la couleur jaune envahissait le nom d'Ordesa, et derrière Ordesa se dessinait la silhouette de mon père au cours d'un été, en 1969. Un état mental qui est un lieu : Ordesa. Et aussi une couleur : le jaune».
Issu d'une famille de «classe moyenne-basse» espagnole qu'on pourrait aisément identifier, selon les mots de l'auteur lui-même, comme étant « dysfonctionnelle», Manuel Vilas égrène dans ORDESA les souvenirs de ses parents morts et de son enfance à Barbastro, petite ville de l'Aragon, alors qu'il vient lui-même de divorcer et qu'il livre seul un douloureux combat contre la dépression et l'alcoolisme.
Par l'évocation de souvenirs en apparence tout à fait banals, souvent reliés au quotidien et d'une simplicité à toute épreuve, tant sur le fond que sur la forme, Manuel Vilas se sert de toute sa palette de jaunes au fil de petits chapitres empreints d'une poésie et d'un lyrisme d'autant plus percutants qu'ils s'appuient justement sur ce qu'il y a de plus ordinaire et universel, nous renvoyant en même temps directement à notre propre famille et à notre enfance.
Face au déroulement de l'existence humaine, vouée par principe au même néant d'où elle provient et vers lequel elle s'achemine, s'en affranchissant grâce à un langage purement intuitif et poétique, libre du carcan où nous risquons sans cesse de nous enserrer avec nos manques, nos blessures, nos récriminations, dépassant les limitations, qu'elles soient temporelles, entre passé, présent et avenir, ou bien existentielles, entre vivants et morts, Manuel Vilas nous invite nous aussi à «ordeser», c'est-à-dire à adopter un point de vue extrapolé et océanique de notre existence que seules l'imagination associée à la mémoire, l'intuition et la poésie peuvent nous révéler dans sa dimension d'épopée unique et singulière. Toute vie, même la plus ordinaire, nous glisse furtivement l'auteur, «réclame un destin légendaire».
Quand Manuel Vilas évoque par exemple le fait que sa mère ne cultivait absolument aucune forme de mémoire, qu'elle oubliait rapidement les morts, ne prenait jamais de photos de ses proches, jetait tout ce qui n'était pas utile (y compris ses livres à lui, puisque comme elle lui expliquait «il les avait déjà lus »), il conclut : «Ma mère n'a été que nature, si bien qu'elle n'avait pas de mémoire, elle vivait uniquement dans le présent, comme la nature (...) Ma mère était le présent. La force de ses instincts la conduit vers ma présence. Sa présence au travers de la mienne se change en présence dans mes fils présents, et en cela elle prévient de sa présence les fils de mes fils quand ceux-ci s'installeront dans le présent».
A voir les choses de la sorte, il y a sans doute une forme de «mystique», qui n'est absolument pas de nature religieuse, mais ancrée dans un sentiment vivant de gratitude et d'amour inconditionnel. Ceci pourra sans doute, je peux tout à fait le concevoir, déplaire à certains lecteurs. Moi, j'avoue, j'en ai été, à ma grande surprise, complètement subjugué.
En exergue d'ORDESA, Manuel Vilas cite ces vers merveilleux de Violeta Parra :
« Merci à la vie, qui m'a tellement donné
Elle m'a donné le rire, elle m'a donné les pleurs
Ainsi je distingue le bonheur du malheur,
Les deux matériaux qui constituent mon chant,
Et votre chant à vous, qui est le même chant,
Et le chant de nous tous, qui est mon propre chant. »
Ordesa est un roman désarmant, plein d'humour et d'une tonifiante ironie, dont on n'en sort pas indemne. Manuel Vilas convoque ses souvenirs. ‘Le souvenir allume une lampe', écrivait Borges, le souvenir est exigeant. Il raconte son histoire. Son récit dense, serré, loin d'être un lamento inlassable, un mea culpa plombant et improductif, est un appel d'air bienfaisant. Il y a des passages à mourir de rire, d'autres, d'une irrémissible désolation; des envolées inattendues à vous couper le souffle avec des situations cocasses et insolites. Un mélange bien assemblé de registres et de genres, dans une langue souple et coulante, très agréable à lire.
Il refuse le dualisme et discourt sur tout sans complexes ou fausses hontes. Il nous parle de la mort, du sentiment de déracinement dans un monde mondialisé, de la perte de repères de la personne vieillissante. C'est en quelque sorte un exutoire qui lui permet de suppurer la douleur d'un impossible deuil.
Pour Vilas, ce récit est une lettre d'amour et de reconnaissance à ses parents disparus. En vérité c'est beaucoup plus que ça.
Une voix unique et tonitruante. Un récit d'une sincérité implacable. Intrépide et transgresseur. J'ai souvent pensé en lisant ce livre, à ce que disait Genet à propos de la lecture :"si je n'écris pas Les Frères Karamazov en même temps que je lis, je ne fais rien."Je lisais quelques pages, puis je m'arrêtais pour méditer, soupeser, en attendant que ça fasse son effet. C'est une lecture qui m'a apportée, qui m'a pris du temps, le temps qu'il faut, son histoire c'est aussi la nôtre, qu'il raconte d'une manière bouleversante, libératoire et vigoureuse.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas lu un ouvrage de cette carrure, qui nous brise le coeur et nous soulage à la fois.
Si la vérité, dont nous parle ce livre nous tient en haleine du début jusqu'à la fin, c'est parce que, comme dirait Joan Manuel Serrat « nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. »
Il refuse le dualisme et discourt sur tout sans complexes ou fausses hontes. Il nous parle de la mort, du sentiment de déracinement dans un monde mondialisé, de la perte de repères de la personne vieillissante. C'est en quelque sorte un exutoire qui lui permet de suppurer la douleur d'un impossible deuil.
Pour Vilas, ce récit est une lettre d'amour et de reconnaissance à ses parents disparus. En vérité c'est beaucoup plus que ça.
Une voix unique et tonitruante. Un récit d'une sincérité implacable. Intrépide et transgresseur. J'ai souvent pensé en lisant ce livre, à ce que disait Genet à propos de la lecture :"si je n'écris pas Les Frères Karamazov en même temps que je lis, je ne fais rien."Je lisais quelques pages, puis je m'arrêtais pour méditer, soupeser, en attendant que ça fasse son effet. C'est une lecture qui m'a apportée, qui m'a pris du temps, le temps qu'il faut, son histoire c'est aussi la nôtre, qu'il raconte d'une manière bouleversante, libératoire et vigoureuse.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas lu un ouvrage de cette carrure, qui nous brise le coeur et nous soulage à la fois.
Si la vérité, dont nous parle ce livre nous tient en haleine du début jusqu'à la fin, c'est parce que, comme dirait Joan Manuel Serrat « nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. »
Vous aimez les chroniques méchantes ? Vous allez être servis ! Je viens de sacrer Ordesa, livre de l'année dans la catégorie lectrice en colère. Il y en a toujours un ou deux chaque année pour me faire sortir de mes gonds, cette fois, pas de chance, ça tombe sur un livre de la sélection de novembre du Grand prix des lectrices Elle, catégorie Document.
Débuté sans aucun a priori négatif, bien au contraire, il ne m'a fallu qu'une vingtaine de pages pour déchanter complètement. J'ai eu l'impression de lire du Jaenada à la sauce Angot : c'est déprimant, mégalo, décousu car digressif avec un souci du détail qui tourne à l'absurde. Jugez plutôt :
"Je ne sais même pas en quelle année est morte ma grand-mère. Peut-être en 1992 ou en 1993, en 1999 ou en 2001, ou alors en 1996 ou en 2000, dans ces eaux-là." Ai-je le droit de lui dire que très sincèrement on s'en fout ?
Et quand ce ne sont pas des considérations de dates ou de vocable (ma grand-mère est-elle plutôt la mère de mon père ou ma grand-mère ? Vous avez 2 heures !) qui me font bouillir, c'est l'usage de la troisième personne du singulier par l'auteur pour parler de lui-même qui me fait définitivement péter une durite.
Je ne vais pas vous résumer le sujet de ce livre car très sincèrement je n'en ai pas la moindre idée, je me suis tellement énervée sur le style ampoulé, prétentieux, pseudo intello, enfin tout ce que je déteste en littérature, que tout le reste m'a échappé. J'ai eu l'impression de lire du vide complété de vide écrit par un auteur sous anxiolytiques à la recherche d'un public pour effectuer sa psychanalyse à moindres frais. Et par moments je peux vous garantir que j'en aurais bien pris moi aussi des petites pilules pour faire redescendre ma tension car là, elle a atteint des sommets ! Je n'ai même pas réussi à aller au bout de ce livre, j'en étais tout bonnement incapable, sous peine de me le traîner pendant des lustres et de sombrer dans une panne de lecture à la sortie, ce que je ne peux absolument pas me permettre en ce moment.
Evidemment, cet avis brut de décoffrage va complètement à l'encontre de l'avis général puisque Ordesa est salué par la critique (la vraie, celle qui sait apprécier la littérature, la vraie) et fait partie entre autres de la sélection du Prix Médicis Etranger. Mais ça n'est pas une nouveauté que de reconnaître que je n'ai pas bon goût en matière de livres "époustouflants".
Lien : https://www.lettres-et-carac..
Débuté sans aucun a priori négatif, bien au contraire, il ne m'a fallu qu'une vingtaine de pages pour déchanter complètement. J'ai eu l'impression de lire du Jaenada à la sauce Angot : c'est déprimant, mégalo, décousu car digressif avec un souci du détail qui tourne à l'absurde. Jugez plutôt :
"Je ne sais même pas en quelle année est morte ma grand-mère. Peut-être en 1992 ou en 1993, en 1999 ou en 2001, ou alors en 1996 ou en 2000, dans ces eaux-là." Ai-je le droit de lui dire que très sincèrement on s'en fout ?
Et quand ce ne sont pas des considérations de dates ou de vocable (ma grand-mère est-elle plutôt la mère de mon père ou ma grand-mère ? Vous avez 2 heures !) qui me font bouillir, c'est l'usage de la troisième personne du singulier par l'auteur pour parler de lui-même qui me fait définitivement péter une durite.
Je ne vais pas vous résumer le sujet de ce livre car très sincèrement je n'en ai pas la moindre idée, je me suis tellement énervée sur le style ampoulé, prétentieux, pseudo intello, enfin tout ce que je déteste en littérature, que tout le reste m'a échappé. J'ai eu l'impression de lire du vide complété de vide écrit par un auteur sous anxiolytiques à la recherche d'un public pour effectuer sa psychanalyse à moindres frais. Et par moments je peux vous garantir que j'en aurais bien pris moi aussi des petites pilules pour faire redescendre ma tension car là, elle a atteint des sommets ! Je n'ai même pas réussi à aller au bout de ce livre, j'en étais tout bonnement incapable, sous peine de me le traîner pendant des lustres et de sombrer dans une panne de lecture à la sortie, ce que je ne peux absolument pas me permettre en ce moment.
Evidemment, cet avis brut de décoffrage va complètement à l'encontre de l'avis général puisque Ordesa est salué par la critique (la vraie, celle qui sait apprécier la littérature, la vraie) et fait partie entre autres de la sélection du Prix Médicis Etranger. Mais ça n'est pas une nouveauté que de reconnaître que je n'ai pas bon goût en matière de livres "époustouflants".
Lien : https://www.lettres-et-carac..
critiques presse (3)
Patient inventaire des manquements, des échecs et des revers de fortune, le livre est aussi le formidable portrait d’une Espagne désenchantée, une Espagne dont Manuel Vilas, en poète désespéré, tente d’immortaliser la beauté avant que ne survienne le « néant historique et solennel ».
Lire la critique sur le site : Bibliobs
Dans son récit «Ordesa», le quinquagénaire affronte ses fantômes d’autrefois et relate, avec poésie, son enfance dans une famille de la classe moyenne inférieure espagnole sous forme de vignettes, comme autant de fragments d’un passé lacunaire.
Lire la critique sur le site : Liberation
En deuil de ses parents, l’écrivain Manuel Vilas ravive le souvenir d’une modeste famille espagnole à l’heure du franquisme déclinant. Un récit délicat et amer.
Lire la critique sur le site : LeMonde
Citations et extraits (48)
Voir plus
Ajouter une citation
J'ai rouvert l'armoire bleue, sachant que c'était la dernière fois que je le faisais et que jamais je ne la reverrais. La machinerie de guerre, l'artillerie et la cavalerie des jours anciens ont alors débarqué en troupes, et je me suis vu choisir une chemise à l'âge de treize ans, me regarder dans le miroir en me demandant si j'arriverais à impressionner une fille qui me plaisait.
J'ai regardé du côté de ma mère morte pour assister à une tempête de temps et d'anéantissement, un ordre logique auquel je n'étais pas prêt. À croire que mourir est presque ce qui importe le moins.
C'est la dernière fois que je t'ai vue, maman, et j'ai compris à compter de cet instant que j'allais être totalement seul dans la vie, comme tu l'avais été alors que je ne m'en rendais pas compte ou que je n'avais pas voulu m'en rendre compte.
Tu m'abandonnais comme je t'avais abandonnée.
Je devenais toi peu à peu et, ainsi, tu perdurerais et tu vaincrais la mort.
J'aurais dû prendre des dizaines de photos de cette chambre. J'aurais dû photographier tout l'appartement pour que rien ne se perde. Viendra un jour où je ne me souviendrai plus avec exactitude de ce lieu où nous nous sommes tant aimés, et ce jour-là, je deviendrai fou.
J'ai regardé du côté de ma mère morte pour assister à une tempête de temps et d'anéantissement, un ordre logique auquel je n'étais pas prêt. À croire que mourir est presque ce qui importe le moins.
C'est la dernière fois que je t'ai vue, maman, et j'ai compris à compter de cet instant que j'allais être totalement seul dans la vie, comme tu l'avais été alors que je ne m'en rendais pas compte ou que je n'avais pas voulu m'en rendre compte.
Tu m'abandonnais comme je t'avais abandonnée.
Je devenais toi peu à peu et, ainsi, tu perdurerais et tu vaincrais la mort.
J'aurais dû prendre des dizaines de photos de cette chambre. J'aurais dû photographier tout l'appartement pour que rien ne se perde. Viendra un jour où je ne me souviendrai plus avec exactitude de ce lieu où nous nous sommes tant aimés, et ce jour-là, je deviendrai fou.
Il y a de la beauté dans l'hypocondrie, car tout humain, à la moitié de sa vie, passe son temps (peut-être avant de s'endormir, le soir, ou quand il prend les transports publics ou s'assoit dans un cabinet médical) à affabuler sur le genre de maladie qui l'arrachera du monde. Il invente, ourdit des histoires à propos de sa propre mort, qui vont du cancer à l'infarctus, de la mort subite à la vieillesse interminable.
Nul ne sait comment il mourra, et notre appréhension devient mélancolie; la tradition de la mélancolie devrait être remise au goût du jour. C'est un mot que plus personne n'emploie.
Nul ne sait comment il mourra, et notre appréhension devient mélancolie; la tradition de la mélancolie devrait être remise au goût du jour. C'est un mot que plus personne n'emploie.
J'ai été un désastre.
Je n'ai pas compris la vie.
Les conversations avec d'autres humains me semblaient ennuyeuses, lentes, nocives.
Parler avec autrui me faisait mal: je percevais l'inutilité de toutes les discussions humaines passées et futures. (...)
Vanité des conversations, vanité de celui qui parle, vanité de celui qui répond. Vanités négociées pour que le monde puisse exister.
C'est alors que j'ai de nouveau repensé à mon père. Car à mon sens, les conversations que j'avais eues avec lui étaient les seules choses qui valaient la peine.Je suis revenu vers elles dans l'espoir d'obtenir un moment de repos au milieu de l'évanouissement général.
Je n'ai pas compris la vie.
Les conversations avec d'autres humains me semblaient ennuyeuses, lentes, nocives.
Parler avec autrui me faisait mal: je percevais l'inutilité de toutes les discussions humaines passées et futures. (...)
Vanité des conversations, vanité de celui qui parle, vanité de celui qui répond. Vanités négociées pour que le monde puisse exister.
C'est alors que j'ai de nouveau repensé à mon père. Car à mon sens, les conversations que j'avais eues avec lui étaient les seules choses qui valaient la peine.Je suis revenu vers elles dans l'espoir d'obtenir un moment de repos au milieu de l'évanouissement général.
« Si seulement la douleur humaine pouvait se mesurer en chiffres clairs plutôt qu’avec des mots incertains .
S’il y avait moyen de savoir combien nous avons souffert, si seulement la douleur avait de la matière et était quantifiable. .
Tout homme finit un jour ou l’autre par se confronter à l’apesanteur de son passage dans le monde .Certains peuvent le supporter ,cela n’a jamais été mon cas .
Je ne l’ai jamais supporté » …..
S’il y avait moyen de savoir combien nous avons souffert, si seulement la douleur avait de la matière et était quantifiable. .
Tout homme finit un jour ou l’autre par se confronter à l’apesanteur de son passage dans le monde .Certains peuvent le supporter ,cela n’a jamais été mon cas .
Je ne l’ai jamais supporté » …..
« Merci à la vie, qui m’a tellement donné .
Elle m’a donné le rire, elle m’a donné
Les pleurs .
Ainsi je distingue le bonheur du malheur,
Les deux matériaux qui constituent
Mon chant ,
Et votre chant à vous, qui est le même
Chant ,
Et le chant de nous tous, qui est
Mon propre chant . »
VIOLETA PARRA .
Elle m’a donné le rire, elle m’a donné
Les pleurs .
Ainsi je distingue le bonheur du malheur,
Les deux matériaux qui constituent
Mon chant ,
Et votre chant à vous, qui est le même
Chant ,
Et le chant de nous tous, qui est
Mon propre chant . »
VIOLETA PARRA .
Videos de Manuel Vilas (10)
Voir plusAjouter une vidéo
Rencontre animée par Sophie Joubert
Interprète : Manuela Corigliano
Quand Marcelo disparaît, Irene rassemble ses économies, quitte Madrid et embarque pour un voyage autour de la Méditerranée à bord d'un cabriolet. de restaurants en hôtels de luxe, de la Cinecittà à Sète, des décors de Ben-Hur aux cimetières marins, chaque escale a son lot de solitude et de rencontres. Telle une sorcière de l'amour invoquant le fantôme de Marcelo, elle ressuscite l'homme de sa vie dans le corps consommé des amants qu'elle collectionne, jusqu'à ce que le roman d'amour prenne des allures de thriller dramatique…
En partenariat avec l'Institut Cervantes.
À lire – Manuel Vilas, Irene, trad. de l'espagnol par Isabelle Gugnon, éditions du sous-sol, 2024.
Quand Marcelo disparaît, Irene rassemble ses économies, quitte Madrid et embarque pour un voyage autour de la Méditerranée à bord d'un cabriolet. de restaurants en hôtels de luxe, de la Cinecittà à Sète, des décors de Ben-Hur aux cimetières marins, chaque escale a son lot de solitude et de rencontres. Telle une sorcière de l'amour invoquant le fantôme de Marcelo, elle ressuscite l'homme de sa vie dans le corps consommé des amants qu'elle collectionne, jusqu'à ce que le roman d'amour prenne des allures de thriller dramatique…
En partenariat avec l'Institut Cervantes.
À lire – Manuel Vilas, Irene, trad. de l'espagnol par Isabelle Gugnon, éditions du sous-sol, 2024.
+ Lire la suite
autres livres classés : littérature espagnoleVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Manuel Vilas (5)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Littérature espagnole au cinéma
Qui est le fameux Capitan Alatriste d'Arturo Pérez-Reverte, dans un film d'Agustín Díaz Yanes sorti en 2006?
Vincent Perez
Olivier Martinez
Viggo Mortensen
10 questions
95 lecteurs ont répondu
Thèmes :
cinema
, espagne
, littérature espagnoleCréer un quiz sur ce livre95 lecteurs ont répondu