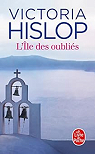Carl Watson/5
2 notes
Résumé :
" En cette époque où la plupart des fictions brèves sont tellement affectées qu'elles se pavanent sur la page comme un acteur vaniteux sur une scène, les mots de Watson nous donnent quelque chose de bon, quelque chose de réel. En cela, son ¦oeuvre est d'une valeur rare. Nul entrant ici n'en ressortira tout à fait le même. " Nick Tosches dans sa préface pour l'édition en langue française de ce recueil de récits de l¹écrivain américain Carl Watson, dont les éditions G... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Sous l'empire des oiseauxVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Quinze nouvelles de 1997, et l'une des plus belles écritures contemporaines de la globalité psychologique et politique des envers du décor, de tout ce qui glisse et tombe à l'ombre de l'individu-roi.
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2021/11/11/note-de-lecture-sous-lempire-des-oiseaux-carl-watson/
Souvent comparé ou associé à Charles Bukowski ou à Hubert Selby Jr., le New-Yorkais Carl Watson, né en 1957, poursuit au fil des années une oeuvre pourtant davantage inclassable, me semble-t-il, rare dans ses fulgurances, économe dans ses moyens et sa fréquence d'apparition, longtemps rendue discrète par la multiplication des boulots alimentaires de toute nature, et aujourd'hui encore inscrite dans les interstices d'un travail d'enseignement de la littérature et de recherche sur les écrits d'Henry Darger. Comme Larry Fondation ou Jerry Wilson, avec qui il partage certainement une extrême attention portée aux laissés-pour-compte du vaste rêve irisé américain, à leurs conditions matérielles d'existence comme à leurs vicissitudes psycho-sociales, il porte un fer à souder particulièrement brûlant dans des recoins urbains ou semi-ruraux fort mal jointoyés, là où se dit quelque chose d'essentiel à propos de nos civilisations, de ce qu'elles se refusent à voir et à faire pour le bien de toutes et tous. Il s'y ajoute peut-être dans son cas une langue réellement exceptionnelle, capable de déployer sa chirurgie géographique et politique aussi bien dans les contraintes salutaires de la forme courte que dans les espaces plus ouverts en apparence du roman.
« Sous l'empire des oiseaux », publié en 1997, traduit par Daniel Bismuth et Thierry Marignac à l'Olivier en 1999, avant d'être repris et augmenté en 2007 chez Vagabonde (qui suit désormais intégralement l'auteur, comme cette belle maison d'édition aime particulièrement à le pratiquer), est son premier recueil de nouvelles, apparu alors que jusque là seuls des poèmes et de brefs essais avaient trouvé le chemin de l'édition underground new-yorkaise, mais que simultanément son roman « Hôtel des actes irrévocables » sortait en français chez Gallimard, dix ans avant d'être publié aux États-Unis.
Cette photographie de l'auteur, prise par l'anthropologue photographe Valérie Jouve en 1998, reflète de façon extraordinairement directe l'atmosphère inquiète qui hante les quinze nouvelles présentées ici. Toutes fascinantes, on y distinguera toutefois peut-être plus particulièrement l'étonnant survol géographique intime, véritable vue en coupe d'une ville malade, proposé par « le damier des dindons », la fabuleuse incision onirique, jouant aux confins du fantastique et de la maladie mentale inavouée, opérée par « La chambre d'Harry », la sublime mise en perspective d'une carrière avortée et rongée par l'alcool (avec de belles résonances du côté du « Alcool Mon Amour » d'Andréas Becker) de « L'avenir est une maladie », le rêve micro-industriel et mécanique de « Active la machine » (avec sa lente glissade presque rêveuse en direction du « À la ligne – Feuillets d'usine » de Joseph Ponthus), la minutieuse et acérée géographie rurale sulfureuse de « le sang sur la plaine est un piège », ou encore l'impensable sens de la métaphore absurde qui irrigue « Sous l'empire des oiseaux ».
Très loin de se réduire à des fragments de dèche et de défonce plus ou moins enflammés et tortueux, datés par les sixties et seventies, dans lesquels certains commentateurs français parfois un rien rapides aiment à compacter Carl Watson, il nous est offert ici, ancrée bien entendu dans une dérive miséreuse presque inexorable, sous les formes les plus variées, l'une des plus belles écritures contemporaines de la globalité psychologique et politique des envers du décor, de tout ce qui glisse et tombe à l'ombre de l'individu-roi.
Lien : https://charybde2.wordpress...
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2021/11/11/note-de-lecture-sous-lempire-des-oiseaux-carl-watson/
Souvent comparé ou associé à Charles Bukowski ou à Hubert Selby Jr., le New-Yorkais Carl Watson, né en 1957, poursuit au fil des années une oeuvre pourtant davantage inclassable, me semble-t-il, rare dans ses fulgurances, économe dans ses moyens et sa fréquence d'apparition, longtemps rendue discrète par la multiplication des boulots alimentaires de toute nature, et aujourd'hui encore inscrite dans les interstices d'un travail d'enseignement de la littérature et de recherche sur les écrits d'Henry Darger. Comme Larry Fondation ou Jerry Wilson, avec qui il partage certainement une extrême attention portée aux laissés-pour-compte du vaste rêve irisé américain, à leurs conditions matérielles d'existence comme à leurs vicissitudes psycho-sociales, il porte un fer à souder particulièrement brûlant dans des recoins urbains ou semi-ruraux fort mal jointoyés, là où se dit quelque chose d'essentiel à propos de nos civilisations, de ce qu'elles se refusent à voir et à faire pour le bien de toutes et tous. Il s'y ajoute peut-être dans son cas une langue réellement exceptionnelle, capable de déployer sa chirurgie géographique et politique aussi bien dans les contraintes salutaires de la forme courte que dans les espaces plus ouverts en apparence du roman.
« Sous l'empire des oiseaux », publié en 1997, traduit par Daniel Bismuth et Thierry Marignac à l'Olivier en 1999, avant d'être repris et augmenté en 2007 chez Vagabonde (qui suit désormais intégralement l'auteur, comme cette belle maison d'édition aime particulièrement à le pratiquer), est son premier recueil de nouvelles, apparu alors que jusque là seuls des poèmes et de brefs essais avaient trouvé le chemin de l'édition underground new-yorkaise, mais que simultanément son roman « Hôtel des actes irrévocables » sortait en français chez Gallimard, dix ans avant d'être publié aux États-Unis.
Cette photographie de l'auteur, prise par l'anthropologue photographe Valérie Jouve en 1998, reflète de façon extraordinairement directe l'atmosphère inquiète qui hante les quinze nouvelles présentées ici. Toutes fascinantes, on y distinguera toutefois peut-être plus particulièrement l'étonnant survol géographique intime, véritable vue en coupe d'une ville malade, proposé par « le damier des dindons », la fabuleuse incision onirique, jouant aux confins du fantastique et de la maladie mentale inavouée, opérée par « La chambre d'Harry », la sublime mise en perspective d'une carrière avortée et rongée par l'alcool (avec de belles résonances du côté du « Alcool Mon Amour » d'Andréas Becker) de « L'avenir est une maladie », le rêve micro-industriel et mécanique de « Active la machine » (avec sa lente glissade presque rêveuse en direction du « À la ligne – Feuillets d'usine » de Joseph Ponthus), la minutieuse et acérée géographie rurale sulfureuse de « le sang sur la plaine est un piège », ou encore l'impensable sens de la métaphore absurde qui irrigue « Sous l'empire des oiseaux ».
Très loin de se réduire à des fragments de dèche et de défonce plus ou moins enflammés et tortueux, datés par les sixties et seventies, dans lesquels certains commentateurs français parfois un rien rapides aiment à compacter Carl Watson, il nous est offert ici, ancrée bien entendu dans une dérive miséreuse presque inexorable, sous les formes les plus variées, l'une des plus belles écritures contemporaines de la globalité psychologique et politique des envers du décor, de tout ce qui glisse et tombe à l'ombre de l'individu-roi.
Lien : https://charybde2.wordpress...
Citations et extraits (4)
Ajouter une citation
C’est comme si le regard forçait les formes à communiquer. Cette communication prend souvent l’aspect d’une parodie, un type de relations fondées sur des champs de références et de délégations. Une fourmilière dans un terrain vague, par exemple, parodie l’imposant hôtel Leland qui s’élève juste en bordure ; un panneau d’affichage annonçant « une vie meilleure » pastiche le quartier qui l’entoure.
Il existe aussi ce jeu spécial entre présence et absence, qui survient lorsque le sujet a été amputé de certaines parties, et c’est souvent le cas d’Uptown. De nombreux morceaux du puzzle manquent à l’appel. L’absence parodie la présence. C’est ainsi qu’un terrain vague devient une parodie de tout ce qu’il n’est pas : terrain de jeu ou marché couvert. Beaucoup d’immeubles sont flanqués d’un jumeau disparu qui se moque d’eux et les envie tout à la fois. Les espaces vides continuent de croître, ponctuant le quadrillage comme les trous d’une carte perforée ou les fenêtres brisées d’immeubles laissés à l’abandon. Et pareillement au temps et à l’espace, qui sont souvent interchangeables, futur et passé se conjuguent pour parodier le présent ; il en est ainsi des bâtiments promis à une prochaine démolition ou des fantômes de ceux qui s’élevèrent autrefois.
Le vide peut servir de prétexte à une ambition mercantile mais il encourage aussi la violence en poussant le moi à la possession. Entre Wilson et Magnolia s’étend un terrain vague propice aux combats de chiens. Ceux-ci éclatent spontanément, en dehors de tout instinct territorial, et ils parodient, en un sens, les luttes qui déchirent les êtres humains. D’ailleurs, ceux qui traînent autour des terrains vagues et passent leur temps à boire et à jurer sont très souvent enclins à la violence, qu’elle soit physique ou émotionnelle.
C’est la nature même de la parodie – témoignage de l’intelligence de l’univers – que toute chose finisse par se parodier elle-même ; c’est le sort des gens vivants à Uptown, qui incarnent la présence physique du quartier. Et comme la parodie est une forme de violence émotionnelle, il est compréhensible que ce soit la présence d’autres êtres humains semblables à eux-mêmes qui irrite le plus les gens. Cela fonctionne sur le même modèle que le miroir – par la raillerie.
Mais bon, Uptown est le secteur des tristement célèbres « immeubles corridors », ainsi baptisés par leurs propriétaires en raison de leurs intérieurs intimidants – des labyrinthes formés de longs couloirs bordés de portes anonymes. Ces bâtiments sont souvent humides et crasseux, parfois même hantés. Ils peuvent porter des noms majestueux comme Au blason Untel, Au manoir Tartempion. Certains n’ont qu’une adresse pour les définir, tel le fameux 4160 N. Malden, situé à l’angle sud-ouest du carrefour Magnolia-Wilson. Derrière sa façade fantaisiste se dissimule une vaste prison de deux pièces et de studios de dernière catégorie. La claustrophobie qui règne à l’intérieur de l’immeuble, inhérente à la rucge qu’on y découvre, pousse ses occupants dans la cour ; là, ils s’appuient aux palissades et font les cent pas, tout comme ils faisaient les cent pas dans les couloirs. Dehors, dedans, cela ne fait que circuler – l’intérieur doit communiquer avec l’extérieur afin de prouver d’une manière ou d’une autre que c’est différent et que cela mérite d’exister. Ça fait partie de l’énigme. (« Le damier des dindons »)
Il existe aussi ce jeu spécial entre présence et absence, qui survient lorsque le sujet a été amputé de certaines parties, et c’est souvent le cas d’Uptown. De nombreux morceaux du puzzle manquent à l’appel. L’absence parodie la présence. C’est ainsi qu’un terrain vague devient une parodie de tout ce qu’il n’est pas : terrain de jeu ou marché couvert. Beaucoup d’immeubles sont flanqués d’un jumeau disparu qui se moque d’eux et les envie tout à la fois. Les espaces vides continuent de croître, ponctuant le quadrillage comme les trous d’une carte perforée ou les fenêtres brisées d’immeubles laissés à l’abandon. Et pareillement au temps et à l’espace, qui sont souvent interchangeables, futur et passé se conjuguent pour parodier le présent ; il en est ainsi des bâtiments promis à une prochaine démolition ou des fantômes de ceux qui s’élevèrent autrefois.
Le vide peut servir de prétexte à une ambition mercantile mais il encourage aussi la violence en poussant le moi à la possession. Entre Wilson et Magnolia s’étend un terrain vague propice aux combats de chiens. Ceux-ci éclatent spontanément, en dehors de tout instinct territorial, et ils parodient, en un sens, les luttes qui déchirent les êtres humains. D’ailleurs, ceux qui traînent autour des terrains vagues et passent leur temps à boire et à jurer sont très souvent enclins à la violence, qu’elle soit physique ou émotionnelle.
C’est la nature même de la parodie – témoignage de l’intelligence de l’univers – que toute chose finisse par se parodier elle-même ; c’est le sort des gens vivants à Uptown, qui incarnent la présence physique du quartier. Et comme la parodie est une forme de violence émotionnelle, il est compréhensible que ce soit la présence d’autres êtres humains semblables à eux-mêmes qui irrite le plus les gens. Cela fonctionne sur le même modèle que le miroir – par la raillerie.
Mais bon, Uptown est le secteur des tristement célèbres « immeubles corridors », ainsi baptisés par leurs propriétaires en raison de leurs intérieurs intimidants – des labyrinthes formés de longs couloirs bordés de portes anonymes. Ces bâtiments sont souvent humides et crasseux, parfois même hantés. Ils peuvent porter des noms majestueux comme Au blason Untel, Au manoir Tartempion. Certains n’ont qu’une adresse pour les définir, tel le fameux 4160 N. Malden, situé à l’angle sud-ouest du carrefour Magnolia-Wilson. Derrière sa façade fantaisiste se dissimule une vaste prison de deux pièces et de studios de dernière catégorie. La claustrophobie qui règne à l’intérieur de l’immeuble, inhérente à la rucge qu’on y découvre, pousse ses occupants dans la cour ; là, ils s’appuient aux palissades et font les cent pas, tout comme ils faisaient les cent pas dans les couloirs. Dehors, dedans, cela ne fait que circuler – l’intérieur doit communiquer avec l’extérieur afin de prouver d’une manière ou d’une autre que c’est différent et que cela mérite d’exister. Ça fait partie de l’énigme. (« Le damier des dindons »)
Une fois j’ai travaillé en usine, pas qu’une fois en fait, et ça a toujours été un boulet. Mais bon, c’est censé être comme ça. On n’est pas censé aimer ça. On le fait pour le fric, c’est tout, comme tout le reste. Pour le fric, l’amour, ou bien à cause d’un macabre instinct de mort. C’est peut-être la même chose tout ça, en fin de compte. On n’a pas non plus tellement le temps d’y réfléchir. Si on ferme les yeux trop longtemps, ça y est, c’est fini, la vie est passée. (« Active la machine »)
Il arrive assez souvent, en ville, que le passant voie des objets voler par les fenêtres – une assiette, une bouteille, un carton plein d’os de poulets, parfois même une pierre représentant un visage. Ça n’est rien, en fait, ça n’a aucune importance. C’est le mode de vie des gens d’ici qui veut ça – un acte parmi d’autres, en direction d’une possible appropriation de la lumière et de l’espace vital. Tout comme la lumière réclame de l’espace pour se déployer, l’esprit doit s’envoler pour supporter de vivre – les oiseaux le savent bien, et ça ne peut que nous émerveiller. Voir, ressentir, sans jamais être obligé de toucher. C’est pourquoi nous les envions. (« Sous l’empire des oiseaux »)
Il arrive assez souvent, en ville, que le passant voie des objets voler par les fenêtres – une assiette, une bouteille, un carton plein d’os de poulets, parfois même une pierre représentant un visage. Ça n’est rien, en fait, ça n’a aucune importance. C’est le mode de vie des gens d’ici qui veut ça – un acte parmi d’autres, en direction d’une possible appropriation de la lumière et de l’espace vital. Tout comme la lumière réclame de l’espace pour se déployer, l’esprit doit s’envoler pour supporter de vivre – les oiseaux le savent bien, et ça ne peut que nous émerveiller. Voir, ressentir, sans jamais être obligé de toucher. C’est pourquoi nous les envions. (« Sous l’empire des oiseaux »)
Tant au sud qu’au nord, les principales voies d’accès qui mènent à Uptown sont Broadway et Sheridan Road. Surtout Broadway, en fait, tout simplement parce qu’il existe un Broadway dans quantité de villes, qu’ils ont tous une spécificité légèrement différente les uns des autres et qu’à ce nom s’attache une riche tradition de souvenirs, des associations d’idées, des nuances, des tics civiques et historiques. Parfois, il s’agit d’une rue où s’alignent les ballets de french cancan, où les théâtres rivalisent d’enseignes lumineuses, une chaude artère où prolifèrent les boîtes de nuit. Cela peut aussi se résumer à une galerie marchande d’une banalité affligeante. Mais ici, à Uptown, il s’agit d’une avenue aux devantures barrées par des planches, aux portes condamnées, vestiges d’un quartier autrefois plein de vitalité, aujourd’hui peuplé par les carapaces solitaires des déshérités en rupture de ban – une avenue abandonnée à la poussière et aux mauvaises herbes, propice aux règlements de comptes entre chien et loup. Broadway coupe Sheridan Road (il s’agit du général Sheridan) à Montrose selon un angle à vingt degrés formant un X aplati.
Comme dans n’importe quelle ville, et comme n’importe où dans le monde du reste, c’est par toute une géométrie de frontières, visibles ou invisibles, que se manifeste la politique de démarcation, les tracés qui séparent l’aisance de la pauvreté, la conformité de la marge. Ainsi, le quartier d’Uptown trace-t-il un damier économique au sein duquel des termes – tels que corridor, parallèle, adjacent, couloir aérien, protubérant, perpendiculaire, limitrophe, barré, sectorisé, souligné de rouge, sondé, tangentiel, bordant, planifié, usé jusqu’à la corde, ascendant, descendant, rénové, six pièces de luxe – servent à décrire l’inégalité des précipitations spatiales qui à la fois divisent et réunissent les populations par affinité. (« Le damier des dindons »)
Comme dans n’importe quelle ville, et comme n’importe où dans le monde du reste, c’est par toute une géométrie de frontières, visibles ou invisibles, que se manifeste la politique de démarcation, les tracés qui séparent l’aisance de la pauvreté, la conformité de la marge. Ainsi, le quartier d’Uptown trace-t-il un damier économique au sein duquel des termes – tels que corridor, parallèle, adjacent, couloir aérien, protubérant, perpendiculaire, limitrophe, barré, sectorisé, souligné de rouge, sondé, tangentiel, bordant, planifié, usé jusqu’à la corde, ascendant, descendant, rénové, six pièces de luxe – servent à décrire l’inégalité des précipitations spatiales qui à la fois divisent et réunissent les populations par affinité. (« Le damier des dindons »)
Il rencontrait beaucoup de gens dans les rues du marché – des pickpockets gitans, des bonimenteurs de fête foraine qui lui proposaient du boulot – toutes sortes de types, en fait – et nombre d’entre eux prétendaient l’avoir connu dans un passé oublié, une autre vie peut-être, une autre identité, à l’époque où il était sans abri et écumait les rues à la recherche d’amour, de camaraderie ou, du moins, d’un domicile.
Mais ce n’était pas seulement les hommes, les femmes et le chaos du marché qui en faisaient le prix à ses yeux, ni le réconfort postapocalyptique des poubelles dans lesquelles on faisait du feu sur les terrains vagues, ni les cabines où l’on vendait de faux papiers, ni les sucreries et les gâteaux rassis empilés, ni les ritournelles, ni le boniment des camelots, ni même le battement de la vie qui semblait sourdre de l’asphalte. Ce n’était pas ce qu’on voyait, ce qu’on entendait. Non, c’était plutôt olfactif.
Oui, très souvent, c’était l’odeur la sensation la plus marquante – les marchés les meilleurs sentaient la mer, la saumure et la levure de bière, le poisson et les algues. Harry pensait qu’il y avait une relation étroite entre cette odeur et les cavités sensuelles du corps humain telles qu’il les connaissait, comme si le marché était une représentation extériorisée des richesses que nous avions possédées avant la naissance, mais aussi, ironiquement, la déchéance de cette pureté. (« La chambre d’Harry »)
Mais ce n’était pas seulement les hommes, les femmes et le chaos du marché qui en faisaient le prix à ses yeux, ni le réconfort postapocalyptique des poubelles dans lesquelles on faisait du feu sur les terrains vagues, ni les cabines où l’on vendait de faux papiers, ni les sucreries et les gâteaux rassis empilés, ni les ritournelles, ni le boniment des camelots, ni même le battement de la vie qui semblait sourdre de l’asphalte. Ce n’était pas ce qu’on voyait, ce qu’on entendait. Non, c’était plutôt olfactif.
Oui, très souvent, c’était l’odeur la sensation la plus marquante – les marchés les meilleurs sentaient la mer, la saumure et la levure de bière, le poisson et les algues. Harry pensait qu’il y avait une relation étroite entre cette odeur et les cavités sensuelles du corps humain telles qu’il les connaissait, comme si le marché était une représentation extériorisée des richesses que nous avions possédées avant la naissance, mais aussi, ironiquement, la déchéance de cette pureté. (« La chambre d’Harry »)
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Carl Watson (5)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Arts et littérature ...
Quelle romancière publie "Les Hauts de Hurle-vent" en 1847 ?
Charlotte Brontë
Anne Brontë
Emily Brontë
16 questions
1081 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, art
, musique
, peinture
, cinemaCréer un quiz sur ce livre1081 lecteurs ont répondu