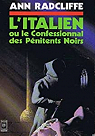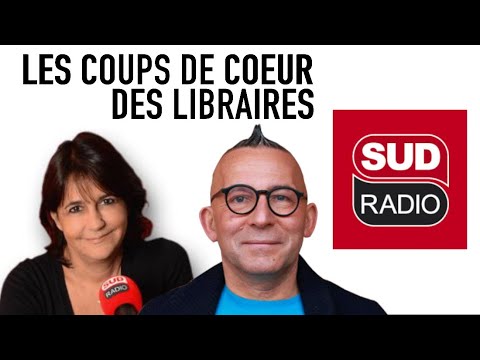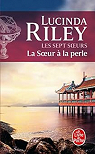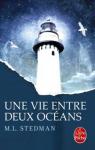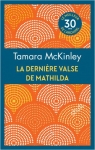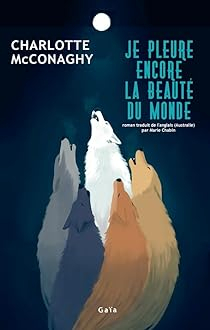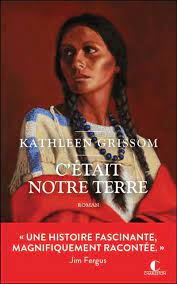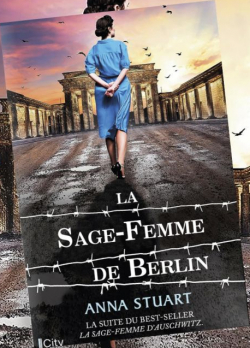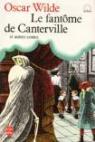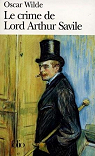Oscar Wilde/5
15 notes
Résumé :
Cette Chasse à l'opossum, dont l'attribution à Oscar Wilde est régulièrement contestée, représente davantage qu'une simple curiosité dans l'oeuvre de l'auteur du Portrait de Dorian Gray. Le narrateur raconte une étrange partie de chasse dans le bush australien, en compagnie d'un ami, de quelques bushmen et d'aborigènes. L'opossum, animal curieux aux particularités singulières constitue un gibier unique, qui ne peut se prendre qu'en obéissant à certaines règles. Docu... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La Chasse à l'opossumVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (5)
Ajouter une critique
O tempora, o possum... *
[Latin de cuisine détournant honteusement une célèbre citation de Cicéron]
Opossum (source : wikipedia) : «Trichosurus vulpecula, appelé Phalanger-renard (ou Phalanger renard), Phalanger vulpin, Phalanger commun, Opossum d'Australie, Opossum à queue en brosse, Cousou ou localement « possum » (ne pas confondre avec les opossums d'Amérique), est une espèce de petit marsupial arboricole australien à queue préhensile qui se nourrit de feuillages et de fruits mais aussi d'insectes, d'oeufs et d'oisillons. Introduit en Nouvelle-Zélande pour sa fourrure, il y est à présent considéré comme une espèce invasive car, sans prédateur sur cette île, il pille les nids, blesse les arbres et transmet la tuberculose bovine.»
Voilà donc la bête épouvantable et féroce que cette nouvelle nous propose d'aller chasser - tout littérairement, il va sans dire.
Ces petites bêtes nocturnes, essentiellement frugivores - hou, hou, on meurt de trouille pour ces intrépides chasseurs -, de la taille d'un très gros rat sont aussi inoffensives qu'un lapin mais à la différence de ces deniers, ils vivent dans les arbres. C'est pourtant ce que le narrateur s'en va nous conter, tandis qu'il suit un sien ami d'enfance répondant au prénom De Robert, un "bushman" et deux braques spécialisés dans cette chasse ô combien imprévisible...
Pour donner un peu de relief à "La chasse à l'opossum" sans grande surprise (en raison même de l'animal traqué), l'auteur nous fera croiser les traces immémoriales de quelques chasseurs aborigènes dont il nous fera découvrir la dextérité proche de l'impossible avec leurs fameux boomerang. le narrateur de s'étonner d'ailleurs en des termes assez peu amène pour ce peuple premier : «C'est véritablement étonnant, et je me demande par quel hasard, par quelle intuition, des sauvages d'un degré de civilisation infime ont pu découvrir un instrument à la fois si peu compliqué et d'une telle puissance d'action que toute la science moderne a peine à s'en rendre compte.»
Petit ouvrage paru en français en 1888, chez un petit éditeur parisien répondant au nom de Lecène et Oudin, cet ouvrage signé d'un étrange Oscar Wild (sans "e") ce qui explique qu'aujourd'hui encore, nombre des spécialistes d'Oscar Wilde refuse de lui attribuer ce petit récit de chasse exotique et de rencontre ethnologique dont il faut bien avouer que s'il est charmant (dans son genre), il n'en constitue pas pour autant un ouvrage d'un grand intérêt littéraire. Il est vrai qu'on peine à y retrouver la verve mordante, l'humour noir et souvent cynique de celui qui proclamait qu'il fallait mettre son génie dans sa vie et son talent dans ses oeuvres. Moins encore la puissance d'évocation de son terrible témoignage intitulé La Balade de la geôle de Reading...
Apocryphe ou simple exercice de style en français de l'auteur irlandais du célèbre roman le portrait de Dorian Gray, ce petit opuscule élégamment réédité aux éditions "La part commune" permettra, pour le mieux, de patienter quelques longues minutes dans une salle d'attente ou d'éviter l'ennui dans les transports en commun...
[Latin de cuisine détournant honteusement une célèbre citation de Cicéron]
Opossum (source : wikipedia) : «Trichosurus vulpecula, appelé Phalanger-renard (ou Phalanger renard), Phalanger vulpin, Phalanger commun, Opossum d'Australie, Opossum à queue en brosse, Cousou ou localement « possum » (ne pas confondre avec les opossums d'Amérique), est une espèce de petit marsupial arboricole australien à queue préhensile qui se nourrit de feuillages et de fruits mais aussi d'insectes, d'oeufs et d'oisillons. Introduit en Nouvelle-Zélande pour sa fourrure, il y est à présent considéré comme une espèce invasive car, sans prédateur sur cette île, il pille les nids, blesse les arbres et transmet la tuberculose bovine.»
Voilà donc la bête épouvantable et féroce que cette nouvelle nous propose d'aller chasser - tout littérairement, il va sans dire.
Ces petites bêtes nocturnes, essentiellement frugivores - hou, hou, on meurt de trouille pour ces intrépides chasseurs -, de la taille d'un très gros rat sont aussi inoffensives qu'un lapin mais à la différence de ces deniers, ils vivent dans les arbres. C'est pourtant ce que le narrateur s'en va nous conter, tandis qu'il suit un sien ami d'enfance répondant au prénom De Robert, un "bushman" et deux braques spécialisés dans cette chasse ô combien imprévisible...
Pour donner un peu de relief à "La chasse à l'opossum" sans grande surprise (en raison même de l'animal traqué), l'auteur nous fera croiser les traces immémoriales de quelques chasseurs aborigènes dont il nous fera découvrir la dextérité proche de l'impossible avec leurs fameux boomerang. le narrateur de s'étonner d'ailleurs en des termes assez peu amène pour ce peuple premier : «C'est véritablement étonnant, et je me demande par quel hasard, par quelle intuition, des sauvages d'un degré de civilisation infime ont pu découvrir un instrument à la fois si peu compliqué et d'une telle puissance d'action que toute la science moderne a peine à s'en rendre compte.»
Petit ouvrage paru en français en 1888, chez un petit éditeur parisien répondant au nom de Lecène et Oudin, cet ouvrage signé d'un étrange Oscar Wild (sans "e") ce qui explique qu'aujourd'hui encore, nombre des spécialistes d'Oscar Wilde refuse de lui attribuer ce petit récit de chasse exotique et de rencontre ethnologique dont il faut bien avouer que s'il est charmant (dans son genre), il n'en constitue pas pour autant un ouvrage d'un grand intérêt littéraire. Il est vrai qu'on peine à y retrouver la verve mordante, l'humour noir et souvent cynique de celui qui proclamait qu'il fallait mettre son génie dans sa vie et son talent dans ses oeuvres. Moins encore la puissance d'évocation de son terrible témoignage intitulé La Balade de la geôle de Reading...
Apocryphe ou simple exercice de style en français de l'auteur irlandais du célèbre roman le portrait de Dorian Gray, ce petit opuscule élégamment réédité aux éditions "La part commune" permettra, pour le mieux, de patienter quelques longues minutes dans une salle d'attente ou d'éviter l'ennui dans les transports en commun...
Cette nouvelle d'Oscar Wilde (si tant est que ce texte soit bien de lui, il ne fait pas partie de la bibliographie officielle de l'auteur) est assez déconcertante : véritable documentaire sur la chasse à l'opossum, elle ne ressemble en rien à ce que j'ai pu lire jusqu'à présent de l'auteur Irlandais.
Point d'ironie ou de regard acerbe sur la société mais une description minutieuse d'une partie de chasse en Australie.
L'auteur décrit avec grande précision son environnement, les bushmen, la façon de chasser, le maniement du boomerang... Il nous fait un petit court de biologie puisqu'il explique par le menu ce qu'est un opossum ("En résumé, ce charmant petit animal m'a bien paru faire partie de la famille des sarigues et kanguroos et, par conséquent, être un marsupiau.").
Le lecteur de l'époque y a peut-être trouvé son compte mais pas moi, je me suis ennuyée. Fort heureusement, la nouvelle est courte et le mal n'a pas duré longtemps.
J'en suis encore à me demander où Wilde (ou qui que ce soit d'autre) voulait en venir avec ce récit sauvage.
Point d'ironie ou de regard acerbe sur la société mais une description minutieuse d'une partie de chasse en Australie.
L'auteur décrit avec grande précision son environnement, les bushmen, la façon de chasser, le maniement du boomerang... Il nous fait un petit court de biologie puisqu'il explique par le menu ce qu'est un opossum ("En résumé, ce charmant petit animal m'a bien paru faire partie de la famille des sarigues et kanguroos et, par conséquent, être un marsupiau.").
Le lecteur de l'époque y a peut-être trouvé son compte mais pas moi, je me suis ennuyée. Fort heureusement, la nouvelle est courte et le mal n'a pas duré longtemps.
J'en suis encore à me demander où Wilde (ou qui que ce soit d'autre) voulait en venir avec ce récit sauvage.
Euh… C'est quoi cette nouvelle ? Aucun intérêt, rien. Rien de l'ironie qui est tellement délicieuse chez Wilde, rien de son dandisme exaspérant. peut-être que dans un recueil de nouvelles ce texte passerait comme une erreur de parcours, mais publié seul ainsi, je m'interroge sur son intérêt et son sens. Est-ce un véritable souvenir de son voyage en Australie, mais alors quel est l'intérêt de cette scène de chasse. On est bien loin des souvenirs virils et brûlants de soleil d'Hemingway ou des observations sagaces de Gheerbrant.
J'attendais une petite distraction wildienne, j'ai eu une vingtaine de pages qui ne me laisseront aucun souvenir.
J'attendais une petite distraction wildienne, j'ai eu une vingtaine de pages qui ne me laisseront aucun souvenir.
Il est intéressant d'avoir la vision d'un jeune noble européen (en admettant que Wilde en soit bien l'auteur) sur les contrées sauvages de l'Australie et sur les Aborigènes. Tantôt dédaigneux, tantôt écoeuré, tantôt admiratif, il découvre et c'est assez évident. du reste, cette courte nouvelle n'est pas transcendante et encore moins palpitante. Il ne s'y passe pas grand-chose, cela fait un peu extraits de journal, bribes choisies sans grand travail sur les émotions ou les situations, mais ça se lit vite et bien.
Rien qu'une partie de chasse! Aussi simplement possible, un simple regard sur les Bushmen de l'australie!!!
Citations et extraits (9)
Voir plus
Ajouter une citation
- Me diras-tu maintenant, Robert, quel genre de gibier nous venons chasser dans ces solitudes ?
- Oui mon ami, j'ai voulu te procurer le plaisir d'une chasse à l'opossum.
- Maigre proie, si j'en crois ce que j'ai lu dans les livres d'histoires naturelles.
- On chasse ce que l'on peut, mon cher.
- Il est bien certain qu'en fait de gibier, l’Australie laisse à désirer.
- Oui mon ami, j'ai voulu te procurer le plaisir d'une chasse à l'opossum.
- Maigre proie, si j'en crois ce que j'ai lu dans les livres d'histoires naturelles.
- On chasse ce que l'on peut, mon cher.
- Il est bien certain qu'en fait de gibier, l’Australie laisse à désirer.
Les opossums que j'avais là devant moi, étaient de la grosseur d'un fort lièvre ; le plus lourd pesait environ huit à dix livres.
Le pelage était, brun fauve et bien fourni ; le dessous du corps et l'intérieur des pattes, gris clair ; la queue, aussi longue que le reste du corps, était garnie, en dessus, de longs poils, en dessous, absolument nue ; c'est sans doute ce qui permet à l'opossum de s'en servir pour s'accrocher ou se soutenir ; les pattes, d'inégale grandeur, celles de devant un peu plus courtes que celles de derrière, étaient armées de griffes longues et acérées. La tête fine, le nez pointu, les yeux très grands et surmontés d'une tache brun clair qui chez les chiens s'appellent : feu. Cette particularité l'a fait nommer quatre-œils, dans certaines contrées de l'Amérique du Sud, où il est très abondant.
En résumé, ce charmant petit animal m'a bien paru faire partie de la famille des sarigues et kanguroos et, par conséquent, être un marsupiau.
Le pelage était, brun fauve et bien fourni ; le dessous du corps et l'intérieur des pattes, gris clair ; la queue, aussi longue que le reste du corps, était garnie, en dessus, de longs poils, en dessous, absolument nue ; c'est sans doute ce qui permet à l'opossum de s'en servir pour s'accrocher ou se soutenir ; les pattes, d'inégale grandeur, celles de devant un peu plus courtes que celles de derrière, étaient armées de griffes longues et acérées. La tête fine, le nez pointu, les yeux très grands et surmontés d'une tache brun clair qui chez les chiens s'appellent : feu. Cette particularité l'a fait nommer quatre-œils, dans certaines contrées de l'Amérique du Sud, où il est très abondant.
En résumé, ce charmant petit animal m'a bien paru faire partie de la famille des sarigues et kanguroos et, par conséquent, être un marsupiau.
C’est véritablement étonnant, et je me demande par quel hasard, par quelle intuition, des sauvages d’un degré de civilisation infime ont pu découvrir [le boomerang,] un instrument à la fois si peu compliqué et d’une telle puissance d’action que toute la science moderne a peine à s’en rendre compte. (p. 23).
Figure-toi, dans les plaines, des bandes de kanguroos qui procèdent par bonds au, lieu de courir et emportent leurs petits dans une poche ; des autruches, qu'ils nomment ici émeus, couvertes de poils, au lieu de porter des plumes comme leurs congénères d'Afrique ; sur le bord dés rivières et des lacs, des mammifères amphibies, avec un corps de loutre et un bec de canard ; c'est l'ornithorynque.
Dans les forêts, des perroquets gros comme des serins, criards et bavards, et sur les arbres, des quadrupèdes, des opossums.
Dans les forêts, des perroquets gros comme des serins, criards et bavards, et sur les arbres, des quadrupèdes, des opossums.
Un des indigènes plonge la main dans la cavité ; des cris aigus se font entendre ; les opossums, car ils sont là toute une famille, sont percés de coups de couteaux et l'un après l'autre, huit cadavres sont sortis du trou. A mesure qu'ils arrivent à terre, un indigène les saisit par la queue, les balance un instant et les envoie au milieu du brasier allumé par les femmes ; après une cuisson sommaire, ils les retirent carbonisés et les mangent en les déchirant à belles dents ; ce repas est écœurant à voir.
Videos de Oscar Wilde (72)
Voir plusAjouter une vidéo
Attention !!! Nouvel horaire pour l'émission "Le coup de coeur des libraires" sur les Ondes de Sud Radio. Valérie Expert et Gérard Collard vous donnent rendez-vous chaque samedi à 14h00 pour vous faire découvrir leurs passions du moment !
•
Retrouvez leurs dernières sélections de livres ici !
•
•
•
Ce que je sais de toi de Eric Chacour aux éditions Philippe Rey
https://www.lagriffenoire.com/ce-que-je-sais-de-toi.html
•
La promesse de l'aube de Romain Gary, Hervé Pierre aux éditions Folio
https://www.lagriffenoire.com/la-promesse-de-l-aube-premiere-partie.html
•
le jongleur de Agata Tuszynska aux éditions Stock
https://www.lagriffenoire.com/le-jongleur.html
•
a fille d'elle-même (Romans contemporains) de Gabrielle Boulianne-Tremblay aux éditions JC Lattès
https://www.lagriffenoire.com/la-fille-d-elle-meme.html
•
Les muses orphelines de Michel Marc Bouchard et Noëlle Renaude aux éditions Théatrales
9782842602161
•
Oum Kalsoum - L'Arme secrète de Nasser de Martine Lagardette et Farid Boudjellal aux éditions Oxymore
https://www.lagriffenoire.com/oum-kalsoum-l-arme-secrete-de-nasser.html
•
le pied de Fumiko - La complainte de la sirène de Junichirô Tanizaki , Jean-Jacques Tschudin aux éditions Folio
https://www.lagriffenoire.com/le-pied-de-fumiko-la-complainte-de-la-sirene.html
•
Amour et amitié de Jane Austen et Pierre Goubert aux éditions Folio
https://www.lagriffenoire.com/amour-et-amitie-1.html
•
L'homme qui vivait sous terre de Richard Wright et Claude-Edmonde Magny aux éditions Folio
https://www.lagriffenoire.com/l-homme-qui-vivait-sous-terre.html
•
Maximes et autres textes de Oscar Wilde et Dominique Jean aux éditions Folio
https://www.lagriffenoire.com/maximes-et-autres-textes.html
•
•
Chinez & découvrez nos livres coups d'coeur dans notre librairie en ligne lagriffenoire.com
•
Notre chaîne Youtube : Griffenoiretv
•
Notre Newsletter https://www.lagriffenoire.com/?fond=n...
•
Vos libraires passionnés,
Gérard Collard & Jean-Edgar Casel
•
•
•
#editionsphilipperey #editionsfolio #editionsstock #editionsjclattes #editionstheatrales #editionsoxymore
+ Lire la suite
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Oscar Wilde (117)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz sur Oscar Wilde
De quelle nationalité est Oscar Wilde ?
écossaise
irlandaise
anglaise
galloise
10 questions
253 lecteurs ont répondu
Thème :
Oscar WildeCréer un quiz sur ce livre253 lecteurs ont répondu