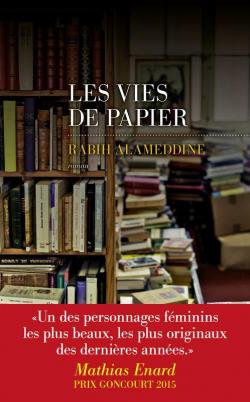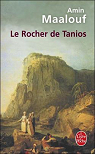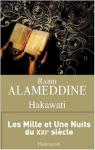Rabih Alameddine/5
485 notes
Résumé :
Aaliya Saleh, 72 ans, les cheveux bleus, a toujours refusé les carcans imposés par la société libanaise. À l'ombre des murs anciens de son appartement, elle s'apprête pour son rituel préféré. Chaque année, le 1er janvier, après avoir allumé deux bougies pour Walter Benjamin, cette femme irrévérencieuse et un brin obsessionnelle commence à traduire en arabe l'une des œuvres de ses romanciers préférés : Kafka, Pessoa ou Nabokov.
À la fois refuge et " plaisir a... >Voir plus
À la fois refuge et " plaisir a... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les vies de papier Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (163)
Voir plus
Ajouter une critique
Aaliya, ancienne libraire et passionnée de livres vit seule dans son appartement. À 72 ans, elle en a vécu des choses. Répudiée par un mari impuissant, issue d'une famille traditionaliste où l'homme possède plus de droits qu'une femme, Aaliya a vu la société libanaise se détruire via des guerres, évoluer, se reconstruire. La seule chose qui lui a permis de tenir toutes ses années... ce sont les livres. Elle prend chaque année la résolution de traduire un livre en arabe.. Et cette lubie dure depuis maintenant 50 ans !
Ses lectures lui permettent d'appréhender le monde et de le contempler via les citations de grands auteurs.
Acheté sur un coup de tête après avoir lu la quatrième de couverture, j'avoue avoir été conquise par le début du roman, très drôle : nous entrons dans le monde d'Aaliya et son erreur de coloration capillaire. Au fil du récit, l'auteur nous offre une découverte de la vie de Beyrouth via les souvenirs et les citations d'auteurs. Nombreuses sont les digressions où un élément active un souvenir du passé.
Ce roman est poétique, étrange, drôle, complexe, innocent, complexe. Il est tout et pourrait faire fuir le lecteur en raison de son côté "brouillon" voulu.
À lire sans modération.📘
Ses lectures lui permettent d'appréhender le monde et de le contempler via les citations de grands auteurs.
Acheté sur un coup de tête après avoir lu la quatrième de couverture, j'avoue avoir été conquise par le début du roman, très drôle : nous entrons dans le monde d'Aaliya et son erreur de coloration capillaire. Au fil du récit, l'auteur nous offre une découverte de la vie de Beyrouth via les souvenirs et les citations d'auteurs. Nombreuses sont les digressions où un élément active un souvenir du passé.
Ce roman est poétique, étrange, drôle, complexe, innocent, complexe. Il est tout et pourrait faire fuir le lecteur en raison de son côté "brouillon" voulu.
À lire sans modération.📘
En flânant en librairie, j'ai lu par hasard le quatrième de couverture du deuxième roman traduit de cet écrivain-peintre libanais... Comme vous pouvez le deviner aisément ce sont les thématiques qui ont capté mon intérêt, et fait me précipiter pour acquérir cet ouvrage , à la couverture
affriolante (un désordre coloré de livres empilés ! )
Un roman attachant, étonnant, prodigue en digressions, références littéraires. Cette fiction met en scène dans un Beyrouth en guerre, une septuagénaire célibataire, répudiée et divorcée depuis des lustres, qui vit seule ; jusqu'à sa retraite , son existence se déroulait entre son travail
de libraire, sa passion de la lecture, qui lui permet de voir écouler le temps avec plus de douceur...
Nous accompagnons Aalya Saleh, 72 ans, ancienne libraire, qui se retrouve à la retraite, vivant seule dans son appartement, où elle continue à suivre un rite immuable le 1er jour de chaque nouvelle année ; elle choisit un texte d'un écrivain qu'elle affectionne particulièrement (dont Sebald, Pessoa, Kafka qui ont une place de choix, dans son Panthéon personnel) pour en faire une traduction en arabe...Contradiction apparente: elle s'implique à chaque traduction mais se moque éperdument de se faire publier,ou connaître de quiconque !
Ce travail de traductrice , ses lectures nombreuses l'aident à trouver un sens à son quotidien, ou du moins adoucissent son existence, dans un Beyrouth en guerre... Aalya vit dans une sorte de bulle, où elle se sent de plus en plus loin des autres, en dehors de ses souvenirs heureux avec
son amie, Hannah, à part quelques visites en solitaire au musée national de Beyrouth, où le gardien lui manifeste une attention affectueuse...
Je parlais précédemment de digressions, car il est bien sûr question avant tout des livres, d'hommages multiples à la Littérature, à la lecture mais aussi au travail des plus complexes du traducteur...Mais moult autres sujets s'entrecroisent dans des mini-histoires imbriquées: Une histoire familiale difficile dans un pays , où même les mères préfèrent les fils aux filles,
la guerre, le temps qui passe, les effets paniquants du vieillissement, qui engrangent plus de solitude et d'isolement, lorsqu'en plus, en tant que femme on a vécu la majeure partie de son existence en dehors du parcours traditionnel d'une femme libanaise, qui se doit de se
marier et de faire des enfants !!
J'ai adoré ce roman, tout en éprouvant des émotions extrêmes: une sorte de jubilation de s'immerger dans l'univers "papivore" d'Aalya, accaparée par ses lectures, ses acquisitions, et ses choix de traduction, qu'elle range méticuleusement , une fois terminés , dans des cartons, avec le livre en langue originale. Dans un même temps, une sorte de forte mélancolie
d'une vie solitaire, en marge des autres vivants, en dehors de "ces vies de papier", qui l'habitent heureusement!!
"Je me suis depuis bien longtemps abandonnée au plaisir aveugle de l'écrit. La littérature est mon bac à sable. J'y joue, j'y construis mes forts et mes châteaux, j'y passe un temps merveilleux. C'est le monde à l'extérieur de mon bac à sable qui me pose problème.Je me suis adaptée avec docilité, quoique de manière non conventionnelle, au monde visible, afin de pouvoir me retirer sans grands désagréments dans mon monde intérieur de livres. Pour filer cette métamorphose sableuse, si la littérature est mon bac à sable, alors le monde réel est mon sablier- un sablier qui s'écoule grain par grain.
La littérature m'apporte la vie, et la vie me tue." (p. 15)
Un très fort moment de lecture dont je suis très heureuse , qui provoque ma curiosité à lire l'ouvrage précédent de cet écrivain libanais, "Hakawati", où l'écrit, le romanesque, l'art de raconter des histoires occupent de nouveau, de façon différente, une place primordiale...
Lien à voir : http://www.lemonde.fr/livres/article/2009/10/29/hakawati-de-rabih-alameddine_1260083_3260.html
affriolante (un désordre coloré de livres empilés ! )
Un roman attachant, étonnant, prodigue en digressions, références littéraires. Cette fiction met en scène dans un Beyrouth en guerre, une septuagénaire célibataire, répudiée et divorcée depuis des lustres, qui vit seule ; jusqu'à sa retraite , son existence se déroulait entre son travail
de libraire, sa passion de la lecture, qui lui permet de voir écouler le temps avec plus de douceur...
Nous accompagnons Aalya Saleh, 72 ans, ancienne libraire, qui se retrouve à la retraite, vivant seule dans son appartement, où elle continue à suivre un rite immuable le 1er jour de chaque nouvelle année ; elle choisit un texte d'un écrivain qu'elle affectionne particulièrement (dont Sebald, Pessoa, Kafka qui ont une place de choix, dans son Panthéon personnel) pour en faire une traduction en arabe...Contradiction apparente: elle s'implique à chaque traduction mais se moque éperdument de se faire publier,ou connaître de quiconque !
Ce travail de traductrice , ses lectures nombreuses l'aident à trouver un sens à son quotidien, ou du moins adoucissent son existence, dans un Beyrouth en guerre... Aalya vit dans une sorte de bulle, où elle se sent de plus en plus loin des autres, en dehors de ses souvenirs heureux avec
son amie, Hannah, à part quelques visites en solitaire au musée national de Beyrouth, où le gardien lui manifeste une attention affectueuse...
Je parlais précédemment de digressions, car il est bien sûr question avant tout des livres, d'hommages multiples à la Littérature, à la lecture mais aussi au travail des plus complexes du traducteur...Mais moult autres sujets s'entrecroisent dans des mini-histoires imbriquées: Une histoire familiale difficile dans un pays , où même les mères préfèrent les fils aux filles,
la guerre, le temps qui passe, les effets paniquants du vieillissement, qui engrangent plus de solitude et d'isolement, lorsqu'en plus, en tant que femme on a vécu la majeure partie de son existence en dehors du parcours traditionnel d'une femme libanaise, qui se doit de se
marier et de faire des enfants !!
J'ai adoré ce roman, tout en éprouvant des émotions extrêmes: une sorte de jubilation de s'immerger dans l'univers "papivore" d'Aalya, accaparée par ses lectures, ses acquisitions, et ses choix de traduction, qu'elle range méticuleusement , une fois terminés , dans des cartons, avec le livre en langue originale. Dans un même temps, une sorte de forte mélancolie
d'une vie solitaire, en marge des autres vivants, en dehors de "ces vies de papier", qui l'habitent heureusement!!
"Je me suis depuis bien longtemps abandonnée au plaisir aveugle de l'écrit. La littérature est mon bac à sable. J'y joue, j'y construis mes forts et mes châteaux, j'y passe un temps merveilleux. C'est le monde à l'extérieur de mon bac à sable qui me pose problème.Je me suis adaptée avec docilité, quoique de manière non conventionnelle, au monde visible, afin de pouvoir me retirer sans grands désagréments dans mon monde intérieur de livres. Pour filer cette métamorphose sableuse, si la littérature est mon bac à sable, alors le monde réel est mon sablier- un sablier qui s'écoule grain par grain.
La littérature m'apporte la vie, et la vie me tue." (p. 15)
Un très fort moment de lecture dont je suis très heureuse , qui provoque ma curiosité à lire l'ouvrage précédent de cet écrivain libanais, "Hakawati", où l'écrit, le romanesque, l'art de raconter des histoires occupent de nouveau, de façon différente, une place primordiale...
Lien à voir : http://www.lemonde.fr/livres/article/2009/10/29/hakawati-de-rabih-alameddine_1260083_3260.html
Les vies de papier : un livre sur les livres. Mais pas que...
Un livre touffu, roboratif, que j'ai trouvé passionnant ; des digressions déroutantes, des réflexions avisées, des anecdotes cocasses ; au final, une histoire émouvante, mais qui ne plaira pas à tout le monde. Un roman pour les amateurs de littérature, une lecture qui exige de la patience.
La narratrice, Aaliya, soixante-douze ans, vit à Beyrouth depuis toujours, dans des conditions modestes. Elle vit seule dans un vieil appartement défraîchi.
Unique employée pendant cinquante ans d'une petite librairie, elle est entrée en littérature comme on entre dans les ordres. Elle a tenu entre ses mains des oeuvres d'écrivains du monde entier – certains dont je n'avais jamais entendu parler, d'autres dont je connaissais le nom mais dont je n'ai rien lu –. Aaliya n'a pas beaucoup vendu, mais elle a tout lu et elle en parle ; une érudite de la littérature...
Elle parle aussi de la vie quotidienne à Beyrouth, le Beyrouth des quartiers populaires, en état de guerre permanent depuis sa jeunesse : guerre civile, guerre de religion, guerre tout court, bombardements, attentats, décombres, cadavres, rues barrées, incendies, coupures d'eau et d'électricité, restrictions alimentaires... Continuer à vivre !
Elle parle de la vieillesse ; le corps qui se délite, les douleurs qui s'installent, les frustrations de l'enfance qui, en dépit du temps, laissent des cicatrices mal refermées ; les menaces de l'inattention – laquelle peut se traduire par une couleur de cheveux inhabituelle !... Elle parle de l'isolement, de la solitude, qui n'en est pas le remède, car elle conduit à s'exclure, à s'enfermer.
Mais quel est le sens de tout cela, me direz-vous ? On ne fait pas un roman passionnant avec des considérations cérébrales aussi démoralisantes !... Patience, vous ai-je dit !
Aaliya est un roman à elle seule. Elle est traductrice. Mais qui le sait ?... Aaliya travaille selon un rituel et des règles propres à elle, qu'elle s'impose sans atermoiement. Elle traduit en arabe classique des ouvrages littéraires ... qui ne doivent en aucun cas être des oeuvres originales écrites en français ou en anglais !... Mais elle ne connaît que l'arabe, le français et l'anglais ; elle ne comprend pas l'allemand, ni le russe, l'italien, le serbe ou que sais-je ! Elle travaille donc à partir des traductions françaises et anglaises des textes originaux !... Aaliya a ses raisons – ne comptez pas sur moi pour vous les dévoiler ! – Et c'est aussi « en toute logique » qu'une fois achevées, les traductions sont placées dans des cartons et entreposées chez elle, dans une ancienne salle d'eau...
Un jour, un incident technique conséquent la contraindra à se dévoiler à ses voisines – trois sorcières ! Catastrophe ou libération ?... Émotion.
Aaliya s'étend sur de multiples sujets. La musique classique, qu'elle connaît parfaitement. Les conditions de vie des femmes en Orient, leurs espoirs, leurs fantasmes, leurs amitiés. A ce propos, elle déclare avoir aimé deux femmes : Hannah, une amie, et Anna... – Karénine, bien sur. Étonnante homophonie.
En revanche, Aaliya entretient des rapports compliqués avec sa mère, très âgée. Elle raconte une histoire de pieds – un lavage et un massage de pieds – qui m'a dégoûté. (Non pas que je manque de compassion, mais personnellement je n'aime pas les pieds et j'ai horreur que l'on touche les miens, à la différence de ma femme qui ne jure que par la réflexologie plantaire.)
L'immanquable débat : la traduction doit-elle privilégier la fidélité littérale à l'original ou au contraire en adapter l'esprit. Cela me rappelle les polémiques soulevées, il y a une vingtaine d'années, par les publications d'une nouvelle génération de traducteurs de Dostoïevski et de Kafka.
La lecture de Les vies de papier est fluide et agréable, mais je me suis longtemps demandé où la narratrice cherchait à m'emmener. Tout s'assemble logiquement vers la fin. Il n'est pas inutile de relire certaines pages pour boucler la cohérence de l'ouvrage ; je veux dire : pour comprendre la cohérence d'Aaliya dans sa propre incohérence. Vous me suivez ?
Performance impressionnante de l'auteur, Rabih Alameddine. Cet homme parvient à se fondre totalement dans son personnage de femme, car quels que soient son mode de vie et ses bizarreries, Aaliya est bien une femme, avec des souvenirs de femme, des manies de femme et des problèmes de femme.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Un livre touffu, roboratif, que j'ai trouvé passionnant ; des digressions déroutantes, des réflexions avisées, des anecdotes cocasses ; au final, une histoire émouvante, mais qui ne plaira pas à tout le monde. Un roman pour les amateurs de littérature, une lecture qui exige de la patience.
La narratrice, Aaliya, soixante-douze ans, vit à Beyrouth depuis toujours, dans des conditions modestes. Elle vit seule dans un vieil appartement défraîchi.
Unique employée pendant cinquante ans d'une petite librairie, elle est entrée en littérature comme on entre dans les ordres. Elle a tenu entre ses mains des oeuvres d'écrivains du monde entier – certains dont je n'avais jamais entendu parler, d'autres dont je connaissais le nom mais dont je n'ai rien lu –. Aaliya n'a pas beaucoup vendu, mais elle a tout lu et elle en parle ; une érudite de la littérature...
Elle parle aussi de la vie quotidienne à Beyrouth, le Beyrouth des quartiers populaires, en état de guerre permanent depuis sa jeunesse : guerre civile, guerre de religion, guerre tout court, bombardements, attentats, décombres, cadavres, rues barrées, incendies, coupures d'eau et d'électricité, restrictions alimentaires... Continuer à vivre !
Elle parle de la vieillesse ; le corps qui se délite, les douleurs qui s'installent, les frustrations de l'enfance qui, en dépit du temps, laissent des cicatrices mal refermées ; les menaces de l'inattention – laquelle peut se traduire par une couleur de cheveux inhabituelle !... Elle parle de l'isolement, de la solitude, qui n'en est pas le remède, car elle conduit à s'exclure, à s'enfermer.
Mais quel est le sens de tout cela, me direz-vous ? On ne fait pas un roman passionnant avec des considérations cérébrales aussi démoralisantes !... Patience, vous ai-je dit !
Aaliya est un roman à elle seule. Elle est traductrice. Mais qui le sait ?... Aaliya travaille selon un rituel et des règles propres à elle, qu'elle s'impose sans atermoiement. Elle traduit en arabe classique des ouvrages littéraires ... qui ne doivent en aucun cas être des oeuvres originales écrites en français ou en anglais !... Mais elle ne connaît que l'arabe, le français et l'anglais ; elle ne comprend pas l'allemand, ni le russe, l'italien, le serbe ou que sais-je ! Elle travaille donc à partir des traductions françaises et anglaises des textes originaux !... Aaliya a ses raisons – ne comptez pas sur moi pour vous les dévoiler ! – Et c'est aussi « en toute logique » qu'une fois achevées, les traductions sont placées dans des cartons et entreposées chez elle, dans une ancienne salle d'eau...
Un jour, un incident technique conséquent la contraindra à se dévoiler à ses voisines – trois sorcières ! Catastrophe ou libération ?... Émotion.
Aaliya s'étend sur de multiples sujets. La musique classique, qu'elle connaît parfaitement. Les conditions de vie des femmes en Orient, leurs espoirs, leurs fantasmes, leurs amitiés. A ce propos, elle déclare avoir aimé deux femmes : Hannah, une amie, et Anna... – Karénine, bien sur. Étonnante homophonie.
En revanche, Aaliya entretient des rapports compliqués avec sa mère, très âgée. Elle raconte une histoire de pieds – un lavage et un massage de pieds – qui m'a dégoûté. (Non pas que je manque de compassion, mais personnellement je n'aime pas les pieds et j'ai horreur que l'on touche les miens, à la différence de ma femme qui ne jure que par la réflexologie plantaire.)
L'immanquable débat : la traduction doit-elle privilégier la fidélité littérale à l'original ou au contraire en adapter l'esprit. Cela me rappelle les polémiques soulevées, il y a une vingtaine d'années, par les publications d'une nouvelle génération de traducteurs de Dostoïevski et de Kafka.
La lecture de Les vies de papier est fluide et agréable, mais je me suis longtemps demandé où la narratrice cherchait à m'emmener. Tout s'assemble logiquement vers la fin. Il n'est pas inutile de relire certaines pages pour boucler la cohérence de l'ouvrage ; je veux dire : pour comprendre la cohérence d'Aaliya dans sa propre incohérence. Vous me suivez ?
Performance impressionnante de l'auteur, Rabih Alameddine. Cet homme parvient à se fondre totalement dans son personnage de femme, car quels que soient son mode de vie et ses bizarreries, Aaliya est bien une femme, avec des souvenirs de femme, des manies de femme et des problèmes de femme.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Cela m'a embêtée toute ma vie de ne pas être comme tout le monde.
J'aime les hommes et les femmes qui ne trouvent pas leur place dans la culture dominante, les étrangers ici comme partout, accidentés de la vie et de l'âme.
J'apprécie la nostalgie.
J'apprécie aussi l'ironie.
Je suis emplie d'une solitude byronique sans avoir aucun des deux exutoires du poète : le génie et l'adultère.
Voilà ce que – entre autres – proclame Aaliya, 72 ans, ancienne libraire et libre traductrice depuis cinquante ans.
Femme tout à fait à part, mal mariée (« le crétin que j'ai épousé, bénie son âme rance. Vous pouvez ajouter le manque implicite de sens de l'humour et de l'honneur, l'incapacité de gagner un revenu, l'art de se satisfaire de son analphabétisme manifeste et d'être un pleutre congénital ») puis répudiée.
Mal-aimée par sa mère et ses demi-frères.
Grande amie d'Hannah, l'attachante Hannah.
Amoureuse des livres qu'elle chouchoute, lit à haute voix à son amie, traduit pour elle-même et remise dans la salle d'eau.
Grande amatrice de musique classique.
Un peu (beaucoup) asociale.
Elle est vieille, maintenant, et elle nous raconte avec verve et vérité ses passions, ses emportements, sa tendresse pour sa ville, Beyrouth, maintes et maintes fois blessée par ces conflits qui l'ont traversée (« J'aime beaucoup la citation de Mark Twain : L'histoire ne se répète pas, mais elle rime »), ses colères envers son ex-mari et sa mère, le tout entrecoupé d'anecdotes de sa vie quotidienne, entre les maux de dos, les problèmes de coiffure et les relations avec ses voisines.
Humour, autodérision, enthousiasme et coups de cafard se mélangent pour former un cocktail détonant où la sagesse prédomine : « La fiabilité renforce-t-elle notre illusion de contrôle ? Si c'est le cas, je me demande si dans les pays développés (je n'utiliserai pas le terme détestable de « civilisés »), le processus de vieillissement perfide et briseur d'illusions, n'est pas plus difficile à supporter ».
J'ai savouré en prenant tout mon temps chaque ligne de cette relation sans détours d'une vie remplie de désillusions mais envisagée avec sagesse. Voici d'ailleurs ce qui le prouve, et je vous laisserai à votre tour déguster les propos de cette vieille dame inventée par Rabih Alameddine :
« J'ai lu un poème sur le bonheur d'Esward Hirsch qui se termine par ces vers : « Ma tête est comme une lucarne, mon coeur est comme l'aube ». Je pense que parfois, pas tout le temps, quand je traduis, ma tête est comme une lucarne. Sans effort de ma part, je suis visitée par le bonheur. Parfois je me dis que cela suffit, quelques moments d'extase, dans une vie d'un ennui à la Beckett.
Durant ces moments, je ne suis plus comme d'habitude, cependant je suis totalement moi-même, de corps et d'esprit. Durant ces moments, je suis guérie de toute blessure. Je suis où il faut que je sois. Mon coeur se distend avec délice. Je me sens sacrée ».
En lisant ce roman, c'est exactement ce que j'ai ressenti.
J'aime les hommes et les femmes qui ne trouvent pas leur place dans la culture dominante, les étrangers ici comme partout, accidentés de la vie et de l'âme.
J'apprécie la nostalgie.
J'apprécie aussi l'ironie.
Je suis emplie d'une solitude byronique sans avoir aucun des deux exutoires du poète : le génie et l'adultère.
Voilà ce que – entre autres – proclame Aaliya, 72 ans, ancienne libraire et libre traductrice depuis cinquante ans.
Femme tout à fait à part, mal mariée (« le crétin que j'ai épousé, bénie son âme rance. Vous pouvez ajouter le manque implicite de sens de l'humour et de l'honneur, l'incapacité de gagner un revenu, l'art de se satisfaire de son analphabétisme manifeste et d'être un pleutre congénital ») puis répudiée.
Mal-aimée par sa mère et ses demi-frères.
Grande amie d'Hannah, l'attachante Hannah.
Amoureuse des livres qu'elle chouchoute, lit à haute voix à son amie, traduit pour elle-même et remise dans la salle d'eau.
Grande amatrice de musique classique.
Un peu (beaucoup) asociale.
Elle est vieille, maintenant, et elle nous raconte avec verve et vérité ses passions, ses emportements, sa tendresse pour sa ville, Beyrouth, maintes et maintes fois blessée par ces conflits qui l'ont traversée (« J'aime beaucoup la citation de Mark Twain : L'histoire ne se répète pas, mais elle rime »), ses colères envers son ex-mari et sa mère, le tout entrecoupé d'anecdotes de sa vie quotidienne, entre les maux de dos, les problèmes de coiffure et les relations avec ses voisines.
Humour, autodérision, enthousiasme et coups de cafard se mélangent pour former un cocktail détonant où la sagesse prédomine : « La fiabilité renforce-t-elle notre illusion de contrôle ? Si c'est le cas, je me demande si dans les pays développés (je n'utiliserai pas le terme détestable de « civilisés »), le processus de vieillissement perfide et briseur d'illusions, n'est pas plus difficile à supporter ».
J'ai savouré en prenant tout mon temps chaque ligne de cette relation sans détours d'une vie remplie de désillusions mais envisagée avec sagesse. Voici d'ailleurs ce qui le prouve, et je vous laisserai à votre tour déguster les propos de cette vieille dame inventée par Rabih Alameddine :
« J'ai lu un poème sur le bonheur d'Esward Hirsch qui se termine par ces vers : « Ma tête est comme une lucarne, mon coeur est comme l'aube ». Je pense que parfois, pas tout le temps, quand je traduis, ma tête est comme une lucarne. Sans effort de ma part, je suis visitée par le bonheur. Parfois je me dis que cela suffit, quelques moments d'extase, dans une vie d'un ennui à la Beckett.
Durant ces moments, je ne suis plus comme d'habitude, cependant je suis totalement moi-même, de corps et d'esprit. Durant ces moments, je suis guérie de toute blessure. Je suis où il faut que je sois. Mon coeur se distend avec délice. Je me sens sacrée ».
En lisant ce roman, c'est exactement ce que j'ai ressenti.
Une vie entière parmi les papiers, voilà la vie d'Aaliya qui, avant d'être à la retraite, est la seule employée d'une librairie de Beyrouth où elle vend peu de livres, commande uniquement ceux qui l'intéresse, pour les lire et les garder. Ce n'est pas très honnête, mais elle s'en moque. D'ailleurs pour le propriétaire, ce lieu n'est qu'un faire valoir vis à vis de ses amis intellectuels, pas une source de revenus.
Chose étrange, chaque premier janvier, cette beyrouthine de soixante douze ans commence la traduction en arabe de livres déjà traduits en anglais et en français. Plus étrange encore, son travail achevé, elle le range dans des cartons qu'elle entrepose dans une chambre de bonne. Oui, vous avez bien lu, elle ne fait rien pour être publiée ! Elle accomplit un long travail inutile. Elle s'en explique, mais je ne vais pas spoiler (divulgâcher comme disent nos amis canadiens), je vous laisse le découvrir par vous-même dans ce livre intrigant.
J'ai d'abord cru que l'auteure était une femme. Les vies sont écrites à la première personne, d'où ma confusion. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison est que Rabih Alameddine se glisse magiquement dans la peau de cette vieille femme - cultivée, obsessionnelle, négligée, irrévérencieuse, ironique et tellement vraie dans sa franchise et parfois sa crudité qu'elle possède une existence tangible.
Aaliya, une femme qui est capable de tout, même de sortir dans la rue titubante et débraillée. Le plus souvent elle résiste à l'empiètement dans sa vie de celles qu'elle appelle les trois sorcières, de sa vieille mère et de ses demi-frères. Il est vrai qu'elle aime peu la compagnie de ses semblables. Mais une chose est sûre, elle parle si bien de littérature et de musique, de l'histoire de Beyrouth et de ses guerres que jamais l'envie de l'interrompre ne vous effleure.
Vous qui aimez les livres, comme moi laissez-vous porter par le charme oriental et l'érudition d'Aaliya, vous ne le regretterez pas.
Chose étrange, chaque premier janvier, cette beyrouthine de soixante douze ans commence la traduction en arabe de livres déjà traduits en anglais et en français. Plus étrange encore, son travail achevé, elle le range dans des cartons qu'elle entrepose dans une chambre de bonne. Oui, vous avez bien lu, elle ne fait rien pour être publiée ! Elle accomplit un long travail inutile. Elle s'en explique, mais je ne vais pas spoiler (divulgâcher comme disent nos amis canadiens), je vous laisse le découvrir par vous-même dans ce livre intrigant.
J'ai d'abord cru que l'auteure était une femme. Les vies sont écrites à la première personne, d'où ma confusion. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison est que Rabih Alameddine se glisse magiquement dans la peau de cette vieille femme - cultivée, obsessionnelle, négligée, irrévérencieuse, ironique et tellement vraie dans sa franchise et parfois sa crudité qu'elle possède une existence tangible.
Aaliya, une femme qui est capable de tout, même de sortir dans la rue titubante et débraillée. Le plus souvent elle résiste à l'empiètement dans sa vie de celles qu'elle appelle les trois sorcières, de sa vieille mère et de ses demi-frères. Il est vrai qu'elle aime peu la compagnie de ses semblables. Mais une chose est sûre, elle parle si bien de littérature et de musique, de l'histoire de Beyrouth et de ses guerres que jamais l'envie de l'interrompre ne vous effleure.
Vous qui aimez les livres, comme moi laissez-vous porter par le charme oriental et l'érudition d'Aaliya, vous ne le regretterez pas.
critiques presse (2)
Cet écrivain a un talent fou pour adopter le point de vue d’une femme d’âge mûr, pour partager ses connaissances de la littérature et adopter un ton à la fois léger et grave pour évoquer le Beyrouth en temps de guerre.
Lire la critique sur le site : LeJournaldeQuebec
Émouvant et inspirant, ce roman émaillé de phrases parmi les plus belles qui n'aient jamais été écrites laissera des traces indélébiles chez tout passionné de littérature.
Lire la critique sur le site : LaPresse
Citations et extraits (297)
Voir plus
Ajouter une citation
Page 32
De tous les plaisirs délicieux que mon corps a commencé à me refuser, le sommeil est le plus précieux, le don sacré qui me manque le plus. Le sommeil sans repos m’a laissé sa suie. Je dors par fragments, quand j’arrive à dormir. Lorsque j’envisageais la fin de ma vie, je ne m’attendais pas à passer chaque nuit dans l’obscurité de ma chambre, les paupières à demi ouverts, calée sur des coussins ratatinés, à tenir salon avec mes souvenirs.
Le sommeil seigneur de tous les dieux et de tous les hommes. Ah, être le flux et le reflux de la vaste mer. Quand j’étais plus jeune, je pouvais dormir n’importe où. Je pouvais m’étaler sur un canapé, m’y enfoncer, l’obligeant à m’accueillir en son sein, et disparaître dans les enfers somnolents. Dans un océan luxurieux je plongeais, dans ses profondeurs je m’abîmais.
Virgile appelait le sommeil frère de la mort, et Isocrate avant lui. Hypnos et Thanatos, fils de Nyx. Cette façon de minimiser la mort est peu imaginative.
« Il est tout aussi indigne, de la part d’un homme pendant, de croire que la mort est un sommeil », a écrit Pessoa. La règle de base du sommeil est que l’on s’en éveille. Le réveil est-il alors une résurrection ?
Sur un canapé, sur un lit, sur une chaise, je dormais. Les rides s’évanouissaient de mon visage. Chaque silencieux tic-tac de l’horloge me rajeunissait. Pourquoi donc est-ce à l’âge où l’on a le plus besoin des vertus curatives d’un sommeil profond qu’on y accède avec le plus de mal ? Hypnos dépérit tandis que Thanatos approche.
Quand je songeais à la fin de ma vie, je n’envisageais pas que je passerais des nuits sans sommeil à revivre mes années antérieures. Je n’avais pas imaginé que je regretterais autant la librairie.
Je me demande parfois à quel point ma vie aurait été différente si je n’avais pas été embauchée ce jour-là.
De tous les plaisirs délicieux que mon corps a commencé à me refuser, le sommeil est le plus précieux, le don sacré qui me manque le plus. Le sommeil sans repos m’a laissé sa suie. Je dors par fragments, quand j’arrive à dormir. Lorsque j’envisageais la fin de ma vie, je ne m’attendais pas à passer chaque nuit dans l’obscurité de ma chambre, les paupières à demi ouverts, calée sur des coussins ratatinés, à tenir salon avec mes souvenirs.
Le sommeil seigneur de tous les dieux et de tous les hommes. Ah, être le flux et le reflux de la vaste mer. Quand j’étais plus jeune, je pouvais dormir n’importe où. Je pouvais m’étaler sur un canapé, m’y enfoncer, l’obligeant à m’accueillir en son sein, et disparaître dans les enfers somnolents. Dans un océan luxurieux je plongeais, dans ses profondeurs je m’abîmais.
Virgile appelait le sommeil frère de la mort, et Isocrate avant lui. Hypnos et Thanatos, fils de Nyx. Cette façon de minimiser la mort est peu imaginative.
« Il est tout aussi indigne, de la part d’un homme pendant, de croire que la mort est un sommeil », a écrit Pessoa. La règle de base du sommeil est que l’on s’en éveille. Le réveil est-il alors une résurrection ?
Sur un canapé, sur un lit, sur une chaise, je dormais. Les rides s’évanouissaient de mon visage. Chaque silencieux tic-tac de l’horloge me rajeunissait. Pourquoi donc est-ce à l’âge où l’on a le plus besoin des vertus curatives d’un sommeil profond qu’on y accède avec le plus de mal ? Hypnos dépérit tandis que Thanatos approche.
Quand je songeais à la fin de ma vie, je n’envisageais pas que je passerais des nuits sans sommeil à revivre mes années antérieures. Je n’avais pas imaginé que je regretterais autant la librairie.
Je me demande parfois à quel point ma vie aurait été différente si je n’avais pas été embauchée ce jour-là.
Beyrouth à l’époque avait un modeste réseau de trams, qui, bien entendu, disparut quand la ville décida de se moderniser dans les années soixante et soixante-dix. Une ligne s’arrêtait à deux immeubles seulement de son hôpital. Malheureusement pour Hannah, la ligne ne desservait pas sa maison. Il lui fallait marcher dix minutes jusqu’à l’arrêt du tram, ce qu’elle refusait de faire, tant elle avait honte de sa claudication.
Beyrouth dispose d’un autre système pour le transport de ses résidents, un système non public qui est né en même temps que les premières automobiles. Les Beyrouthins appellent ça un « service» (prononcé à la française et non pas à l’anglaise).
Il s’agit d’un système bon marché de taxi officieux. Les clients se tiennent sur le bord de la route, les voitures de «service» ralentissent à l’approche, et le conducteur décide si oui ou non il fera monter la personne. Pour une somme modique, on peut aller n’importe où en ville, du moment que votre destination correspond à l’itinéraire du conducteur. La plupart des voitures peuvent accueillir cinq passagers, deux à l’avant, à côté du conducteur, et trois à l’arrière.
En 1944, quiconque ayant une voiture pouvait prendre des passagers, mais à un moment donné, dans les années cinquante, il fallut obtenir une plaque minéralogique particulière, de couleur rouge, pour pouvoir faire le taxi.
En 1944, aucune femme respectable n’utilisait de «service». On ne pouvait savoir avec qui il faudrait partager la voiture, ou, pire, si le conducteur ne risquait pas de tenir des propos déplacés. Une femme respectable évitait les «services». Pas Hannah.
Entre être vue en train de marcher et être vue en train de prendre un « service », le choix était clair. C’était toujours la deuxième option, mais elle payait systématiquement double tarif pour ne pas avoir à s’asseoir à côté d’un inconnu. Elle ne voulait pas s’asseoir à l’avant, à côté du conducteur. Elle prenait place à l’arrière. Elle s’installa à l’arrière et payait pour deux places, de manière qu’une seule personne partage la banquette avec elle, et cette personne serait assise à l’autre fenêtre. Elle estimait que c’était là une solution chaste et convenable.
Son système fonctionnait. Pendant deux mois, elle n’eut pas un seul problème, pas le moindre. Elle s’était préparée aux remarques narquoises ou lubriques de l’un des chauffeurs ou de l’un des passagers, mais aucune ne fut prononcée. Les Beyrouthins, semble-t-il, étaient des gentlemen, du moins auprès d’elle. Elle se disait que l’uniforme jaune impeccable de l’hôpital, et tout particulièrement la charlotte en papier dont elle se coiffait, avait beaucoup à voir avec le respect qu’on lui témoignait. Chaque matin elle partait de chez elle et attendait brièvement sur le bord du trottoir qu’un « service » apparaisse. Elle ne montait pas dans une voiture dans laquelle il y avait plus d’un passager à l’arrière. Elle arrivait à l’hôpital à peine vingt minutes plus tard. C’était facile.
Elle eut son premier problème le 21 novembre 1944, jour qu’elle allait considérer comme le plus beau de sa vie, le plus heureux. (P 159)
Beyrouth dispose d’un autre système pour le transport de ses résidents, un système non public qui est né en même temps que les premières automobiles. Les Beyrouthins appellent ça un « service» (prononcé à la française et non pas à l’anglaise).
Il s’agit d’un système bon marché de taxi officieux. Les clients se tiennent sur le bord de la route, les voitures de «service» ralentissent à l’approche, et le conducteur décide si oui ou non il fera monter la personne. Pour une somme modique, on peut aller n’importe où en ville, du moment que votre destination correspond à l’itinéraire du conducteur. La plupart des voitures peuvent accueillir cinq passagers, deux à l’avant, à côté du conducteur, et trois à l’arrière.
En 1944, quiconque ayant une voiture pouvait prendre des passagers, mais à un moment donné, dans les années cinquante, il fallut obtenir une plaque minéralogique particulière, de couleur rouge, pour pouvoir faire le taxi.
En 1944, aucune femme respectable n’utilisait de «service». On ne pouvait savoir avec qui il faudrait partager la voiture, ou, pire, si le conducteur ne risquait pas de tenir des propos déplacés. Une femme respectable évitait les «services». Pas Hannah.
Entre être vue en train de marcher et être vue en train de prendre un « service », le choix était clair. C’était toujours la deuxième option, mais elle payait systématiquement double tarif pour ne pas avoir à s’asseoir à côté d’un inconnu. Elle ne voulait pas s’asseoir à l’avant, à côté du conducteur. Elle prenait place à l’arrière. Elle s’installa à l’arrière et payait pour deux places, de manière qu’une seule personne partage la banquette avec elle, et cette personne serait assise à l’autre fenêtre. Elle estimait que c’était là une solution chaste et convenable.
Son système fonctionnait. Pendant deux mois, elle n’eut pas un seul problème, pas le moindre. Elle s’était préparée aux remarques narquoises ou lubriques de l’un des chauffeurs ou de l’un des passagers, mais aucune ne fut prononcée. Les Beyrouthins, semble-t-il, étaient des gentlemen, du moins auprès d’elle. Elle se disait que l’uniforme jaune impeccable de l’hôpital, et tout particulièrement la charlotte en papier dont elle se coiffait, avait beaucoup à voir avec le respect qu’on lui témoignait. Chaque matin elle partait de chez elle et attendait brièvement sur le bord du trottoir qu’un « service » apparaisse. Elle ne montait pas dans une voiture dans laquelle il y avait plus d’un passager à l’arrière. Elle arrivait à l’hôpital à peine vingt minutes plus tard. C’était facile.
Elle eut son premier problème le 21 novembre 1944, jour qu’elle allait considérer comme le plus beau de sa vie, le plus heureux. (P 159)
J'étais une lectrice vorace, mais après la mort de Hannah, je devins insatiable. Les livres devinrent mon lait et mon miel. Pour me réconforter, je me récitais des formules naïves du genre "Les livres sont l'air que je respire", ou pire, "La vie n'a pas de sens sans la littérature", tout cela en une faible tentative d'éviter le fait que je trouvais le monde inexplicable et impénétrable. Comparée à la complexité de la compréhension du chagrin, Foucault ou Blanchot sont dans la catégorie des livres pour enfants
Tout juste en état de marche, comme moi : membres enflés, arthrite, insomnie, à la fois constipation et incontinence, les hautes et basses marées des enfers du vieillissement. Dans mes veines du matin, le sang s'écoule avec une lenteur de mélasse. Mon corps me fait défaut, mon esprit aussi. Lorsque mon corps fonctionne, on dirait que c'est indépendamment de mes désirs, et mon esprit oublie régulièrement ce que sont ces désirs, sans parler de savoir où j'ai posé mes clefs ou mes lunettes de lecture. On pourrait dire que chaque jour est une aventure.
[...] Marguerite Yourcenar [...] lorsqu'elle traduisit les poèmes de Cavafy en français. [...] Elle modifia complètement les poèmes, les francisa, se les appropria. Brodsky aurait dit qu'on ne lisait pas Cavafy, qu'on lisait Yourcenar, et il aurait eu tout à fait raison. Si ce n'est que les traductions de Yourcenar sont intéressantes en tant que telles. Elle desservit Cavafy, mais je peux lui pardonner. Ses poèmes devinrent autre chose, quelque chose de nouveau, comme du champagne.
Video de Rabih Alameddine (1)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Rabih Alameddine (8)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3167 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3167 lecteurs ont répondu