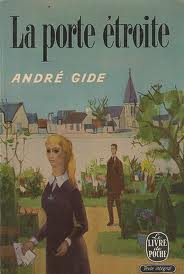Critiques de André Gide (714)
« D’autres en auraient pu faire un livre ; mais l’histoire que je raconte ici, j’ai mis toute ma force à la vivre et ma vertu s’y est usée. » c'est par ces mots que débute La porte étroite ,roman "autobiographique "d' André Gide publié en 1909 à l'âge de 40 ans .
Orphelin de père jeune, il est élevé par sa mère et Anna Shackleton, l'ancienne institutrice de sa mère. De santé fragile il est souvent amené à séjourner en Normandie et est très proche de ses cousines. Un amour violent, passionné va l'unir à Alissa l'aînée . Mais dans ce milieu protestant où la religion imprègne chaque moment , son amour va devoir affronter l'idéal d'absolu , de pureté et de vertu auxquels Alissa aspire. S'en suit alors une correspondance régulière, un éloignement de fait et une aspiration à un idéal amoureux .
Tout le chemin que suivront les deux cousins est guidé par la bible et l'Evangile de Mathieu "Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent."
Difficile me semble t'il de pénétrer dans cet univers si loin de notre monde actuel , il m'a semblé entendre en écho certains textes de Julien Green . Difficile aussi en ce début du XXème siècle d'affirmer et de vivre son homosexualité .
La Porte étroite est le premier texte d'André Gide que je lis. Cet écrivain comme d'autres avant lui a dérangé par ses mœurs, ses idées politiques et il aura fallu attendre 2016 pour que ce Prix Nobel de littérature 1947 soit inscrit au programme du Bac !!!
Orphelin de père jeune, il est élevé par sa mère et Anna Shackleton, l'ancienne institutrice de sa mère. De santé fragile il est souvent amené à séjourner en Normandie et est très proche de ses cousines. Un amour violent, passionné va l'unir à Alissa l'aînée . Mais dans ce milieu protestant où la religion imprègne chaque moment , son amour va devoir affronter l'idéal d'absolu , de pureté et de vertu auxquels Alissa aspire. S'en suit alors une correspondance régulière, un éloignement de fait et une aspiration à un idéal amoureux .
Tout le chemin que suivront les deux cousins est guidé par la bible et l'Evangile de Mathieu "Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent."
Difficile me semble t'il de pénétrer dans cet univers si loin de notre monde actuel , il m'a semblé entendre en écho certains textes de Julien Green . Difficile aussi en ce début du XXème siècle d'affirmer et de vivre son homosexualité .
La Porte étroite est le premier texte d'André Gide que je lis. Cet écrivain comme d'autres avant lui a dérangé par ses mœurs, ses idées politiques et il aura fallu attendre 2016 pour que ce Prix Nobel de littérature 1947 soit inscrit au programme du Bac !!!
Une perle perdue dans ma bibliothèque.
Un roman d'amour construit sur une imagination débridée, une sensibilité exacerbée, une jeunesse encore folle pour qui tout est possible. Un court voyage dans le temps où les belles lettres sont de mise, où les mots ont tout leur sens, où les métaphores font rêver... Ou encore, une prose emplie de poésie...
Un moment hors du temps quand l'esprit se prend au jeu de l'histoire et quand le cœur se met à battre au rythme de la musique des phrases et la magie des mots.
Un petit roman qui a tout d'un grand :-)
Gide, un auteur oublié, lu pendant mes années d'école et dont les ouvrages prennent un peu la poussière bien classés dans les rayons de ma bibliothèque. Quelle belle découverte que celui-ci que je n'avais jamais lu :-)
Un roman d'amour construit sur une imagination débridée, une sensibilité exacerbée, une jeunesse encore folle pour qui tout est possible. Un court voyage dans le temps où les belles lettres sont de mise, où les mots ont tout leur sens, où les métaphores font rêver... Ou encore, une prose emplie de poésie...
Un moment hors du temps quand l'esprit se prend au jeu de l'histoire et quand le cœur se met à battre au rythme de la musique des phrases et la magie des mots.
Un petit roman qui a tout d'un grand :-)
Gide, un auteur oublié, lu pendant mes années d'école et dont les ouvrages prennent un peu la poussière bien classés dans les rayons de ma bibliothèque. Quelle belle découverte que celui-ci que je n'avais jamais lu :-)
Quel beau livre! Quel bonheur! Voici une offrande qu’on voudrait déposer au pied du lit, pour qu’au réveil nous puissions boire à la source cette eau lustrale et nous y retremper, pour que nous offrions un OUI au jour qui s’éveille, pour avoir le courage, quand-même et malgré tout, d’être soi-même! “Un mot encore : Certains ne savent voir dans ce livre, ou ne consentent à y voir, qu’une glorification du désir et des instincts. Il me semble que c’est une vue un peu courte. Pour moi, lorsque je le rouvre, c’est plus encore une apologie du dénuement, que j’y vois. C’est là ce que j’en ai retenu, quittant le reste, et c’est à quoi précisément je demeure encore fidèle. Et c’est à cela que j’ai dû, comme je le raconterai par la suite, de rallier plus tard la doctrine de l’Évangile, pour trouver dans l’oubli de soi la réalisation de soi la plus parfaite, la plus, haute exigence, et la plus illimitée permission de bonheur. « Que mon livre t’enseigne à t’intéresser plus à toi qu’à lui-même, – puis à tout le reste plus qu’à toi.» André Gide.
André Gide nous entraine dans une histoire intemporelle. Afin d’étudier des textes en vue d’écrire un doctorat, le narrateur Gérard Lacase quitte Paris pour quelques jours et vit dans un château normand auprès d’une famille désargentée complètement dysfonctionnelle. Découvrant une photographie d’Isabelle, il en tombe amoureux et fantasme sur cette femme.
André Gide se joue de l’ambiguïté des sentiments. Si en apparence Gérard Lacase est submergé par une histoire romantique qu’il a créée de toute pièce, nous comprenons en lisant entre les lignes qu’il porte son affection au jeune Casimir.
Cette courte nouvelle permet d’apprécier le style et l’écriture de Gide, sa lecture n’en laissera cependant pas un souvenir impérissable.
Il y a des jours où je regrette d'être tombée dans le piège des notes, ces froids petits chiffres posés avec nonchalance sur nos lectures (et sur tant d'autres choses d'ailleurs: des produits, des services, et même des gens...), et qui dans leur format lapidaire et définitif révèlent bien peu de ce que l'on veut dire. Je me prends même ici à rêver que ces notes soient celles que les auteurs attribuent au lecteur et non l'inverse: qui suis-je pour "noter" Gide?
D'autant que mettre une note est en soi une démarche facile, totalement inverse à celle de la porte étroite! "La route que vous nous enseignez, Seigneur, est une route étroite – étroite à n'y pouvoir marcher deux de front", dit Alissa qui se dérobe à l'amour de Jérôme, qu'elle aime pourtant, mais qui choisit la voie de l'abstinence pour préserver ce que cet amour a de plus pur.
L'exigence et l'élégance de la plume de Gide, la délicate austérité du récit tout comme l'ambition d'élévation de l'âme de ses personnages sont évidemment au-delà de toute vulgaire notation. En revanche, je dois avouer que cette lecture, bien que courte, aura été pour moi assez poussive, trop marquée de religiosité et d'introspection pour mes papilles de lectrice, d'où ce piètre 3 dont je la gratifie. J'ai bien peur de ne toujours pas être prête à lire Proust...
D'autant que mettre une note est en soi une démarche facile, totalement inverse à celle de la porte étroite! "La route que vous nous enseignez, Seigneur, est une route étroite – étroite à n'y pouvoir marcher deux de front", dit Alissa qui se dérobe à l'amour de Jérôme, qu'elle aime pourtant, mais qui choisit la voie de l'abstinence pour préserver ce que cet amour a de plus pur.
L'exigence et l'élégance de la plume de Gide, la délicate austérité du récit tout comme l'ambition d'élévation de l'âme de ses personnages sont évidemment au-delà de toute vulgaire notation. En revanche, je dois avouer que cette lecture, bien que courte, aura été pour moi assez poussive, trop marquée de religiosité et d'introspection pour mes papilles de lectrice, d'où ce piètre 3 dont je la gratifie. J'ai bien peur de ne toujours pas être prête à lire Proust...
C'est une autobiographie de sa jeunesse qu'André Gide nous offre.
Qu'est-ce encore que ce titre bizarre ?
Si le grain ne meurt fait allusion aux versets de l'Évangile selon Jean :
« Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. »
Il exprime ainsi tout l'enjeu de la vie de Gide : « L'enfant obtus » qu'il reconnaît en lui-même, oppressé et paralysé par l'éducation puritaine et sévère de sa mère, doit mourir et céder la place au jeune homme épanoui, créatif et libre d'esprit.
.
Par bien des côtés, ma jeunesse personnelle ressemble à la sienne :
Obtus, fils unique, père prof, mère « tu comprendras plus tard », naviguant entre mes familles maternelle et paternelle, me sentant différent comme il le fut, tabassé par les élèves, solaire,…, passant des heures à regarder un petit être vivant (moi fasciné par les têtards et pieds de tomates, lui plein d'insectes ou de jeunes plantes ), trimbalé à droite-à gauche par mes parents, et d'établissement en établissement, prenant des notes….. Mais peut-être le seul point différent est que je n'ai jamais eu de tendance homosexuelle, bien au contraire.
.
Pourtant, malgré l'identification, ce livre qui est aussi une re-lecture, ne progresse pas dans le nombre d'étoiles : trois, je ne sais pourquoi… Sans doute qu'une telle jeunesse, malgré notre enthousiasme, celui d'André et le mien, n'est pas visible dans cette biographie ?
Qu'est-ce encore que ce titre bizarre ?
Si le grain ne meurt fait allusion aux versets de l'Évangile selon Jean :
« Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. »
Il exprime ainsi tout l'enjeu de la vie de Gide : « L'enfant obtus » qu'il reconnaît en lui-même, oppressé et paralysé par l'éducation puritaine et sévère de sa mère, doit mourir et céder la place au jeune homme épanoui, créatif et libre d'esprit.
.
Par bien des côtés, ma jeunesse personnelle ressemble à la sienne :
Obtus, fils unique, père prof, mère « tu comprendras plus tard », naviguant entre mes familles maternelle et paternelle, me sentant différent comme il le fut, tabassé par les élèves, solaire,…, passant des heures à regarder un petit être vivant (moi fasciné par les têtards et pieds de tomates, lui plein d'insectes ou de jeunes plantes ), trimbalé à droite-à gauche par mes parents, et d'établissement en établissement, prenant des notes….. Mais peut-être le seul point différent est que je n'ai jamais eu de tendance homosexuelle, bien au contraire.
.
Pourtant, malgré l'identification, ce livre qui est aussi une re-lecture, ne progresse pas dans le nombre d'étoiles : trois, je ne sais pourquoi… Sans doute qu'une telle jeunesse, malgré notre enthousiasme, celui d'André et le mien, n'est pas visible dans cette biographie ?
Le dicton nous dit : l'habit ne fait pas le moine.
André Gide corrige : l'habit fait le condamné. En effet il ressort de ce court texte qu'il est bien plus aisé d'être acquitté si l'on ressemble à un prince russe qu'a un misérable en guenilles.
Et pour leur malheur ce sont ces derniers qui sont toujours assis sur le banc des accusés car la société n'est guère douce pour eux.
En 1912 André Gide fut appelé à être juré au tribunal de Rouen.
Il nous décrit différentes affaires avec le constat amer que la justice des hommes est le plus souvent aléatoire et tyrannique.
Il ne faisait pas bon en ces temps-là d'être du mauvais côté du manche. Ne pas naitre bourgeois vous condamnait à l'esclavage par le travail au mieux.
Au pire une peccadille vous envoyait au bagne le restant de vos jours, aussi sûre que la pluie mouille.
On peut penser que cette expérience marqua l'auteur aux sympathies dreyfusardes et que ses luttes futures s'en sont nourries.
Un texte d'à peine soixante pages (version La Pléiade) qui vous fera apprécier la parfaite maitrise narrative d'un auteur en pleine maturité.
André Gide corrige : l'habit fait le condamné. En effet il ressort de ce court texte qu'il est bien plus aisé d'être acquitté si l'on ressemble à un prince russe qu'a un misérable en guenilles.
Et pour leur malheur ce sont ces derniers qui sont toujours assis sur le banc des accusés car la société n'est guère douce pour eux.
En 1912 André Gide fut appelé à être juré au tribunal de Rouen.
Il nous décrit différentes affaires avec le constat amer que la justice des hommes est le plus souvent aléatoire et tyrannique.
Il ne faisait pas bon en ces temps-là d'être du mauvais côté du manche. Ne pas naitre bourgeois vous condamnait à l'esclavage par le travail au mieux.
Au pire une peccadille vous envoyait au bagne le restant de vos jours, aussi sûre que la pluie mouille.
On peut penser que cette expérience marqua l'auteur aux sympathies dreyfusardes et que ses luttes futures s'en sont nourries.
Un texte d'à peine soixante pages (version La Pléiade) qui vous fera apprécier la parfaite maitrise narrative d'un auteur en pleine maturité.
Grandiose d’énergie, mais aussi effrayé par la nouvelle morale que sa santé foudroyante lui procure, Michel réunit ses anciens amis pour plaider son innocence. Il raconte son histoire et sa longue maladie, surmontée à force de confiance et de volonté, abattue comme un ennemi physiquement appréhendable. L’ennemi disparu, Michel retrouve ses forces et se sent envahi par un appétit que même son ancienne vigueur ne lui avait permis de connaître. Vivre, ce n’est plus se reposer tranquillement sur le fil d’un temps qui se déroule à notre insu : il s’agit désormais de dompter la vie comme la maladie –d’ailleurs, la vie n’est qu’une maladie appréhendée avec toutes les forces physiques et mentales de l’individu.
Michel ne veut se fixer à nul endroit mais il est contraint de se discipliner au rythme de vie plus apaisé souhaité par sa jeune femme. Séjournant en Algérie puis en Italie, il fait mine de s’installer en Normandie, puis en Suisse, mais finit irrémédiablement par souhaiter un retour en Algérie alors qu’entre-temps, la maladie a changé de camp pour frapper son épouse. Comment un individu ayant triomphé de la maladie peut-il accepter le rythme de vie languissant d’une femme affaiblie ?
« Ce qu’elle appelait le bonheur, c’est ce que j’appelais le repos, et moi je ne voulais ni ne pouvais me reposer. »
S’il n’avait pas traversé cette phase de dépression physique et mentale avant de recouvrer son énergie, Michel aurait peut-être accompagné sa femme calmement dans sa convalescence. Désormais, il n’accepte plus aucun sacrifice qui ne lui soit pas destiné. Héritier des nouvelles conceptions physiologiques de son époque, André Gide relie le corps à l’esprit, et donc à la morale : « Il me semblait avoir jusqu’à ce jour si peu senti pour tant penser, que je m’étonnais à la fin de ceci : ma sensation devenait aussi forte qu’une pensée ». L’homme nietzschéen se dresse et se prétend impitoyable, brandit sa fierté et son amour-propre à la façon d’une revanche qu’il s’agit de prendre sur les souffrances morbides surmontées : « J’ai horreur de la sympathie ; toutes les contagions s’y cachent ; on ne devrait sympathiser qu’avec les forts ».
André Gide parvient à installer authentiquement son personnage dans les contradictions de sa nouvelle morale. Ses pensées et ses idées semblent elles-mêmes issues d’un parcours similaire à celui de Michel, mais peut-être parce qu’il est encore tôt, en 1902, d’avancer un individualisme aussi impudique et cruel, l’Immoraliste se réfugie derrière une platitude rhétorique qui ne permet pas à André Gide de rejoindre l’amoralisme dansant de Nietzsche. Voilà peut-être pourquoi Michel se contente de n’être qu’un « immoraliste ».
Lien : http://colimasson.blogspot.f..
Michel ne veut se fixer à nul endroit mais il est contraint de se discipliner au rythme de vie plus apaisé souhaité par sa jeune femme. Séjournant en Algérie puis en Italie, il fait mine de s’installer en Normandie, puis en Suisse, mais finit irrémédiablement par souhaiter un retour en Algérie alors qu’entre-temps, la maladie a changé de camp pour frapper son épouse. Comment un individu ayant triomphé de la maladie peut-il accepter le rythme de vie languissant d’une femme affaiblie ?
« Ce qu’elle appelait le bonheur, c’est ce que j’appelais le repos, et moi je ne voulais ni ne pouvais me reposer. »
S’il n’avait pas traversé cette phase de dépression physique et mentale avant de recouvrer son énergie, Michel aurait peut-être accompagné sa femme calmement dans sa convalescence. Désormais, il n’accepte plus aucun sacrifice qui ne lui soit pas destiné. Héritier des nouvelles conceptions physiologiques de son époque, André Gide relie le corps à l’esprit, et donc à la morale : « Il me semblait avoir jusqu’à ce jour si peu senti pour tant penser, que je m’étonnais à la fin de ceci : ma sensation devenait aussi forte qu’une pensée ». L’homme nietzschéen se dresse et se prétend impitoyable, brandit sa fierté et son amour-propre à la façon d’une revanche qu’il s’agit de prendre sur les souffrances morbides surmontées : « J’ai horreur de la sympathie ; toutes les contagions s’y cachent ; on ne devrait sympathiser qu’avec les forts ».
André Gide parvient à installer authentiquement son personnage dans les contradictions de sa nouvelle morale. Ses pensées et ses idées semblent elles-mêmes issues d’un parcours similaire à celui de Michel, mais peut-être parce qu’il est encore tôt, en 1902, d’avancer un individualisme aussi impudique et cruel, l’Immoraliste se réfugie derrière une platitude rhétorique qui ne permet pas à André Gide de rejoindre l’amoralisme dansant de Nietzsche. Voilà peut-être pourquoi Michel se contente de n’être qu’un « immoraliste ».
Lien : http://colimasson.blogspot.f..
Pédophile ! Un mot terrible en 2023...
Mais en 1902, au Maghreb, avec des petits garçons pauvres, que dit la loi ? Dit-elle quelque chose ?
Immoraliste, peut-être... C'est tout.
Et encore, ce n'est pas à cause de ça que Michel se sent immoral, car les enfants rient parce qu'il leur donne des piécettes.
Il se sent immoral parce que.... Mais je ne vais pas divulgâcher, comme on dit !
Divulgâcher, un beau mot-valise que j'ai appris sur un site de lecture comprenant beaucoup de Québecois : évidemment, l'anglais "spoiler" est une trahison envers les cousins de France.
Le verbe anglais to spoil, « gâcher, abimer », est issu de l'ancien français espoillier, lui-même issu du latin spoliare.
.
Revenons au livre :
sans vraiment divulgâcher, je vais analyser cette oeuvre à ma façon... Ah oui, c'est du divulgâchage quand même ? Oh, et puis zut !
J'ai ajouté une étoile, car, parti d'un rythme lent que je n'aime pas, tout s'accétère vers la fin : Michel recherche la vraie vie comme je l'ai fait un certain temps, lui s'étourdissant de petits garçons arabes puis un petit Normand, avant de revenir aux petits Arabes ; moi avec les femmes...
Malade au début du livre, frôlant l'aile de la mort, mais soigné par sa femme Marceline, Michel pense qu'en devenant un important chercheur en civilisation gothique ( les Goths d'Athalaric, pas les jeunes gens habillés de noir en 2023 ), il se révèle.
Mais, discutant avec Ménalque, personnage récurrent chez André Gide, il s'aperçoit qu'il s'est trompé de vie : la Culture, n'est pas la vie, elle fait illusion et elle détruit la vie.
Alors, TGV embarquant derrière lui sa femme malade de la tuberculose, se sentant coupable et essayant de lui porter plein d'attentions malgré tout, il court après la vraie vie !
Docteur Jekyll le jour, Mister Hyde la nuit...
Pour employer les mots que j'utilise dans "L'homme cardinal", il est déchiré entre son cerveau et ses tripes ; son "surmoi" et son "ça", cherchant son véritable "moi", son coeur, son homme cardinal.
Le "Das" est quelque chose de terrible ! Mais il est, quelque part, la création : sans lui, point de déchirement, point de cri, point de révolte, comme pour moi, l'homme cardinal qui fut un volcan, évidemment crachant de tous les côtés. Pas étonnant qu'une prof de philo ait dit :
"Ce n'est pas de la philo, ça !"
Evidemment, ce n'est pas une dissertation dans les règles de l'art comme je l'apprends à mes jeunes élèves en cours de soutien, qui passent le bac de Français. C'est une révolte, c'est ma révolution française, comme "L'immoraliste" est peut être la révolution d'André Gide comme le suggère peut être "Stratégies narratives de l'aveu homosexuel dans les autobiographies d'André Gide et Julien Green" : ici, la stratégie consiste à rejeter la "faute morale" non pas sur l'homosexualité, mais sur la fureur de vivre ( James Dean, ou Cyril Collard, auteur de "Les nuits fauves" ) du TGV Michel ( André Gide ? ) qui traîne coupablement son wagon ( "elle est lasse" est répété au moins 20 fois dans le livre ) Marceline derrière lui....
... Alors que la cure en Suisse commençait à la guérir... Mais la Suisse est trop calme pour un fou comme Michel...
Mais en 1902, au Maghreb, avec des petits garçons pauvres, que dit la loi ? Dit-elle quelque chose ?
Immoraliste, peut-être... C'est tout.
Et encore, ce n'est pas à cause de ça que Michel se sent immoral, car les enfants rient parce qu'il leur donne des piécettes.
Il se sent immoral parce que.... Mais je ne vais pas divulgâcher, comme on dit !
Divulgâcher, un beau mot-valise que j'ai appris sur un site de lecture comprenant beaucoup de Québecois : évidemment, l'anglais "spoiler" est une trahison envers les cousins de France.
Le verbe anglais to spoil, « gâcher, abimer », est issu de l'ancien français espoillier, lui-même issu du latin spoliare.
.
Revenons au livre :
sans vraiment divulgâcher, je vais analyser cette oeuvre à ma façon... Ah oui, c'est du divulgâchage quand même ? Oh, et puis zut !
J'ai ajouté une étoile, car, parti d'un rythme lent que je n'aime pas, tout s'accétère vers la fin : Michel recherche la vraie vie comme je l'ai fait un certain temps, lui s'étourdissant de petits garçons arabes puis un petit Normand, avant de revenir aux petits Arabes ; moi avec les femmes...
Malade au début du livre, frôlant l'aile de la mort, mais soigné par sa femme Marceline, Michel pense qu'en devenant un important chercheur en civilisation gothique ( les Goths d'Athalaric, pas les jeunes gens habillés de noir en 2023 ), il se révèle.
Mais, discutant avec Ménalque, personnage récurrent chez André Gide, il s'aperçoit qu'il s'est trompé de vie : la Culture, n'est pas la vie, elle fait illusion et elle détruit la vie.
Alors, TGV embarquant derrière lui sa femme malade de la tuberculose, se sentant coupable et essayant de lui porter plein d'attentions malgré tout, il court après la vraie vie !
Docteur Jekyll le jour, Mister Hyde la nuit...
Pour employer les mots que j'utilise dans "L'homme cardinal", il est déchiré entre son cerveau et ses tripes ; son "surmoi" et son "ça", cherchant son véritable "moi", son coeur, son homme cardinal.
Le "Das" est quelque chose de terrible ! Mais il est, quelque part, la création : sans lui, point de déchirement, point de cri, point de révolte, comme pour moi, l'homme cardinal qui fut un volcan, évidemment crachant de tous les côtés. Pas étonnant qu'une prof de philo ait dit :
"Ce n'est pas de la philo, ça !"
Evidemment, ce n'est pas une dissertation dans les règles de l'art comme je l'apprends à mes jeunes élèves en cours de soutien, qui passent le bac de Français. C'est une révolte, c'est ma révolution française, comme "L'immoraliste" est peut être la révolution d'André Gide comme le suggère peut être "Stratégies narratives de l'aveu homosexuel dans les autobiographies d'André Gide et Julien Green" : ici, la stratégie consiste à rejeter la "faute morale" non pas sur l'homosexualité, mais sur la fureur de vivre ( James Dean, ou Cyril Collard, auteur de "Les nuits fauves" ) du TGV Michel ( André Gide ? ) qui traîne coupablement son wagon ( "elle est lasse" est répété au moins 20 fois dans le livre ) Marceline derrière lui....
... Alors que la cure en Suisse commençait à la guérir... Mais la Suisse est trop calme pour un fou comme Michel...
André Gide nous emmène dans un chassé-croisé de personnages et d’intrigues autour d’une fausse nouvelle orchestrée par un escroc, Protos : le prétendu enlèvement du pape Léon XIII qui serait séquestré dans les caves du Vatican et remplacé par un imposteur…
Anthime, ancien franc-maçon, vient de se convertir suite à une visite de la Vierge ayant entrainé la guérison de sa sciatique. Il vit désormais pauvrement car il a perdu tous ses biens et la promesse de l’Eglise de le dédommager est restée lettre morte.
Son beau-frère Julius se découvre un demi-frère Lafcadio, pas très catholique…personnage sans foi ni loi mais au charme indéniable…qui n’hésitera pas à tuer sans motif un inconnu…qui n’est autre qu’Amédée Fleurissoire, un autre beau-frère.
Quand est tombé la nouvelle de la disparition du Saint-Père, Amédée a laissé sa chère Arnica, sœur des épouses d’Anthime et de Julius et s’est embarqué dans un périple plein de rebondissements. Il rencontre dans les rues de Naples de faux religieux et de vrais filous, se retrouve dans les bras de la belle Carola, ancienne maitresse de Lafcadio et actuelle de Protos, le grand manitou de cette sombre épopée…
Et quand Julius, parti à son tour à Rome, rencontre le pape pour plaider la cause d’Anthime, est-ce bien le vrai ou un usurpateur qu’il rencontre ?
Filouteries, escroqueries, crime gratuit…rien ne nous sera épargné dans ce roman foisonnant, plein d’humour, où l’on ne sait jamais qui se cache derrière de trompeuses apparences… Et quand l’écrivain imagine le crime parfait, sans motif donc impunissable, il est loin d’envisager sa réalité. Jusqu’au bout l’auteur nous perd dans des jeux de miroirs. Qui se cache derrière les masques de ceux que l’on pense être ce qu’ils ne sont pas ? Qui sont les plus filous ? C’est bien d’une farce dont il s’agit, en tout cas une heureuse découverte d’un classique très moderne !
Anthime, ancien franc-maçon, vient de se convertir suite à une visite de la Vierge ayant entrainé la guérison de sa sciatique. Il vit désormais pauvrement car il a perdu tous ses biens et la promesse de l’Eglise de le dédommager est restée lettre morte.
Son beau-frère Julius se découvre un demi-frère Lafcadio, pas très catholique…personnage sans foi ni loi mais au charme indéniable…qui n’hésitera pas à tuer sans motif un inconnu…qui n’est autre qu’Amédée Fleurissoire, un autre beau-frère.
Quand est tombé la nouvelle de la disparition du Saint-Père, Amédée a laissé sa chère Arnica, sœur des épouses d’Anthime et de Julius et s’est embarqué dans un périple plein de rebondissements. Il rencontre dans les rues de Naples de faux religieux et de vrais filous, se retrouve dans les bras de la belle Carola, ancienne maitresse de Lafcadio et actuelle de Protos, le grand manitou de cette sombre épopée…
Et quand Julius, parti à son tour à Rome, rencontre le pape pour plaider la cause d’Anthime, est-ce bien le vrai ou un usurpateur qu’il rencontre ?
Filouteries, escroqueries, crime gratuit…rien ne nous sera épargné dans ce roman foisonnant, plein d’humour, où l’on ne sait jamais qui se cache derrière de trompeuses apparences… Et quand l’écrivain imagine le crime parfait, sans motif donc impunissable, il est loin d’envisager sa réalité. Jusqu’au bout l’auteur nous perd dans des jeux de miroirs. Qui se cache derrière les masques de ceux que l’on pense être ce qu’ils ne sont pas ? Qui sont les plus filous ? C’est bien d’une farce dont il s’agit, en tout cas une heureuse découverte d’un classique très moderne !
En 1897, André Gide publie « Les nourritures terrestres », un succès et un fort beau texte souvent qualifié à juste titre de « poème en prose ». Un éloge à tout ce que la Nature produit… et une discipline de vie, basée sur le dénuement l’observation de la nature et de tout ce qu’elle produit.
En 1935, Gide « récidive » avec ces « Nouvelles nourritures terrestres », l’homme a vieilli et ses préoccupations se font plus philosophiques, même si le thème reste quasiment inchangé….
« Il me parut que le meilleur et plus sûr moyen de répandre autour de soi le bonheur était d'en donner soi-même l'image, et je résolus d'être heureux. » ou comme le disait Voltaire : « J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé »...
A lire et à relire quand nos temps troublés nous abreuvent de préoccupations qui n’en sont pas… La nature, elle, se préoccupe de l’essentiel. Le printemps vient qui porte l’espérance de beaux fruits…
En 1935, Gide « récidive » avec ces « Nouvelles nourritures terrestres », l’homme a vieilli et ses préoccupations se font plus philosophiques, même si le thème reste quasiment inchangé….
« Il me parut que le meilleur et plus sûr moyen de répandre autour de soi le bonheur était d'en donner soi-même l'image, et je résolus d'être heureux. » ou comme le disait Voltaire : « J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé »...
A lire et à relire quand nos temps troublés nous abreuvent de préoccupations qui n’en sont pas… La nature, elle, se préoccupe de l’essentiel. Le printemps vient qui porte l’espérance de beaux fruits…
Un livre très émouvant! L'écriture de Gide est une merveille, elle s'affine aussi avec le choix que l'auteur fait de son héros aboulique et asthénique, un mollasson d'une santé fragile et très inconstante. Il raconte son histoire à ses amis, il leur parle de son mariage, de ces contraintes qui l'obligent d'une part à l'oisiveté pour sa santé altérable et d'autre part à voyager pour le mal qui fourmille dans sa peau. C'est à cela que la plume de Gide se déchaine avec de ces descriptions alléchantes qui s'incrustent et se refondent selon l'état physique et psychique de notre héros lymphatique, si bien que le rythme est ni accéléré, ni lent, il est simplement calme, le temps n'est pas rude, ni joyeux, il simplement paisible. Et à notre héros, on lui absous ses tendances quelque peu inconvenantes qu'il découvre lui-même, d'ailleurs, au fur et à mesure, et avec surprise ...
Tour à tour , je fulmine , suis euphorique de retrouver quelques pépites oubliées dans mon abondante bibliothèque que je réagence dans de nouveaux rayonnages , qui vont du sol au plafond... et je tombe sur une correspondance étonnante, lue il y a plus de 10 ans (je relis avec étonnement mes soulignements au crayon, habituels dont je n'ai pas le moindre souvenir. !!!
Pourtant l'histoire de cette correspondance amicale est des plus inédites et uniques. Je désire parler de la Correspondance d'André Gide et Jean Malaquais, entre 1935 et 1950. C'est une magnifique correspondance, âpre , authentique entre deux êtres si différents, qui n'appartiennent pas à la même classe sociale.
Cf " note de l'éditeur: ils n'auraient pas dû se rencontrer, ils se rencontrent. Une conjonction promise à faire quelques étincelles. Quarante ans les séparent, mais bien d'autres choses encore.
Malaquais- né Vladimir Malacki-, petit juif de Pologne parti de chez lui à dix-huit ans courir le monde , débarqué en France au début des années trente et y crevant la dalle au gré de cent boulots de galérien... mais allant se chauffer le soir en bibliothèque, apprenant tout Villon par cœur, et se piquant d'écrire en notre belle langue alors qu'il parle encore avec l'accent de sa quasi-Sibérie natale. (...)
Cette franchise bien râpeuse plaît à Gide, et une amitié commence là, turbulente parfois, qui durera jusqu'à la mort de l'aîné en 1951, sans défection d'un côté ni de l'autre. (p. 9)
Cela me donne une vive envie de relire les textes de André Gide, lu dans mon adolescence, en découvrant un visage inconnu de cet écrivain, que je trouvais à tort "bourgeois et frileux "!!!
Un bourgeois qui n'a pas eu besoin de travailler pour vivre, mais qui a aidé financièrement , moralement, pratiquement (corrections, conseils stylistiques) un grand nombre d'écrivains, en qui il croyait. Un homme narcissique, mais aussi généreux et exigeant, lorsqu'il pressentait du talent et de la sensibilité. De même, Gide s'est battu pour faire émigrer des Juifs en Amérique... dans cette période terrible...
Je dois préciser que l'écrivain, Jean Malaquais a des tripes et du style... Du moins ce que j'ai pu en "juger" à travers ces quelques lettres !!!
J'avoue humblement que je n'ai toujours pas lu son texte plus connu "Les Javanais"
Je trouve cette correspondance sensationnelle pour plusieurs raisons entrecroisées : on assiste à l'éclosion d'une amitié authentique où chacun des protagonistes garde sa personnalité et son franc-parler, où des vérités , pas toujours agréables, se disent, explosent... Parallèlement, on observe le vrai souci de Gide pour son ami, Malacki (Malaquais) , qu'i puisse puisse écrire, travailler son premier manuscrit ("Les Javanais"), avec moins de soucis financiers...
Au fil de ces lettres, on constate la progression très significative de l'écriture de Malaquais, la reconnaissance de son travail d'écrivain...par le milieu littéraire... les engagements humanitaires, amicaux de Gide...
Plus que "Les Javanais", cette correspondance m'a insufflé l'envie de lire son 2ème roman, "Planète sans visa"- Dans cette fresque, dont Marseille en 1941-1942 est le centre, des dizaines de personnages se battent face aux difficultés qu'engendre la guerre; parmi eux, Stephen Audry, dont le modèle est André Gide....
Une correspondance incroyable nourrie d'amitié, des engagements les plus forts (dont une longue période de guerre), un amour de la littérature et de l'écriture !! Pour tous les passionnés de "tout cela"... précipitez-vous... même en lecture d'été !!!
Pourtant l'histoire de cette correspondance amicale est des plus inédites et uniques. Je désire parler de la Correspondance d'André Gide et Jean Malaquais, entre 1935 et 1950. C'est une magnifique correspondance, âpre , authentique entre deux êtres si différents, qui n'appartiennent pas à la même classe sociale.
Cf " note de l'éditeur: ils n'auraient pas dû se rencontrer, ils se rencontrent. Une conjonction promise à faire quelques étincelles. Quarante ans les séparent, mais bien d'autres choses encore.
Malaquais- né Vladimir Malacki-, petit juif de Pologne parti de chez lui à dix-huit ans courir le monde , débarqué en France au début des années trente et y crevant la dalle au gré de cent boulots de galérien... mais allant se chauffer le soir en bibliothèque, apprenant tout Villon par cœur, et se piquant d'écrire en notre belle langue alors qu'il parle encore avec l'accent de sa quasi-Sibérie natale. (...)
Cette franchise bien râpeuse plaît à Gide, et une amitié commence là, turbulente parfois, qui durera jusqu'à la mort de l'aîné en 1951, sans défection d'un côté ni de l'autre. (p. 9)
Cela me donne une vive envie de relire les textes de André Gide, lu dans mon adolescence, en découvrant un visage inconnu de cet écrivain, que je trouvais à tort "bourgeois et frileux "!!!
Un bourgeois qui n'a pas eu besoin de travailler pour vivre, mais qui a aidé financièrement , moralement, pratiquement (corrections, conseils stylistiques) un grand nombre d'écrivains, en qui il croyait. Un homme narcissique, mais aussi généreux et exigeant, lorsqu'il pressentait du talent et de la sensibilité. De même, Gide s'est battu pour faire émigrer des Juifs en Amérique... dans cette période terrible...
Je dois préciser que l'écrivain, Jean Malaquais a des tripes et du style... Du moins ce que j'ai pu en "juger" à travers ces quelques lettres !!!
J'avoue humblement que je n'ai toujours pas lu son texte plus connu "Les Javanais"
Je trouve cette correspondance sensationnelle pour plusieurs raisons entrecroisées : on assiste à l'éclosion d'une amitié authentique où chacun des protagonistes garde sa personnalité et son franc-parler, où des vérités , pas toujours agréables, se disent, explosent... Parallèlement, on observe le vrai souci de Gide pour son ami, Malacki (Malaquais) , qu'i puisse puisse écrire, travailler son premier manuscrit ("Les Javanais"), avec moins de soucis financiers...
Au fil de ces lettres, on constate la progression très significative de l'écriture de Malaquais, la reconnaissance de son travail d'écrivain...par le milieu littéraire... les engagements humanitaires, amicaux de Gide...
Plus que "Les Javanais", cette correspondance m'a insufflé l'envie de lire son 2ème roman, "Planète sans visa"- Dans cette fresque, dont Marseille en 1941-1942 est le centre, des dizaines de personnages se battent face aux difficultés qu'engendre la guerre; parmi eux, Stephen Audry, dont le modèle est André Gide....
Une correspondance incroyable nourrie d'amitié, des engagements les plus forts (dont une longue période de guerre), un amour de la littérature et de l'écriture !! Pour tous les passionnés de "tout cela"... précipitez-vous... même en lecture d'été !!!
Je vous invite cette fois-ci à descendre à la cave.
Pas n’importe quelle cave : il s’agit d’explorer celles du Vatican.
Je vous présente, pour commencer, les trois sœurs Péterat (Gide a dû bien s’amuser à choisir les noms de ses personnages), trois sœurs au prénom végétal : Véronique, Marguerite et... Arnica.
Bon, on ne va pas se mentir, elles ne sont là que pour servir de liant littéraire ; les personnages principaux sont leurs trois maris.
(Ça, déjà, ça m’agace.)
Je vous présente donc Anthime, le gros tout perclus, là sur votre gauche, un scientifique qui vient d’être touché par la grâce : la Madone lui apparaît, et pouf, toute raison l’abandonne.
À votre droite le fringant Julius, écrivain et ex-futur académicien, on va dire, devant ses espoirs déçus.
Et au centre, le pauvre Amédée Fleurissoire qui n’éclot qu’un printemps.
Chacun son tour apparaît sur scène, choisissez votre préféré, ça n’aura guère d’importance car l’intrigue sera dirigée par deux comparses, Lafcadio et Protos.
Et le Vatican dans tout ça ???
C’est que les déclarations "progressistes" du pape (toutes proportions gardées) amènent les âmes simples à croire à... son kidnapping et son remplacement.
Oui, l’intrigue est très, très mince.
Gide s’est surtout amusé à tracer le portrait de personnages qui se font tous embobiner : Anthime par la religion, Julius par la notoriété, Amédée par l’escroc Protos et par les fake news, et même Lafcadio par la philosophie et l’idée d’acte gratuit. Des caves qui ne se rebiffent guère, en quelque sorte (Et non, aucun grand cru ne figure dans cette œuvre.)
Un petit catalogue, donc, une petite distraction pour Gide sans doute, puisqu’il a lui-même nommé "sotie", bouffonnerie, cette courte tragi-comédie.
Pas déplaisant, mais pas la lecture du siècle non plus.
Merci tout de même aux camarades de la lecture commune !
Challenge Nobel
Club de lecture avril 2024 : "Un livre offert ou emprunté"
Pas n’importe quelle cave : il s’agit d’explorer celles du Vatican.
Je vous présente, pour commencer, les trois sœurs Péterat (Gide a dû bien s’amuser à choisir les noms de ses personnages), trois sœurs au prénom végétal : Véronique, Marguerite et... Arnica.
Bon, on ne va pas se mentir, elles ne sont là que pour servir de liant littéraire ; les personnages principaux sont leurs trois maris.
(Ça, déjà, ça m’agace.)
Je vous présente donc Anthime, le gros tout perclus, là sur votre gauche, un scientifique qui vient d’être touché par la grâce : la Madone lui apparaît, et pouf, toute raison l’abandonne.
À votre droite le fringant Julius, écrivain et ex-futur académicien, on va dire, devant ses espoirs déçus.
Et au centre, le pauvre Amédée Fleurissoire qui n’éclot qu’un printemps.
Chacun son tour apparaît sur scène, choisissez votre préféré, ça n’aura guère d’importance car l’intrigue sera dirigée par deux comparses, Lafcadio et Protos.
Et le Vatican dans tout ça ???
C’est que les déclarations "progressistes" du pape (toutes proportions gardées) amènent les âmes simples à croire à... son kidnapping et son remplacement.
Oui, l’intrigue est très, très mince.
Gide s’est surtout amusé à tracer le portrait de personnages qui se font tous embobiner : Anthime par la religion, Julius par la notoriété, Amédée par l’escroc Protos et par les fake news, et même Lafcadio par la philosophie et l’idée d’acte gratuit. Des caves qui ne se rebiffent guère, en quelque sorte (Et non, aucun grand cru ne figure dans cette œuvre.)
Un petit catalogue, donc, une petite distraction pour Gide sans doute, puisqu’il a lui-même nommé "sotie", bouffonnerie, cette courte tragi-comédie.
Pas déplaisant, mais pas la lecture du siècle non plus.
Merci tout de même aux camarades de la lecture commune !
Challenge Nobel
Club de lecture avril 2024 : "Un livre offert ou emprunté"
André Gide rêvait de connaître l’Afrique ; il réussit à se faire missionner sous un vague prétexte par le ministère des Colonies, et le voilà parti, avec force vivres, médicaments, livres, sans oublier Marc Allégret comme secrétaire particulier. Et le bougre, quoique plus vraiment de première jeunesse, se tient bien : malgré la fièvre, les longues marches, les sentines traitresses et le transport d’un hippopotame (occis), Gide avance et manie la litote comme jamais.
« Imagine-t-on bien ce que peut être la vie dans une baleinière, parmi les tonnelets, cantines, sacs, affaires de toilette, fusils, réchauds, vivres, etc…, la mienne habitée, durant le jour, par treize hommes (moi compris) dont quatre malades. Si parfois quelque objet tombe et glisse entre les lattes du plancher mobile, on hésite à le rechercher dans le jus fétide qui clapote au fond […]. Oui, si parfaite que puissent être la méditation et la lecture dans une baleinière, je serai content de quitter celle-ci. Tout allait bien jusqu’à l’hippopotame ; mais depuis que les pagayeurs ont suspendu tout autour de nous ses festons puants, on n’ose plus respirer qu’à peine. »
Contrairement à ce que ces lignes pourraient laisser penser, Gide a des conditions de voyage plutôt privilégiées et n’est pas insensible au sort de ses porteurs harassés. Parti pour le plaisir, il se découvre en chemin intronisé lanceur d’alerte (selon les standards de l’époque, on disait plutôt « intellectuel de gauche ») et il dénoncera l’attitude odieuse, voire sadique, de certains colonisateurs.
Sans le scandale qui s’en suivit, lirait-on encore ces carnets de voyage ? Ils ont certes bien du charme. Gide est un prosateur hors-pair et j’ai plus d’une fois été surprise par l’extraordinaire acuité de son regard et sa capacité à formuler précisément ce à quoi il assiste. Nous voyons ce qu’il nous décrit tant le mot est juste au point que nous ne pouvons imaginer que le spectacle pût être exprimé autrement.
Et puis il y a le couple qu’il forme avec Dindiki, le paresseux qu’on lui a offert et qui se cramponne amoureusement à lui nuit et jour. Pour lui, Gide se transforme en mère juive, aimante et castratrice.
Mais peut-être ces carnets seraient-ils de toute façon rentrés dans l’histoire comme témoins d’une époque et de son idéologie. Dans sa description d’un village, Gide va des cases aux femmes, reléguées en bout d’énumération : « Dans la cour, d’assez curieuses échelles […]. Accumulation d’objets ménagers, poussière, désordre. Quantité prodigieuse de lézards (margouillats) de toutes tailles. Certaines femmes aux formes pleines, très Maillol. »
Encore n’est-ce là que péché véniel. Le pire étant dans l’autosatisfaction répétée d’un écrivain persuadé de son humanité lorsqu’il apprivoise les Noirs qu’il rencontre d’un sourire et se rengorge de la reconnaissance que ces « braves gens » lui vouent. On a beau le savoir, on a beau s’y attendre, ce motif répété du bon nègre passe difficilement.
D’autant plus que la 4° de couverture insiste sur la stature de l’écrivain dénonçant l’injustice. En fait, j’en veux moins à Gide qui n’était jamais qu’un homme de son temps, qu’aux éditeurs pas foutus de rappeler les faits, à savoir l’insupportable sentiment de supériorité du Blanc (et qui a dû en plus se taper du jeune indigène). Ça m’a rappelé mes profs de fac qui m’ont envoyé voir ce chef-d’œuvre du 7° art qu’est « Naissance d’une nation » de Griffith en oubliant de préciser qu’il s’agissait rien de moins qu’une défense et illustration du Ku-Klux-Klan.
Merci donc de ne pas faire comme si l’éléphant au milieu de la pièce n’existait pas, quand bien même il s’apparente, comme ici, à un hippopotame.
« Imagine-t-on bien ce que peut être la vie dans une baleinière, parmi les tonnelets, cantines, sacs, affaires de toilette, fusils, réchauds, vivres, etc…, la mienne habitée, durant le jour, par treize hommes (moi compris) dont quatre malades. Si parfois quelque objet tombe et glisse entre les lattes du plancher mobile, on hésite à le rechercher dans le jus fétide qui clapote au fond […]. Oui, si parfaite que puissent être la méditation et la lecture dans une baleinière, je serai content de quitter celle-ci. Tout allait bien jusqu’à l’hippopotame ; mais depuis que les pagayeurs ont suspendu tout autour de nous ses festons puants, on n’ose plus respirer qu’à peine. »
Contrairement à ce que ces lignes pourraient laisser penser, Gide a des conditions de voyage plutôt privilégiées et n’est pas insensible au sort de ses porteurs harassés. Parti pour le plaisir, il se découvre en chemin intronisé lanceur d’alerte (selon les standards de l’époque, on disait plutôt « intellectuel de gauche ») et il dénoncera l’attitude odieuse, voire sadique, de certains colonisateurs.
Sans le scandale qui s’en suivit, lirait-on encore ces carnets de voyage ? Ils ont certes bien du charme. Gide est un prosateur hors-pair et j’ai plus d’une fois été surprise par l’extraordinaire acuité de son regard et sa capacité à formuler précisément ce à quoi il assiste. Nous voyons ce qu’il nous décrit tant le mot est juste au point que nous ne pouvons imaginer que le spectacle pût être exprimé autrement.
Et puis il y a le couple qu’il forme avec Dindiki, le paresseux qu’on lui a offert et qui se cramponne amoureusement à lui nuit et jour. Pour lui, Gide se transforme en mère juive, aimante et castratrice.
Mais peut-être ces carnets seraient-ils de toute façon rentrés dans l’histoire comme témoins d’une époque et de son idéologie. Dans sa description d’un village, Gide va des cases aux femmes, reléguées en bout d’énumération : « Dans la cour, d’assez curieuses échelles […]. Accumulation d’objets ménagers, poussière, désordre. Quantité prodigieuse de lézards (margouillats) de toutes tailles. Certaines femmes aux formes pleines, très Maillol. »
Encore n’est-ce là que péché véniel. Le pire étant dans l’autosatisfaction répétée d’un écrivain persuadé de son humanité lorsqu’il apprivoise les Noirs qu’il rencontre d’un sourire et se rengorge de la reconnaissance que ces « braves gens » lui vouent. On a beau le savoir, on a beau s’y attendre, ce motif répété du bon nègre passe difficilement.
D’autant plus que la 4° de couverture insiste sur la stature de l’écrivain dénonçant l’injustice. En fait, j’en veux moins à Gide qui n’était jamais qu’un homme de son temps, qu’aux éditeurs pas foutus de rappeler les faits, à savoir l’insupportable sentiment de supériorité du Blanc (et qui a dû en plus se taper du jeune indigène). Ça m’a rappelé mes profs de fac qui m’ont envoyé voir ce chef-d’œuvre du 7° art qu’est « Naissance d’une nation » de Griffith en oubliant de préciser qu’il s’agissait rien de moins qu’une défense et illustration du Ku-Klux-Klan.
Merci donc de ne pas faire comme si l’éléphant au milieu de la pièce n’existait pas, quand bien même il s’apparente, comme ici, à un hippopotame.
L’esprit d’un temps est bien volatile et il n’est pas donné à n’importe quel roman de sembler figé dans l’éternité de sa perfection. Voilà à peu près les termes de ma réflexion après avoir refermé les Caves du Vatican car le style délicieusement suranné de cet ouvrage a déteint sur ma plume et mes pensées caméléones capables, filles de peu de constance, de prendre sans y toucher l’apparence et la pompe des dernières phrases où j’ai été trainée au point que j’en vienne à formuler de telles sentences. Bigre, ce que peut la littérature tout de même !
Mais laissons là les fausses mines d’un style protéen et revenons, non pas à nos moutons, nous ne sommes pas dans la Symphonie pastorale ni dans Paludes, mais à nos Caves du Vatican, sous-titrées « sotie », soit une farce médiévale donnée par des acteurs en costume de bouffon. Notre petite bande de joyeux lecteurs qui avait initié cette lecture commune se voyait déjà, en vertu d’un tel programme, poursuivant peut-être un abbé égrillard, chasser sous les voutes pontificales le millésime rare et la dives bouteille. Sur ce point, nous aurons été cueillis à froid par une narration ayant beaucoup de l’hermétique et pas grand-chose d’immédiatement plaisant. Ce n’est assurément pas une œuvre qui se livre aisément aujourd’hui et avant d’en goûter le sel, il faut faire l’effort de se remémorer toute une époque.
Les historiens ont coutume de faire débuter le 20e siècle avec la Première guerre mondiale. A ce compte, Les Caves du Vatican, publiées en 1914, est bien de son siècle, le 19e. De cette époque où latin et grec dominent les enseignements, les forts en thème le haut des classements et où la séparation de l’Eglise et de l’Etat brûle d’une actualité scandaleuse dont on a peine à se représenter les enjeux aujourd’hui. Il faut se figurer une fine-fleur française qui ne pouvait être qu’aristocratique, rentière, souvent de province et naturellement catholique. Ce que pouvaient les contre-pouvoir d’une industrialisation en marche, d’une laïcisation de la vie publique n’était visible que dans la lutte qu’ils opposaient à la suprématie morale et financière d’une élite vieille France d’autant plus réactionnaire qu’elle était chahutée.
Ce cadre-là, il faut l’avoir bien en tête pour se délecter du contraste grotesque qu’il fait avec les personnages campés dans les Caves du Vatican. Anthime Armand-Dubois, virulent franc-maçon et époux aigri de Véronique née Péterat (prout ! oui, tout à fait, allez-y, c’est fait pour), son beau-frère Julius, écrivain médiocre candidat à l’académie (ceci explique cela), dont le dernier livre est si mauvais qu’il mérite que l’on s’asseye dessus, au sens littéral du terme. Ce sera l’héritier du titre de Comte de Baraglioul après la mort de son volage de père. Julius aura épousé Marguerite Péterat, sœur de Véronique et d’Arnica (oui, oui, trois fleurs pour un pet, joli bouquet, non ?). Ajoutez-y l’incroyable, époux d’Arnica, Amédée Fleurissoire (un nom prédestiné à devenir celui de son épouse, convenez-en), son acolyte Gaston Blafaphas et vous arriverez à l’incontournable conclusion que tout ceci ne peut pas être bien sérieux.
Une fois ces accommodements fait avec une époque désormais reculée, c’est évident, Les caves du Vatican sont une farce bouffonne, une provocation potache qui met en scène la fourberie de charlatans. Sur la foi d’une presse aux quatre-cents coups, remuée par le tour effectivement réformateur que prennent les encycliques du Pape Léon XIII, des petits malins décident d’organiser une arnaque aux bas bleus en faisant croire que le vrai Pape est prisonnier de malfrats tandis qu’un faux œuvre à sa place. Un réseau de fidèles catholiques mènerait ainsi une quête clandestine pour venir grossir les fonds qui viendront libérer le très Saint homme. Evidemment, tout est faux, des postiches utilisés pour se grimer en prêtre dévot aux larmes de crocodile versées afin d’attendrir les veuves aussi éplorées que fortunées. Une vraie aventure des Pieds nickelés !
Le lecteur, redevenu un temps mauvais garnement lui aussi, exulte du tour joué et de la grossièreté du filet dans lequel tombent ces oies. Prenez ainsi le discours tenu à la Comtesse Guy de Saint-Prix, sœur ainée de Julius (mais si, l’écrivain raté sur le livre duquel on pose son séant !) par le faux chanoine, Protos, bonimenteur véritable et instigateur de cette comédie. Ayant demandé audience, se recommandant d’un cardinal, faisant des mines de diva puis finissant par éclater en sanglots, le gredin a suffisamment chauffé sa proie pour en venir au fait : « Il s’agit ici, Madame, d’une croisade ; oui, mais d’une croisade cachée. Excusez-moi d’insister sur ce point, mais je suis chargé tout spécialement de vous en avertir par le cardinal, qui veut tout ignorer de cette histoire et qui ne comprendra même pas ce dont il est question si on lui en parle. » La pauvre comtesse est ferrée. Lorsqu’elle se débat ensuite à l’idée de débourser soixante mille francs ( !) immédiatement, le supposé chanoine, en fieffé disciple du vicomte de Valmont a beau jeu de l’assommer : « Il y a là plus que de la tiédeur (et il faisait avec la langue de petits claquements propres à manifester son dégoût) et presque de la duplicité. » Et hop, le coup de l’escroc qui se drape dans sa dignité et soupçonne le pigeon de… fausseté, ah le gredin ! Mais ça marche, elle casque la Comtesse.
Ajoutez à cette trame jubilatoire une nouvelle péripétie : alerté par Arnica, la belle-sœur de la Comtesse (il faut suivre, enfin !), Amédée Fleurissoire, le mari d’Arnica donc, a soudain un élan héroïque digne de Don Quichotte et le voilà qui, non content d’envisager se dépouiller au profit de cette quête gaguesque, décide de sacrifier toute sa personne à cette cause absurde et de se rendre à Rome, tel un preux chevalier d’un temps ancien, afin de sauver le Pape de ses propres mains.
Amédée, c’est Bouvard. Et son Pécuchet, c’est Gaston Blafaphas, son meilleur ami. Ce que fricotent ces deux-là, le narrateur ne le dit pas mais on peut imaginer qu’ils ne se contentent pas de causer trappe à mouches, pèse-billes et autres subtiles et merveilleuses inventions. A moins qu’ils soient niais jusqu’au bout et subliment héroïquement leur attirance réciproque dans le culte de la « pipe fumivore hygiénique » qu’a inventée Gaston. C’est bien possible avec de tels olibrius. Mais ceci est une autre histoire.
Toujours est-il qu’à peine avisé de cette affaire de faux pape, ne prenant que le temps de se demander « car enfin, si rien de tout cela n’était vrai ? » afin d’y répondre par un péremptoire et absurde « précisément, je ne peux pas rester dans le doute », Fleurissoire décide : « je pars secrètement, mais je pars ». Le voilà donc à manier le secret d’une main et l’indicateur des chemins de fer de l’autre, à rajuster son foulard pour ne pas attraper un rhume et à se lancer à son tour dans cette hilarante poursuite d’un faux pape qui n’existe pas.
Je ne vous conterai pas toute cette odyssée, sachez juste que punaises, moustiques et fille de petite vertu y ont une place héroïque. Et qu’enfin on boit ! Car, tout de même, appâtée par la perspective d’un hommage à Bacchus dans des caves pontificales, je commençais à trouver très désagréable mon gosier éternellement à sec.
Sachez aussi qu’avec ce périple, notre brave Amédée amène un nouveau fil narratif à cette intrigue qui en compte décidément beaucoup mais aussi le point de bascule qui fait passer les Caves du Vatican de la farce pour érudit fripon au roman philosophique.
Parfaitement, au roman philosophique. 28 ans avant le « à cause du soleil » de Meursault dans l’Etranger, 48 ans après le meurtre de l’infâme logeuse de Raskolnikov dans Crime et châtiment, Gide met en scène un crime gratuit, parfaite illustration de la liberté d’un homme qui ne croit plus en Dieu et ne pèse donc plus ses actes à l’aune de sa conscience.
Le ridicule de papistes désavoués par une modernité qui galope, la farce grotesque de potaches qui s’engraissent sur le dos des dupes, une histoire d’héritage et de bâtard aussi, et, pour faire bonne mesure, une réflexion sur la gratuité du mal. Le tout assaisonné d’un style délicieux et de savoureuses mises en abime sur la mystification, ce qu’est la fiction (romanesque, tiens !) et le pacte littéraire qu’elle impose tout en même temps qu’elle s’en joue. Prout et patatras ! Vous aurez tout cela dans les Caves du Vatican !
Pas l’ombre d’un pape en revanche et pas vraiment plus de caves. A moins qu’il ne s’agisse, en bon argot, de ces personnes qui se laissent si facilement duper ? Ah peste de la canaille, nous voilà encore couillonnés !
Je me suis régalée tout du long de cette courte lecture, riant parfois aux éclats des audaces de Gide, m’ébahissant de la modernité de son projet, sa manière de dynamiter le cadre romanesque classique au profit d’un ovni où le second degré le dispute à des réflexions métaphysiques. Alors c’est vrai, l’intrigue ne tient que sur la foi qu’on lui prête, les allusions qui devaient être limpides pour ses contemporains cryptent encore un peu plus un texte très travaillé, bruissant de références à d’autres monuments littéraires, j’ai passé pas mal de temps à chercher le sens de termes que je croisais pour la première fois. Mais quel délice !
Et n’est-ce pas justement toute la puissance de ce texte que de nous embarquer dans une intrigue qui ne tient pas la route, d’y superposer un drame existentiel comme à la hussarde ? Car enfin, si Dieu n’existe pas ou si, comme le suppose un moment Anthime (le franc-maçon, beau-frère de Julius) « son bon Dieu non plus n’est pas le vrai ? », alors tout ce sur quoi repose notre éthique est faribole, contes pour marmots, farce grotesque et songeries, filles de Prospéro (La Tempête).
Et que vaut une histoire qu’on nous raconte dans ce monde sans Dieu où même le narrateur ne sait trop que penser de certains de ses personnages ? Elle vaut le crédit qu’on lui porte, le projet esthétique et critique qui la meut et qui doit, pour assumer la nécessaire subversion d’un monde sans transcendance, faire montre de sa part de dissonance et d’iconoclasme.
Les caves du Vatican ne sont pas alors que du 19e siècle finissant, elles claironnent la modernité d’un monde désarticulé en cours de devenir, amorphe à force d’être changeant, avide du refuge faussement rassurant d’idéologies dont Gide lui ne sera jamais la dupe. Quel tour de force que ce livre !
Je crains toutefois que la petite bande que j’ai, sur la base d’obscures raisons encore mal élucidées à cette heure, entrainée avec moi dans cette lecture commune n’ait pas communié au même enthousiasme que moi ou alors de manière bien plus modérée. Merci donc à Anne-So, Isa, Pat et Yellowsub d’avoir tenté l’aventure et à Doriane et Nico d’avoir fait la claque et maintenu un rythme soutenu aux commentaires constructifs qui nous ont heureusement accompagnés. Foi de polissonne païenne, croyez-moi, même à mon insu, c'est la dernière fois que je vous piège ainsi !
Mais laissons là les fausses mines d’un style protéen et revenons, non pas à nos moutons, nous ne sommes pas dans la Symphonie pastorale ni dans Paludes, mais à nos Caves du Vatican, sous-titrées « sotie », soit une farce médiévale donnée par des acteurs en costume de bouffon. Notre petite bande de joyeux lecteurs qui avait initié cette lecture commune se voyait déjà, en vertu d’un tel programme, poursuivant peut-être un abbé égrillard, chasser sous les voutes pontificales le millésime rare et la dives bouteille. Sur ce point, nous aurons été cueillis à froid par une narration ayant beaucoup de l’hermétique et pas grand-chose d’immédiatement plaisant. Ce n’est assurément pas une œuvre qui se livre aisément aujourd’hui et avant d’en goûter le sel, il faut faire l’effort de se remémorer toute une époque.
Les historiens ont coutume de faire débuter le 20e siècle avec la Première guerre mondiale. A ce compte, Les Caves du Vatican, publiées en 1914, est bien de son siècle, le 19e. De cette époque où latin et grec dominent les enseignements, les forts en thème le haut des classements et où la séparation de l’Eglise et de l’Etat brûle d’une actualité scandaleuse dont on a peine à se représenter les enjeux aujourd’hui. Il faut se figurer une fine-fleur française qui ne pouvait être qu’aristocratique, rentière, souvent de province et naturellement catholique. Ce que pouvaient les contre-pouvoir d’une industrialisation en marche, d’une laïcisation de la vie publique n’était visible que dans la lutte qu’ils opposaient à la suprématie morale et financière d’une élite vieille France d’autant plus réactionnaire qu’elle était chahutée.
Ce cadre-là, il faut l’avoir bien en tête pour se délecter du contraste grotesque qu’il fait avec les personnages campés dans les Caves du Vatican. Anthime Armand-Dubois, virulent franc-maçon et époux aigri de Véronique née Péterat (prout ! oui, tout à fait, allez-y, c’est fait pour), son beau-frère Julius, écrivain médiocre candidat à l’académie (ceci explique cela), dont le dernier livre est si mauvais qu’il mérite que l’on s’asseye dessus, au sens littéral du terme. Ce sera l’héritier du titre de Comte de Baraglioul après la mort de son volage de père. Julius aura épousé Marguerite Péterat, sœur de Véronique et d’Arnica (oui, oui, trois fleurs pour un pet, joli bouquet, non ?). Ajoutez-y l’incroyable, époux d’Arnica, Amédée Fleurissoire (un nom prédestiné à devenir celui de son épouse, convenez-en), son acolyte Gaston Blafaphas et vous arriverez à l’incontournable conclusion que tout ceci ne peut pas être bien sérieux.
Une fois ces accommodements fait avec une époque désormais reculée, c’est évident, Les caves du Vatican sont une farce bouffonne, une provocation potache qui met en scène la fourberie de charlatans. Sur la foi d’une presse aux quatre-cents coups, remuée par le tour effectivement réformateur que prennent les encycliques du Pape Léon XIII, des petits malins décident d’organiser une arnaque aux bas bleus en faisant croire que le vrai Pape est prisonnier de malfrats tandis qu’un faux œuvre à sa place. Un réseau de fidèles catholiques mènerait ainsi une quête clandestine pour venir grossir les fonds qui viendront libérer le très Saint homme. Evidemment, tout est faux, des postiches utilisés pour se grimer en prêtre dévot aux larmes de crocodile versées afin d’attendrir les veuves aussi éplorées que fortunées. Une vraie aventure des Pieds nickelés !
Le lecteur, redevenu un temps mauvais garnement lui aussi, exulte du tour joué et de la grossièreté du filet dans lequel tombent ces oies. Prenez ainsi le discours tenu à la Comtesse Guy de Saint-Prix, sœur ainée de Julius (mais si, l’écrivain raté sur le livre duquel on pose son séant !) par le faux chanoine, Protos, bonimenteur véritable et instigateur de cette comédie. Ayant demandé audience, se recommandant d’un cardinal, faisant des mines de diva puis finissant par éclater en sanglots, le gredin a suffisamment chauffé sa proie pour en venir au fait : « Il s’agit ici, Madame, d’une croisade ; oui, mais d’une croisade cachée. Excusez-moi d’insister sur ce point, mais je suis chargé tout spécialement de vous en avertir par le cardinal, qui veut tout ignorer de cette histoire et qui ne comprendra même pas ce dont il est question si on lui en parle. » La pauvre comtesse est ferrée. Lorsqu’elle se débat ensuite à l’idée de débourser soixante mille francs ( !) immédiatement, le supposé chanoine, en fieffé disciple du vicomte de Valmont a beau jeu de l’assommer : « Il y a là plus que de la tiédeur (et il faisait avec la langue de petits claquements propres à manifester son dégoût) et presque de la duplicité. » Et hop, le coup de l’escroc qui se drape dans sa dignité et soupçonne le pigeon de… fausseté, ah le gredin ! Mais ça marche, elle casque la Comtesse.
Ajoutez à cette trame jubilatoire une nouvelle péripétie : alerté par Arnica, la belle-sœur de la Comtesse (il faut suivre, enfin !), Amédée Fleurissoire, le mari d’Arnica donc, a soudain un élan héroïque digne de Don Quichotte et le voilà qui, non content d’envisager se dépouiller au profit de cette quête gaguesque, décide de sacrifier toute sa personne à cette cause absurde et de se rendre à Rome, tel un preux chevalier d’un temps ancien, afin de sauver le Pape de ses propres mains.
Amédée, c’est Bouvard. Et son Pécuchet, c’est Gaston Blafaphas, son meilleur ami. Ce que fricotent ces deux-là, le narrateur ne le dit pas mais on peut imaginer qu’ils ne se contentent pas de causer trappe à mouches, pèse-billes et autres subtiles et merveilleuses inventions. A moins qu’ils soient niais jusqu’au bout et subliment héroïquement leur attirance réciproque dans le culte de la « pipe fumivore hygiénique » qu’a inventée Gaston. C’est bien possible avec de tels olibrius. Mais ceci est une autre histoire.
Toujours est-il qu’à peine avisé de cette affaire de faux pape, ne prenant que le temps de se demander « car enfin, si rien de tout cela n’était vrai ? » afin d’y répondre par un péremptoire et absurde « précisément, je ne peux pas rester dans le doute », Fleurissoire décide : « je pars secrètement, mais je pars ». Le voilà donc à manier le secret d’une main et l’indicateur des chemins de fer de l’autre, à rajuster son foulard pour ne pas attraper un rhume et à se lancer à son tour dans cette hilarante poursuite d’un faux pape qui n’existe pas.
Je ne vous conterai pas toute cette odyssée, sachez juste que punaises, moustiques et fille de petite vertu y ont une place héroïque. Et qu’enfin on boit ! Car, tout de même, appâtée par la perspective d’un hommage à Bacchus dans des caves pontificales, je commençais à trouver très désagréable mon gosier éternellement à sec.
Sachez aussi qu’avec ce périple, notre brave Amédée amène un nouveau fil narratif à cette intrigue qui en compte décidément beaucoup mais aussi le point de bascule qui fait passer les Caves du Vatican de la farce pour érudit fripon au roman philosophique.
Parfaitement, au roman philosophique. 28 ans avant le « à cause du soleil » de Meursault dans l’Etranger, 48 ans après le meurtre de l’infâme logeuse de Raskolnikov dans Crime et châtiment, Gide met en scène un crime gratuit, parfaite illustration de la liberté d’un homme qui ne croit plus en Dieu et ne pèse donc plus ses actes à l’aune de sa conscience.
Le ridicule de papistes désavoués par une modernité qui galope, la farce grotesque de potaches qui s’engraissent sur le dos des dupes, une histoire d’héritage et de bâtard aussi, et, pour faire bonne mesure, une réflexion sur la gratuité du mal. Le tout assaisonné d’un style délicieux et de savoureuses mises en abime sur la mystification, ce qu’est la fiction (romanesque, tiens !) et le pacte littéraire qu’elle impose tout en même temps qu’elle s’en joue. Prout et patatras ! Vous aurez tout cela dans les Caves du Vatican !
Pas l’ombre d’un pape en revanche et pas vraiment plus de caves. A moins qu’il ne s’agisse, en bon argot, de ces personnes qui se laissent si facilement duper ? Ah peste de la canaille, nous voilà encore couillonnés !
Je me suis régalée tout du long de cette courte lecture, riant parfois aux éclats des audaces de Gide, m’ébahissant de la modernité de son projet, sa manière de dynamiter le cadre romanesque classique au profit d’un ovni où le second degré le dispute à des réflexions métaphysiques. Alors c’est vrai, l’intrigue ne tient que sur la foi qu’on lui prête, les allusions qui devaient être limpides pour ses contemporains cryptent encore un peu plus un texte très travaillé, bruissant de références à d’autres monuments littéraires, j’ai passé pas mal de temps à chercher le sens de termes que je croisais pour la première fois. Mais quel délice !
Et n’est-ce pas justement toute la puissance de ce texte que de nous embarquer dans une intrigue qui ne tient pas la route, d’y superposer un drame existentiel comme à la hussarde ? Car enfin, si Dieu n’existe pas ou si, comme le suppose un moment Anthime (le franc-maçon, beau-frère de Julius) « son bon Dieu non plus n’est pas le vrai ? », alors tout ce sur quoi repose notre éthique est faribole, contes pour marmots, farce grotesque et songeries, filles de Prospéro (La Tempête).
Et que vaut une histoire qu’on nous raconte dans ce monde sans Dieu où même le narrateur ne sait trop que penser de certains de ses personnages ? Elle vaut le crédit qu’on lui porte, le projet esthétique et critique qui la meut et qui doit, pour assumer la nécessaire subversion d’un monde sans transcendance, faire montre de sa part de dissonance et d’iconoclasme.
Les caves du Vatican ne sont pas alors que du 19e siècle finissant, elles claironnent la modernité d’un monde désarticulé en cours de devenir, amorphe à force d’être changeant, avide du refuge faussement rassurant d’idéologies dont Gide lui ne sera jamais la dupe. Quel tour de force que ce livre !
Je crains toutefois que la petite bande que j’ai, sur la base d’obscures raisons encore mal élucidées à cette heure, entrainée avec moi dans cette lecture commune n’ait pas communié au même enthousiasme que moi ou alors de manière bien plus modérée. Merci donc à Anne-So, Isa, Pat et Yellowsub d’avoir tenté l’aventure et à Doriane et Nico d’avoir fait la claque et maintenu un rythme soutenu aux commentaires constructifs qui nous ont heureusement accompagnés. Foi de polissonne païenne, croyez-moi, même à mon insu, c'est la dernière fois que je vous piège ainsi !
Le voyage de Michel revêt bien des similitudes avec celui qu’entreprit Gide en 1893 accompagné du peintre-graveur Paul Albert Laurens qui fréquenta, lui aussi L’École alsacienne de la rue d’Assas. Un périple favorisant pour Gide un affranchissement moral et sexuel. Au cours de ce grand voyage, l’écrivain malade vit son état empirer, mais cette expérience en fera un nouvel être , dévoilé par l’entremise de Michel qui sous le soleil algérien rejettera lui aussi, les contraintes, pour aller vers l’absolue liberté, devenant un autre , s’affirmant un autre. Madeleine Rondeaux, son épouse, prend ici les traits de Marceline. L’homosexualité, la pédophilie affleurent , se disent à demi-mots pour s’afficher sans ambiguïté lors des dernières lignes du roman dédicacé à Henri Ghéon « son franc camarade » "l'ami et le compagnon le plus proche de Gide lors d'innombrables exploits homosexuels" selon le biographe de Gide, Alan Sheridan,
Un titre énigmatique et une histoire qui commence à Paris par la lettre féroce que Bernard envoie à son père adoptif ; il vient d'apprendre qu'il est un « bâtard », selon la terminologie de l'époque. Fracassant début de roman dont il ne faut pas attendre d'autre conséquence que la liberté qu'elle octroie au jeune homme en coupant tout net les ponts avec sa famille. Renverrait-elle à celle que prend l'auteur avec la composition de ce roman si peu orthodoxe ? La première partie se noue, au moment de leur baccalauréat, autour de Bernard et Olivier auxquels se joint bientôt Edouard, plus âgé, qui arrive d'Angleterre. le livre commence par prendre forme autour du journal d'Edouard découvert par Bernard dans la valise qu'il lui a subtilisée. Il est ensuite bien délicat de rendre compte de toute la série d'événements simultanés affectant les trajectoires individuelles des personnages dans ce roman à tiroirs.
Même l'enquête, évoquée en filigrane concernant une affaire de maison close et un réseau de fausse monnaie écoulée par une bande de lycéens (animée par Georges le frère cadet d'Olivier), n'est qu'un écran. C'est une piste se profilant parmi d'autres dans un mille-feuille d'histoires alambiquées qui se juxtaposent ou s'entrecroisent et dont ne sont pas exclues allées et venues entre présent et passé mais dont les tenants et les aboutissants importent peu. Des nombreux personnages qu'on y rencontre tous, peu ou prou, sont à un moment donné principaux puis secondaires ou vice-versa, mais ceux d'Edouard, l'écrivain en train d'écrire, et de Passavant, le dandy mondain, qui se pique de littérature, auteur de «La Barre fixe», représentent chacun un pôle nettement plus identifiable autour duquel gravitent leurs satellites.
La deuxième partie du roman, en Suisse (Saas-Fé) fait apparaître de nouveaux personnages (Boris et sa psychanalyste) et toujours plus de complexité puisqu'il s'avère que le journal d'Edouard, connu au début grâce à Bernard, n'est que la préhistoire d'un roman en gestation : « Les Faux-Monnayeurs ». Roman futur d'Edouard dans le roman présent d'André. Ainsi Gide embarque-t-il le lecteur dans les arcanes de sa création littéraire avec toutefois assez de recul et d'ironie, décelables dans les propos verbeux qu'il prête à Edouard (2ème partie, chapitre 3), pour faire penser qu'il ne prend pas forcément au sérieux sa propre tentative romanesque. du coup la fausseté de la monnaie qui s'écoule dans le roman peut prendre une tout autre signification. Parabole mettant en jeu les fondements de l'écriture ? Au royaume du faux chacun règne ici en maître : Edouard et Passavant l'illustrant à merveille avec leur appétence pour l'artifice ou la phrase creuse. La littérature n'est-elle finalement qu'une forme d'illusion, de fausse-monnaie ? On sent bien que ce questionnement traverse la composition. La troisième partie se déroule à la pension Vedel, où le jeune Boris, venu retrouver son grand-père, trouvera une fin tragique (issue d'un fait divers réel relevé par Gide). Rien ne s'achève mais tout se transforme, se poursuit en apparence, dans ce vrai/faux roman. Gide jauge et examine aussi ses personnages, leur façon de fonctionner dans le récit et, comme s'ils lui échappaient presque, semble prendre le lecteur à témoin de leur autonomie. Roman nouveau ou nouveau roman, on ne sait, mais Gide novateur sûrement.
On fait tout aussi bien de se laisser porter par la vague d'énergie qui traverse les dialogues dans un flot ininterrompu de théories et de réflexions échangées entre les personnages (sur l'homosexualité, l'éducation, le couple, la paternité, la création littéraire, l'amour, le mariage, les femmes etc.) ; lecture très tonique sur ce plan là. La nouveauté de la construction autorise peut-être Gide à faire de l'homosexualité un des sujets majeurs du livre. Les multiples départs d'intrigues sont autant de prétextes, dans cette composition en abyme, lui permettant de dévoiler en creux ce qui doit rester discret : l'amour entre personnes de même sexe et l'ambivalence des sentiments. Dans cet espace conquis sur les conventions on aurait d'ailleurs pu espérer que les personnages féminins s'émancipent aussi du schéma traditionnel or c'est tout le contraire : piégées par le mariage elles sont soit dévouées à leur mari et leurs enfants, soit lâchées par leurs amants ou résignées comme Laura, la femme du pasteur Vedel, et Pauline, la mère d'Olivier, seule Sarah s'en tire un peu mieux. On reste en 1925 tout de même !
Une bonne relecture. Suscitant réflexions - intérêt majeur du livre. Une phrase de G. Painter en conclusion : « le but visé par les Faux-Monnayeurs n'est pas de transmettre une monnaie, même authentique, fabriquée par Gide, mais de permettre au lecteur d'accéder à son indépendance en frappant la sienne »
Même l'enquête, évoquée en filigrane concernant une affaire de maison close et un réseau de fausse monnaie écoulée par une bande de lycéens (animée par Georges le frère cadet d'Olivier), n'est qu'un écran. C'est une piste se profilant parmi d'autres dans un mille-feuille d'histoires alambiquées qui se juxtaposent ou s'entrecroisent et dont ne sont pas exclues allées et venues entre présent et passé mais dont les tenants et les aboutissants importent peu. Des nombreux personnages qu'on y rencontre tous, peu ou prou, sont à un moment donné principaux puis secondaires ou vice-versa, mais ceux d'Edouard, l'écrivain en train d'écrire, et de Passavant, le dandy mondain, qui se pique de littérature, auteur de «La Barre fixe», représentent chacun un pôle nettement plus identifiable autour duquel gravitent leurs satellites.
La deuxième partie du roman, en Suisse (Saas-Fé) fait apparaître de nouveaux personnages (Boris et sa psychanalyste) et toujours plus de complexité puisqu'il s'avère que le journal d'Edouard, connu au début grâce à Bernard, n'est que la préhistoire d'un roman en gestation : « Les Faux-Monnayeurs ». Roman futur d'Edouard dans le roman présent d'André. Ainsi Gide embarque-t-il le lecteur dans les arcanes de sa création littéraire avec toutefois assez de recul et d'ironie, décelables dans les propos verbeux qu'il prête à Edouard (2ème partie, chapitre 3), pour faire penser qu'il ne prend pas forcément au sérieux sa propre tentative romanesque. du coup la fausseté de la monnaie qui s'écoule dans le roman peut prendre une tout autre signification. Parabole mettant en jeu les fondements de l'écriture ? Au royaume du faux chacun règne ici en maître : Edouard et Passavant l'illustrant à merveille avec leur appétence pour l'artifice ou la phrase creuse. La littérature n'est-elle finalement qu'une forme d'illusion, de fausse-monnaie ? On sent bien que ce questionnement traverse la composition. La troisième partie se déroule à la pension Vedel, où le jeune Boris, venu retrouver son grand-père, trouvera une fin tragique (issue d'un fait divers réel relevé par Gide). Rien ne s'achève mais tout se transforme, se poursuit en apparence, dans ce vrai/faux roman. Gide jauge et examine aussi ses personnages, leur façon de fonctionner dans le récit et, comme s'ils lui échappaient presque, semble prendre le lecteur à témoin de leur autonomie. Roman nouveau ou nouveau roman, on ne sait, mais Gide novateur sûrement.
On fait tout aussi bien de se laisser porter par la vague d'énergie qui traverse les dialogues dans un flot ininterrompu de théories et de réflexions échangées entre les personnages (sur l'homosexualité, l'éducation, le couple, la paternité, la création littéraire, l'amour, le mariage, les femmes etc.) ; lecture très tonique sur ce plan là. La nouveauté de la construction autorise peut-être Gide à faire de l'homosexualité un des sujets majeurs du livre. Les multiples départs d'intrigues sont autant de prétextes, dans cette composition en abyme, lui permettant de dévoiler en creux ce qui doit rester discret : l'amour entre personnes de même sexe et l'ambivalence des sentiments. Dans cet espace conquis sur les conventions on aurait d'ailleurs pu espérer que les personnages féminins s'émancipent aussi du schéma traditionnel or c'est tout le contraire : piégées par le mariage elles sont soit dévouées à leur mari et leurs enfants, soit lâchées par leurs amants ou résignées comme Laura, la femme du pasteur Vedel, et Pauline, la mère d'Olivier, seule Sarah s'en tire un peu mieux. On reste en 1925 tout de même !
Une bonne relecture. Suscitant réflexions - intérêt majeur du livre. Une phrase de G. Painter en conclusion : « le but visé par les Faux-Monnayeurs n'est pas de transmettre une monnaie, même authentique, fabriquée par Gide, mais de permettre au lecteur d'accéder à son indépendance en frappant la sienne »
Décidément, je ne suis pas touchée par le verbe d'André Gide. Il tend au superbe et dépeint avec lyrisme et spiritualité des relations sentimentales quasi mystiques et élevées. Je me sens terriblement prosaïque dans ces moments-là. Non pas que je sois incapable de reconnaître la beauté de l'absolu dans l'amour mais simplement parce que cela éloigne de moi, pauvre mortel, les protagonistes qui éprouvent ces émotions.
La narrateur, un pasteur, recueille chez lui Gertrude, une jeune femme aveugle couverte de crasse et analphabète, à la suite du décès dans l'isolement de sa seule parente. Bien que sa femme torde le nez (la suite lui donnera raison), le pasteur s'attelle à sortir cette "enfant sauvage", enfant de Dieu, de sa misère sociale et intellectuelle. Il s'implique tellement dans son rôle de mentor que tel Pygmalion, il s'éprend de son élève. Sa Galatée lui renvoie une image de pureté si intense qu'il est d'abord dans le déni quant aux sentiments qu'elle lui inspire et qui va contre tout ce en quoi il croit et qu'il prêche. Le cas de conscience n'est pas loin, surtout quand il écarte sous de faux prétextes un prétendant de Gertrude.
Le style est beau, j'en conviens mais sa plastique ne le rend pas attachant. Le récit est émouvant, surtout vers le dénouement, de mon point de vue, et sans doute qu'il aurait mérité plus de développements. Le roman est court, abouti mais laisse une impression de fugacité qui nuit aux amours qu'il narre.
Challenge RIQUIQUI 2022
Challenge XXème siècle 2022
Challenge ATOUT PRIX 2022
Challenge NOBEL
Challenge COEUR d'ARTICHAUT 2022
La narrateur, un pasteur, recueille chez lui Gertrude, une jeune femme aveugle couverte de crasse et analphabète, à la suite du décès dans l'isolement de sa seule parente. Bien que sa femme torde le nez (la suite lui donnera raison), le pasteur s'attelle à sortir cette "enfant sauvage", enfant de Dieu, de sa misère sociale et intellectuelle. Il s'implique tellement dans son rôle de mentor que tel Pygmalion, il s'éprend de son élève. Sa Galatée lui renvoie une image de pureté si intense qu'il est d'abord dans le déni quant aux sentiments qu'elle lui inspire et qui va contre tout ce en quoi il croit et qu'il prêche. Le cas de conscience n'est pas loin, surtout quand il écarte sous de faux prétextes un prétendant de Gertrude.
Le style est beau, j'en conviens mais sa plastique ne le rend pas attachant. Le récit est émouvant, surtout vers le dénouement, de mon point de vue, et sans doute qu'il aurait mérité plus de développements. Le roman est court, abouti mais laisse une impression de fugacité qui nuit aux amours qu'il narre.
Challenge RIQUIQUI 2022
Challenge XXème siècle 2022
Challenge ATOUT PRIX 2022
Challenge NOBEL
Challenge COEUR d'ARTICHAUT 2022
Un pasteur recueille une jeune aveugle et va lui faire connaître la beauté du monde et lui consacrer bien plus de temps qu'il n'en consacre à ses propres enfants. Il lui fera découvrir la symphonie pastorale de Beethoven et tentera de lui faire comprendre certaines choses grâce à la musique
J'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a fait repenser au livre "sourde, muette et aveugle" qui était magnifique
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de André Gide
Lecteurs de André Gide Voir plus
Quiz
Voir plus
André Gide
Né en ...
1869
1889
1909
1929
10 questions
108 lecteurs ont répondu
Thème :
André GideCréer un quiz sur cet auteur108 lecteurs ont répondu