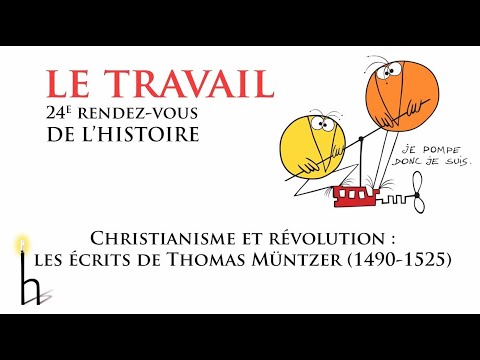Né(e) à : Martigues , le 30/07/1978
Johann Chapoutot est un historien spécialiste d'histoire contemporaine, du nazisme et de l'Allemagne.
Il est admis au lycée Henri-IV, puis à l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud (promotion 1998, classé premier au concours d'entrée dans la série "Langues vivantes"). Il obtient l'agrégation d’histoire en 2001. Il est diplômé de l’Institut d'études politiques de Paris (promotion 2002). Il est docteur en histoire en 2006, puis habilité à diriger des recherches en 2013.
Professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université depuis 2016, il a auparavant été successivement maître de conférences à l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble (2008-2014), puis professeur à l'université Sorbonne-Nouvelle (Paris-III, 2014-2016).
Il enseigne l'histoire de l'Allemagne, en particulier son histoire contemporaine depuis 1806, les sociétés européennes au XIXe siècle (1815-1914), ainsi que l'histoire mise en regard avec le cinéma.
Il consacre ses travaux à l'histoire de la culture nazie, notamment dans son essai intitulé "Le national-socialisme et l’Antiquité" (2008), tiré de sa thèse d'histoire, rédigée à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et soutenue en 2006. Il a également publié des travaux généraux sur l'histoire de l'Allemagne et sur l'Europe des dictatures de l'entre-deux-guerres. En 2015, il conteste la pertinence de rééditer "Mein Kampf" d'Adolf Hitler.
Ces thématiques ont été l'objet de sa thèse de doctorat ("Le National-socialisme et l'Antiquité", 2006) et de son mémoire d'habilitation ("La loi du sang", 2014). Avec la parution de son ouvrage "La révolution culturelle nazie" (2017), Chapoutot approfondit sa thèse en s'appuyant sur une abondante bibliographie, aussi bien allemande qu'européenne.
Il mène des recherches résolument pluridisciplinaires, publiant en histoire comme en lettres ou en philosophie. Il a également publié "Le Grand Récit" (PUF, 2021) et "Libre d’obéir" (Gallimard, 2020).
Table ronde, carte blanche aux Presses universitaires de Lyon Modération : Julien THÉRY, directeur scientifique des Presses universitaires de Lyon Avec Johann CHAPOUTOT, professeur à Sorbonne Université, Éric VUILLARD, écrivain, lauréat du Prix Goncourt 2017 À l'occasion de la réédition des écrits politico-théologiques majeurs de Thomas Müntzer (1490-1525) dans une magnifique traduction signée Joël Lefebvre, les Presses universitaires de Lyon invitent à découvrir ce penseur méconnu en France, alors qu'il fut l'un des principaux artisans de la Réforme protestante. Prédicateur de talent, partisan de Luther de la première heure, Müntzer prend toutefois rapidement ses distances et assume des positions bien plus radicales : il prône la fin de l'oppression culturelle entretenue par les doctes et les clercs, la fin de l'oppression politique instituée par les princes, la fin de l'exploitation économique dont profitent les seigneurs. Il rejoint bientôt un mouvement de révolte, qui donnera naissance à la “guerre des Paysans”, et devient l'un des chefs de la rébellion, appelant à une révolution à la fois spirituelle et matérielle. Rapidement capturé, il est torturé puis exécuté. À travers la traduction de sept textes fondateurs et d'une vingtaine de lettres, Joël Lefebvre met en lumière l'intérêt à la fois philosophique, historique et linguistique de l'oeuvre de Thomas Müntzer. Les préfaciers de cet ouvrage, l'historien spécialiste de l'Allemagne Johann Chapoutot et l'écrivain Éric Vuillard, auteur d'un livre récent inspiré par l'action de Müntzer, évoqueront la portée de ses écrits dans une discussion animée par Julien Théry, directeur scientifique des Presses universitaires de Lyon et historien des relations entre religion et politique.
Et d’autre part, la réalité.
J’ai bien dit « la réalité ». Le réel. La vraie vie. Pas le « ressenti ».
La réalité, c’est aussi la façon dont – directement ou entre les lignes – les ordres sont donnés, et exécutés. Tout au long de la pyramide hiérarchique.
Depuis le ministre de l’Education nationale Monsieur Jean-Michel BLANQUER en personne, les secrétaires d’Etat, les directeurs généraux, les conseillers, les chefs de service, les chefs de bureaux, les délégués, les chargés de mission, les décideurs et les responsables du ministère de l’Education nationale.
Jusqu’au dernier des petits chefaillons le plus nuisible, le plus abject, le plus tordu et minable qui soit, qui se croit « en droit et en devoir » d’exécuter ces ordres plus ou moins implicites et de détruire des vies humaines, dans l’établissement scolaire au sein duquel on lui a donné une once de pouvoir.
La vision nazie du monde et de l’histoire est sombre : la vie est un combat permanent, contre la nature, contre les maladies, contre les autres peuples et les autres races. Ce topo du darwinisme social est radicalisé et répété sous le IIIème Reich, dans une Allemagne fortement ébranlée par des traumatismes à répétition : modernisation rapide et brutale de 1871 à 1914, Grande guerre (1914-1918/9) et défaite, quasi-guerre civile entre 1918 et 1923, hyperinflation en 1922 et 1923 puis, derechef, grande crise économique, sociale et politique – ainsi que culturelle et psychologique – à partir de 1929. La représentation obsidionale d’une Allemagne menacée de toutes parts et assiégée trouve donc dans l’histoire récente des éléments de plausibilité certains – avec leurs discours anxiogène et déploratoire, les nazis savent qu’ils suscitent un écho dans l’expérience de leurs contemporains.
Le prisme biologique nazi déforme donc les allogènes, les étrangers à la race, perçus comme inférieurs ou dangereux, mais aussi l’humanité allemande elle-même, qui doit faire preuve de son excellence – Hitler n’hésitant pas à considérer en mars 1945 que, les Allemands ayant perdu la guerre, la totalité de son peuple pouvait bien périr en raison de son infériorité avérée.
L’ingénierie sociale, biologique et médicale frappe de plein fouet les « êtres non performants » et les « entités indignes de vivre », mais aussi les « asociaux » - vagabonds, rêveurs, originaux divers ou sous-préfets aux champs dont l’existence n’est pas encore « rentable » pour la « communauté du peuple ». A partir de 1936, plusieurs opérations de la police et de la SS raflent des milliers d’oisifs ou considérés comme tels, versés à des camps de travail ou dans des camps de concentration.
L’homme allemand ne doit donc être ni malade, ni oisif, ni engagé contre le nouveau pouvoir. Procréateur, il doit être de constitution saine, entretenir celle-ci par l’hygiène et le sport afin de s’aguerrir au travail comme à la guerre.
En 1936, un village olympique de la KdF construit à cet effet permet à des dizaines de milliers de « Volksgenossen » de venir assister aux JO d’été à Berlin – le spectacle du sport étant une source d’émulation qui doit se traduire, selon les vœux explicites d’Hitler lui-même, en santé physique, en force productive et en agressivité guerrière.
La récompense ultime est, pour l’ouvrier allemand, la « voiture KdF », la KdF-Wagen dessinée par Ferdinand Porsche, dont la production débute en 1938 et qui prendra, après 1945, le nom populaire de « coccinelle ». La Volkswagen, littéralement la « voiture du peuple », est une des nombreuses promesses non tenues du IIIème Reich, car du fait de la guerre, sa production cesse dès 1939 au profit de la construction, dans les usines KdF, de Kübelwagen, des véhicules militaires comparables à la Jeep américaine.
Nous proposons simplement une étude de cas, qui repose sur deux constats intéressants pour notre réflexion sur le monde dans lequel nous vivons et travaillons : de jeunes juristes, universitaires et hauts fonctionnaires du IIIème Reich ont beaucoup réfléchi aux questions managériales, car l’entreprise nazie faisait face à des besoins gigantesques en termes de mobilisation des ressources et d’organisation du travail. Ils ont élaboré, paradoxalement, une conception du travail non autoritaire, où l’employé et l’ouvrier consentent à leur sort et approuvent leur activité, dans un espace de liberté et d’autonomie a priori bien incompatible avec le caractère illibéral du IIIème Reich, une forme de travail « par la joie » (durch Freude) qui a prospéré après 1945, et qui nous est familière aujourd’hui, à l’heure où l’«engagement », la « motivation » et l’«implication » sont censés procéder du « plaisir » de travailler et de la « bienveillance » de la structure.
Assuré de l’autonomie des moyens, sans pouvoir participer à la définition et à la fixation des objectifs, l’exécutant se trouvait d’autant plus responsable – et donc, en l’espèce, coupable – en cas d’échec de la mission.
L’État, tout comme ses serviteurs, n’a plus de dignité éminente sous le IIIème Reich.
Leur réponse inaugurait une nouvelle société politique, sans sociétés économiques, sans, ou alors de taille très réduite. L'idéal, comme chez Rousseau déjà, se révélait être le travailleur indépendant – l'horloger ou le lapidaire jurassien, le producteur libre ou l'artiste, chantés par Proudhon, et chers à son compatriote Courbet, qui partageait ses idées.
Ces auteurs et ces idées n'ont cessé d'inspirer des pratiques alternatives, des coopératives égalitaires aux reconversions néorurales, en passant par les retrouvailles de cadres lassés par leur aliénation avec une activité artisanale enfin indépendante. Une Arcadie "an-archique", délivrée de la subordination et du management, qui n'est pas un paradis pour autant. La réalité du travail, de l'effort à fournir, d'une certaine anxiété face au résultat, demeure, mais sans l'aliénation. « Qu'il est doux de travailler pour soi », entend-on chez ceux qui sont heureux de réhabiliter une maison et d'en faire revivre le potager.
Solipsisme naïf et irresponsable ?
Peut-être pas, comme le montre le succès de l'économie sociale et solidaire - et le partage des légumes dudit potager : on peut travailler pour soi et être utile aux autres. On se situe ici aux antipodes des structures, des idéaux et du monde de Reinhard Höhn, auquel on peut préférer Hegel : le travail humain, c'est le travail non aliéné, qui permet a l'esprit de se réaliser et de se connaître par la production d'une chose (res) qui l'exprime et qui lui ressemble - pâtisserie ou bouture, livre ou objet manufacturé - et non cette activité qui réifie l'individu, le transforme en objet – « ressource humaine », « facteur travail », « masse salariale » voué au benchmarking, a l'entretien d'évaluation et à l'inévitable réunion Powerpoint.
Discipliner les femmes et les hommes en les considérant comme de simples facteurs de production et dévaster la Terre, conçue comme un simple objet, vont de pair. En poussant la destruction de la nature et l'exploitation de la « force vitale » jusqu'à des niveaux inédits, les nazis apparaissent comme l'image déformée et révélatrice d'une modernité devenue folle – servie par des illusions (la « victoire finale » ou la « reprise de la croissance ») et par des mensonges (« liberté », « autonomie ») dont des penseurs du management comme Reinhard Höhn ont été les habiles artisans.
Son destin personnel montre toutefois que ces idées n'ont qu'un temps et que leurs auteurs ont leur époque. Hõhn a pâti des révélations sur son passé et des critiques adressées à son modèle managérial - critiques internes, fourbies par d'autres modèles. Les temps peuvent également changer sous l'effet de circonstances plus générales et plus pressantes : notre regard sur nous-mêmes, sur autrui et sur le monde, pétri de « gestion », de « lutte » et de « management » par quelques décennies d'économie hautement productiviste et de divertissements bien orientés (de « l'industrie Walt Disney », du « maillon faible », aux jeux concurrentiels de télé-réalité) changera peut-être en raison du caractère parfaitement irréaliste de notre organisation économique et de nos « valeurs ».
De ville en ville
Le pèlerinage commence à la fin du 14e siècle avec Thomas CHAUCER et ses Contes de ...
182 lecteurs ont répondu