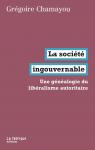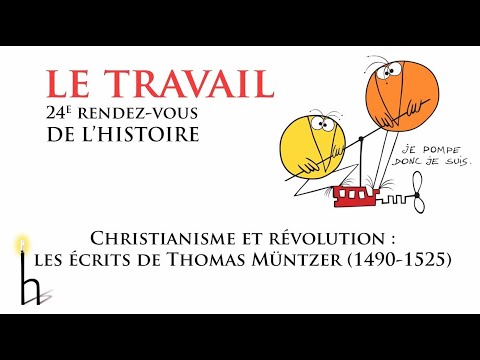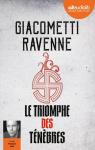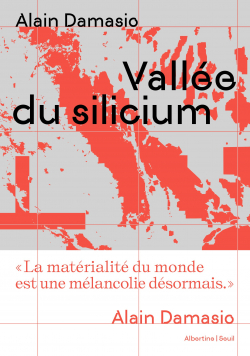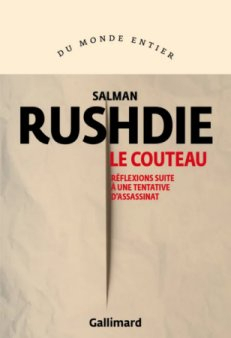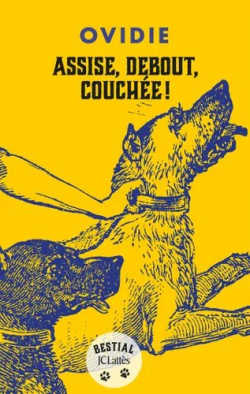Johann Chapoutot/5
190 notes
Résumé :
Johann Chapoutot, spécialiste reconnu de l’histoire du nazisme, nous livre ici un petit essai pugnace et provoquant. L’annonce faite par le titre et le sous-titre place la barre très haut. Elle déclare qu’il y quelque chose d’important à dire si l’on traite de l’histoire du management en commençant au nazisme.
Reinhard Hohn (1904-2000) est l'archétype de l'intellectuel technocrate au service du IIIe Reich. Brillant fonctionnaire de la SS - il termine... >Voir plus
Reinhard Hohn (1904-2000) est l'archétype de l'intellectuel technocrate au service du IIIe Reich. Brillant fonctionnaire de la SS - il termine... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Libres d'obéir : Le management, du nazisme à aujourd'huiVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (46)
Voir plus
Ajouter une critique
Et si les nazis étaient des managers nés ?
La thèse de l'historien Johann Chapoutot dans “Libres d'Obéir, le management du nazisme à aujourd'hui” (bel oxymore dans le titre au passage) est assez simple : contre-intuitivement, les théoriciens nazis, et en particulier Reinhard Höhn, défendaient l'avènement d'un management plus élastique, hérité du commandement militaire, plus souple, laissant une plus grande latitude au subordonné afin d'accomplir une mission déterminée, qu'il n'aura pas choisi, et d'en assumer l'éventuel échec (en lieu et place de sa hiérarchie).
Par exemple j'exige de vous que vous alliez sur la lune, ordre que vous ne discutez pas et à la conception duquel vous n'êtes pas associé en amont, en vous laissant libre des moyens (que je ne vous fournis pas) pour y parvenir, si vous échouez…c'est votre faute : vous n'êtes pas performant ou n'avez pas réussi à sortir de votre zone de “confort”.
Fustigeant la hiérarchie bureaucratique des ronds de cuirs français, mais aussi le carcan de l'Etat, de la loi, des normes au profit d'une vision vitaliste, nous dirions aujourd'hui la libération des “forces vives” contre les “charges”, les “procédures” qui entravent la liberté d'agir, le nazisme s'avère étrangement anti-étatique.
Cette “liberté germanique” pour l'auteur se justifie par la recherche constante d'adhésion. Conscient que la contrainte, la violence et la sanction certes pratiquées mais dont la portée sur des millions d'allemands est limitée, le pouvoir nazi s'est toujours beaucoup appuyé sur la propagande. Notamment par le pillage de préoccupations portées par les militants de gauche en retranchant toutefois la lutte des classes (le parti unique invente le syndicat unique car il n'y a pas de différence entre les intérêts du patron et de l'ouvrier). Ainsi les nazis reprennent les refrains de gauche sur le bien-être au travail, l'avènement du temps libre et ses loisirs (y compris sur le lieu de travail, chief happiness officers, conciergerie et baby-foot avant l'heure), de baisses d'impôts de prestations sociales à destination des seuls ouvriers ariens (les prisonniers travaillent dans des camps) et financées par les spoliations des juifs et opposants.
Cette prise en charge de la sphère privée que documente aujourd'hui la sociologue Danièle Linhart, afin que la ressource humaine soit déchargée de toute pensée “non rentable”, cette adéquation sur papier entre les intérêts d'une direction, d'un encadrement et de “collaborateurs” jadis subordonnés mais désormais soit disant égaux face au marché, au client, fait étrangement écho à ce que l'auteur décrit des pratiques nazis.
Tout repos, tout loisir est destiné à refroidir la machine humaine, lourdement mise à contribution de l'effort productif et de guerre. Ouvriers et soldats sont sommés d'être toujours performants, soit de par leurs aptitudes naturelles (c'est le darwinisme social nazi et les autres sont écartés, stérilisés, supprimés) soit au besoin par le recours à la chimie, par exemple la distribution de métamphétamines pratiquée par les nazis. Un darwinisme social qui perdure, le récent procès de l'affaire de la privatisation de France Telecom nous le rappelle, en autres les propos de ses ex-dirigeants, désormais condamnés, pour qui les salariés jugés non productifs ou au statut trop coûteux doivent être dégagés par tous moyens.
Le juriste Reinhard Höhn, “victime” de la dénazification est condamné à l'inique amende de 1 500 euros “pour solde de tout compte” nous dit l'auteur, pour avoir armé intellectuellement le IIIe Reich. Très vite, comme beaucoup d'anciens nazis (dénazification vaste blague) il entame à nouveau une carrière d'envergure. Il créé l'équivalent allemand de l'INSEAD, une école supérieure de management où les cadres des grandes entreprises allemandes et internationales (Ford, Colgate, BMW, Bayer, Opel, Aldi etc) viennent apprendre à manager comme au bon vieux temps du Reich de mille ans. Dès les années soixante-dix, Höhn a conscience des effets sur la santé des salariés de ses méthodes, il étudie le bore out qu'il appelle “la démission intérieure”.
“Liberté d'obéir, obligation de réussir”, c'est la formule de l'école managériale allemande Bad Harzbourg. Purgées des thèses racistes, les obsessions des théoriciens nazis sont les mêmes dans les années soixante et soixante-dix, parler de “collaborateurs” au lieu “d'employés”, se prémunir contre toute tentative de lecture politico-économique “dominant-dominé”, le transfert de responsabilité vers l'exécutant, la fiche de poste individuelle contre le paradigme collectif du travail.
« Au moment où le salarié est souverain dans l'ordre politique, il est, dans l'ordre économique, réduit à une sorte de servage » Jean Jaurès. Un livre instructif, érudit, un réel effort de pédagogie écrit par un historien spécialiste de l'Allemagne. On peut regretter un peu le manque de contextualisation de ces théories managériales dans un ensemble plus vaste, et quelle furent leur réelle influence mondiale, en comparaison avec d'autres écoles, américaines et japonaises notamment, quelle part d'influence dans le management par objectifs et délégation de responsabilité d'aujourd'hui. Néanmoins, à l'heure de l'entreprise libérée, de la semaine de quatre jours ou encore du télétravail il y a à nouveau comme une envie de démocratie sociale dans l'entreprise comme dans la cité.
Il manque quelques wagons pour raccrocher l'expérience nazie à la situation actuelle mais c'est un signe que ce livre suscite bien des questions au croisement de l'histoire, de la sociologie des organisations ou des sciences juridiques…
Qu'en pensez-vous ?
La thèse de l'historien Johann Chapoutot dans “Libres d'Obéir, le management du nazisme à aujourd'hui” (bel oxymore dans le titre au passage) est assez simple : contre-intuitivement, les théoriciens nazis, et en particulier Reinhard Höhn, défendaient l'avènement d'un management plus élastique, hérité du commandement militaire, plus souple, laissant une plus grande latitude au subordonné afin d'accomplir une mission déterminée, qu'il n'aura pas choisi, et d'en assumer l'éventuel échec (en lieu et place de sa hiérarchie).
Par exemple j'exige de vous que vous alliez sur la lune, ordre que vous ne discutez pas et à la conception duquel vous n'êtes pas associé en amont, en vous laissant libre des moyens (que je ne vous fournis pas) pour y parvenir, si vous échouez…c'est votre faute : vous n'êtes pas performant ou n'avez pas réussi à sortir de votre zone de “confort”.
Fustigeant la hiérarchie bureaucratique des ronds de cuirs français, mais aussi le carcan de l'Etat, de la loi, des normes au profit d'une vision vitaliste, nous dirions aujourd'hui la libération des “forces vives” contre les “charges”, les “procédures” qui entravent la liberté d'agir, le nazisme s'avère étrangement anti-étatique.
Cette “liberté germanique” pour l'auteur se justifie par la recherche constante d'adhésion. Conscient que la contrainte, la violence et la sanction certes pratiquées mais dont la portée sur des millions d'allemands est limitée, le pouvoir nazi s'est toujours beaucoup appuyé sur la propagande. Notamment par le pillage de préoccupations portées par les militants de gauche en retranchant toutefois la lutte des classes (le parti unique invente le syndicat unique car il n'y a pas de différence entre les intérêts du patron et de l'ouvrier). Ainsi les nazis reprennent les refrains de gauche sur le bien-être au travail, l'avènement du temps libre et ses loisirs (y compris sur le lieu de travail, chief happiness officers, conciergerie et baby-foot avant l'heure), de baisses d'impôts de prestations sociales à destination des seuls ouvriers ariens (les prisonniers travaillent dans des camps) et financées par les spoliations des juifs et opposants.
Cette prise en charge de la sphère privée que documente aujourd'hui la sociologue Danièle Linhart, afin que la ressource humaine soit déchargée de toute pensée “non rentable”, cette adéquation sur papier entre les intérêts d'une direction, d'un encadrement et de “collaborateurs” jadis subordonnés mais désormais soit disant égaux face au marché, au client, fait étrangement écho à ce que l'auteur décrit des pratiques nazis.
Tout repos, tout loisir est destiné à refroidir la machine humaine, lourdement mise à contribution de l'effort productif et de guerre. Ouvriers et soldats sont sommés d'être toujours performants, soit de par leurs aptitudes naturelles (c'est le darwinisme social nazi et les autres sont écartés, stérilisés, supprimés) soit au besoin par le recours à la chimie, par exemple la distribution de métamphétamines pratiquée par les nazis. Un darwinisme social qui perdure, le récent procès de l'affaire de la privatisation de France Telecom nous le rappelle, en autres les propos de ses ex-dirigeants, désormais condamnés, pour qui les salariés jugés non productifs ou au statut trop coûteux doivent être dégagés par tous moyens.
Le juriste Reinhard Höhn, “victime” de la dénazification est condamné à l'inique amende de 1 500 euros “pour solde de tout compte” nous dit l'auteur, pour avoir armé intellectuellement le IIIe Reich. Très vite, comme beaucoup d'anciens nazis (dénazification vaste blague) il entame à nouveau une carrière d'envergure. Il créé l'équivalent allemand de l'INSEAD, une école supérieure de management où les cadres des grandes entreprises allemandes et internationales (Ford, Colgate, BMW, Bayer, Opel, Aldi etc) viennent apprendre à manager comme au bon vieux temps du Reich de mille ans. Dès les années soixante-dix, Höhn a conscience des effets sur la santé des salariés de ses méthodes, il étudie le bore out qu'il appelle “la démission intérieure”.
“Liberté d'obéir, obligation de réussir”, c'est la formule de l'école managériale allemande Bad Harzbourg. Purgées des thèses racistes, les obsessions des théoriciens nazis sont les mêmes dans les années soixante et soixante-dix, parler de “collaborateurs” au lieu “d'employés”, se prémunir contre toute tentative de lecture politico-économique “dominant-dominé”, le transfert de responsabilité vers l'exécutant, la fiche de poste individuelle contre le paradigme collectif du travail.
« Au moment où le salarié est souverain dans l'ordre politique, il est, dans l'ordre économique, réduit à une sorte de servage » Jean Jaurès. Un livre instructif, érudit, un réel effort de pédagogie écrit par un historien spécialiste de l'Allemagne. On peut regretter un peu le manque de contextualisation de ces théories managériales dans un ensemble plus vaste, et quelle furent leur réelle influence mondiale, en comparaison avec d'autres écoles, américaines et japonaises notamment, quelle part d'influence dans le management par objectifs et délégation de responsabilité d'aujourd'hui. Néanmoins, à l'heure de l'entreprise libérée, de la semaine de quatre jours ou encore du télétravail il y a à nouveau comme une envie de démocratie sociale dans l'entreprise comme dans la cité.
Il manque quelques wagons pour raccrocher l'expérience nazie à la situation actuelle mais c'est un signe que ce livre suscite bien des questions au croisement de l'histoire, de la sociologie des organisations ou des sciences juridiques…
Qu'en pensez-vous ?
Ce court et brillant essai dont on parle beaucoup ces derniers mois s'ouvre sur le genre d'observation sémantique qui me ravit : alors que la plus grande partie du discours nazi nous paraît aujourd'hui (encore pour longtemps ?) monstrueusement étrangère, les productions conceptuelles et intellectuelles concernant l'organisation du travail et de l'administration résonnent dans nos oreilles contemporaines avec une familiarité inquiétante : surtout lorsqu'il est question du modèle de la « délégation de responsabilité » et du « management par objectifs » et plus généralement de la méfiance envers la réglementation et le pouvoir centralisé. La thèse du livre est que nos théories actuelles sur le management sont non seulement les héritières directes de la pensée et de la pratique nazies – peut-être davantage que du taylorisme si vitupéré, devrait-on ajouter – mais qu'elles se sont imposées en Occident à partir de l'après-guerre sans solution de continuité avec le IIIe Reich, par le truchement d'un certain nombre de personnalités dont la reconversion professionnelle en RFA s'est opéré avec la plus grande facilité, sans heurt ni reniements, et même grâce à un soutien trans-continental allant de pair avec une influence de même amplitude. Thèse hardie, excellemment démontrée.
Il faut d'abord se départir de l'idée que l'administration nazie ait opéré conformément à la tradition prussienne, comme un rouage de parfaite transmission (juridique) d'ordres provenant de la hiérarchie : les nazis se sont trouvés très vite dans l'obligation d'administrer un territoire immense avec les contraintes de l'économie de guerre, dans l'urgence concernant l'allocation des ressources (nourriture, énergie, matières premières pour l'industrie) et avec le minimum d'hommes (la majorité étant combattants) ; et par ailleurs dans une structure administrative massivement purgée des opposants politiques et « raciaux » (Chap. I : « Penser l'administration du Grand Reich »).
Mais idéologiquement aussi, le nazisme se caractérisait par son antipathie pour le droit (une invention judaïque), et pour l'État (une création de l'Empire romain déclinant), l'essence originaire des Germains se fondant au contraire sur la « liberté germanique », sur la « communauté » d'un peuple homogène racialement et dans sa volonté profonde (fût-elle inconsciente), une fois celui-ci « assaini » de ses éléments décadents et aliènes. Concrètement, le pouvoir nazi était une « polycratie » de personnalités fortement rivales entre elles et dans leurs tentatives d'anticiper, par la radicalité, les désirs du « Führer », à travers une pléthore d'« agences » ad hoc dotées de « missions » et d'« objectifs » spécifiques (Chap. II : « Faut-il en finir avec l'État ? »).
Évidemment, le concept de « liberté germanique » est une fiction perverse : fiction dans la mesure où elle présuppose cette « homogénéité » sociale et la communauté d'aspirations à l'intérieur de la Volksgemeinshaft (on notera la double polysémie de Volk – peuple ou bien race – et de Gemeinshaft – communauté humaine ou bien d'opinions) en gommant les antagonismes de classe ; perverse car, la verticalité du pouvoir étant conservée et même exacerbée, se précise le sens du titre : la liberté se réduit à l'état d'être « libres d'obéir » (Chap. III : « La "Liberté germanique").
L'on aperçoit que ces principes posent une analogie entre le gouvernement de société et l'organisation du travail : les objectifs étant établis au sommet de la pyramide du pouvoir, il ne reste aux échelons intermédiaires, aux cadres, que la « liberté » de trouver le moyen de les réaliser de façon autonome et sous leur responsabilité, contrairement à la vision individualiste du libéralisme et au « despotisme oriental » du bolchevisme ; par ailleurs l'eugénisme permet aux nazis de se débarrasser des « êtres non performants », « asociaux » et autres « entités indignes de vivre » : « le triptyque procréer-combattre-régner résume la mission historique et la vocation biologique du Germain » (p. 67) (Chap. IV : « Manager et ménager la "ressource humaine").
Nous sommes à la moitié du livre : il est temps de passer à la postérité du nazisme, et l'auteur choisit le parcours le plus emblématique, celui de Reinhard Höhn, docteur en droit, ayant gravi rapidement tous les échelons du cursus honorum de la SS jusqu'au grade de Oberführer (Général), passant sans encombre ni changement d'identité l'après-guerre, avec juste une « parenthèse naturopathe » de quelques années, puis profitant pleinement du réseau de ses « alte Kameraden » pour être propulsé d'abord dans un « think tank » industriel qui réfléchit aux méthodes de gestion des ressources humaines les plus modernes, enfin à la fondation d'une Akademie für Führungskräfte, grande école de management, l'équivalent de notre INSEAD (inagurée un an plus tard), sur le modèle de la Harvard Business School avec laquelle elle entretiendra toujours des rapports de dialogue (Chap. V : « De la SS au management : L'Akademie für Führungskräfte de Reinhard Höhn »).
Notre protagoniste Höhn a une passion : l'histoire militaire. Avec une étude de 1952 sur Scharnhorst, réformateur de l'armée prussienne après la défaite d'Iéna par Napoléon, il esquisse par analogie explicite son théorème sur les réformes nécessaires à son pays dans l'immédiat, avec cette optique pluridisciplinaire qui peut s'appliquer également à l'armée qu'à l'administration qu'à l'entreprise : une tactique du « cas particulier », « par mission » : Auftragstaktik, de « l'action plutôt que de la réflexion », une « stratégie de l'élasticité » (lire : flexibilité!) (Chap. VI : « L'art de la guerre (économique) »).
Le chapitre suivant démontre comment cet enseignement est particulièrement bien reçu en RFA des années du miracle économique, et comment des centaines de milliers de cadres sont envoyés se former à son école (Chap. VII : La méthode de Bad Harzburg : la liberté d'obéir, l'obligation de réussir »).
La biographie de Höhn se termine tout de même par un relatif déclin à la fin des années 70, alors qu'il a confortablement atteint l'âge de la retraite, mais qu'il montre une énergie inépuisable dans sa production scientifique. Son passé nazi commence à être inconfortable (le chancelier Willy Brandt était quand même un ancien résistant...), mais peut-être aussi parce que des nouveautés sur le plan des méthodes managériales, plus américaines, mais qui ne contredisent en rien les principes du modèle de la « délégation de responsabilité » ni le « management par objectifs » semblent plus aptes à surmonter les crises pétrolières et la fin du boom économique : pourtant les grandes entreprises allemandes (comme Aldi) semblent avoir parfaitement intégré ses enseignements, voire en avoir retenu le côté le plus radical et pervers : les contrôles et les délais (Chap. VIII : « Le crépuscule d'un dieu »).
L'Épilogue s'ouvre sur une analogie entre la carrière de Höhn et celle de « notre » Maurice Papon ; ensuite le rôle « dogmatique » du management est analysé dans notre société actuelle, sous le prisme de la « modernité réactionnaire » que nous vivons actuellement – et non seulement l'Allemagne de la reconstruction - ; enfin la problématique classique en philosophie politique qu'est celle de la liberté est évoquée à l'époque des « mastodontes organisationnels » mais aussi des remises en cause radicales du modèle économique productiviste qui sont les nôtres.
Cit. :
1. « Outre cette réjouissante perspective, celle du changement d'état, de la promotion, de l'avancement social, outre une politique fiscale et sociale avantageuse, il faut également administrer aux travailleurs allemands un baume qui adoucit l'effort, qui leur procure du plaisir, voire de la "joie", à travailler. le modèle, ici, est italien et, plus précisément, fasciste. C'est à l'exemple du "Dopolavoro" péninsulaire qu'est créée la "Force par la joie", l'organisation Kraft durch Freude, que l'on peut définir comme un immense comité d'entreprise à l'échelle du Reich tout entier. » (pp. 72-73)
2. « Les réflexions sur l'organisation du travail, sur l'optimisation des facteurs de production, sur la société productive la plus efficiente ont été nombreuses et intenses sous le IIIe Reich, non seulement parce qu'elles répondaient à des questions urgentes, sinon vitales, mais aussi parce que se trouvait en Allemagne une élite de jeunes universitaires qui alliaient volontiers savoir et action, réflexion savante et technocratie, et qui ont trouvé, pour quelques dizaines d'entre eux, un lieu naturel dans le service de renseignement (SD) de la SS, les autres se répartissant dans la myriade d'institutions et d'agences créées ad hoc sous le gouvernement nazi, quand ils ne profitaient pas tout simplement de la bonne aubaine offerte par la purge politique et raciale de l'Université, qui, en licenciant le tiers des effectifs de professeurs, d'assistants et de chercheurs, a libéré des milliers de postes dès le 7 avril 1933. » (p. 77)
3. « [La culture politique] de la RFA a accueilli avec faveur le management de Bad Harzburg, qui était parfaitement compatible avec elle : l'ordo-libéralisme se voulait une liberté encadrée, l'économie sociale de marché visait à l'intégration des masses par la participation et la cogestion, pour éviter la lutte des classes et le glissement vers le "bolchevisme". Höhn n'a jamais abandonné son cadre conceptuel de référence, à la fois principe et idéal – celui de la communauté, fermée de préférence. C'est, de fait, une communauté de carrières, d'intuitions et de culture qui, après 1949, a "reconstruit" les fondements de la production économique, de l'État et de l'armée. Les cadres d'après-guerre avaient tous fourbi leurs premières armes sous le IIIe Reich, et nombre d'entre eux étaient issus du SD de la SS. La transition personnelle – celle des carrières – et conceptuelle – celle des idées – ne fut généralement pas si malaisée : la "liberté germanique" devenait la liberté tout court, "l'effort d'armement" se muait en reconstruction et l'ennemi "judéo-bolchevique" n'était plus que benoîtement soviétique. Reinhard Höhn aura été, avant comme après 1945, l'homme de son temps. » (pp. 123-124)
4. « Être rentable / performant / productif (leistungsfähig) et s'affirmer (sich durchsetzen) dans un univers concurrentiel (Wettbewerb) pour triompher (siegen) dans le combat pour la vie (Lebenskampf) : ces vocables typiques de la pensée nazie furent les siens après 1945, comme ils sont trop souvent les nôtres aujourd'hui. Les nazis ne les ont pas inventés – ils sont hérités du darwinisme social militaire, économique et eugéniste de l'Occident des années 1850-1930 – mais ils les ont incarnés et illustrés d'une manière qui devrait nous conduire à réfléchir sur ce que nous sommes, pensons et faisons. » (p. 135)
Il faut d'abord se départir de l'idée que l'administration nazie ait opéré conformément à la tradition prussienne, comme un rouage de parfaite transmission (juridique) d'ordres provenant de la hiérarchie : les nazis se sont trouvés très vite dans l'obligation d'administrer un territoire immense avec les contraintes de l'économie de guerre, dans l'urgence concernant l'allocation des ressources (nourriture, énergie, matières premières pour l'industrie) et avec le minimum d'hommes (la majorité étant combattants) ; et par ailleurs dans une structure administrative massivement purgée des opposants politiques et « raciaux » (Chap. I : « Penser l'administration du Grand Reich »).
Mais idéologiquement aussi, le nazisme se caractérisait par son antipathie pour le droit (une invention judaïque), et pour l'État (une création de l'Empire romain déclinant), l'essence originaire des Germains se fondant au contraire sur la « liberté germanique », sur la « communauté » d'un peuple homogène racialement et dans sa volonté profonde (fût-elle inconsciente), une fois celui-ci « assaini » de ses éléments décadents et aliènes. Concrètement, le pouvoir nazi était une « polycratie » de personnalités fortement rivales entre elles et dans leurs tentatives d'anticiper, par la radicalité, les désirs du « Führer », à travers une pléthore d'« agences » ad hoc dotées de « missions » et d'« objectifs » spécifiques (Chap. II : « Faut-il en finir avec l'État ? »).
Évidemment, le concept de « liberté germanique » est une fiction perverse : fiction dans la mesure où elle présuppose cette « homogénéité » sociale et la communauté d'aspirations à l'intérieur de la Volksgemeinshaft (on notera la double polysémie de Volk – peuple ou bien race – et de Gemeinshaft – communauté humaine ou bien d'opinions) en gommant les antagonismes de classe ; perverse car, la verticalité du pouvoir étant conservée et même exacerbée, se précise le sens du titre : la liberté se réduit à l'état d'être « libres d'obéir » (Chap. III : « La "Liberté germanique").
L'on aperçoit que ces principes posent une analogie entre le gouvernement de société et l'organisation du travail : les objectifs étant établis au sommet de la pyramide du pouvoir, il ne reste aux échelons intermédiaires, aux cadres, que la « liberté » de trouver le moyen de les réaliser de façon autonome et sous leur responsabilité, contrairement à la vision individualiste du libéralisme et au « despotisme oriental » du bolchevisme ; par ailleurs l'eugénisme permet aux nazis de se débarrasser des « êtres non performants », « asociaux » et autres « entités indignes de vivre » : « le triptyque procréer-combattre-régner résume la mission historique et la vocation biologique du Germain » (p. 67) (Chap. IV : « Manager et ménager la "ressource humaine").
Nous sommes à la moitié du livre : il est temps de passer à la postérité du nazisme, et l'auteur choisit le parcours le plus emblématique, celui de Reinhard Höhn, docteur en droit, ayant gravi rapidement tous les échelons du cursus honorum de la SS jusqu'au grade de Oberführer (Général), passant sans encombre ni changement d'identité l'après-guerre, avec juste une « parenthèse naturopathe » de quelques années, puis profitant pleinement du réseau de ses « alte Kameraden » pour être propulsé d'abord dans un « think tank » industriel qui réfléchit aux méthodes de gestion des ressources humaines les plus modernes, enfin à la fondation d'une Akademie für Führungskräfte, grande école de management, l'équivalent de notre INSEAD (inagurée un an plus tard), sur le modèle de la Harvard Business School avec laquelle elle entretiendra toujours des rapports de dialogue (Chap. V : « De la SS au management : L'Akademie für Führungskräfte de Reinhard Höhn »).
Notre protagoniste Höhn a une passion : l'histoire militaire. Avec une étude de 1952 sur Scharnhorst, réformateur de l'armée prussienne après la défaite d'Iéna par Napoléon, il esquisse par analogie explicite son théorème sur les réformes nécessaires à son pays dans l'immédiat, avec cette optique pluridisciplinaire qui peut s'appliquer également à l'armée qu'à l'administration qu'à l'entreprise : une tactique du « cas particulier », « par mission » : Auftragstaktik, de « l'action plutôt que de la réflexion », une « stratégie de l'élasticité » (lire : flexibilité!) (Chap. VI : « L'art de la guerre (économique) »).
Le chapitre suivant démontre comment cet enseignement est particulièrement bien reçu en RFA des années du miracle économique, et comment des centaines de milliers de cadres sont envoyés se former à son école (Chap. VII : La méthode de Bad Harzburg : la liberté d'obéir, l'obligation de réussir »).
La biographie de Höhn se termine tout de même par un relatif déclin à la fin des années 70, alors qu'il a confortablement atteint l'âge de la retraite, mais qu'il montre une énergie inépuisable dans sa production scientifique. Son passé nazi commence à être inconfortable (le chancelier Willy Brandt était quand même un ancien résistant...), mais peut-être aussi parce que des nouveautés sur le plan des méthodes managériales, plus américaines, mais qui ne contredisent en rien les principes du modèle de la « délégation de responsabilité » ni le « management par objectifs » semblent plus aptes à surmonter les crises pétrolières et la fin du boom économique : pourtant les grandes entreprises allemandes (comme Aldi) semblent avoir parfaitement intégré ses enseignements, voire en avoir retenu le côté le plus radical et pervers : les contrôles et les délais (Chap. VIII : « Le crépuscule d'un dieu »).
L'Épilogue s'ouvre sur une analogie entre la carrière de Höhn et celle de « notre » Maurice Papon ; ensuite le rôle « dogmatique » du management est analysé dans notre société actuelle, sous le prisme de la « modernité réactionnaire » que nous vivons actuellement – et non seulement l'Allemagne de la reconstruction - ; enfin la problématique classique en philosophie politique qu'est celle de la liberté est évoquée à l'époque des « mastodontes organisationnels » mais aussi des remises en cause radicales du modèle économique productiviste qui sont les nôtres.
Cit. :
1. « Outre cette réjouissante perspective, celle du changement d'état, de la promotion, de l'avancement social, outre une politique fiscale et sociale avantageuse, il faut également administrer aux travailleurs allemands un baume qui adoucit l'effort, qui leur procure du plaisir, voire de la "joie", à travailler. le modèle, ici, est italien et, plus précisément, fasciste. C'est à l'exemple du "Dopolavoro" péninsulaire qu'est créée la "Force par la joie", l'organisation Kraft durch Freude, que l'on peut définir comme un immense comité d'entreprise à l'échelle du Reich tout entier. » (pp. 72-73)
2. « Les réflexions sur l'organisation du travail, sur l'optimisation des facteurs de production, sur la société productive la plus efficiente ont été nombreuses et intenses sous le IIIe Reich, non seulement parce qu'elles répondaient à des questions urgentes, sinon vitales, mais aussi parce que se trouvait en Allemagne une élite de jeunes universitaires qui alliaient volontiers savoir et action, réflexion savante et technocratie, et qui ont trouvé, pour quelques dizaines d'entre eux, un lieu naturel dans le service de renseignement (SD) de la SS, les autres se répartissant dans la myriade d'institutions et d'agences créées ad hoc sous le gouvernement nazi, quand ils ne profitaient pas tout simplement de la bonne aubaine offerte par la purge politique et raciale de l'Université, qui, en licenciant le tiers des effectifs de professeurs, d'assistants et de chercheurs, a libéré des milliers de postes dès le 7 avril 1933. » (p. 77)
3. « [La culture politique] de la RFA a accueilli avec faveur le management de Bad Harzburg, qui était parfaitement compatible avec elle : l'ordo-libéralisme se voulait une liberté encadrée, l'économie sociale de marché visait à l'intégration des masses par la participation et la cogestion, pour éviter la lutte des classes et le glissement vers le "bolchevisme". Höhn n'a jamais abandonné son cadre conceptuel de référence, à la fois principe et idéal – celui de la communauté, fermée de préférence. C'est, de fait, une communauté de carrières, d'intuitions et de culture qui, après 1949, a "reconstruit" les fondements de la production économique, de l'État et de l'armée. Les cadres d'après-guerre avaient tous fourbi leurs premières armes sous le IIIe Reich, et nombre d'entre eux étaient issus du SD de la SS. La transition personnelle – celle des carrières – et conceptuelle – celle des idées – ne fut généralement pas si malaisée : la "liberté germanique" devenait la liberté tout court, "l'effort d'armement" se muait en reconstruction et l'ennemi "judéo-bolchevique" n'était plus que benoîtement soviétique. Reinhard Höhn aura été, avant comme après 1945, l'homme de son temps. » (pp. 123-124)
4. « Être rentable / performant / productif (leistungsfähig) et s'affirmer (sich durchsetzen) dans un univers concurrentiel (Wettbewerb) pour triompher (siegen) dans le combat pour la vie (Lebenskampf) : ces vocables typiques de la pensée nazie furent les siens après 1945, comme ils sont trop souvent les nôtres aujourd'hui. Les nazis ne les ont pas inventés – ils sont hérités du darwinisme social militaire, économique et eugéniste de l'Occident des années 1850-1930 – mais ils les ont incarnés et illustrés d'une manière qui devrait nous conduire à réfléchir sur ce que nous sommes, pensons et faisons. » (p. 135)
Il y a quelques mois, j'ai suivi une formation. Théoriquement, c'était une formation professionnelle mais elle s'est révélée bien plus que ça, une semaine de réflexion sur et pour moi.
Dans la bibliographie de cette formation se trouvait ‘Libres d'obéir'. Théoriquement, c'était un livre sur la filiation entre le nazisme et le management moderne. Pas courant, me direz-vous ?
Le livre s'est révélé encore plus que ça : une brillante étude historique de la ‘Menschenführung' vue par les nazis, couplée à une mise en cause implicite du monde économique moderne.
Le titre ‘Libres d'obéir' est tout à fait révélateur du propos : si l'Allemagne nazie a bafoué la liberté de nombreux individus (ainsi que leur vie) et mis toute la doctrine entre les mains du ‘Führer', elle prônait pourtant, pour la réalisation de la doctrine, l'autonomie de moyens à tous les échelons.
Ainsi, les individus n'avaient pas leur mot à dire sur la politique, l'antisémitisme ou la guerre. En ce sens, ils devaient ‘obéir'.
Mais, une fois l'objectif fixé, ils disposaient d'un grand champ d'actions sur les moyens de le réaliser. D'où la liberté (illusoire).
La description du système d'organisation imaginé par les théoriciens nazis est très intéressante, aux antipodes de ce que j'imaginais. La présence de ces théoriciens nazis dans les instances économiques et éducatives de l'Allemagne des Années 1950 à 1990 est glaçante.
Le parallèle avec le management moderne l'est également. Si les finalités n'y sont évidemment pas les mêmes que celles du Reich, les salariés et managers y sont pour autant tout aussi 'libres d'obéir'.
En effet, les objectifs stratégiques leur viennent toujours d'en haut et ne font pas l'objet de discussions. Ils ont en revanche la (pseudo-) liberté que leur confèrent l'agilité, la délégation de moyens ou le management par objectifs.
En un sens, le management nazi était beaucoup plus libre que je l'imaginais… et le management moderne beaucoup moins ! C'est donc un livre passionnant qui m'a appris des choses et fait réfléchir à des concepts.
Dans la bibliographie de cette formation se trouvait ‘Libres d'obéir'. Théoriquement, c'était un livre sur la filiation entre le nazisme et le management moderne. Pas courant, me direz-vous ?
Le livre s'est révélé encore plus que ça : une brillante étude historique de la ‘Menschenführung' vue par les nazis, couplée à une mise en cause implicite du monde économique moderne.
Le titre ‘Libres d'obéir' est tout à fait révélateur du propos : si l'Allemagne nazie a bafoué la liberté de nombreux individus (ainsi que leur vie) et mis toute la doctrine entre les mains du ‘Führer', elle prônait pourtant, pour la réalisation de la doctrine, l'autonomie de moyens à tous les échelons.
Ainsi, les individus n'avaient pas leur mot à dire sur la politique, l'antisémitisme ou la guerre. En ce sens, ils devaient ‘obéir'.
Mais, une fois l'objectif fixé, ils disposaient d'un grand champ d'actions sur les moyens de le réaliser. D'où la liberté (illusoire).
La description du système d'organisation imaginé par les théoriciens nazis est très intéressante, aux antipodes de ce que j'imaginais. La présence de ces théoriciens nazis dans les instances économiques et éducatives de l'Allemagne des Années 1950 à 1990 est glaçante.
Le parallèle avec le management moderne l'est également. Si les finalités n'y sont évidemment pas les mêmes que celles du Reich, les salariés et managers y sont pour autant tout aussi 'libres d'obéir'.
En effet, les objectifs stratégiques leur viennent toujours d'en haut et ne font pas l'objet de discussions. Ils ont en revanche la (pseudo-) liberté que leur confèrent l'agilité, la délégation de moyens ou le management par objectifs.
En un sens, le management nazi était beaucoup plus libre que je l'imaginais… et le management moderne beaucoup moins ! C'est donc un livre passionnant qui m'a appris des choses et fait réfléchir à des concepts.
AVERTISSEMENT : Macroniste s'abstenir !
Je suis en colère.
Cette colère est devenue rage. Et cette rage a commencé maintenant à s'attaquer à mon corps, à mes organes, à mon foie, mes poumons.
Et cette colère, puis cette rage trouve sa source dans le monde demi-divin (semi-jupitérien) macroniste, de ce monde LREM qui détruit tout ce qui reste de manifestation de Fraternité (ou Soro-Fraternité comme j'aimerais pouvoir l'écrire) de notre pays, le mot Liberté à perdu son sens et égalité deviens une sombre équité, ce « mérite » cher à Buchenwald. Et ces être humains élus sous l'étiquette LREM se revendique du management moderne
Et…
Et j'ai lu cet essaie. Et il m'a éclairé sur la source de ma rage. Comment des personnes humaines peuvent-être s'enténébrer ainsi ? Comment peuvent-elles ne pas voir l'appel au néant qu'elles émettent ? LREM est l'étiquette de « Manager le pays comme on Manage une multinationale capitaliste » (Manger le pays comme on mange les personnes humaines d'une industrie capitaliste).
Et j'ai compris pourquoi certain présentateurs radio ont voulu discréditer le travail de monsieur Chapoutot. Par aveuglement, pas l'aveuglement de l'obscurité créative des insomniaques, non, celle des ténèbres destructrice né de la peur de l'à venir. Chapoutot nous dit d'où tous cela vient. Il nous expose la genèse du management totalitaire ultra-libérale. le Nazisme est un totalitarisme comme le fut le stalinisme comme l'est l'ultra-libéralisme.
Maintenant, je peux regarder ma rage en face, puis ma colère, je pourrais regarder son cheminement et son effet et je sais qu'une fois qu'elle sera passé, je pourrais me retrouver et alors je serais libre à nouveau de désobéir en conscience et en amour. Ce cour essai fut pour moi une belle thérapie.
Macroniste s'abstenir au risque d'être déstabilisé !
Lien : https://tsuvadra.blog/2020/0..
Je suis en colère.
Cette colère est devenue rage. Et cette rage a commencé maintenant à s'attaquer à mon corps, à mes organes, à mon foie, mes poumons.
Et cette colère, puis cette rage trouve sa source dans le monde demi-divin (semi-jupitérien) macroniste, de ce monde LREM qui détruit tout ce qui reste de manifestation de Fraternité (ou Soro-Fraternité comme j'aimerais pouvoir l'écrire) de notre pays, le mot Liberté à perdu son sens et égalité deviens une sombre équité, ce « mérite » cher à Buchenwald. Et ces être humains élus sous l'étiquette LREM se revendique du management moderne
Et…
Et j'ai lu cet essaie. Et il m'a éclairé sur la source de ma rage. Comment des personnes humaines peuvent-être s'enténébrer ainsi ? Comment peuvent-elles ne pas voir l'appel au néant qu'elles émettent ? LREM est l'étiquette de « Manager le pays comme on Manage une multinationale capitaliste » (Manger le pays comme on mange les personnes humaines d'une industrie capitaliste).
Et j'ai compris pourquoi certain présentateurs radio ont voulu discréditer le travail de monsieur Chapoutot. Par aveuglement, pas l'aveuglement de l'obscurité créative des insomniaques, non, celle des ténèbres destructrice né de la peur de l'à venir. Chapoutot nous dit d'où tous cela vient. Il nous expose la genèse du management totalitaire ultra-libérale. le Nazisme est un totalitarisme comme le fut le stalinisme comme l'est l'ultra-libéralisme.
Maintenant, je peux regarder ma rage en face, puis ma colère, je pourrais regarder son cheminement et son effet et je sais qu'une fois qu'elle sera passé, je pourrais me retrouver et alors je serais libre à nouveau de désobéir en conscience et en amour. Ce cour essai fut pour moi une belle thérapie.
Macroniste s'abstenir au risque d'être déstabilisé !
Lien : https://tsuvadra.blog/2020/0..
L'expansion rapide du territoire du IIIe Reich a posé un problème à l'administration nazie (bon, en vrai, ça a surtout posé des problèmes aux populations locales, mais laissons cet aspect de côté dans cette critique) : en effet, le nombre de fonctionnaires et de cadres n'augmente pas en proportion des conquêtes. Il faut donc faire toujours plus avec des ressources humaines qui ne changent pas.
L'auteur montre comment a émergé une pensée du management directement dérivée des idées nazies. Paradoxalement, elle ne se reposait pas sur une hiérarchie stricte, comme on pourrait s'y attendre dans un système autocratique, mais au contraire sur une décentralisation extrême. Tout d'abord en s'inspirant du mythe de la « liberté du Germain », en opposition à une application tatillonne et (surtout) judéo-romaine de la loi. Ensuite, en favorisant la compétition, censée sélectionner les meilleurs éléments : l'auteur montre qu'il n'était pas rare que plusieurs agences aient des missions similaires, celle apportant la meilleure solution étant automatiquement justifiée dans toutes ses actions. Enfin, en abolissant le conflit de classe patron-travailleur : chacun doit être convaincu du bien-fondé de sa mission et doit faire le maximum pour servir le système. À ce titre, il doit prendre en charge lui-même la santé physique et mentale de ses travailleurs, afin de s'assurer qu'ils soient correctement reposés et prêts à donner toute leur énergie.
On se retrouve au final avec un système dans lequel toute la pression retombe sur les éléments à la base : leurs objectifs sont fixés, sans la possibilité de les modifier ou de les déclarer irréalisables, mais ils sont « libres » de choisir la meilleure manière de les atteindre. Un objectif non-atteint sera donc toujours de leur faute, jamais de celle du supérieur : il fallait être plus souple, plus efficace, plus malin.
Ce système a survécu au régime nazi : beaucoup de cadres se sont en effet recyclés dans le civil, dont des écoles de management, car, après tout, le régime était un modèle d'efficacité. C'est là où le propos du livre devient ambigu : l'auteur montre que le passé nazi de certains professeurs a été dévoilé, que leurs principes de management ont finalement été écartés, … et pourtant, on ressort du livre avec l'idée que toutes les entreprises, encore aujourd'hui, s'inspirent d'idées nazies pour gérer leur personnel ; idée qui m'est restée également après avoir entendu des interviews de l'auteur. J'aurais préféré que l'auteur approfondisse ce sujet, ou qu'il s'en tienne au cadre strictement historique, car il me semble trop grave que pour être abordé uniquement par quelques suggestions éparpillées dans plusieurs chapitres.
L'auteur montre comment a émergé une pensée du management directement dérivée des idées nazies. Paradoxalement, elle ne se reposait pas sur une hiérarchie stricte, comme on pourrait s'y attendre dans un système autocratique, mais au contraire sur une décentralisation extrême. Tout d'abord en s'inspirant du mythe de la « liberté du Germain », en opposition à une application tatillonne et (surtout) judéo-romaine de la loi. Ensuite, en favorisant la compétition, censée sélectionner les meilleurs éléments : l'auteur montre qu'il n'était pas rare que plusieurs agences aient des missions similaires, celle apportant la meilleure solution étant automatiquement justifiée dans toutes ses actions. Enfin, en abolissant le conflit de classe patron-travailleur : chacun doit être convaincu du bien-fondé de sa mission et doit faire le maximum pour servir le système. À ce titre, il doit prendre en charge lui-même la santé physique et mentale de ses travailleurs, afin de s'assurer qu'ils soient correctement reposés et prêts à donner toute leur énergie.
On se retrouve au final avec un système dans lequel toute la pression retombe sur les éléments à la base : leurs objectifs sont fixés, sans la possibilité de les modifier ou de les déclarer irréalisables, mais ils sont « libres » de choisir la meilleure manière de les atteindre. Un objectif non-atteint sera donc toujours de leur faute, jamais de celle du supérieur : il fallait être plus souple, plus efficace, plus malin.
Ce système a survécu au régime nazi : beaucoup de cadres se sont en effet recyclés dans le civil, dont des écoles de management, car, après tout, le régime était un modèle d'efficacité. C'est là où le propos du livre devient ambigu : l'auteur montre que le passé nazi de certains professeurs a été dévoilé, que leurs principes de management ont finalement été écartés, … et pourtant, on ressort du livre avec l'idée que toutes les entreprises, encore aujourd'hui, s'inspirent d'idées nazies pour gérer leur personnel ; idée qui m'est restée également après avoir entendu des interviews de l'auteur. J'aurais préféré que l'auteur approfondisse ce sujet, ou qu'il s'en tienne au cadre strictement historique, car il me semble trop grave que pour être abordé uniquement par quelques suggestions éparpillées dans plusieurs chapitres.
critiques presse (3)
L'ouvrage de l’historien Johann Chapoutot, spécialiste de la pensée et de la culture nazies, met en perspective les contraintes de développement de l’organisation nazie avec la nécessité de développer une nouvelle forme de management des équipes
Lire la critique sur le site : NonFiction
L’historien du nazisme retrace dans un essai passionnant la deuxième vie de Reinhard Höhn, brillant juriste du IIIe Reich devenu après-guerre le fondateur de la principale école de commerce allemande.
Lire la critique sur le site : LeFigaro
Un livre remarquable qui fait mal et nous montre combien notre relation au monde du travail est encore imprégnée de l’idéologie nazie.
Lire la critique sur le site : Marianne_
Citations et extraits (69)
Voir plus
Ajouter une citation
(P66) : Le racisme nazi est eugéniste : il ne suffit pas de posséder le bon sang et la bonne couleur de peau, il faut aussi être pleinement employable comme appareil producteur et reproducteur. Le pronostic génétique prénatal n’existant pas à l’époque, l’heure est au diagnostic : tous ceux qui sont considérés comme malades héréditaires doivent être exclus du cycle procréatif (400 000 stérilisations forcées de 1933 à 1945), voire assassinés, comme c’est le cas à partir de l’entrée en guerre en 1939 (200 000 morts jusqu’en 1945), dans le cadre de l’opération T4 et de ses prolongements : comme on le voit, le crime contre l’humanité et le massacre de masse frappent également la biologie ou, littéralement, la biomasse « germanique » quand celle-ci est considérée comme insatisfaisante ou défaillante. Les « êtres non performants », « non productifs », « non rentable » (leistungsunfähige Wesen) sont des « êtres indignes de vivre » (lebensunwürdige Menschen), de simples « enveloppes corporelles humanoïdes vides » (leere Menschenhülsen) qui doivent être exclus du « patrimoine génétique allemand » (deutsche Erbmasse). Les médecins ont d’autant moins de scrupule à collaborer à cette entreprise d’ingénierie biopolitique ou, pour le dire dans les termes d’un juriste nazi, « bionomique », qu’ils considèrent que le sujet à soigner n’est pas l’individu, mais le « corps » de la « communauté du peuple » dans son entier, dont les individus ne sont que des membres.
Le prisme biologique nazi déforme donc les allogènes, les étrangers à la race, perçus comme inférieurs ou dangereux, mais aussi l’humanité allemande elle-même, qui doit faire preuve de son excellence – Hitler n’hésitant pas à considérer en mars 1945 que, les Allemands ayant perdu la guerre, la totalité de son peuple pouvait bien périr en raison de son infériorité avérée.
L’ingénierie sociale, biologique et médicale frappe de plein fouet les « êtres non performants » et les « entités indignes de vivre », mais aussi les « asociaux » - vagabonds, rêveurs, originaux divers ou sous-préfets aux champs dont l’existence n’est pas encore « rentable » pour la « communauté du peuple ». A partir de 1936, plusieurs opérations de la police et de la SS raflent des milliers d’oisifs ou considérés comme tels, versés à des camps de travail ou dans des camps de concentration.
L’homme allemand ne doit donc être ni malade, ni oisif, ni engagé contre le nouveau pouvoir. Procréateur, il doit être de constitution saine, entretenir celle-ci par l’hygiène et le sport afin de s’aguerrir au travail comme à la guerre.
Le prisme biologique nazi déforme donc les allogènes, les étrangers à la race, perçus comme inférieurs ou dangereux, mais aussi l’humanité allemande elle-même, qui doit faire preuve de son excellence – Hitler n’hésitant pas à considérer en mars 1945 que, les Allemands ayant perdu la guerre, la totalité de son peuple pouvait bien périr en raison de son infériorité avérée.
L’ingénierie sociale, biologique et médicale frappe de plein fouet les « êtres non performants » et les « entités indignes de vivre », mais aussi les « asociaux » - vagabonds, rêveurs, originaux divers ou sous-préfets aux champs dont l’existence n’est pas encore « rentable » pour la « communauté du peuple ». A partir de 1936, plusieurs opérations de la police et de la SS raflent des milliers d’oisifs ou considérés comme tels, versés à des camps de travail ou dans des camps de concentration.
L’homme allemand ne doit donc être ni malade, ni oisif, ni engagé contre le nouveau pouvoir. Procréateur, il doit être de constitution saine, entretenir celle-ci par l’hygiène et le sport afin de s’aguerrir au travail comme à la guerre.
(P 75) : Rasséréné par un lieu de travail transfiguré, l’ouvrier est également pris en charge en dehors de l’usine ou du bureau. Là encore, il s’agit de renforcer et de reconstituer sa force productive par des loisirs qui lui permettront de revenir au poste pleinement reposé et disponible. L’organisation Kde F offre ainsi des randonnées dans la nature, des croisières maritimes ou des séjours tout compris dans des centres de vacances montagnards ou balnéaires créés à cet effet, comme le titanesque site de Prora, sur l’île de Rügen, avec son hôtel de 6 kilomètres de long et ses 20000 lits. De 1933 à 1939, ce sont 36 millions de voyages courts qui sont organisés, et 7 millions de voyages et séjours longs, dont 700000 croisières sur les « bateaux KdeF », ces paquebots construits et affrétés par l’organisation elle-même. La promesse « socialiste » a ses limites : les croisières, en raison de leur prix (120 RM), sont réservées aux employés et aux cadres, le salaire moyen de l’ouvrier (150 RM) mettant ce loisir hors de sa portée. Les ouvriers ont plutôt droit aux excursions de quelques jours dans la montagne bavaroise – ce qui, à l’époque, n’est pas rien – ainsi qu’aux sorties au théâtre, au cinéma, ou dans les musées (presque 40 millions d’entrées jusqu’en 1939.)
En 1936, un village olympique de la KdF construit à cet effet permet à des dizaines de milliers de « Volksgenossen » de venir assister aux JO d’été à Berlin – le spectacle du sport étant une source d’émulation qui doit se traduire, selon les vœux explicites d’Hitler lui-même, en santé physique, en force productive et en agressivité guerrière.
La récompense ultime est, pour l’ouvrier allemand, la « voiture KdF », la KdF-Wagen dessinée par Ferdinand Porsche, dont la production débute en 1938 et qui prendra, après 1945, le nom populaire de « coccinelle ». La Volkswagen, littéralement la « voiture du peuple », est une des nombreuses promesses non tenues du IIIème Reich, car du fait de la guerre, sa production cesse dès 1939 au profit de la construction, dans les usines KdF, de Kübelwagen, des véhicules militaires comparables à la Jeep américaine.
En 1936, un village olympique de la KdF construit à cet effet permet à des dizaines de milliers de « Volksgenossen » de venir assister aux JO d’été à Berlin – le spectacle du sport étant une source d’émulation qui doit se traduire, selon les vœux explicites d’Hitler lui-même, en santé physique, en force productive et en agressivité guerrière.
La récompense ultime est, pour l’ouvrier allemand, la « voiture KdF », la KdF-Wagen dessinée par Ferdinand Porsche, dont la production débute en 1938 et qui prendra, après 1945, le nom populaire de « coccinelle ». La Volkswagen, littéralement la « voiture du peuple », est une des nombreuses promesses non tenues du IIIème Reich, car du fait de la guerre, sa production cesse dès 1939 au profit de la construction, dans les usines KdF, de Kübelwagen, des véhicules militaires comparables à la Jeep américaine.
(P62) : La célébration de la fête du travail le 1er mai 1933 fut l’occasion, lors d’une cérémonie grandiose à Berlin-Tempelhof, de proclamer la fin de la lutte des classes et l’avènement d’une société de « camarades de race » (Volksgenossen) unis dans le combat que l’Allemagne doit mener pour sa survie.
La vision nazie du monde et de l’histoire est sombre : la vie est un combat permanent, contre la nature, contre les maladies, contre les autres peuples et les autres races. Ce topo du darwinisme social est radicalisé et répété sous le IIIème Reich, dans une Allemagne fortement ébranlée par des traumatismes à répétition : modernisation rapide et brutale de 1871 à 1914, Grande guerre (1914-1918/9) et défaite, quasi-guerre civile entre 1918 et 1923, hyperinflation en 1922 et 1923 puis, derechef, grande crise économique, sociale et politique – ainsi que culturelle et psychologique – à partir de 1929. La représentation obsidionale d’une Allemagne menacée de toutes parts et assiégée trouve donc dans l’histoire récente des éléments de plausibilité certains – avec leurs discours anxiogène et déploratoire, les nazis savent qu’ils suscitent un écho dans l’expérience de leurs contemporains.
La vision nazie du monde et de l’histoire est sombre : la vie est un combat permanent, contre la nature, contre les maladies, contre les autres peuples et les autres races. Ce topo du darwinisme social est radicalisé et répété sous le IIIème Reich, dans une Allemagne fortement ébranlée par des traumatismes à répétition : modernisation rapide et brutale de 1871 à 1914, Grande guerre (1914-1918/9) et défaite, quasi-guerre civile entre 1918 et 1923, hyperinflation en 1922 et 1923 puis, derechef, grande crise économique, sociale et politique – ainsi que culturelle et psychologique – à partir de 1929. La représentation obsidionale d’une Allemagne menacée de toutes parts et assiégée trouve donc dans l’histoire récente des éléments de plausibilité certains – avec leurs discours anxiogène et déploratoire, les nazis savent qu’ils suscitent un écho dans l’expérience de leurs contemporains.
(P 84) : Après la parenthèse naturopathe, la situation de Reinhard Höhn s’améliore rapidement, grâce aux réseaux de solidarité qui lient les quelques 6500 anciens du SD (pour 50000 personnes employées par le RSAH (Reichssicherheitshauptamt, l’office central de sécurité du Reich). Ces réseaux sont actifs et puissants, car on retrouve d’anciens technocrates et intellectuels SS partout dans le monde de l’administration, de l’Université, de la justice et de l’économie. Les anciens gestionnaires du Grand Reich sont particulièrement plébiscités dans le secteur privé, où l’on apprécie leur excellent formation (de juriste, généralement), leur expérience à la tête des organes du Reich, et où l’on se souvient des excellentes affaires réalisées, pendant douze ans, grâce au réarmement et à la coopération fructueuse entre industrie allemande et empire concentrationnaire SS.
(P19) : Notre propos n’est ni essentialiste, ni généalogique : il ne s’agit pas de dire que le management a des origines nazies – c’est faux, il lui préexiste de quelques décennies – ni qu’il est une activité criminelle par essence.
Nous proposons simplement une étude de cas, qui repose sur deux constats intéressants pour notre réflexion sur le monde dans lequel nous vivons et travaillons : de jeunes juristes, universitaires et hauts fonctionnaires du IIIème Reich ont beaucoup réfléchi aux questions managériales, car l’entreprise nazie faisait face à des besoins gigantesques en termes de mobilisation des ressources et d’organisation du travail. Ils ont élaboré, paradoxalement, une conception du travail non autoritaire, où l’employé et l’ouvrier consentent à leur sort et approuvent leur activité, dans un espace de liberté et d’autonomie a priori bien incompatible avec le caractère illibéral du IIIème Reich, une forme de travail « par la joie » (durch Freude) qui a prospéré après 1945, et qui nous est familière aujourd’hui, à l’heure où l’«engagement », la « motivation » et l’«implication » sont censés procéder du « plaisir » de travailler et de la « bienveillance » de la structure.
Assuré de l’autonomie des moyens, sans pouvoir participer à la définition et à la fixation des objectifs, l’exécutant se trouvait d’autant plus responsable – et donc, en l’espèce, coupable – en cas d’échec de la mission.
Nous proposons simplement une étude de cas, qui repose sur deux constats intéressants pour notre réflexion sur le monde dans lequel nous vivons et travaillons : de jeunes juristes, universitaires et hauts fonctionnaires du IIIème Reich ont beaucoup réfléchi aux questions managériales, car l’entreprise nazie faisait face à des besoins gigantesques en termes de mobilisation des ressources et d’organisation du travail. Ils ont élaboré, paradoxalement, une conception du travail non autoritaire, où l’employé et l’ouvrier consentent à leur sort et approuvent leur activité, dans un espace de liberté et d’autonomie a priori bien incompatible avec le caractère illibéral du IIIème Reich, une forme de travail « par la joie » (durch Freude) qui a prospéré après 1945, et qui nous est familière aujourd’hui, à l’heure où l’«engagement », la « motivation » et l’«implication » sont censés procéder du « plaisir » de travailler et de la « bienveillance » de la structure.
Assuré de l’autonomie des moyens, sans pouvoir participer à la définition et à la fixation des objectifs, l’exécutant se trouvait d’autant plus responsable – et donc, en l’espèce, coupable – en cas d’échec de la mission.
Videos de Johann Chapoutot (24)
Voir plusAjouter une vidéo
Table ronde, carte blanche aux Presses universitaires de Lyon
Modération : Julien THÉRY, directeur scientifique des Presses universitaires de Lyon
Avec Johann CHAPOUTOT, professeur à Sorbonne Université, Éric VUILLARD, écrivain, lauréat du Prix Goncourt 2017
À l'occasion de la réédition des écrits politico-théologiques majeurs de Thomas Müntzer (1490-1525) dans une magnifique traduction signée Joël Lefebvre, les Presses universitaires de Lyon invitent à découvrir ce penseur méconnu en France, alors qu'il fut l'un des principaux artisans de la Réforme protestante. Prédicateur de talent, partisan de Luther de la première heure, Müntzer prend toutefois rapidement ses distances et assume des positions bien plus radicales : il prône la fin de l'oppression culturelle entretenue par les doctes et les clercs, la fin de l'oppression politique instituée par les princes, la fin de l'exploitation économique dont profitent les seigneurs. Il rejoint bientôt un mouvement de révolte, qui donnera naissance à la “guerre des Paysans”, et devient l'un des chefs de la rébellion, appelant à une révolution à la fois spirituelle et matérielle. Rapidement capturé, il est torturé puis exécuté. À travers la traduction de sept textes fondateurs et d'une vingtaine de lettres, Joël Lefebvre met en lumière l'intérêt à la fois philosophique, historique et linguistique de l'oeuvre de Thomas Müntzer. Les préfaciers de cet ouvrage, l'historien spécialiste de l'Allemagne Johann Chapoutot et l'écrivain Éric Vuillard, auteur d'un livre récent inspiré par l'action de Müntzer, évoqueront la portée de ses écrits dans une discussion animée par Julien Théry, directeur scientifique des Presses universitaires de Lyon et historien des relations entre religion et politique.
À l'occasion de la réédition des écrits politico-théologiques majeurs de Thomas Müntzer (1490-1525) dans une magnifique traduction signée Joël Lefebvre, les Presses universitaires de Lyon invitent à découvrir ce penseur méconnu en France, alors qu'il fut l'un des principaux artisans de la Réforme protestante. Prédicateur de talent, partisan de Luther de la première heure, Müntzer prend toutefois rapidement ses distances et assume des positions bien plus radicales : il prône la fin de l'oppression culturelle entretenue par les doctes et les clercs, la fin de l'oppression politique instituée par les princes, la fin de l'exploitation économique dont profitent les seigneurs. Il rejoint bientôt un mouvement de révolte, qui donnera naissance à la “guerre des Paysans”, et devient l'un des chefs de la rébellion, appelant à une révolution à la fois spirituelle et matérielle. Rapidement capturé, il est torturé puis exécuté. À travers la traduction de sept textes fondateurs et d'une vingtaine de lettres, Joël Lefebvre met en lumière l'intérêt à la fois philosophique, historique et linguistique de l'oeuvre de Thomas Müntzer. Les préfaciers de cet ouvrage, l'historien spécialiste de l'Allemagne Johann Chapoutot et l'écrivain Éric Vuillard, auteur d'un livre récent inspiré par l'action de Müntzer, évoqueront la portée de ses écrits dans une discussion animée par Julien Théry, directeur scientifique des Presses universitaires de Lyon et historien des relations entre religion et politique.
+ Lire la suite
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Johann Chapoutot (18)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
859 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre859 lecteurs ont répondu