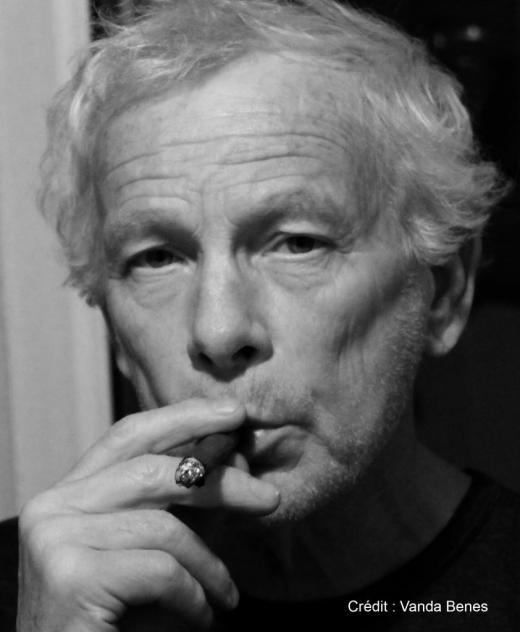Citation de Partemps
05/10 [une goutte de lait]
des cuvettes du firmament
petit homme dès qu’étant né
tu files au néant
le Léthé
pleut pas de bol son jet
de non-oubli : ça fait
un trou de face hallu
ciné (moi) c’est foutu
*
07/10 [home cinéma : western à l’envers]
Missouri breaks (Arthur Penn, 1976). Prologue : trois cavaliers dans la prairie du Missouri. Parlent, paisibles, derrière les fleurs caressées de vent, d’un monde qui s’en va (moins d’herbe, trop de voleurs, plus de morale : ravines dans les têtes comme dans la plaine, décentrement de l’espace, du temps, des pensées).
L’un des trois est morose. Sans plus. Cut. Une autre image déboule, non commentée : le jeune homme à la triste figure, corde au cou, sur son cheval. Éperonne lui-même la bête. Spasmes. Fin de la séquence. Causes de la pendaison, détails de sa cruauté : ça viendra après, par petites bulles disséminées au long de la fiction.
Penn entre à l’envers dans le western (il renverse sa ligne narrative). Après : décentrements, contrastes, torsions, lacunes (narration baroque).
Par exemple : une demoiselle directe (insoumise au code) pousse au lit un brigand réticent (soumis au code). Et hop : l’idylle. Soit : inversion (topos baroque) de l’ordre narratif et moral. Celui où, au moins en français, on se vouvoie, devient amoureux, couche, se dit tu : où le spectateur sait que les héros ont couché parce qu’ils se disent tout d’un coup tu.
Autre : dans leur ranch (ils y rassemblent les chevaux qu’ils volent), les outlaws se font des niches puériles, élèvent des poules, papotent : dures enfances, pourquoi je suis mauvais, de petites causes (feu sur le chien qui lécha le beurre !) à grands effets (destins criminels), vrac de lieux communs, essais d’aphorismes. Mais par désœuvrement, brefs flashes de mémoire, coq-à-l’âne, pensées vite suspendues. Tarentino s’en souviendra.
L’image aussi est baroque. Vives alternances de très gros plans (visages, armes) et de panoramiques immenses (à côté : Sergio Leone). Les fonds (paysages profonds, surfaces fuyantes du fleuve Missouri, forêts canadiennes) viennent manger les devants où s’agitent, figurines minusculées, des héros dérisoires. Symétriquement, les premiers plans (corps des protagonistes) reculent vers des fonds qui les décentrent et les effacent, avalés par la pénombre des maisons (l’intérieur) ou la lumière des ciels et des eaux (l’extérieur). Voire : les corps se noient dans ces fonds (Randy Quaid, as Little Tod). Ou finissent brûlés par eux (Dean Stanton, as Calvin). Entre fonds et premiers plans passent des guirlandes de chevaux comme passent biches et lapins derrière les batailles de Paolo Uccello.
Restait à concentrer sur une figure les attributs du baroque (au sens, du coup, de : tordu, braque — étrangement inquiétant). Voici Marlon Brando, as Lee Clayton, le « régulateur » (oxymore de la régulation, en vérité). Jamais tout à fait dans le champ : rêveur, nocturne, absent, non vraiment « concerné ». Spectaculairement présent, cependant : occupant all over l’écran. Thorax en tonneau sur pattes grêles, chapeaux hyperboliques, vaste veste à franges, travestissements (à la fin : en terrificque Ma Dalton), pistolets ornés, jumelles (ça floute et ça zoome), tactiques sinueuses, bricolages à la Buster Keaton, rires inquiétants, silences pas moins. Il sature espace et récit d’une hésitation effrayante entre bouffonnerie rococo et violence dramatique sur-jouée à force d’affectation de froideur maniériste.
*
des cuvettes du firmament
petit homme dès qu’étant né
tu files au néant
le Léthé
pleut pas de bol son jet
de non-oubli : ça fait
un trou de face hallu
ciné (moi) c’est foutu
*
07/10 [home cinéma : western à l’envers]
Missouri breaks (Arthur Penn, 1976). Prologue : trois cavaliers dans la prairie du Missouri. Parlent, paisibles, derrière les fleurs caressées de vent, d’un monde qui s’en va (moins d’herbe, trop de voleurs, plus de morale : ravines dans les têtes comme dans la plaine, décentrement de l’espace, du temps, des pensées).
L’un des trois est morose. Sans plus. Cut. Une autre image déboule, non commentée : le jeune homme à la triste figure, corde au cou, sur son cheval. Éperonne lui-même la bête. Spasmes. Fin de la séquence. Causes de la pendaison, détails de sa cruauté : ça viendra après, par petites bulles disséminées au long de la fiction.
Penn entre à l’envers dans le western (il renverse sa ligne narrative). Après : décentrements, contrastes, torsions, lacunes (narration baroque).
Par exemple : une demoiselle directe (insoumise au code) pousse au lit un brigand réticent (soumis au code). Et hop : l’idylle. Soit : inversion (topos baroque) de l’ordre narratif et moral. Celui où, au moins en français, on se vouvoie, devient amoureux, couche, se dit tu : où le spectateur sait que les héros ont couché parce qu’ils se disent tout d’un coup tu.
Autre : dans leur ranch (ils y rassemblent les chevaux qu’ils volent), les outlaws se font des niches puériles, élèvent des poules, papotent : dures enfances, pourquoi je suis mauvais, de petites causes (feu sur le chien qui lécha le beurre !) à grands effets (destins criminels), vrac de lieux communs, essais d’aphorismes. Mais par désœuvrement, brefs flashes de mémoire, coq-à-l’âne, pensées vite suspendues. Tarentino s’en souviendra.
L’image aussi est baroque. Vives alternances de très gros plans (visages, armes) et de panoramiques immenses (à côté : Sergio Leone). Les fonds (paysages profonds, surfaces fuyantes du fleuve Missouri, forêts canadiennes) viennent manger les devants où s’agitent, figurines minusculées, des héros dérisoires. Symétriquement, les premiers plans (corps des protagonistes) reculent vers des fonds qui les décentrent et les effacent, avalés par la pénombre des maisons (l’intérieur) ou la lumière des ciels et des eaux (l’extérieur). Voire : les corps se noient dans ces fonds (Randy Quaid, as Little Tod). Ou finissent brûlés par eux (Dean Stanton, as Calvin). Entre fonds et premiers plans passent des guirlandes de chevaux comme passent biches et lapins derrière les batailles de Paolo Uccello.
Restait à concentrer sur une figure les attributs du baroque (au sens, du coup, de : tordu, braque — étrangement inquiétant). Voici Marlon Brando, as Lee Clayton, le « régulateur » (oxymore de la régulation, en vérité). Jamais tout à fait dans le champ : rêveur, nocturne, absent, non vraiment « concerné ». Spectaculairement présent, cependant : occupant all over l’écran. Thorax en tonneau sur pattes grêles, chapeaux hyperboliques, vaste veste à franges, travestissements (à la fin : en terrificque Ma Dalton), pistolets ornés, jumelles (ça floute et ça zoome), tactiques sinueuses, bricolages à la Buster Keaton, rires inquiétants, silences pas moins. Il sature espace et récit d’une hésitation effrayante entre bouffonnerie rococo et violence dramatique sur-jouée à force d’affectation de froideur maniériste.
*