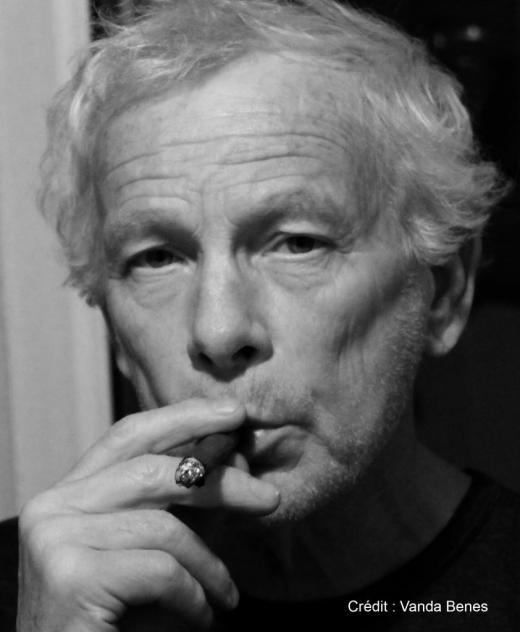Citation de Partemps
On peut, cependant, à vous entendre, imaginer que vous intégrez, au-delà de la simple déclaration
théorique, les partis-pris critiques des artistes que vous évoquez. Vous parliez de Viallat. Pourrait-on
retrouver, dans vos textes, un équivalent verbal de ce «module» obsessionnel, ambigu dans sa forme
(un osselet ou une palette?), par lequel, selon vous3
, ce peintre troue ses constructions picturales et figure
optiquement, dans sa peinture, le vide où s’échappe «l’Immense» qui nous est constitutif ? Pourrait-on
en voir une transposition, quoique éloignée, dans la répétition obsessionnelle du mot «poussière» (au
contenu sémantique infime mais équivoque) qui troue semblablement la fin du «douzième matin» de
votre roman Commencement?
Si « j’intègre » quoi que ce soit qui me vient de mon intérêt pour la peinture,
c’est à la façon que je viens de dire: pas d’une manière calculée et transposée point
par point. Mais sous l’impulsion, plutôt, d’une sorte d’imprégnation des effets
qu’ont pu faire sur moi ces œuvres et les réflexions qu’elles ont suscitées. Et avec
la conscience croissante que plus on écrit sous l’effet de cette imprégnation, plus,
d’une certaine façon, on s’éloigne aussi de la peinture: plus on désigne, parce qu’on
les mobilise entièrement, les moyens spécifiques au champ littéraire en tant que tel
et ce qui les différencie radicalement de ceux de la peinture.
Parmi les œuvres de la peinture, les toiles de Claude Viallat ont en effet beaucoup retenu mon attention. C’est sans doute parce que le «module » qui les ponctue est exemplaire d’un certain type de résistance à la « figure » identifiable – une
résistance qui ferait de la figure la figure de cette résistance en tant que telle. Le fait que
l’on ne parvienne pas, si on tente de nommer ce module, à éviter une interminable
hésitation (osselet, éponge, haricot, palette, etc.) en est le premier signe: il n’y a pas
de nom pour ce module et, en même temps, il sollicite invinciblement la nomination,
il passe toujours à la limite de quelque chose de nommable (d’un objet du monde
répertorié en langue). Ce passage à la limite (de la fixation nommée) fait trembler les
noms et s’ouvrir sous eux une épaisseur et un dynamisme qui sont la condition de
leur vitalité et de leur puissance de séduction inarraisonnable. Ainsi des mots, dans
l’opération poétique: tous (et pas seulement les noms, les verbes, les adjectifs – mais
aussi les déterminants, les articulations grammaticales, etc.) sont à la fois, évidemment, le signe de ce qu’ils désignent dans la langue de l’échange courant; mais tous
tremblent sur leur base sémantique sous les coups de leur liaison calculée (paronomastique et isochronique…) aux autres mots avec lesquels ils entrent en résonance
dans la fabrique stylistique (dans un poème sérieux, une rime n’est pas seulement
un écho phonétique: les mots qu’elle lie déteignent l’un sur l’autre et contaminent
réciproquement leurs significations). De même, parce que l’écrit tel que je l’entends
essaie de travailler la profondeur immémoriale de la langue aussi bien que la pluralité
de ses niveaux (savant, argotique, etc.), les mots s’ouvrent, par en dessous sur leur
mémoire étymologique, par les côtés sur leur polysémie, infiniment potentielle. Un
espace poétique vit, je crois, de ce tremblement et de ces équivoques.
théorique, les partis-pris critiques des artistes que vous évoquez. Vous parliez de Viallat. Pourrait-on
retrouver, dans vos textes, un équivalent verbal de ce «module» obsessionnel, ambigu dans sa forme
(un osselet ou une palette?), par lequel, selon vous3
, ce peintre troue ses constructions picturales et figure
optiquement, dans sa peinture, le vide où s’échappe «l’Immense» qui nous est constitutif ? Pourrait-on
en voir une transposition, quoique éloignée, dans la répétition obsessionnelle du mot «poussière» (au
contenu sémantique infime mais équivoque) qui troue semblablement la fin du «douzième matin» de
votre roman Commencement?
Si « j’intègre » quoi que ce soit qui me vient de mon intérêt pour la peinture,
c’est à la façon que je viens de dire: pas d’une manière calculée et transposée point
par point. Mais sous l’impulsion, plutôt, d’une sorte d’imprégnation des effets
qu’ont pu faire sur moi ces œuvres et les réflexions qu’elles ont suscitées. Et avec
la conscience croissante que plus on écrit sous l’effet de cette imprégnation, plus,
d’une certaine façon, on s’éloigne aussi de la peinture: plus on désigne, parce qu’on
les mobilise entièrement, les moyens spécifiques au champ littéraire en tant que tel
et ce qui les différencie radicalement de ceux de la peinture.
Parmi les œuvres de la peinture, les toiles de Claude Viallat ont en effet beaucoup retenu mon attention. C’est sans doute parce que le «module » qui les ponctue est exemplaire d’un certain type de résistance à la « figure » identifiable – une
résistance qui ferait de la figure la figure de cette résistance en tant que telle. Le fait que
l’on ne parvienne pas, si on tente de nommer ce module, à éviter une interminable
hésitation (osselet, éponge, haricot, palette, etc.) en est le premier signe: il n’y a pas
de nom pour ce module et, en même temps, il sollicite invinciblement la nomination,
il passe toujours à la limite de quelque chose de nommable (d’un objet du monde
répertorié en langue). Ce passage à la limite (de la fixation nommée) fait trembler les
noms et s’ouvrir sous eux une épaisseur et un dynamisme qui sont la condition de
leur vitalité et de leur puissance de séduction inarraisonnable. Ainsi des mots, dans
l’opération poétique: tous (et pas seulement les noms, les verbes, les adjectifs – mais
aussi les déterminants, les articulations grammaticales, etc.) sont à la fois, évidemment, le signe de ce qu’ils désignent dans la langue de l’échange courant; mais tous
tremblent sur leur base sémantique sous les coups de leur liaison calculée (paronomastique et isochronique…) aux autres mots avec lesquels ils entrent en résonance
dans la fabrique stylistique (dans un poème sérieux, une rime n’est pas seulement
un écho phonétique: les mots qu’elle lie déteignent l’un sur l’autre et contaminent
réciproquement leurs significations). De même, parce que l’écrit tel que je l’entends
essaie de travailler la profondeur immémoriale de la langue aussi bien que la pluralité
de ses niveaux (savant, argotique, etc.), les mots s’ouvrent, par en dessous sur leur
mémoire étymologique, par les côtés sur leur polysémie, infiniment potentielle. Un
espace poétique vit, je crois, de ce tremblement et de ces équivoques.