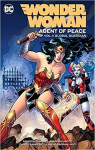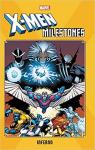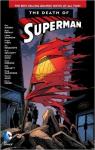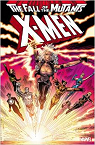Critiques de Louise Simonson (29)
Avec Covergirls, Urban Comics publie à nouveau un sorte d’anthologie-essai sur l’histoire des comics, et notamment ici les héroïnes de DC Comics ; cependant, il s’agit cette fois d’une traduction d’un ouvrage existant déjà aux États-Unis réalisé par Louise Simonson en 2009.
On retrouve ici l’âme même des premiers comics, où l’image de couverture souvent soutenue par des « covergirls » appelées à faire vendre à un public masculin des aventures très normées. Louise Simonson retrace ainsi 75 ans d’histoire des personnages féminins chez DC Comics : Wonder Woman, Loïs Lane (la seule sans pouvoir, encore que…, mais tellement proche du plus puissant d’entre eux), les nombreuses femmes à pouvoir de Gotham et de l’environ de Batman, etc. allant même jusqu’à faire des liens intéressants, quoiqu’un peu fouillis, avec le catalogue Vertigo appartenant à DC Comics, avec le parallélisme de chez Marvel et avec des séries indépendantes de chez Image. En bémol principal, regrettons un peu que l’image de la femme ne soit pas questionnée jusqu’au bout, jusque dans ses ressorts les plus problématiques : immanquablement, une femme, forte ou non, héroïne ou non, a immanquablement une poitrine vertigineuse. Étudiez bien chacune nombreuses couvertures étudiées dans cet ouvrage (il est très bien fait pour cet apport) et notez la taille de son bonnet en fonction de son rôle et de ses caractéristiques, on en apprend toujours beaucoup…
On retrouve ici l’âme même des premiers comics, où l’image de couverture souvent soutenue par des « covergirls » appelées à faire vendre à un public masculin des aventures très normées. Louise Simonson retrace ainsi 75 ans d’histoire des personnages féminins chez DC Comics : Wonder Woman, Loïs Lane (la seule sans pouvoir, encore que…, mais tellement proche du plus puissant d’entre eux), les nombreuses femmes à pouvoir de Gotham et de l’environ de Batman, etc. allant même jusqu’à faire des liens intéressants, quoiqu’un peu fouillis, avec le catalogue Vertigo appartenant à DC Comics, avec le parallélisme de chez Marvel et avec des séries indépendantes de chez Image. En bémol principal, regrettons un peu que l’image de la femme ne soit pas questionnée jusqu’au bout, jusque dans ses ressorts les plus problématiques : immanquablement, une femme, forte ou non, héroïne ou non, a immanquablement une poitrine vertigineuse. Étudiez bien chacune nombreuses couvertures étudiées dans cet ouvrage (il est très bien fait pour cet apport) et notez la taille de son bonnet en fonction de son rôle et de ses caractéristiques, on en apprend toujours beaucoup…
Je voulais essayer les Batman de Louise Simonson et... disons qu'ils sont très typiques des comics DC des années 90. Trop de textes inutiles, des intrigues en papier mâché. On a ici un Batman plutôt fade, un peu ridicule même.
J'évite normalement la période, mais j'essaie de découvrir les trop rares autrices de comics et.... voilà.
J'évite normalement la période, mais j'essaie de découvrir les trop rares autrices de comics et.... voilà.
Wonder Woman dans des histoires courtes diversifiées
-
Ce tome contient une série d'histoires courtes, indépendantes les unes des autres, ne nécessitant pas de connaissance préalable du personnage. Il regroupe 13 histoires allant de 8 à 24 pages, réalisées par autant d'équipe créatrices différentes. Côté scénariste, se trouvent le tandem Amanda Conner & Jimmy Palmiotti (6 histoires, les autres n'en écrivant qu'une), Van Jensen, Scott Kolins qui dessine son histoire, Jeff Parker, Steve Pugh, Andrea Shea, Louise Simonson, Marv Wolfman. Côté dessinateur se trouvent Inaki Miranda, Daniel Sampere qui dessine 4 histoires dont 3 encrées par Juan Albarran, Jeremy Raapack, Aneke, Marguerite Sauvage qui effectue sa propre mise en couleurs, Meghan Hetrick, Paul Pelletier encré par Norm Rapmund, Hendry Pasetya, José Luis encré par Jonas Trindade. Les coloristes sont le studio Hi-Fi (6 histoires), Adriano Lucas (4 histoires), Romulo Fajardo junior, Arif Prianto. La couverture a été réalisée par Amanda Conner.
Wonder Woman se retrouve impliquée dans une histoire de fraude immobilière : Simon Wickett et sa sœur, deux milliardaires, ont recours à des criminels pour détruire des bâtiments afin d'acquérir le terrain à un prix plus avantageux. Ils décident d'acheter par cette méthode l'immeuble habité par Harley Quinn et ses amis. Wonder Woman enquête sur la disparition d'alpinistes et de Lois Lane en haute montagne dans la chaîne de l'Himalaya : elle se retrouve confrontée à une ancienne déesse agressive. Il y a quelques temps de cela, Wonder Woman a pulvérisé une météorite qui menaçait la Terre, mais un gros morceau s'est englouti dans l'océan à proximité de Gorilla City et il en est sorti une créature agressive. Les supercriminels ont décidé d'échanger leurs ennemis habituels et Scarecrow s'occupe de Wonder Woman. Deadshot a un contrat à accomplir lors d'un sommet de grandes nations : Wonder Woman doit intervenir pour l'empêcher d'abattre sa cible.
Dans le repère d'une organisation terroriste, Steve Trevor donne tout ce qu'il a pour avancer et parvenir jusqu'à Wonder Woman pour lui apporter son aide. Wonder Woman arrive dans un petit village des Balkans pour mettre de l'ordre dans un bar : il s'y trouve une femme de grande taille habillée comme une valkyrie et se faisant appeler Gundra. Elle attaque la superhéroïne à peine la conversation engagée. Wonder Woman intervient dans un théâtre pour neutraliser des individus ayant pris des enfants en otage. Sans qu'elle s'en aperçoive, un des enfants lui dérobe son lasso magique. Dans une grande gare de Moscou, Wonder Woman est en train de se battre contre des agents KGBeast. Dans un coin, Etta Candy incognito observe la scène se préparant à passer à l'action pour récupérer la mallette d'un scientifique qui veut revendre une bombe à impulsion électromagnétique. Dans une chaîne de montagne péruvienne, Wonder Woman découvre un artefact de puissance, mais Cheetah s'en empare avant elle. Wonder Woman a hérité de cinq cents millions de dollars et d'une demeure de luxe où elle se rend. Elle y est attaquée par des squelettes. Wonder Woman est victime d'un chantage à l'otage, organisé par Docteur Psycho qui lui fait voler des appareils technologiques. Une femme siphonne les pouvoirs de Wonder Woman pour son profit.
Régulièrement, l'éditeur DC Comics met en œuvre une série anthologique consacrée au personnage de Wonder Woman : Sensation Comics Featuring Wonder Woman Vol. 1 (2014/2015), Wonder Woman: Come Back to Me (2019/2020) écrite par Amanda Conner & Jimmy Palmiotti, dessinés par Chad Hardin, puis par Tom Derenick. C'est à nouveau ce dont il s'agit avec la présente série. Le lecteur passe d'une histoire à l'autre : deux de 24 pages, sept de 16 pages, quatre de 8 pages. Afin de raconter quelque chose dans un pagination réduite, il faut que les scénaristes adoptent une écriture dense : c'est ce qu'ils font. Le lecteur retrouve donc la narration assez lourde en cellules de texte d'Amanda Conner & Jimmy Palmiotti, un peu moins lourde des autres, mais dense, soit en informations pour que la narration visuelle puisse se concentrer sur l'action, soit en commentaires pas toujours intéressants. Chacun connaît son métier et sait qu'il ou elle doit dérouler une intrigue rapide, résolue en 1 épisode, avec au moins un affrontement physique. En fonction du scénariste, elle ou il décide d'inventer un nouvel opposant ou de s'appuyer sur un supercriminel déjà existant, de faire en sorte que Wonder Woman soit le seul personnage avec des capacités extraordinaires ou de l'opposer à un supercriminel ou une créature surnaturelle ou divine, de mettre plus ou moins à profit la richesse de l'univers partagé DC.
Au fil des histoires, le lecteur se sent plus ou moins impliqué en fonction de leur originalité, soit le point de départ, soit le déroulement, soit le thème, soit la narration visuelle. Conner & Palmiotti jouent le jeu de réaliser une intrigue bien consistante, pas forcément sophistiquée, en mettant un point d'honneur à faire transparaître une facette ou une autre de la personnalité de Wonder Woman. Dans la première histoire, ils ne résistent pas à la tentation de mettre en scène un des personnages qu'ils ont écrit pendant plusieurs années : Harley Quinn. Les coauteurs jouent à fond sur l'opposition de caractère entre la femme responsable et la fofolle prompte à se comporter comme un enfant. Sampere réalise des dessins bien fournis, descriptifs et clairs, glissant même une femme à la peau hâlée avec une belle iroquoise de cheveux blancs dont la ressemblance avec Ororo Munroe n'est pas le fruit du hasard. L'histoire suivante est plus convenue, un peu étirée pour remplir le quota de pages, avec un combat dans une caverne, à la mise en scène pas très inspirée. L'histoire suivante, toujours des mêmes auteurs, présente une meilleure cohésion, avec un enjeu d'affrontement plus complexe, une résolution moins évidente, et des dessins qui mettent en valeur les habitants de Gorilla City. Quatrième histoire consécutive de ces créateurs, ils montrent un autre aspect du caractère de Diana, son optimisme, son refus de céder au désespoir facile, à la vision d'une apocalypse inéluctable. À nouveau, le trio d'auteurs réalise une histoire bien construite, compacte, divertissante, et tout à l'honneur de l'héroïne : très réussi.
La cinquième histoire de Conner & Pamiotti commencent par une scène kitch au possible : Diana attaquée par des squelettes dans une demeure luxueuse : impossible à croire. Le lecteur continue quand même avec des dessins d'un niveau professionnel, avec un bon niveau de détails, sans assez de personnalité pour être mémorables. Il découvre que derrière cette attaque, les scénaristes mettent en scène une autre caractéristique de Diana, totalement évidente, mais rarement évoquée : sa beauté, et l'effet qu'elle peut avoir sur un homme. Une histoire très touchante. La dernière histoire s'avère à nouveau bien dense, avec une femme parvenant à siphonner les pouvoirs de Wonder Woman, et cette dernière qui met à profit l'un d'eux, pas le plus connu, pour gagner, avec des dessins très soignés de Sampere qui s'encre lui-même. Très sympathique.
Van Jensen & Raapack montrent Wonder Woman se démener pour éviter un assassinat, une histoire aussi vite lue qu'oubliée, avec des dessins compétents mais sans panache, et une facette combattante du personnage qui finit par faire peur à Floyd Lawton. Le lecteur passe alors à l'histoire de Scott Kolins : Steve Trevor avance face à des ennemis plus forts et plus nombreux, pour rejoindre Diana afin de l'aider : une mise en scène intéressante de la force et du courage que peut donner le sentiment amoureux, très sympathique. Puis Parker et Aneke montrent comment une amitié peut naître en deux guerrières reconnaissant les compétences de l'autre, vite oublié. Steve Pugh raconte une histoire en tant que scénariste avec les couleurs pastel douces de Marguerite Sauvage : une histoire qui sort de l'ordinaire, à la fois sur le plan visuel, à la fois pour cet adolescent intelligent et débrouillard, et Diana qui se retrouve dans une position à mi-chemin entre la grande sœur et la maman : une histoire mémorable. Le lecteur passe ensuite à une histoire de type espionnage, évoquant de loin la guerre froide, mettant en valeur Etta Candy : des très belles couleurs d'Arif Prianto, une intrigue bien menée et originale, et des dessins très agréables à l'œil, une réussite. Louise Simonson et Paul Pelletier racontent une histoire assez convenue d'artefact magique donnant de grands pouvoirs, d'une supercriminelle comptant bien le mettre à profit pour avoir le dessus sur Wonder Woman : très convenu. Enfin Marv Wolfman, un autre vétéran, oppose Diana au docteur Psycho, une relation toujours très malsaine, avec un relent de domination psychologique et d'ascendant toxique, dans une histoire à la dynamique enfantine, avec des dessins compétents, mais une résolution téléphonée.
Ce recueil propose treize histoires courtes de Wonder Woman, toutes assez denses pour pouvoir raconter quelque chose dans une pagination limitée. Tous les créateurs sont des professionnels compétents. Quelques-uns réalisent des histoires convenues et vite oubliées. Certains parviennent à mettre en scène une facette inattendue de l'héroïne, ou un drame qui sort du tout-venant, avec une narration visuelle adaptée.
-
Ce tome contient une série d'histoires courtes, indépendantes les unes des autres, ne nécessitant pas de connaissance préalable du personnage. Il regroupe 13 histoires allant de 8 à 24 pages, réalisées par autant d'équipe créatrices différentes. Côté scénariste, se trouvent le tandem Amanda Conner & Jimmy Palmiotti (6 histoires, les autres n'en écrivant qu'une), Van Jensen, Scott Kolins qui dessine son histoire, Jeff Parker, Steve Pugh, Andrea Shea, Louise Simonson, Marv Wolfman. Côté dessinateur se trouvent Inaki Miranda, Daniel Sampere qui dessine 4 histoires dont 3 encrées par Juan Albarran, Jeremy Raapack, Aneke, Marguerite Sauvage qui effectue sa propre mise en couleurs, Meghan Hetrick, Paul Pelletier encré par Norm Rapmund, Hendry Pasetya, José Luis encré par Jonas Trindade. Les coloristes sont le studio Hi-Fi (6 histoires), Adriano Lucas (4 histoires), Romulo Fajardo junior, Arif Prianto. La couverture a été réalisée par Amanda Conner.
Wonder Woman se retrouve impliquée dans une histoire de fraude immobilière : Simon Wickett et sa sœur, deux milliardaires, ont recours à des criminels pour détruire des bâtiments afin d'acquérir le terrain à un prix plus avantageux. Ils décident d'acheter par cette méthode l'immeuble habité par Harley Quinn et ses amis. Wonder Woman enquête sur la disparition d'alpinistes et de Lois Lane en haute montagne dans la chaîne de l'Himalaya : elle se retrouve confrontée à une ancienne déesse agressive. Il y a quelques temps de cela, Wonder Woman a pulvérisé une météorite qui menaçait la Terre, mais un gros morceau s'est englouti dans l'océan à proximité de Gorilla City et il en est sorti une créature agressive. Les supercriminels ont décidé d'échanger leurs ennemis habituels et Scarecrow s'occupe de Wonder Woman. Deadshot a un contrat à accomplir lors d'un sommet de grandes nations : Wonder Woman doit intervenir pour l'empêcher d'abattre sa cible.
Dans le repère d'une organisation terroriste, Steve Trevor donne tout ce qu'il a pour avancer et parvenir jusqu'à Wonder Woman pour lui apporter son aide. Wonder Woman arrive dans un petit village des Balkans pour mettre de l'ordre dans un bar : il s'y trouve une femme de grande taille habillée comme une valkyrie et se faisant appeler Gundra. Elle attaque la superhéroïne à peine la conversation engagée. Wonder Woman intervient dans un théâtre pour neutraliser des individus ayant pris des enfants en otage. Sans qu'elle s'en aperçoive, un des enfants lui dérobe son lasso magique. Dans une grande gare de Moscou, Wonder Woman est en train de se battre contre des agents KGBeast. Dans un coin, Etta Candy incognito observe la scène se préparant à passer à l'action pour récupérer la mallette d'un scientifique qui veut revendre une bombe à impulsion électromagnétique. Dans une chaîne de montagne péruvienne, Wonder Woman découvre un artefact de puissance, mais Cheetah s'en empare avant elle. Wonder Woman a hérité de cinq cents millions de dollars et d'une demeure de luxe où elle se rend. Elle y est attaquée par des squelettes. Wonder Woman est victime d'un chantage à l'otage, organisé par Docteur Psycho qui lui fait voler des appareils technologiques. Une femme siphonne les pouvoirs de Wonder Woman pour son profit.
Régulièrement, l'éditeur DC Comics met en œuvre une série anthologique consacrée au personnage de Wonder Woman : Sensation Comics Featuring Wonder Woman Vol. 1 (2014/2015), Wonder Woman: Come Back to Me (2019/2020) écrite par Amanda Conner & Jimmy Palmiotti, dessinés par Chad Hardin, puis par Tom Derenick. C'est à nouveau ce dont il s'agit avec la présente série. Le lecteur passe d'une histoire à l'autre : deux de 24 pages, sept de 16 pages, quatre de 8 pages. Afin de raconter quelque chose dans un pagination réduite, il faut que les scénaristes adoptent une écriture dense : c'est ce qu'ils font. Le lecteur retrouve donc la narration assez lourde en cellules de texte d'Amanda Conner & Jimmy Palmiotti, un peu moins lourde des autres, mais dense, soit en informations pour que la narration visuelle puisse se concentrer sur l'action, soit en commentaires pas toujours intéressants. Chacun connaît son métier et sait qu'il ou elle doit dérouler une intrigue rapide, résolue en 1 épisode, avec au moins un affrontement physique. En fonction du scénariste, elle ou il décide d'inventer un nouvel opposant ou de s'appuyer sur un supercriminel déjà existant, de faire en sorte que Wonder Woman soit le seul personnage avec des capacités extraordinaires ou de l'opposer à un supercriminel ou une créature surnaturelle ou divine, de mettre plus ou moins à profit la richesse de l'univers partagé DC.
Au fil des histoires, le lecteur se sent plus ou moins impliqué en fonction de leur originalité, soit le point de départ, soit le déroulement, soit le thème, soit la narration visuelle. Conner & Palmiotti jouent le jeu de réaliser une intrigue bien consistante, pas forcément sophistiquée, en mettant un point d'honneur à faire transparaître une facette ou une autre de la personnalité de Wonder Woman. Dans la première histoire, ils ne résistent pas à la tentation de mettre en scène un des personnages qu'ils ont écrit pendant plusieurs années : Harley Quinn. Les coauteurs jouent à fond sur l'opposition de caractère entre la femme responsable et la fofolle prompte à se comporter comme un enfant. Sampere réalise des dessins bien fournis, descriptifs et clairs, glissant même une femme à la peau hâlée avec une belle iroquoise de cheveux blancs dont la ressemblance avec Ororo Munroe n'est pas le fruit du hasard. L'histoire suivante est plus convenue, un peu étirée pour remplir le quota de pages, avec un combat dans une caverne, à la mise en scène pas très inspirée. L'histoire suivante, toujours des mêmes auteurs, présente une meilleure cohésion, avec un enjeu d'affrontement plus complexe, une résolution moins évidente, et des dessins qui mettent en valeur les habitants de Gorilla City. Quatrième histoire consécutive de ces créateurs, ils montrent un autre aspect du caractère de Diana, son optimisme, son refus de céder au désespoir facile, à la vision d'une apocalypse inéluctable. À nouveau, le trio d'auteurs réalise une histoire bien construite, compacte, divertissante, et tout à l'honneur de l'héroïne : très réussi.
La cinquième histoire de Conner & Pamiotti commencent par une scène kitch au possible : Diana attaquée par des squelettes dans une demeure luxueuse : impossible à croire. Le lecteur continue quand même avec des dessins d'un niveau professionnel, avec un bon niveau de détails, sans assez de personnalité pour être mémorables. Il découvre que derrière cette attaque, les scénaristes mettent en scène une autre caractéristique de Diana, totalement évidente, mais rarement évoquée : sa beauté, et l'effet qu'elle peut avoir sur un homme. Une histoire très touchante. La dernière histoire s'avère à nouveau bien dense, avec une femme parvenant à siphonner les pouvoirs de Wonder Woman, et cette dernière qui met à profit l'un d'eux, pas le plus connu, pour gagner, avec des dessins très soignés de Sampere qui s'encre lui-même. Très sympathique.
Van Jensen & Raapack montrent Wonder Woman se démener pour éviter un assassinat, une histoire aussi vite lue qu'oubliée, avec des dessins compétents mais sans panache, et une facette combattante du personnage qui finit par faire peur à Floyd Lawton. Le lecteur passe alors à l'histoire de Scott Kolins : Steve Trevor avance face à des ennemis plus forts et plus nombreux, pour rejoindre Diana afin de l'aider : une mise en scène intéressante de la force et du courage que peut donner le sentiment amoureux, très sympathique. Puis Parker et Aneke montrent comment une amitié peut naître en deux guerrières reconnaissant les compétences de l'autre, vite oublié. Steve Pugh raconte une histoire en tant que scénariste avec les couleurs pastel douces de Marguerite Sauvage : une histoire qui sort de l'ordinaire, à la fois sur le plan visuel, à la fois pour cet adolescent intelligent et débrouillard, et Diana qui se retrouve dans une position à mi-chemin entre la grande sœur et la maman : une histoire mémorable. Le lecteur passe ensuite à une histoire de type espionnage, évoquant de loin la guerre froide, mettant en valeur Etta Candy : des très belles couleurs d'Arif Prianto, une intrigue bien menée et originale, et des dessins très agréables à l'œil, une réussite. Louise Simonson et Paul Pelletier racontent une histoire assez convenue d'artefact magique donnant de grands pouvoirs, d'une supercriminelle comptant bien le mettre à profit pour avoir le dessus sur Wonder Woman : très convenu. Enfin Marv Wolfman, un autre vétéran, oppose Diana au docteur Psycho, une relation toujours très malsaine, avec un relent de domination psychologique et d'ascendant toxique, dans une histoire à la dynamique enfantine, avec des dessins compétents, mais une résolution téléphonée.
Ce recueil propose treize histoires courtes de Wonder Woman, toutes assez denses pour pouvoir raconter quelque chose dans une pagination limitée. Tous les créateurs sont des professionnels compétents. Quelques-uns réalisent des histoires convenues et vite oubliées. Certains parviennent à mettre en scène une facette inattendue de l'héroïne, ou un drame qui sort du tout-venant, avec une narration visuelle adaptée.
• « Wolverine Meltdown » de Walter Simonson et Louise Simonson, publié chez Marvel Comics Inc.
• Je précise en premier lieu que j'ai lu cette histoire en anglais, comme la quasi-totalité des comics Marvel et DC publiés avant les années 2000.. Pas de raison particulière, si ce n'est que j'ai commencer dans cette langue pour une question de prix il y a quelques années et que j'ai tendance à continuer ainsi. Aussi, je ne suis pas certain que cette run ai été publiée un jour en France.. si c'est le cas n'hésitez pas à me partager l'information, je suis curieux de savoir.
• Au départ, j'étais assez dubitatif sur la qualité du récit et l'intérêt que j'aurais à suivre cette aventure. Une histoire impliquant la Russie comme méchant, sa sent parfois la facilité scénaristique sans véritable fond et sans réelle remise en question. Et pourtant c'est ici très bien fait, avec un scénario qui tient bien la route dans l'ensemble, des situations jouissives et des personnages marquants. Des facilitées scénaristiques peuvent toutefois apparaître, d'une manière assez légère en comparaison d'autres comics que j'ai pu lire, mais celles-ci n'entacherons qu'infiniment peu le récit. Le contexte de l'époque, avec une image de la Russie très connue de ces fameuses années '90, est pour le coup intéressant dans ce récit.
• Au niveau du casting, je vais commencer par parler des héros, à savoir Logan (Wolverine) et Alex Summers (Havok). Une association de personnage aux caractère bien trempées et inattendue, tout bonnement excellente. Pour ceux qui ne le savent pas, cette histoire est un one-shot dans la continuité des comics, qui trouvent bien sa place dans la chronologie des mutants. Et dans les années '90, Havok fait partie intégrante de l'équipe des X-Men, aux côtés de Tornade, Dazzler et bien évidemment Wolverine. Les deux hommes, à l'instar de la relation entre Wolverine et Cyclope 'aka' Scott Summers, sont régulièrement en conflit, étant en compétition permanente et confrontant leur caractère de meneur de troupe. Cette aventure est l'occasion de montrer une amitié et un travail d'équipe inédite et détonante.
Pour ce qui est des antagonistes, ceux-ci sont marquants mais reste dans le classique schéma de ce type d'aventure. Un personnage mystérieux qui dirige ces troupes dans l'ombre, le disciple dévoué et sans personnalité si ce n'est par l'image du fameux camarade russe et la jeune femme à l'apparence enivrante et à la personnalité nuancée. Ils ne sont pas inoubliables, mais reste dans un registre trop classique pour devenir pleinement intéressants.
• Enfin, comment parler de Meltdown sans évoquer ses époustouflants dessins. C'est graphiquement une pure tuerie, très originale et en parfaite adéquation avec la trame principale. Les traits offres des perspectives véritablement inédites pour les aventures mutantes, avec du mouvement, des ombres et des couleurs mémorable. J'ai parfois eu l'impression d'être devant des tableaux atypiques, d'une beauté époustouflantes tant il s'en dégage une force attirante. Beaucoup resteront dubitatif quant à l'aspect des illustrations, je pense franchement que les avis seront tranchés, soit l'on aime, soit l'on n'aime pas du tout. Les illustrations sont de Jon J. Muth et Kent Williams pour les curieux.
• Une aventure que j'ai étonnamment beaucoup appréciée et qui m'a réellement marquée l'esprit. J'écris cette critique plus d'un mois après l'avoir découverte, et tout est resté très clair dans mon esprit. Mais si le récit est sympathique, c'est l'aspect graphique qui est véritablement notable, et c'est au moins pour cette raison que je ne peut que vous recommander de lire ces chapitres.
• Je précise en premier lieu que j'ai lu cette histoire en anglais, comme la quasi-totalité des comics Marvel et DC publiés avant les années 2000.. Pas de raison particulière, si ce n'est que j'ai commencer dans cette langue pour une question de prix il y a quelques années et que j'ai tendance à continuer ainsi. Aussi, je ne suis pas certain que cette run ai été publiée un jour en France.. si c'est le cas n'hésitez pas à me partager l'information, je suis curieux de savoir.
• Au départ, j'étais assez dubitatif sur la qualité du récit et l'intérêt que j'aurais à suivre cette aventure. Une histoire impliquant la Russie comme méchant, sa sent parfois la facilité scénaristique sans véritable fond et sans réelle remise en question. Et pourtant c'est ici très bien fait, avec un scénario qui tient bien la route dans l'ensemble, des situations jouissives et des personnages marquants. Des facilitées scénaristiques peuvent toutefois apparaître, d'une manière assez légère en comparaison d'autres comics que j'ai pu lire, mais celles-ci n'entacherons qu'infiniment peu le récit. Le contexte de l'époque, avec une image de la Russie très connue de ces fameuses années '90, est pour le coup intéressant dans ce récit.
• Au niveau du casting, je vais commencer par parler des héros, à savoir Logan (Wolverine) et Alex Summers (Havok). Une association de personnage aux caractère bien trempées et inattendue, tout bonnement excellente. Pour ceux qui ne le savent pas, cette histoire est un one-shot dans la continuité des comics, qui trouvent bien sa place dans la chronologie des mutants. Et dans les années '90, Havok fait partie intégrante de l'équipe des X-Men, aux côtés de Tornade, Dazzler et bien évidemment Wolverine. Les deux hommes, à l'instar de la relation entre Wolverine et Cyclope 'aka' Scott Summers, sont régulièrement en conflit, étant en compétition permanente et confrontant leur caractère de meneur de troupe. Cette aventure est l'occasion de montrer une amitié et un travail d'équipe inédite et détonante.
Pour ce qui est des antagonistes, ceux-ci sont marquants mais reste dans le classique schéma de ce type d'aventure. Un personnage mystérieux qui dirige ces troupes dans l'ombre, le disciple dévoué et sans personnalité si ce n'est par l'image du fameux camarade russe et la jeune femme à l'apparence enivrante et à la personnalité nuancée. Ils ne sont pas inoubliables, mais reste dans un registre trop classique pour devenir pleinement intéressants.
• Enfin, comment parler de Meltdown sans évoquer ses époustouflants dessins. C'est graphiquement une pure tuerie, très originale et en parfaite adéquation avec la trame principale. Les traits offres des perspectives véritablement inédites pour les aventures mutantes, avec du mouvement, des ombres et des couleurs mémorable. J'ai parfois eu l'impression d'être devant des tableaux atypiques, d'une beauté époustouflantes tant il s'en dégage une force attirante. Beaucoup resteront dubitatif quant à l'aspect des illustrations, je pense franchement que les avis seront tranchés, soit l'on aime, soit l'on n'aime pas du tout. Les illustrations sont de Jon J. Muth et Kent Williams pour les curieux.
• Une aventure que j'ai étonnamment beaucoup appréciée et qui m'a réellement marquée l'esprit. J'écris cette critique plus d'un mois après l'avoir découverte, et tout est resté très clair dans mon esprit. Mais si le récit est sympathique, c'est l'aspect graphique qui est véritablement notable, et c'est au moins pour cette raison que je ne peut que vous recommander de lire ces chapitres.
Ce tome est le cinquième dans la série d'anthologies publiées pour célébrer les 80 ans d'existence de l'éditeur Marvel Comics. Il comprend Iron Man 170, Uncanny X-Men 173, Fantastic Four 265, Amazing Spider-Man 252 et Annual 21, Incredible Hulk 324, Thor 378, Captain America 333, X-Fatctor 24.
Iron Man 170 (Denny O'Neill, Luke McDonnell, Steve Mitchell) - Dans une pièce secrète de la zone industrielle des Industries Stark, James Rhodes a revêtu l'armure d'Iron Man et il s'apprête à mettre le casque, alors que Tony Stark est sous l'emprise de l'alcool et que Magma détruit une installation après l'autre. Uncanny X-Men 173 (Chris Claremont, Paul Smith, Bob Wiacek) - Les X-Men sont à Tokyo au Japon en vue du mariage de Logan avec Mariko Yashida : Wolverine et Rogue sont à la recherche de Silver Samourai, pendant que Ororo Munroe neutralise quelques agresseurs, avec Yukio. Fantastic Four 265 (John Byrne) - Trapster (Peter Petruski) s'introduit dans le Baxter Building pour se livrer à un cambriolage. Peu de temps après Susan Richards se rend à Central Park pour voir les héros de retour de Battlworld. Amazing Spider-Man 252 (Roger Stern, Tom DeFalco, Ron Frenz, Brett Breeding) - Spider-Man est de retour de Battleworld avec Curt Connors : il lui faut reprendre sa vie normale, avec prise de photos de Spider-Man et essayer de prendre contact avec Black Cat (Felicia Hardy). Incredible Hulk 324 (Al Milgrom, Dennis Janke) - Bruce Banner est détenu dans une base du SHIELD, où Leonard Samson doit se livrer à une expérience pour refusionner Banner avec Hulk.
Thor 378 (Walter Simonson, Sal Buscema) - Dans sa propre forteresse, Loki est attaqué par des géants du gel, attiré par la source de froid (Iceman détenu prisonnier par Loki), alors que Thor blessé gît par terre sans connaissance. - Captain America 333 (Mark Gruenwald, Tom Morgan, Dave Hunt) - Steve Rogers a rendu son costume, refusant d'agir uniquement sous les ordres du gouvernement. Mandatée par la Commission Valerie Cooper fait passer un entretien et des tests à John Walker (Super-Patriot) qui est conseillé par son agent Ethan Thurm. Amazing Spider-Man Annual 21 (Jim Shooter, David Michelinie, Paul Ryan, Vince Colletta) - Toujours habillé de son costume noir, Spider-Man neutralise Electro. Son plus gros défi dans les jours qui viennent est de faire face aux doutes qui l'assaillent avant la cérémonie de mariage avec Mary Jane Watson. X-Factor 24 (Louise Simonson, Walter Simonson, Bob Wiacek) - X-Factor est à bord du vaisseau d'Apocalypse qui leur explique sa position et ce qu'il va faire, puis leur présente ses cavaliers de l'apocalypse. L'équipe se compose de Cyclops (Scott Summers), Marvel Girl (Jean Grey), Beast (Hank McCoy), Iceman (Bobby Drake) et Caliban.
Après un tome déconcertant consacré aux monstres plutôt qu'aux superhéros des années 1970, ce cinquième tome se focalise à nouveaux sur les propriétés intellectuelles les plus célèbres de l'éditeur Marvel. La couverture du recueil correspond à celle du magazine d'autopromotion (mais payant) Marvel Age 57 et fait apparaître plusieurs changements significatifs dans le statu quo de personnages de premier plan. Le lecteur retrouve les épisodes correspondants à l'intérieur, sauf pour l'armure rouge et argent d'Iron Man. Dans les années 1980, cela fait entre 20 et 25 ans que les principaux superhéros Marvel sont en activité, depuis le premier épisode Fantastic Four en 1961. Du côté de DC Comics, les personnages sont encore plus âgés, et l'éditeur a procédé à une remise à zéro audacieuse en 1986 après Crisis On Infinite Earths (Marv Wolfman & George Perez). L'air du temps est donc à la remise en question du statu quo, à l'évolution significative. Toutefois l'éditeur Marvel estime qu'il n'a pas besoin de repartir de zéro, que ses personnages sont encore assez jeunes pour pouvoir évoluer, sans impression de redite, de rabâchage. Ainsi, au cours de ces épisodes, le lecteur peut assister à une passation de l'armure d'Iron Man à un nouveau porteur, à l'évolution de la personnalité et du look d'Ororo Munroe, à l'intégration d'un nouveau membre dans les Fantastic Four, au changement de costume de Spider-Man, au retour à une peau grise pour Hulk, à une armure pour Thor, au changement du porteur de costume de Captain America, au mariage de Peter Parker, à l'évolution d'Angel (Warren Worthington).
Certains de ces changements concernent des personnages présents depuis 1962 (Spider-Man, Hulk), d'autres plus récents (Storm apparue la première fois en 1975), et un autre beaucoup plus ancien car Captain America est présent dans les comics depuis 1941. Certains changements sont moins impressionnants que d'autres : l'équipe des Fantastic Four a déjà eu des remplaçants, Steve Rogers a déjà été remplacé (rétroactivement par William Burnside et d'autres). D'autres semblent transitoires : Thor finira bien guérir et pouvoir se passer de son armure, Spider-Man pourra bien revenir à son ancien costume. D'autres semblent plus pérennes (même sans tenir compte des slogans fracassants qui les accompagnent jurant que plus rien ne sera jamais comme avant) : le mariage de Mary Jane & Peter, la transformation de Warren Worthington III. Bien évidemment, le lecteur s'attache également à voir si les formes narratives ont évolué. Pour la majeure partie, ces 9 épisodes sont écrits par des scénaristes confirmés, mais appartenant à des tranches d'âge différentes, et avec une expérience plus ou moins longue. Les bulles de pensée sont toujours en usage, à la seule exception de l'épisode de X-Factor, ainsi que les monologues explicatifs. Il faut toujours un affrontement physique minimum par épisode.
En y regardant de plus près, l'épisode à la narration la plus datée est celui d'Incredible Hulk où Al Milgrom semble s'appliquer pour reproduire les tics narratifs des années 1960 qu'il s'agisse d'une dramatisation larmoyante, ou des dessins tassés avec un mélange de références visuelles à Steve Ditko, Herb Trimpe et Sal Buscema. En termes de dramaturgie tire-larme, Louise Simonson, Tom DeFalco et David Michelinie s'appliquent aussi à reproduire l'approche de Stan Lee, mais sans sa verve et son emphase empathique. Walter Simonson reste dans le même registre, mais avec une emphase épique plus marquée. Denny O'Neill réussit à faire passer la déchéance de Tony Stark en slip incapable d'intervenir de manière efficace avec une justesse certaine, ainsi que les hésitations de James Rhodes en grand débutant. Chris Claremont est toujours étonnant de sensibilité pour transmettre les émotions de ses personnages, que ce soit le choc de Kitty Pryde découvrant Ororo habillée en cuir, ou Logan se prenant le non de Mariko en pleine face. John Byrne s'amuse avec son épisode, contraint de gérer 2 histoires distinctes qu'il sépare effectivement, pour une première en vue subjective et une seconde plus classique. L'écriture de Mark Gruenwald est pesante mais il montre comment John Walker doit passer d'un style de vie à un autre, et opérer des changements dans son entourage, avec le comportement très juste de son agent Ethan Thurm plus réaliste que caricatural.
Avec le recul des années, il est plus facile de voir en quoi les caractéristiques des dessins de Luke McDonnell allaient à l'encontre de la tendance à arrondir chaque contour pour être plus agréable à l'œil, lui préférant un résultat plus dur, plus adulte. Par contraste, le lecteur est frappé par l'aérodynamisme des dessins de Paul Smith, l'art de travailler sur les traits pour des compositions plus élégantes, avec un encrage également très élégant de Bob Wiacek. Le lecteur observe que Smith reprend des mises en page de Frank Miller qu'il s'agisse du drapeau (une case de la hauteur de la page, avec les autres qui s'y rattache) ou des cases de la largeur de la page pour le combat entre Wolverine et Silver Samourai. John Byrne fait tout tout seul et sa narration est toujours aussi plaisante à l'œil et claire, à commencer par ce cambriolage en vue subjective. Le duo Frenz & Breeding dessine dans un registre plus réaliste qui n'a pas vieillit. Il est difficile de regarder les pages d'Al Milgrom du fait de cette approche très référentielle et pas toujours cohérente d'une référence à l'autre. Sal Buscema s'applique à dessiner à la manière de Walt Simonson sans réussir à en reproduire l'emphase mythologique. Tom Morgan s'inspire lui aussi d'autres dessinateurs, comme John Byrne, Mike Zeck, pour un résultat plus homogène que Milgrom, et une narration appliquée mais encore satisfaisante. Paul Ryan doit mettre en scène des séquences surtout civiles. Lui aussi reste dans un registre sage et appliqué, bénéficiant de l'encrage de Vince Colletta qui fait l'effort de ne pas écraser les visages avec ses tics personnels, pour un résultat qui n'est pas nostalgique tout en évoquant les grandes heures des années 1960 de Marvel. Enfin, Walter Simonson se lâche dans la mise en scène dramatique et spectaculaire, faisant passer la force des énergies mises en jeu, malgré des jeux d'acteur un peu trop appuyés et un degré de naïveté dans les représentations.
Au vu du volume de la production de comics de Marvel dans les années 1980, une anthologie de 230 pages contenant 9 épisodes ne peut pas donner un aperçu global. Comme l'indique Jess Harold dans son introduction, il s'agit de montrer dans quelle mesure l'éditeur était capable de faire évoluer ses personnages, de les remettre en question. Le lecteur peut ainsi se faire son idée sur la manière d'insuffler de la nouveauté dans des superhéros ayant 20 ans d'âge, et sur le chemin parcouru en termes de narration visuelle depuis le début de l'ère Marvel, dans une anthologie bien conçue.
Iron Man 170 (Denny O'Neill, Luke McDonnell, Steve Mitchell) - Dans une pièce secrète de la zone industrielle des Industries Stark, James Rhodes a revêtu l'armure d'Iron Man et il s'apprête à mettre le casque, alors que Tony Stark est sous l'emprise de l'alcool et que Magma détruit une installation après l'autre. Uncanny X-Men 173 (Chris Claremont, Paul Smith, Bob Wiacek) - Les X-Men sont à Tokyo au Japon en vue du mariage de Logan avec Mariko Yashida : Wolverine et Rogue sont à la recherche de Silver Samourai, pendant que Ororo Munroe neutralise quelques agresseurs, avec Yukio. Fantastic Four 265 (John Byrne) - Trapster (Peter Petruski) s'introduit dans le Baxter Building pour se livrer à un cambriolage. Peu de temps après Susan Richards se rend à Central Park pour voir les héros de retour de Battlworld. Amazing Spider-Man 252 (Roger Stern, Tom DeFalco, Ron Frenz, Brett Breeding) - Spider-Man est de retour de Battleworld avec Curt Connors : il lui faut reprendre sa vie normale, avec prise de photos de Spider-Man et essayer de prendre contact avec Black Cat (Felicia Hardy). Incredible Hulk 324 (Al Milgrom, Dennis Janke) - Bruce Banner est détenu dans une base du SHIELD, où Leonard Samson doit se livrer à une expérience pour refusionner Banner avec Hulk.
Thor 378 (Walter Simonson, Sal Buscema) - Dans sa propre forteresse, Loki est attaqué par des géants du gel, attiré par la source de froid (Iceman détenu prisonnier par Loki), alors que Thor blessé gît par terre sans connaissance. - Captain America 333 (Mark Gruenwald, Tom Morgan, Dave Hunt) - Steve Rogers a rendu son costume, refusant d'agir uniquement sous les ordres du gouvernement. Mandatée par la Commission Valerie Cooper fait passer un entretien et des tests à John Walker (Super-Patriot) qui est conseillé par son agent Ethan Thurm. Amazing Spider-Man Annual 21 (Jim Shooter, David Michelinie, Paul Ryan, Vince Colletta) - Toujours habillé de son costume noir, Spider-Man neutralise Electro. Son plus gros défi dans les jours qui viennent est de faire face aux doutes qui l'assaillent avant la cérémonie de mariage avec Mary Jane Watson. X-Factor 24 (Louise Simonson, Walter Simonson, Bob Wiacek) - X-Factor est à bord du vaisseau d'Apocalypse qui leur explique sa position et ce qu'il va faire, puis leur présente ses cavaliers de l'apocalypse. L'équipe se compose de Cyclops (Scott Summers), Marvel Girl (Jean Grey), Beast (Hank McCoy), Iceman (Bobby Drake) et Caliban.
Après un tome déconcertant consacré aux monstres plutôt qu'aux superhéros des années 1970, ce cinquième tome se focalise à nouveaux sur les propriétés intellectuelles les plus célèbres de l'éditeur Marvel. La couverture du recueil correspond à celle du magazine d'autopromotion (mais payant) Marvel Age 57 et fait apparaître plusieurs changements significatifs dans le statu quo de personnages de premier plan. Le lecteur retrouve les épisodes correspondants à l'intérieur, sauf pour l'armure rouge et argent d'Iron Man. Dans les années 1980, cela fait entre 20 et 25 ans que les principaux superhéros Marvel sont en activité, depuis le premier épisode Fantastic Four en 1961. Du côté de DC Comics, les personnages sont encore plus âgés, et l'éditeur a procédé à une remise à zéro audacieuse en 1986 après Crisis On Infinite Earths (Marv Wolfman & George Perez). L'air du temps est donc à la remise en question du statu quo, à l'évolution significative. Toutefois l'éditeur Marvel estime qu'il n'a pas besoin de repartir de zéro, que ses personnages sont encore assez jeunes pour pouvoir évoluer, sans impression de redite, de rabâchage. Ainsi, au cours de ces épisodes, le lecteur peut assister à une passation de l'armure d'Iron Man à un nouveau porteur, à l'évolution de la personnalité et du look d'Ororo Munroe, à l'intégration d'un nouveau membre dans les Fantastic Four, au changement de costume de Spider-Man, au retour à une peau grise pour Hulk, à une armure pour Thor, au changement du porteur de costume de Captain America, au mariage de Peter Parker, à l'évolution d'Angel (Warren Worthington).
Certains de ces changements concernent des personnages présents depuis 1962 (Spider-Man, Hulk), d'autres plus récents (Storm apparue la première fois en 1975), et un autre beaucoup plus ancien car Captain America est présent dans les comics depuis 1941. Certains changements sont moins impressionnants que d'autres : l'équipe des Fantastic Four a déjà eu des remplaçants, Steve Rogers a déjà été remplacé (rétroactivement par William Burnside et d'autres). D'autres semblent transitoires : Thor finira bien guérir et pouvoir se passer de son armure, Spider-Man pourra bien revenir à son ancien costume. D'autres semblent plus pérennes (même sans tenir compte des slogans fracassants qui les accompagnent jurant que plus rien ne sera jamais comme avant) : le mariage de Mary Jane & Peter, la transformation de Warren Worthington III. Bien évidemment, le lecteur s'attache également à voir si les formes narratives ont évolué. Pour la majeure partie, ces 9 épisodes sont écrits par des scénaristes confirmés, mais appartenant à des tranches d'âge différentes, et avec une expérience plus ou moins longue. Les bulles de pensée sont toujours en usage, à la seule exception de l'épisode de X-Factor, ainsi que les monologues explicatifs. Il faut toujours un affrontement physique minimum par épisode.
En y regardant de plus près, l'épisode à la narration la plus datée est celui d'Incredible Hulk où Al Milgrom semble s'appliquer pour reproduire les tics narratifs des années 1960 qu'il s'agisse d'une dramatisation larmoyante, ou des dessins tassés avec un mélange de références visuelles à Steve Ditko, Herb Trimpe et Sal Buscema. En termes de dramaturgie tire-larme, Louise Simonson, Tom DeFalco et David Michelinie s'appliquent aussi à reproduire l'approche de Stan Lee, mais sans sa verve et son emphase empathique. Walter Simonson reste dans le même registre, mais avec une emphase épique plus marquée. Denny O'Neill réussit à faire passer la déchéance de Tony Stark en slip incapable d'intervenir de manière efficace avec une justesse certaine, ainsi que les hésitations de James Rhodes en grand débutant. Chris Claremont est toujours étonnant de sensibilité pour transmettre les émotions de ses personnages, que ce soit le choc de Kitty Pryde découvrant Ororo habillée en cuir, ou Logan se prenant le non de Mariko en pleine face. John Byrne s'amuse avec son épisode, contraint de gérer 2 histoires distinctes qu'il sépare effectivement, pour une première en vue subjective et une seconde plus classique. L'écriture de Mark Gruenwald est pesante mais il montre comment John Walker doit passer d'un style de vie à un autre, et opérer des changements dans son entourage, avec le comportement très juste de son agent Ethan Thurm plus réaliste que caricatural.
Avec le recul des années, il est plus facile de voir en quoi les caractéristiques des dessins de Luke McDonnell allaient à l'encontre de la tendance à arrondir chaque contour pour être plus agréable à l'œil, lui préférant un résultat plus dur, plus adulte. Par contraste, le lecteur est frappé par l'aérodynamisme des dessins de Paul Smith, l'art de travailler sur les traits pour des compositions plus élégantes, avec un encrage également très élégant de Bob Wiacek. Le lecteur observe que Smith reprend des mises en page de Frank Miller qu'il s'agisse du drapeau (une case de la hauteur de la page, avec les autres qui s'y rattache) ou des cases de la largeur de la page pour le combat entre Wolverine et Silver Samourai. John Byrne fait tout tout seul et sa narration est toujours aussi plaisante à l'œil et claire, à commencer par ce cambriolage en vue subjective. Le duo Frenz & Breeding dessine dans un registre plus réaliste qui n'a pas vieillit. Il est difficile de regarder les pages d'Al Milgrom du fait de cette approche très référentielle et pas toujours cohérente d'une référence à l'autre. Sal Buscema s'applique à dessiner à la manière de Walt Simonson sans réussir à en reproduire l'emphase mythologique. Tom Morgan s'inspire lui aussi d'autres dessinateurs, comme John Byrne, Mike Zeck, pour un résultat plus homogène que Milgrom, et une narration appliquée mais encore satisfaisante. Paul Ryan doit mettre en scène des séquences surtout civiles. Lui aussi reste dans un registre sage et appliqué, bénéficiant de l'encrage de Vince Colletta qui fait l'effort de ne pas écraser les visages avec ses tics personnels, pour un résultat qui n'est pas nostalgique tout en évoquant les grandes heures des années 1960 de Marvel. Enfin, Walter Simonson se lâche dans la mise en scène dramatique et spectaculaire, faisant passer la force des énergies mises en jeu, malgré des jeux d'acteur un peu trop appuyés et un degré de naïveté dans les représentations.
Au vu du volume de la production de comics de Marvel dans les années 1980, une anthologie de 230 pages contenant 9 épisodes ne peut pas donner un aperçu global. Comme l'indique Jess Harold dans son introduction, il s'agit de montrer dans quelle mesure l'éditeur était capable de faire évoluer ses personnages, de les remettre en question. Le lecteur peut ainsi se faire son idée sur la manière d'insuffler de la nouveauté dans des superhéros ayant 20 ans d'âge, et sur le chemin parcouru en termes de narration visuelle depuis le début de l'ère Marvel, dans une anthologie bien conçue.
Ce tome est le quatrième dans la série des Milestones, après X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga (1980), X-Men Milestones: Mutant Massacre (1986), X-Men Milestones: Fall of the Mutants (1988). Il contient la minisérie X-Terminators (4 épisodes, Louise Simonson & Jon Bogdanove), les épisodes 239 à 243 d'Uncanny X-Men (Chris Claremont & Marc Silvestri), 35 à 39 de X-Factor (Louise Simonson & Walter Simonson), 71 à 73 de New Mutants (Louise Simonson & Brett Blevins). Ces épisodes sont initialement parus en 1988/1989. Le tome s'ouvre avec une introduction dense d'une page, récapitulant les principaux événements depuis Jean Grey trouvant la mort sur la face cachée de la Lune, jusqu'à la loi de recensement des mutants et la mort de Candy Southern.
Dans les profondeurs du royaume des Limbes (Limbo), N'Astirh s'avance sur S'ym. Le premier est suivi par plusieurs démons, le second se tient devant une grande épée, celle de Darkchilde, à savoir Illyana Rasputine. S'ym met sa pâtée à N'Astirh, tout en lui expliquant qu'il lui confie la mission de ramener 13 bébés dotés de pouvoir, en se rendant sur Terre. Les membres de X-Factor (Cyclops, Beast, Iceman, Angel et Marvel Girl) regardent Rusty Collins (un mutant) se rendre aux autorités, sous le regard d'Artie Maddicks & Leech (deux enfants mutants), de Julio Richter (Rictor) et de Sally Blevins (Skids). Après son départ entre deux militaires de la marine, Marvel Girl (Jean Grey) va déposer Artie et Leech dans une école avec internat, dirigée par Gloria Johnson, avec son adjointe Lynne Hutington. Le jeune Takeshi Matsuya les voit arriver avec une pointe de jalousie. Iceman (Bobby Drake) va déposer Julio Richter, Sally Blevins et Tabitha Smith dans un lycée avec internat. Pendant la nuit, quatre démons viennent enlever Leech dans son lit. L'intervention de Takeshi Matsuya et d'Artie ne suffit pas pour empêcher le kidnapping.
À New York aussi, des démons commencent à se manifester, d'abord en possédant des objets du quotidien comme une ascenseur dont la cabine dévore ses passagers. Ailleurs, dans son quartier général, Mister Sinister considère ce qu'implique pour lui la disparition des X-Men. Il est interrompu par l'arrivée de l'entité Malice qui possède le corps de Lorna Dane. Une vive discussion s'en suit. En Australie, Alison Blaire fit son entrée dans un bar, et monte sur scène pour chanter avec le groupe qui s'y produit. En observant les écrans dans la base que les X-Men se sont appropriée, Ororo Munroe découvre que Jean Grey, sa meilleure amie, est vivante et que Logan lui a caché ce fait. À New York, Beast (Hank McCoy) et Iceman (Bobby Drake) luttent contre un camion-citerne possédé par un démon, pour sauver des civils. Scott Summers et Jean Grey se trouvent au Nebraska, devant l'orphelinat qui a accueilli Scott quand il était enfant. Alors qu'ils visitent les différentes pièces, un vaisseau apparaît au-dessus de l'établissement : celui de Nanny et Orphan-Maker.
La légende veut que tout a commencé avec l'intrigue pour Mutant Massacre (1986) : en découvrant l'intrigue imaginée par Chris Claremont, Louise Simonson aurait fait remarquer qu'elle était trop longue pour être racontée dans la seule série Uncanny X-Men (en abrégé UXM), et aurait proposé d'en raconter une partie dans la série X-Factor en assurant la coordination entre les deux titres. C'est de là que viendrait l'idée de coordonner des histoires au travers de plusieurs séries dédiées à des mutants. De loin, le lecteur éprouve l'impression que Fall of the Mutants recommence, avec à nouveau une histoire impliquant des démons. Mais il se rend vite compte que l'ampleur du présent récit est toute autre. Cette fois-ci, il s'agit de coordonner 3 titres mutants, et de proposer une minisérie supplémentaire. Plusieurs intrigues secondaires s'entrecroisent, et se résolvent. Le lecteur de longue date découvre enfin qui est vraiment Madelyne Pryor, apparue pour la première fois dans UXM 168 en 1983. Il découvre également ce que devient Magik quand elle est entièrement recouverte de son armure démoniaque, l'aboutissement de sa perversion par Belasco, entamée dans une minisérie de 1983. Il en apprend un peu plus sur le mystérieux Mister Sinister. Enfin, Scott Summers doit faire face Madelyne Pryor et Jean Grey revenue d'entre les morts en 1986. D'une certaine manière, ce crossover importe dans la continuité des personnages, du fait du nombre de révélations majeures, et de l'évolution significative de plusieurs personnages de premier plan.
Ce recueil comprend donc 17 épisodes dont 3 d'une pagination double. Sur ces 17 épisodes, 5 sont écrits par Chris Claremont qui écrit les X-Men depuis 1975, et les 12 autres par Louise Simonson, scénariste de X-Factor depuis 1986 et New Mutants depuis 1987, mais responsable éditoriale de UXM depuis le numéro 137 (1980). Le responsable éditorial a réalisé une coordination satisfaisante entre les différents titres, mais pas toujours facile à suivre : un personnage peu disparaître au milieu d'un épisode d'une série, pour réapparaître au milieu d'un épisode d'une autre série publiée le même mois. Les artistes assurent chacun leur série, sans remplaçant. Ils officient chacun dans un registre descriptif et assez réaliste, avec un degré de simplification pour être tout public, et chacun avec leurs idiosyncrasies. John Bogdanove exagère les expressions pour un effet parfois comique, une impression globale plus enfantine, ce qui est cohérent avec le fait que les personnages sont des enfants de moins de 10 ans. Comme les autres dessinateurs, il connaît tous les trucs et astuces pour s'économiser sur les décors. Par rapport à son travail sur la série Superman, le lecteur ne retrouve pas l'énergie empruntée à Jack Kirby, mais ces épisodes se regardent sans déplaisir, du fait d'une narration claire. Malgré le nombre important de pages à réaliser chaque mois, Marc Silvestri tient le rythme, grâce à ses encreurs. Ses dessins donnent une impression plus adulte, avec des personnages plus élancés, plus dynamiques. S'il y prête attention, le lecteur relève une ou deux cases par épisode dans laquelle Silvestri se montre facétieux, avec une touche comique sur les visages ou sur les costumes (impossible d'oublier celui d'Havok en Goblin King).
Par comparaison, les deux autres artistes donnent l'impression d'une approche graphique plus marquée, moins consensuelle. En surface, les visages des personnages de Walter Simonson sont moches, parce que mal finis, leurs expressions manquent de nuances. Les contours des silhouettes des personnages sont anguleux, parfois disgracieux. Par contre, Simonson a conservé l'énergie de Jack Kirby, avec une force plus primale dans la manière de représenter les énergies, la force des superhéros. Les dessins de Brett Blevins sont encore plus personnels, à commencer par les expressions des visages : ils sont un peu plus allongés que la normale, et les différents individus sont habités par des émotions d'une rare intensité, souvent négatives comme la peur ou la souffrance, la méchanceté pour les ennemis, voire la cruauté. Le lecteur éprouve des difficultés à prendre du recul par rapport à ces émotions, tellement les visages sont expressifs, et les situations traumatisantes. C'est à la fois cohérent avec l'écriture très émotionnelle de Louise Simonson qui force la dose de pathos, et avec l'état d'esprit de ces adolescents, souvent le jouet de leurs émotions. Entre deux scènes de dialogues et trois scènes de combat, chacun des 4 dessinateurs se retrouvent à illustrer des séquences sortant de l'ordinaire, souvent visuellement mémorables.
Avec les décennies ayant passé depuis la parution initiale de ces épisodes, il est possible que l'implication émotionnelle du lecteur ait diminué, s'il les a lus initialement, ou ait du mal à naître du fait de l'absence de de la connaissance du contexte et des enjeux souvent développés sur plusieurs années de parution. Pourtant, dans sa globalité, le récit forme une saga de grande ampleur. Le lecteur de longue date peut apprécier de la lire d'une traite, et de découvrir des épisodes qu'il n'avait pas lus à l'époque (ayant par exemple fait l'impasse sur la minisérie X-Terminators), et le lecteur récent peut découvrir cet incroyable imbroglio entre Madelyne Pryor, Jean Grey, Mister Sinister, sans oublier la tragique histoire personnelle d'Illyana Rasputin. Il tombe régulièrement sur une scène ahurissante : des démons ailés subtilisant un bébé dans son landau à Central Park, Betsy Braddock enlevant son armure pour prendre un bain dans un lac souterrain, une parodie des Ghostbusters interrompant le dîner aux chandelles de Madelyne et Alex, Betsy Braddock posant nue pour Piotr Rasputin, Rahne Sinclair devenant hystérique en découvrant le cadavre de Piotr Rasputin dans les Limbes, un touriste se faisant arracher les yeux par des jumelles sur l'Empire State Building, la forme démoniaque intégrale d'Illyana, Warlock en superhéros avec une belle cape rouge, Logan embrassant fougueusement Jean Grey sans consentement dans un dessin en pleine page, etc. Rien ne peut préparer à voir Alison Blaire et Longshot batifoler comme des adolescents en proie à leurs hormones, alors que les X-Men se battent contre des démons à quelques mètres de là.
Ces 17 épisodes constituent un crossover de bonne ampleur, perfectionnant la recette événementielle. La cohérence du récit est assurée par le fait qu'il n'y a que deux scénaristes à se partager l'écriture et que le responsable éditorial assure un travail de coordination d'un niveau satisfaisant. Chaque série dispose d'un dessinateur attitré, chaque style étant assez proche pour être compatible, ce qui n'empêche des différences significatives entre eux. Le lecteur remarque vite que la série New Mutants sort du lot en tonalité narrative du fait de sa dramatisation beaucoup plus appuyée, ce qui est cohérent avec l'âge des personnages. Pour pouvoir être pleinement appréciée, cette histoire requiert une bonne connaissance de ce qui s'est passé avant, de l'histoire de Jean Grey, de Madelyne Pryor, d'Illyana Rasputin, et également d'une partie de celle de Scott Summers (ses années en orphelinat). Sous cette réserve, il est probable que le lecteur se replonge avec plaisir dans cette histoire, appréciant de retrouver ou de découvrir la résolution d'intrigues secondaires développées sur plusieurs années, et de voir des personnages chers à son cœur évoluer.
Dans les profondeurs du royaume des Limbes (Limbo), N'Astirh s'avance sur S'ym. Le premier est suivi par plusieurs démons, le second se tient devant une grande épée, celle de Darkchilde, à savoir Illyana Rasputine. S'ym met sa pâtée à N'Astirh, tout en lui expliquant qu'il lui confie la mission de ramener 13 bébés dotés de pouvoir, en se rendant sur Terre. Les membres de X-Factor (Cyclops, Beast, Iceman, Angel et Marvel Girl) regardent Rusty Collins (un mutant) se rendre aux autorités, sous le regard d'Artie Maddicks & Leech (deux enfants mutants), de Julio Richter (Rictor) et de Sally Blevins (Skids). Après son départ entre deux militaires de la marine, Marvel Girl (Jean Grey) va déposer Artie et Leech dans une école avec internat, dirigée par Gloria Johnson, avec son adjointe Lynne Hutington. Le jeune Takeshi Matsuya les voit arriver avec une pointe de jalousie. Iceman (Bobby Drake) va déposer Julio Richter, Sally Blevins et Tabitha Smith dans un lycée avec internat. Pendant la nuit, quatre démons viennent enlever Leech dans son lit. L'intervention de Takeshi Matsuya et d'Artie ne suffit pas pour empêcher le kidnapping.
À New York aussi, des démons commencent à se manifester, d'abord en possédant des objets du quotidien comme une ascenseur dont la cabine dévore ses passagers. Ailleurs, dans son quartier général, Mister Sinister considère ce qu'implique pour lui la disparition des X-Men. Il est interrompu par l'arrivée de l'entité Malice qui possède le corps de Lorna Dane. Une vive discussion s'en suit. En Australie, Alison Blaire fit son entrée dans un bar, et monte sur scène pour chanter avec le groupe qui s'y produit. En observant les écrans dans la base que les X-Men se sont appropriée, Ororo Munroe découvre que Jean Grey, sa meilleure amie, est vivante et que Logan lui a caché ce fait. À New York, Beast (Hank McCoy) et Iceman (Bobby Drake) luttent contre un camion-citerne possédé par un démon, pour sauver des civils. Scott Summers et Jean Grey se trouvent au Nebraska, devant l'orphelinat qui a accueilli Scott quand il était enfant. Alors qu'ils visitent les différentes pièces, un vaisseau apparaît au-dessus de l'établissement : celui de Nanny et Orphan-Maker.
La légende veut que tout a commencé avec l'intrigue pour Mutant Massacre (1986) : en découvrant l'intrigue imaginée par Chris Claremont, Louise Simonson aurait fait remarquer qu'elle était trop longue pour être racontée dans la seule série Uncanny X-Men (en abrégé UXM), et aurait proposé d'en raconter une partie dans la série X-Factor en assurant la coordination entre les deux titres. C'est de là que viendrait l'idée de coordonner des histoires au travers de plusieurs séries dédiées à des mutants. De loin, le lecteur éprouve l'impression que Fall of the Mutants recommence, avec à nouveau une histoire impliquant des démons. Mais il se rend vite compte que l'ampleur du présent récit est toute autre. Cette fois-ci, il s'agit de coordonner 3 titres mutants, et de proposer une minisérie supplémentaire. Plusieurs intrigues secondaires s'entrecroisent, et se résolvent. Le lecteur de longue date découvre enfin qui est vraiment Madelyne Pryor, apparue pour la première fois dans UXM 168 en 1983. Il découvre également ce que devient Magik quand elle est entièrement recouverte de son armure démoniaque, l'aboutissement de sa perversion par Belasco, entamée dans une minisérie de 1983. Il en apprend un peu plus sur le mystérieux Mister Sinister. Enfin, Scott Summers doit faire face Madelyne Pryor et Jean Grey revenue d'entre les morts en 1986. D'une certaine manière, ce crossover importe dans la continuité des personnages, du fait du nombre de révélations majeures, et de l'évolution significative de plusieurs personnages de premier plan.
Ce recueil comprend donc 17 épisodes dont 3 d'une pagination double. Sur ces 17 épisodes, 5 sont écrits par Chris Claremont qui écrit les X-Men depuis 1975, et les 12 autres par Louise Simonson, scénariste de X-Factor depuis 1986 et New Mutants depuis 1987, mais responsable éditoriale de UXM depuis le numéro 137 (1980). Le responsable éditorial a réalisé une coordination satisfaisante entre les différents titres, mais pas toujours facile à suivre : un personnage peu disparaître au milieu d'un épisode d'une série, pour réapparaître au milieu d'un épisode d'une autre série publiée le même mois. Les artistes assurent chacun leur série, sans remplaçant. Ils officient chacun dans un registre descriptif et assez réaliste, avec un degré de simplification pour être tout public, et chacun avec leurs idiosyncrasies. John Bogdanove exagère les expressions pour un effet parfois comique, une impression globale plus enfantine, ce qui est cohérent avec le fait que les personnages sont des enfants de moins de 10 ans. Comme les autres dessinateurs, il connaît tous les trucs et astuces pour s'économiser sur les décors. Par rapport à son travail sur la série Superman, le lecteur ne retrouve pas l'énergie empruntée à Jack Kirby, mais ces épisodes se regardent sans déplaisir, du fait d'une narration claire. Malgré le nombre important de pages à réaliser chaque mois, Marc Silvestri tient le rythme, grâce à ses encreurs. Ses dessins donnent une impression plus adulte, avec des personnages plus élancés, plus dynamiques. S'il y prête attention, le lecteur relève une ou deux cases par épisode dans laquelle Silvestri se montre facétieux, avec une touche comique sur les visages ou sur les costumes (impossible d'oublier celui d'Havok en Goblin King).
Par comparaison, les deux autres artistes donnent l'impression d'une approche graphique plus marquée, moins consensuelle. En surface, les visages des personnages de Walter Simonson sont moches, parce que mal finis, leurs expressions manquent de nuances. Les contours des silhouettes des personnages sont anguleux, parfois disgracieux. Par contre, Simonson a conservé l'énergie de Jack Kirby, avec une force plus primale dans la manière de représenter les énergies, la force des superhéros. Les dessins de Brett Blevins sont encore plus personnels, à commencer par les expressions des visages : ils sont un peu plus allongés que la normale, et les différents individus sont habités par des émotions d'une rare intensité, souvent négatives comme la peur ou la souffrance, la méchanceté pour les ennemis, voire la cruauté. Le lecteur éprouve des difficultés à prendre du recul par rapport à ces émotions, tellement les visages sont expressifs, et les situations traumatisantes. C'est à la fois cohérent avec l'écriture très émotionnelle de Louise Simonson qui force la dose de pathos, et avec l'état d'esprit de ces adolescents, souvent le jouet de leurs émotions. Entre deux scènes de dialogues et trois scènes de combat, chacun des 4 dessinateurs se retrouvent à illustrer des séquences sortant de l'ordinaire, souvent visuellement mémorables.
Avec les décennies ayant passé depuis la parution initiale de ces épisodes, il est possible que l'implication émotionnelle du lecteur ait diminué, s'il les a lus initialement, ou ait du mal à naître du fait de l'absence de de la connaissance du contexte et des enjeux souvent développés sur plusieurs années de parution. Pourtant, dans sa globalité, le récit forme une saga de grande ampleur. Le lecteur de longue date peut apprécier de la lire d'une traite, et de découvrir des épisodes qu'il n'avait pas lus à l'époque (ayant par exemple fait l'impasse sur la minisérie X-Terminators), et le lecteur récent peut découvrir cet incroyable imbroglio entre Madelyne Pryor, Jean Grey, Mister Sinister, sans oublier la tragique histoire personnelle d'Illyana Rasputin. Il tombe régulièrement sur une scène ahurissante : des démons ailés subtilisant un bébé dans son landau à Central Park, Betsy Braddock enlevant son armure pour prendre un bain dans un lac souterrain, une parodie des Ghostbusters interrompant le dîner aux chandelles de Madelyne et Alex, Betsy Braddock posant nue pour Piotr Rasputin, Rahne Sinclair devenant hystérique en découvrant le cadavre de Piotr Rasputin dans les Limbes, un touriste se faisant arracher les yeux par des jumelles sur l'Empire State Building, la forme démoniaque intégrale d'Illyana, Warlock en superhéros avec une belle cape rouge, Logan embrassant fougueusement Jean Grey sans consentement dans un dessin en pleine page, etc. Rien ne peut préparer à voir Alison Blaire et Longshot batifoler comme des adolescents en proie à leurs hormones, alors que les X-Men se battent contre des démons à quelques mètres de là.
Ces 17 épisodes constituent un crossover de bonne ampleur, perfectionnant la recette événementielle. La cohérence du récit est assurée par le fait qu'il n'y a que deux scénaristes à se partager l'écriture et que le responsable éditorial assure un travail de coordination d'un niveau satisfaisant. Chaque série dispose d'un dessinateur attitré, chaque style étant assez proche pour être compatible, ce qui n'empêche des différences significatives entre eux. Le lecteur remarque vite que la série New Mutants sort du lot en tonalité narrative du fait de sa dramatisation beaucoup plus appuyée, ce qui est cohérent avec l'âge des personnages. Pour pouvoir être pleinement appréciée, cette histoire requiert une bonne connaissance de ce qui s'est passé avant, de l'histoire de Jean Grey, de Madelyne Pryor, d'Illyana Rasputin, et également d'une partie de celle de Scott Summers (ses années en orphelinat). Sous cette réserve, il est probable que le lecteur se replonge avec plaisir dans cette histoire, appréciant de retrouver ou de découvrir la résolution d'intrigues secondaires développées sur plusieurs années, et de voir des personnages chers à son cœur évoluer.
Malgré sa pléiade de « pointures » du comics, « X-men, l'intégrale 1990, tome 2 » est affreusement mauvais.
Le scénario initié par Claremont puis continué par Simonson est d'une grande faiblesse avec ses épuisantes répétitions de super héros se faisant tailler en pièces par un super méchant, Cameron Hodge en apparence invincible.
La multiplicité des personnages conduit inévitablement à une intrigue brouillonne et à la sous exploitation de certains d'entre eux comme la quasi totalité de Facteur X et Wolverine présent "parce que" populaire.
Au niveau graphisme c'est encore pire, seul Lee surnageant au dessus de la mêlée. Liefield déçoit, Bogdanove et Shoemaker n'ayant quant à eux clairement pas le niveau.
Une année 90 qui contribuera certainement à continuer à enterrer les X-men, avec le reboot raté de Facteur X et ces Nouveaux mutants incapables de décoller malgré l'arrivée quasi constante de nouveaux personnages.
Vous pouvez clairement passer votre chemin !
Lien : https://lediscoursdharnois.b..
Le scénario initié par Claremont puis continué par Simonson est d'une grande faiblesse avec ses épuisantes répétitions de super héros se faisant tailler en pièces par un super méchant, Cameron Hodge en apparence invincible.
La multiplicité des personnages conduit inévitablement à une intrigue brouillonne et à la sous exploitation de certains d'entre eux comme la quasi totalité de Facteur X et Wolverine présent "parce que" populaire.
Au niveau graphisme c'est encore pire, seul Lee surnageant au dessus de la mêlée. Liefield déçoit, Bogdanove et Shoemaker n'ayant quant à eux clairement pas le niveau.
Une année 90 qui contribuera certainement à continuer à enterrer les X-men, avec le reboot raté de Facteur X et ces Nouveaux mutants incapables de décoller malgré l'arrivée quasi constante de nouveaux personnages.
Vous pouvez clairement passer votre chemin !
Lien : https://lediscoursdharnois.b..
Ce tome contient une histoire complète, essentielle dans la continuité et le développement des X-Men, parue en 1986/1987. Il comprend les épisodes suivants : 210 à 214 d'Uncanny X-men (scénario de Chris Claremont, dessins successivement de John Romita junior & Dan Green, JRjr & Bret Blevins, Rick Leonardi & Dan Green, Alan Davis & Paul Neary, Barry Windsor Smith et Bob Wiacek), 9 à 11 de X-Factor (scénario de Louise Simonson, dessins successivement de Terry Shoemaker & Joe Rubinstein, puis Walter Simonson & Bob Wiacek), 46 de New Mutants (scénario de Chris Claremont, dessins de Jackson Guice, encrage de Kyle Baker), 373 & 374 de Mighty Thor (scénario de Walter Simonson, dessins et encrage de Sal Buscema), 27 de Power Pack (scénario de Louise Simonson, dessins de John Bogdanove, encrage d'Al Gordon), et 238 de Daredevil (scénario d'Ann Nocenti, dessins de Sal Buscema, encrage de Steve Leialoha). Initialement, cette histoire est parue en 1986/1987. Elle fait suite à X-Men: Ghosts (épisodes 199 à 209, et annual 10).
Cette histoire est remarquable à plus d'un titre. Pour commencer il s'agit d'un crossover construit avec une certaine dextérité. Chris Claremont joue le rôle de locomotive pour l'histoire avec la série Uncanny X-Men (en abrégé UXM), Louise Simonson (ancienne responsable éditoriale de la série UXM, sous son nom de jeune fille Louise Jones) raccroche le wagon de X-Factor pour gagner en notoriété avec cette série débutante. Elle en profite pour raccrocher sa deuxième série : Power Pack (Power Pack Classic 1, épisodes 1 à 10). Walter Simonson vient épauler sa femme Louise, avec le titre dont il est le scénariste (Mighty Thor) et en dessinant la série X-Factor.
Ann Nocenti (c'est son deuxième épisode en tant que scénariste sur Daredevil, la suite sera nettement meilleure, par exemple Lone stranger, épisodes 265 à 273) s'invite également, en tant que responsable éditoriale de la série UXM. Ces considérations permettent de comprendre comment les enfants de Power pack en viennent à découdre avec le psychopathe Sabretooth, et pourquoi Thor et Daredevil se retrouvent soudain embarqués dans cette histoire de mutants.
Lors de la (re)lecture de cette histoire, ses qualités et son rôle charnière apparaissent pleinement. Chris Claremont dispose encore de plein d'idées neuves pour les personnages qu'il a fait sien et cette équipe dont il dirige la destinée depuis 1975. Au fil des épisodes, le lecteur se rappelle que Magneto est alors directeur de l'école pour surdoués de Westchester (qui accueille l'équipe des New Mutants), qu'Ororo n'a plus ses pouvoirs. Il découvre pour la première fois les Marauders et il apprend l'existence d'un certain Mister Sinister. Il découvre Malice, il apprend que Wolverine et Sabretooth (un personnage encore nouveau à l'époque, en provenance des épisodes d'Iron Fist écrits par Claremont et dessinés par Byrne) se connaissent de longue date. Il voit Betsy Braddock intégrer l'équipe des X-Men (avec son joli costume rose pâle).
De son coté Louise Simonson essaye de récupérer comme elle peut le concept de départ calamiteux de la série X-Factor (les 5 premiers X-Men qui se font passer pour des chasseurs de mutants, attisant ainsi le racisme envers les mutants, ne cherchez pas, c'est aussi idiot que ça en a l'air). Contre toute attente (alors qu'il s'agit de ses débuts de scénariste), elle réussit à faire ressortir l'étrangeté de la situation par le biais de Jean Grey qui revient d'un coma prolongé (voir Phoenix rising).
Au-delà de cette phase historique de l'équipe des X-Men, la locomotive Claremont a senti le vent tourner : il sait que le lectorat vieillit et qu'il doit écrire des récits plus sombres. De ce coté là, le lecteur est servi : une épuration ethnique par le biais d'exécution de sang froid, et des héros tuant leur adversaire faute d'autre solution. En vrai scénariste, Claremont raconte une vraie histoire, pas simplement une suite de scènes de carnage. Lorsque Colossus tue l'un des Marauders, ce n'est pas une scène choc n'ayant de valeur que pour la case de l'exécution. C'est un véritable traumatisme, un reniement d'une des valeurs fondamentales de Piotr Rasputin qui est confronté à un individu dont les agissements dépassent son entendement. Lorsque des X-Men sont blessés, ils ne guérissent pas entre 2 épisodes.
Le niveau de souffrance des personnages est à la hauteur de l'abomination de l'extermination mise en scène. Les époux Simonson ne sont pas en reste avec la torture infligée à Angel (Warren Worthington), ou la blessure de Thor. La violence et les blessures ne sont pas édulcorées ou réduites à l'état de ressort dramatique gratuit, il y a une vraie souffrance avec des répercussions à long terme. Dans l'épisode des New Mutants, Claremont décrit l'installation de l'hôpital de fortune, la pression subie par les New Mutants s'occupant de la logistique, et le dénuement des victimes. On est très loin de la violence glorifiée comme simple dispositif de divertissement.
Bien sûr parmi ces 13 épisodes, certains ressortent comme des pièces rapportées. Les 2 premiers épisodes de X-Factor sont assez indigestes à lire parce Louise Simonson s'applique de manière besogneuse pour tout expliquer, dans un style lourd et dépourvu d'émotion. Ça va mieux pour le troisième épisode. La présence des enfants de Power Pack semble totalement déplacée parce qu'il s'agit d'une série destinée à un lectorat plus jeune, trop en décalage avec cette épuration sadique.
L'épisode de Daredevil est intéressant sur le fond avec une analyse psychologique des pulsions de Sabretooth qui en font un individu à part entière (au lieu d'une caricature de psychopathe générique), mais dans la forme il est visible que Nocenti est aussi inexpérimenté que L. Simonson pour écrire des dialogues ou des bulles de pensée digestes. Le cas de Walter Simonson est un peu différent : le rythme de son scénario est plus fluide, par contre il écrit d'une manière vieillotte (déjà pour l'époque), trop proche de celle de Stan Lee. Malgré tout l'ensemble dépeint un événement horrifiant de grande ampleur en donnant plusieurs points de vue complémentaires.
Sur le plan visuel, Sal Buscema effectue un travail à mi-chemin entre les illustrations des années 1970 (formes un peu simplistes) et une approche plus agressive qui confère un ton plus en adéquation avec le tragique des événements. Simonson semble dessiner un peu vite, avec une apparence très dynamique, mais là aussi une approche encore légèrement teintée d'une vision enfantine. Les dessins de Bogdanove transcrivent gentiment les aventures du Power Pack, pour une apparence plus douce, plus adaptée à ce lectorat plus jeune. Le meilleur se trouve donc dans les épisodes de la série UXM. La mise en page de Romita junior est très vivante et Dan Green, comme Blevins apporte une texture un peu coupante aux dessins qui illustrent bien le ton cruel du récit. L'épisode dessiné par Leonardi n'est pas très joli à regarder (comme celui de Shoemaker). Betsy Braddock affronte Sabretooth dans des dessins vifs et très jolis, tout en rondeurs, de Davis et Neary. D'un coté, c'est visuellement très mignon (et donc peu raccord avec l'animalité de Sabretooth). De l'autre, cet aspect un peu jovial retranscrit bien le refus de Claremont de se vautrer dans une narration se complaisant dans une violence facile, et préférant mettre en avant le travail d'équipe, et des valeurs humanistes.
Oui, Betsy est ridicule dans sa robe rose et ses petits talons ; oui elle n'en est que plus admirable dans son courage. Le tome se clôt avec l'incroyable prestation de Barry Windsor Smith. À cette époque il réalise 1 épisode des X-Men de temps à autre ; ils ont tous été réédités dans X-Men: Lifedeath (épisodes 53, 186, 198, 205 et 214). Il ne s'agit pas du plus beau car il ne s'encre pas lui-même et il ne fait la mise en couleurs. Malgré cela, la maîtrise et l'inventivité graphique de Windsor Smith éclatent par comparaison avec les prédécesseurs. Au lieu de jouer dans le registre du réalisme sanguinolent, il met magnifiquement en valeur les superpouvoirs des mutants, mais aussi leurs émotions, un vrai régal.
D'un coté cette histoire est plombée par quelques épisodes à la narration maladroite (même pour l'époque), et par l'aspect hétérogène des différentes séries. De l'autre, Chris Claremont raconte un récit qui marque la fin de l'innocence pour les X-Men, avec une plongée dans un massacre écoeurant, et des cicatrices aussi bien physiques que psychologiques qui ne s'effaceront pas de sitôt, à l'opposé des récits où seul l'effet choc compte. Après quelques épisodes plus mineurs, les X-Men luttent contre une invasion démoniaque dans "Fall of the mutants 1" (épisodes UXM 220 à 227, Incredible Hulk 340, New Mutants 55 à 61). Kitty Pride et Piotr Rasputin pansent leurs plaies dans "Excalibur (The sword is drawn)".
Cette histoire est remarquable à plus d'un titre. Pour commencer il s'agit d'un crossover construit avec une certaine dextérité. Chris Claremont joue le rôle de locomotive pour l'histoire avec la série Uncanny X-Men (en abrégé UXM), Louise Simonson (ancienne responsable éditoriale de la série UXM, sous son nom de jeune fille Louise Jones) raccroche le wagon de X-Factor pour gagner en notoriété avec cette série débutante. Elle en profite pour raccrocher sa deuxième série : Power Pack (Power Pack Classic 1, épisodes 1 à 10). Walter Simonson vient épauler sa femme Louise, avec le titre dont il est le scénariste (Mighty Thor) et en dessinant la série X-Factor.
Ann Nocenti (c'est son deuxième épisode en tant que scénariste sur Daredevil, la suite sera nettement meilleure, par exemple Lone stranger, épisodes 265 à 273) s'invite également, en tant que responsable éditoriale de la série UXM. Ces considérations permettent de comprendre comment les enfants de Power pack en viennent à découdre avec le psychopathe Sabretooth, et pourquoi Thor et Daredevil se retrouvent soudain embarqués dans cette histoire de mutants.
Lors de la (re)lecture de cette histoire, ses qualités et son rôle charnière apparaissent pleinement. Chris Claremont dispose encore de plein d'idées neuves pour les personnages qu'il a fait sien et cette équipe dont il dirige la destinée depuis 1975. Au fil des épisodes, le lecteur se rappelle que Magneto est alors directeur de l'école pour surdoués de Westchester (qui accueille l'équipe des New Mutants), qu'Ororo n'a plus ses pouvoirs. Il découvre pour la première fois les Marauders et il apprend l'existence d'un certain Mister Sinister. Il découvre Malice, il apprend que Wolverine et Sabretooth (un personnage encore nouveau à l'époque, en provenance des épisodes d'Iron Fist écrits par Claremont et dessinés par Byrne) se connaissent de longue date. Il voit Betsy Braddock intégrer l'équipe des X-Men (avec son joli costume rose pâle).
De son coté Louise Simonson essaye de récupérer comme elle peut le concept de départ calamiteux de la série X-Factor (les 5 premiers X-Men qui se font passer pour des chasseurs de mutants, attisant ainsi le racisme envers les mutants, ne cherchez pas, c'est aussi idiot que ça en a l'air). Contre toute attente (alors qu'il s'agit de ses débuts de scénariste), elle réussit à faire ressortir l'étrangeté de la situation par le biais de Jean Grey qui revient d'un coma prolongé (voir Phoenix rising).
Au-delà de cette phase historique de l'équipe des X-Men, la locomotive Claremont a senti le vent tourner : il sait que le lectorat vieillit et qu'il doit écrire des récits plus sombres. De ce coté là, le lecteur est servi : une épuration ethnique par le biais d'exécution de sang froid, et des héros tuant leur adversaire faute d'autre solution. En vrai scénariste, Claremont raconte une vraie histoire, pas simplement une suite de scènes de carnage. Lorsque Colossus tue l'un des Marauders, ce n'est pas une scène choc n'ayant de valeur que pour la case de l'exécution. C'est un véritable traumatisme, un reniement d'une des valeurs fondamentales de Piotr Rasputin qui est confronté à un individu dont les agissements dépassent son entendement. Lorsque des X-Men sont blessés, ils ne guérissent pas entre 2 épisodes.
Le niveau de souffrance des personnages est à la hauteur de l'abomination de l'extermination mise en scène. Les époux Simonson ne sont pas en reste avec la torture infligée à Angel (Warren Worthington), ou la blessure de Thor. La violence et les blessures ne sont pas édulcorées ou réduites à l'état de ressort dramatique gratuit, il y a une vraie souffrance avec des répercussions à long terme. Dans l'épisode des New Mutants, Claremont décrit l'installation de l'hôpital de fortune, la pression subie par les New Mutants s'occupant de la logistique, et le dénuement des victimes. On est très loin de la violence glorifiée comme simple dispositif de divertissement.
Bien sûr parmi ces 13 épisodes, certains ressortent comme des pièces rapportées. Les 2 premiers épisodes de X-Factor sont assez indigestes à lire parce Louise Simonson s'applique de manière besogneuse pour tout expliquer, dans un style lourd et dépourvu d'émotion. Ça va mieux pour le troisième épisode. La présence des enfants de Power Pack semble totalement déplacée parce qu'il s'agit d'une série destinée à un lectorat plus jeune, trop en décalage avec cette épuration sadique.
L'épisode de Daredevil est intéressant sur le fond avec une analyse psychologique des pulsions de Sabretooth qui en font un individu à part entière (au lieu d'une caricature de psychopathe générique), mais dans la forme il est visible que Nocenti est aussi inexpérimenté que L. Simonson pour écrire des dialogues ou des bulles de pensée digestes. Le cas de Walter Simonson est un peu différent : le rythme de son scénario est plus fluide, par contre il écrit d'une manière vieillotte (déjà pour l'époque), trop proche de celle de Stan Lee. Malgré tout l'ensemble dépeint un événement horrifiant de grande ampleur en donnant plusieurs points de vue complémentaires.
Sur le plan visuel, Sal Buscema effectue un travail à mi-chemin entre les illustrations des années 1970 (formes un peu simplistes) et une approche plus agressive qui confère un ton plus en adéquation avec le tragique des événements. Simonson semble dessiner un peu vite, avec une apparence très dynamique, mais là aussi une approche encore légèrement teintée d'une vision enfantine. Les dessins de Bogdanove transcrivent gentiment les aventures du Power Pack, pour une apparence plus douce, plus adaptée à ce lectorat plus jeune. Le meilleur se trouve donc dans les épisodes de la série UXM. La mise en page de Romita junior est très vivante et Dan Green, comme Blevins apporte une texture un peu coupante aux dessins qui illustrent bien le ton cruel du récit. L'épisode dessiné par Leonardi n'est pas très joli à regarder (comme celui de Shoemaker). Betsy Braddock affronte Sabretooth dans des dessins vifs et très jolis, tout en rondeurs, de Davis et Neary. D'un coté, c'est visuellement très mignon (et donc peu raccord avec l'animalité de Sabretooth). De l'autre, cet aspect un peu jovial retranscrit bien le refus de Claremont de se vautrer dans une narration se complaisant dans une violence facile, et préférant mettre en avant le travail d'équipe, et des valeurs humanistes.
Oui, Betsy est ridicule dans sa robe rose et ses petits talons ; oui elle n'en est que plus admirable dans son courage. Le tome se clôt avec l'incroyable prestation de Barry Windsor Smith. À cette époque il réalise 1 épisode des X-Men de temps à autre ; ils ont tous été réédités dans X-Men: Lifedeath (épisodes 53, 186, 198, 205 et 214). Il ne s'agit pas du plus beau car il ne s'encre pas lui-même et il ne fait la mise en couleurs. Malgré cela, la maîtrise et l'inventivité graphique de Windsor Smith éclatent par comparaison avec les prédécesseurs. Au lieu de jouer dans le registre du réalisme sanguinolent, il met magnifiquement en valeur les superpouvoirs des mutants, mais aussi leurs émotions, un vrai régal.
D'un coté cette histoire est plombée par quelques épisodes à la narration maladroite (même pour l'époque), et par l'aspect hétérogène des différentes séries. De l'autre, Chris Claremont raconte un récit qui marque la fin de l'innocence pour les X-Men, avec une plongée dans un massacre écoeurant, et des cicatrices aussi bien physiques que psychologiques qui ne s'effaceront pas de sitôt, à l'opposé des récits où seul l'effet choc compte. Après quelques épisodes plus mineurs, les X-Men luttent contre une invasion démoniaque dans "Fall of the mutants 1" (épisodes UXM 220 à 227, Incredible Hulk 340, New Mutants 55 à 61). Kitty Pride et Piotr Rasputin pansent leurs plaies dans "Excalibur (The sword is drawn)".
« X-men, l'intégrale, 1991, tome 1 » déploie des efforts considérables pour redynamiser une franchise tablant déjà sur son glorieux passé.
Les scénarios de Claremont sont plutot bons et le style graphique de Lee, très puissant (et sexy !) forment une bonne combinaison.
Mais difficile de crier au génie lorsqu'on ressort les histoires de complots Skrulls mixées avec les aventures spatiales des Shi'ar.
Grosse faiblesse également pour moi, la multiplication des personnages qui empêche de creuser véritablement l'aspect psychologique et apporte une grande confusion dans les intrigues, ainsi que dans les scènes de combat.
On peut comprendre la volonté de Claremont de renouveler les X-men en imposant Cable, mais ce personnage demeure des plus discrets sur l'étendue de l'intégrale.
Quant aux Nouveaux mutants, ils ne font que de la figuration...
Et quand on veut mélanger le présent et le futur en ajoutant en prime les 4 Fantastiques, Rachel Summers et Franklin Richards, la confusion monte encore de plusieurs crans...
Heureusement il reste Magnéto et la Terre sauvage pour l'aspect spectaculaire...
Les autres artistes s'en sortent honorablement à l'exception de Simonson et Bogdanove clairement en dessous.
Même si j'aurais adoré aimé cette intégrale pour les colossaux efforts dont elle a fait l'objet, je ne peux me montrer satisfait du résultat qui confirme l'errance de Claremont et de Marvel dans les années 90 !
Lien : https://lediscoursdharnois.b..
Les scénarios de Claremont sont plutot bons et le style graphique de Lee, très puissant (et sexy !) forment une bonne combinaison.
Mais difficile de crier au génie lorsqu'on ressort les histoires de complots Skrulls mixées avec les aventures spatiales des Shi'ar.
Grosse faiblesse également pour moi, la multiplication des personnages qui empêche de creuser véritablement l'aspect psychologique et apporte une grande confusion dans les intrigues, ainsi que dans les scènes de combat.
On peut comprendre la volonté de Claremont de renouveler les X-men en imposant Cable, mais ce personnage demeure des plus discrets sur l'étendue de l'intégrale.
Quant aux Nouveaux mutants, ils ne font que de la figuration...
Et quand on veut mélanger le présent et le futur en ajoutant en prime les 4 Fantastiques, Rachel Summers et Franklin Richards, la confusion monte encore de plusieurs crans...
Heureusement il reste Magnéto et la Terre sauvage pour l'aspect spectaculaire...
Les autres artistes s'en sortent honorablement à l'exception de Simonson et Bogdanove clairement en dessous.
Même si j'aurais adoré aimé cette intégrale pour les colossaux efforts dont elle a fait l'objet, je ne peux me montrer satisfait du résultat qui confirme l'errance de Claremont et de Marvel dans les années 90 !
Lien : https://lediscoursdharnois.b..
Ce tome contient une histoire complète, essentielle dans la continuité et le développement des X-Men, parue en 1986/1987. Il comprend les épisodes suivants : 210 à 214 d'Uncanny X-men (scénario de Chris Claremont, dessins successivement de John Romita junior & Dan Green, JRjr & Bret Blevins, Rick Leonardi & Dan Green, Alan Davis & Paul Neary, Barry Windsor Smith et Bob Wiacek), 9 à 11 de X-Factor (scénario de Louise Simonson, dessins successivement de Terry Shoemaker & Joe Rubinstein, puis Walter Simonson & Bob Wiacek), 46 de New Mutants (scénario de Chris Claremont, dessins de Jackson Guice, encrage de Kyle Baker), 373 & 374 de Mighty Thor (scénario de Walter Simonson, dessins et encrage de Sal Buscema), 27 de Power Pack (scénario de Louise Simonson, dessins de John Bogdanove, encrage d'Al Gordon). Initialement, cette histoire est parue en 1986/1987.
Cette histoire est remarquable à plus d'un titre. Pour commencer il s'agit d'un crossover construit avec une certaine dextérité. Chris Claremont joue le rôle de locomotive pour l'histoire avec la série Uncanny X-Men (en abrégé UXM), Louise Simonson (ancienne responsable éditoriale de la série UXM, sous son nom de jeune fille Louise Jones) raccroche le wagon de X-Factor pour gagner en notoriété avec cette série débutante. Elle en profite pour raccrocher sa deuxième série : Power Pack (Power Pack Classic 1, épisodes 1 à 10). Walter Simonson vient épauler sa femme Louise, avec le titre dont il est le scénariste (Mighty Thor) et en dessinant la série X-Factor. Ann Nocenti (c'est son deuxième épisode en tant que scénariste sur Daredevil, la suite sera nettement meilleure, par exemple Lone stranger, épisodes 265 à 273) s'invite également, en tant que responsable éditoriale de la série UXM. Ces considérations permettent de comprendre comment les enfants de Power pack en viennent à découdre avec le psychopathe Sabretooth, et pourquoi Thor et Daredevil se retrouvent soudain embarqués dans cette histoire de mutants.
Lors de la (re)lecture de cette histoire, ses qualités et son rôle charnière apparaissent pleinement. Chris Claremont dispose encore de plein d'idées neuves pour les personnages qu'il a fait sien et cette équipe dont il dirige la destinée depuis 1975. Au fil des épisodes, le lecteur se rappelle que Magneto est alors directeur de l'école pour surdoués de Westchester (qui accueille l'équipe des New Mutants), qu'Ororo n'a plus ses pouvoirs. Il découvre pour la première fois les Marauders et il apprend l'existence d'un certain Mister Sinister. Il découvre Malice, il apprend que Wolverine et Sabretooth (un personnage encore nouveau à l'époque, en provenance des épisodes d'Iron Fist écrits par Claremont et dessinés par Byrne) se connaissent de longue date. Il voit Betsy Braddock intégrer l'équipe des X-Men (avec son joli costume rose pâle). De son coté Louise Simonson essaye de récupérer comme elle peut le concept de départ calamiteux de la série X-Factor (les 5 premiers X-Men qui se font passer pour des chasseurs de mutants, attisant ainsi le racisme envers les mutants, ne cherchez pas, c'est aussi idiot que ça en a l'air). Contre toute attente (alors qu'il s'agit de ses débuts de scénariste), elle réussit à faire ressortir l'étrangeté de la situation par le biais de Jean Grey qui revient d'un coma prolongé.
Au-delà de cette phase historique de l'équipe des X-Men, la locomotive Claremont a senti le vent tourner : il sait que le lectorat vieillit et qu'il doit écrire des récits plus sombres. De ce coté là, le lecteur est servi : une épuration ethnique par le biais d'exécution de sang froid, et des héros tuant leur adversaire faute d'autre solution. En vrai scénariste, Claremont raconte une vraie histoire, pas simplement une suite de scènes de carnage. Lorsque Colossus tue l'un des Marauders, ce n'est pas une scène choc n'ayant de valeur que pour la case de l'exécution. C'est un véritable traumatisme, un reniement d'une des valeurs fondamentales de Piotr Rasputin qui est confronté à un individu dont les agissements dépassent son entendement. Lorsque des X-Men sont blessés, ils ne guérissent pas entre 2 épisodes. Le niveau de souffrance des personnages est à la hauteur de l'abomination de l'extermination mise en scène. Les époux Simonson ne sont pas en reste avec la torture infligée à Angel (Warren Worthington), ou la blessure de Thor. La violence et les blessures ne sont pas édulcorées ou réduites à l'état de ressort dramatique gratuit, il y a une vraie souffrance avec des répercussions à long terme. Dans l'épisode des New Mutants, Claremont décrit l'installation de l'hôpital de fortune, la pression subie par les New Mutants s'occupant de la logistique, et le dénuement des victimes. On est très loin de la violence glorifiée comme simple dispositif de divertissement.
Bien sûr parmi ces 12 épisodes, certains ressortent comme des pièces rapportées. Les 2 premiers épisodes de X-Factor sont assez indigestes à lire parce Louise Simonson s'applique de manière besogneuse pour tout expliquer, dans un style lourd et dépourvu d'émotion. Ça va mieux pour le troisième épisode. La présence des enfants de Power Pack semble totalement déplacée parce qu'il s'agit d'une série destinée à un lectorat plus jeune, trop en décalage avec cette épuration sadique. Le cas de Walter Simonson est un peu différent : le rythme de son scénario est plus fluide, par contre il écrit d'une manière vieillotte (déjà pour l'époque), trop proche de celle de Stan Lee. Malgré tout l'ensemble dépeint un événement horrifiant de grande ampleur en donnant plusieurs points de vue complémentaires.
Sur le plan visuel, Simonson semble dessiner un peu vite, avec une apparence très dynamique, mais là aussi une approche encore légèrement teintée d'une vision enfantine. Les dessins de Bogdanove transcrivent gentiment les aventures du Power Pack, pour une apparence plus douce, plus adaptée à ce lectorat plus jeune. Le meilleur se trouve donc dans les épisodes de la série UXM. La mise en page de Romita junior est très vivante et Dan Green, comme Blevins apporte une texture un peu coupante aux dessins qui illustrent bien le ton cruel du récit. L'épisode dessiné par Leonardi n'est pas très joli à regarder (comme celui de Shoemaker). Betsy Braddock affronte Sabretooth dans des dessins vifs et très jolis, tout en rondeurs, de Davis et Neary. D'un coté, c'est visuellement très mignon (et donc peu raccord avec l'animalité de Sabretooth). De l'autre, cet aspect un peu jovial retranscrit bien le refus de Claremont de se vautrer dans une narration se complaisant dans une violence facile, et préférant mettre en avant le travail d'équipe, et des valeurs humanistes. Oui, Betsy est ridicule dans sa robe rose et ses petits talons ; oui elle n'en est que plus admirable dans son courage. Le tome se clôt avec l'incroyable prestation de Barry Windsor Smith. À cette époque il réalise 1 épisode des X-Men de temps à autre : épisodes 53, 186, 198, 205 et 214). Il ne s'agit pas du plus beau car il ne s'encre pas lui-même et il ne fait la mise en couleurs. Malgré cela, la maîtrise et l'inventivité graphique de Windsor Smith éclatent par comparaison avec les prédécesseurs. Au lieu de jouer dans le registre du réalisme sanguinolent, il met magnifiquement en valeur les superpouvoirs des mutants, mais aussi leurs émotions, un vrai régal.
D'un coté cette histoire est plombée par quelques épisodes à la narration maladroite (même pour l'époque), et par l'aspect hétérogène des différentes séries. De l'autre, Chris Claremont raconte un récit qui marque la fin de l'innocence pour les X-Men, avec une plongée dans un massacre écœurant, et des cicatrices aussi bien physiques que psychologiques qui ne s'effaceront pas de sitôt, à l'opposé des récits où seul l'effet choc compte. Après quelques épisodes plus mineurs, les X-Men luttent contre une invasion démoniaque dans Fall of the mutants. Kitty Pride et Piotr Rasputin pansent leurs plaies avec l'équipe Excalibur.
Cette histoire est remarquable à plus d'un titre. Pour commencer il s'agit d'un crossover construit avec une certaine dextérité. Chris Claremont joue le rôle de locomotive pour l'histoire avec la série Uncanny X-Men (en abrégé UXM), Louise Simonson (ancienne responsable éditoriale de la série UXM, sous son nom de jeune fille Louise Jones) raccroche le wagon de X-Factor pour gagner en notoriété avec cette série débutante. Elle en profite pour raccrocher sa deuxième série : Power Pack (Power Pack Classic 1, épisodes 1 à 10). Walter Simonson vient épauler sa femme Louise, avec le titre dont il est le scénariste (Mighty Thor) et en dessinant la série X-Factor. Ann Nocenti (c'est son deuxième épisode en tant que scénariste sur Daredevil, la suite sera nettement meilleure, par exemple Lone stranger, épisodes 265 à 273) s'invite également, en tant que responsable éditoriale de la série UXM. Ces considérations permettent de comprendre comment les enfants de Power pack en viennent à découdre avec le psychopathe Sabretooth, et pourquoi Thor et Daredevil se retrouvent soudain embarqués dans cette histoire de mutants.
Lors de la (re)lecture de cette histoire, ses qualités et son rôle charnière apparaissent pleinement. Chris Claremont dispose encore de plein d'idées neuves pour les personnages qu'il a fait sien et cette équipe dont il dirige la destinée depuis 1975. Au fil des épisodes, le lecteur se rappelle que Magneto est alors directeur de l'école pour surdoués de Westchester (qui accueille l'équipe des New Mutants), qu'Ororo n'a plus ses pouvoirs. Il découvre pour la première fois les Marauders et il apprend l'existence d'un certain Mister Sinister. Il découvre Malice, il apprend que Wolverine et Sabretooth (un personnage encore nouveau à l'époque, en provenance des épisodes d'Iron Fist écrits par Claremont et dessinés par Byrne) se connaissent de longue date. Il voit Betsy Braddock intégrer l'équipe des X-Men (avec son joli costume rose pâle). De son coté Louise Simonson essaye de récupérer comme elle peut le concept de départ calamiteux de la série X-Factor (les 5 premiers X-Men qui se font passer pour des chasseurs de mutants, attisant ainsi le racisme envers les mutants, ne cherchez pas, c'est aussi idiot que ça en a l'air). Contre toute attente (alors qu'il s'agit de ses débuts de scénariste), elle réussit à faire ressortir l'étrangeté de la situation par le biais de Jean Grey qui revient d'un coma prolongé.
Au-delà de cette phase historique de l'équipe des X-Men, la locomotive Claremont a senti le vent tourner : il sait que le lectorat vieillit et qu'il doit écrire des récits plus sombres. De ce coté là, le lecteur est servi : une épuration ethnique par le biais d'exécution de sang froid, et des héros tuant leur adversaire faute d'autre solution. En vrai scénariste, Claremont raconte une vraie histoire, pas simplement une suite de scènes de carnage. Lorsque Colossus tue l'un des Marauders, ce n'est pas une scène choc n'ayant de valeur que pour la case de l'exécution. C'est un véritable traumatisme, un reniement d'une des valeurs fondamentales de Piotr Rasputin qui est confronté à un individu dont les agissements dépassent son entendement. Lorsque des X-Men sont blessés, ils ne guérissent pas entre 2 épisodes. Le niveau de souffrance des personnages est à la hauteur de l'abomination de l'extermination mise en scène. Les époux Simonson ne sont pas en reste avec la torture infligée à Angel (Warren Worthington), ou la blessure de Thor. La violence et les blessures ne sont pas édulcorées ou réduites à l'état de ressort dramatique gratuit, il y a une vraie souffrance avec des répercussions à long terme. Dans l'épisode des New Mutants, Claremont décrit l'installation de l'hôpital de fortune, la pression subie par les New Mutants s'occupant de la logistique, et le dénuement des victimes. On est très loin de la violence glorifiée comme simple dispositif de divertissement.
Bien sûr parmi ces 12 épisodes, certains ressortent comme des pièces rapportées. Les 2 premiers épisodes de X-Factor sont assez indigestes à lire parce Louise Simonson s'applique de manière besogneuse pour tout expliquer, dans un style lourd et dépourvu d'émotion. Ça va mieux pour le troisième épisode. La présence des enfants de Power Pack semble totalement déplacée parce qu'il s'agit d'une série destinée à un lectorat plus jeune, trop en décalage avec cette épuration sadique. Le cas de Walter Simonson est un peu différent : le rythme de son scénario est plus fluide, par contre il écrit d'une manière vieillotte (déjà pour l'époque), trop proche de celle de Stan Lee. Malgré tout l'ensemble dépeint un événement horrifiant de grande ampleur en donnant plusieurs points de vue complémentaires.
Sur le plan visuel, Simonson semble dessiner un peu vite, avec une apparence très dynamique, mais là aussi une approche encore légèrement teintée d'une vision enfantine. Les dessins de Bogdanove transcrivent gentiment les aventures du Power Pack, pour une apparence plus douce, plus adaptée à ce lectorat plus jeune. Le meilleur se trouve donc dans les épisodes de la série UXM. La mise en page de Romita junior est très vivante et Dan Green, comme Blevins apporte une texture un peu coupante aux dessins qui illustrent bien le ton cruel du récit. L'épisode dessiné par Leonardi n'est pas très joli à regarder (comme celui de Shoemaker). Betsy Braddock affronte Sabretooth dans des dessins vifs et très jolis, tout en rondeurs, de Davis et Neary. D'un coté, c'est visuellement très mignon (et donc peu raccord avec l'animalité de Sabretooth). De l'autre, cet aspect un peu jovial retranscrit bien le refus de Claremont de se vautrer dans une narration se complaisant dans une violence facile, et préférant mettre en avant le travail d'équipe, et des valeurs humanistes. Oui, Betsy est ridicule dans sa robe rose et ses petits talons ; oui elle n'en est que plus admirable dans son courage. Le tome se clôt avec l'incroyable prestation de Barry Windsor Smith. À cette époque il réalise 1 épisode des X-Men de temps à autre : épisodes 53, 186, 198, 205 et 214). Il ne s'agit pas du plus beau car il ne s'encre pas lui-même et il ne fait la mise en couleurs. Malgré cela, la maîtrise et l'inventivité graphique de Windsor Smith éclatent par comparaison avec les prédécesseurs. Au lieu de jouer dans le registre du réalisme sanguinolent, il met magnifiquement en valeur les superpouvoirs des mutants, mais aussi leurs émotions, un vrai régal.
D'un coté cette histoire est plombée par quelques épisodes à la narration maladroite (même pour l'époque), et par l'aspect hétérogène des différentes séries. De l'autre, Chris Claremont raconte un récit qui marque la fin de l'innocence pour les X-Men, avec une plongée dans un massacre écœurant, et des cicatrices aussi bien physiques que psychologiques qui ne s'effaceront pas de sitôt, à l'opposé des récits où seul l'effet choc compte. Après quelques épisodes plus mineurs, les X-Men luttent contre une invasion démoniaque dans Fall of the mutants. Kitty Pride et Piotr Rasputin pansent leurs plaies avec l'équipe Excalibur.
Ce tome est le premier d'une série de 4 qui reprennent des épisodes consacrés à une période très particulière du personnage. Il comprend les épisodes 122 à 125 de la série Superman (écrite par Dan Jurgens, dessinés par Ron Frenz, avec un encrage de Joe Rubinstein), 732 à 734 de la série Action Comics (écrits par David Michelinie, dessinés par Tom Grummett, encrés par Denis Rodier), 545 à 547 de la série Adventures of Superman (écrits par Karl Kesel, dessinés par Scot Eaton et encré par José Marzan, puis dessinés par Stuart Immonen encré par Marzan), 67 à 69 de la série Superman: The man of steel (écrits par Louise Simonson, dessinés par Jon Bogdanove et encrés par Dennis Janke), le numéro annuel 9 de la série Superman (écrit par Dan Jurgens, dessiné par Sean Chen et encré par Brett Breeding). Ils sont initialement parus en 1997.
Dans la cité de Kandor (une cité miniaturisée dans une bouteille) et peuplée de kryptoniens, Ceritak continue de se rebeller en enfreignant la loi. Cerimul (son père, le chef du gouvernement) se voit contraint de le déchoir de ses droits civiques, appliquant la loi de Tolos, étonnement absent lors des actions d'éclat de Ceritak. À Metropolis, Clark Kent est en train de se raser dans la salle de bain, tout en discutant avec Lois Lane son épouse. Ils sont interrompus par des coups frappés à la porte : il s'agit de Dirk Armstrong, un collègue du Daily Planet, qui leur apporte des doughnuts. Clark entend des coups de feu dans la rue : Lois met fermement Armstrong à la porte. Superman intervient pour neutraliser des individus cagoulés armés, mais à sa grande surprise les balles traversent son corps, manquant de peu des civils. Superman décide de se rendre à sa forteresse de solitude en Antarctique en y emmenant pour la première fois Lois Lane. De manière inattendue, Superman se retrouve aspiré dans la bouteille de Kandor après être devenu intangible, puis en est expulsé de manière tout aussi inexplicable. Ceritak est également expulsé mais à l'extérieur de la forteresse, à l'insu de Lois & Clark.
De retour à Metropolis, Clark Kent souffre à nouveau de troubles de la tangibilité et son corps émet parfois des décharges électriques incontrôlées. Il doit affronter Atomic Skull (Joseph Martin) et une décharge d'énergie du supercriminel semble dissiper Superman, laissant Lois Lane seule face à lui. Pendant ce temps-là, Ceritak commence son périple pour gagner Metropolis où se trouve l'individu dont le nom l'obsède : Superman. Au Daily Planet, Clark Kent perd son poste de responsable éditorial car Perry White effectue son retour, malgré le cancer qui le ronge. Simone D'Neige fait tout ce qu'elle peut pour améliorer les ventes, à commencer par donner le feu vert à une dénigrant Superman, et à chercher à faire licencier Clark Kent, trop souvent absent. De son côté, Jimmy Olsen doit lui aussi faire face à la pression de son chef qui exige des reportages plus musclés pour leur chaîne de télévision, quitte à ce qu'il soit contraint à se mettre en danger pour les réaliser.
La couverture et le titre indiquent clairement que ce recueil et les suivants sont consacrés à une phase de la vie de Superman sortant de l'ordinaire. Déjà en 1993, les responsables éditoriaux des séries Superman avaient réussi un coup extraordinaire avec Death of Superman. Ils avaient donc tout naturellement pérennisé le mode de coordination des 4 séries mensuelles consacrées à Superman : 1 scénariste par série, une parution alternée de manière à ce qu'il y ait un nouvel épisode d'une série mettant en scène Superman chaque semaine, une numérotation séquentielle par le biais d'un numéro dans un petit triangle incrémenté d'un chaque semaine, et des réunions régulières de coordination entre les 4 scénaristes. Dans la postface (un texte de 2 pages), Dan Jurgens rappelle ce mode de parution et explique que l'idée d'un Superman bleu (et un rouge, apparus pour la première fois dans Superman 162 en 1963) avait déjà été proposée à plusieurs reprises par le coloriste Glenn Whitmore, mais qu'à chaque fois le contexte ne s'y prêtait pas. En 1997, les conditions sont réunies pour mettre en œuvre cette idée.
S'il n'a jamais lu d'aventures de Superman de cette époque, le lecteur est frappé par les spécificités de la construction narrative. Pour commencer, la coordination éditoriale entre les scénaristes est de haute volée, car il n'y a pas de hiatus lors du passage d'une série à l'autre, pas d'incohérence, alors que de nombreux personnages se retrouvent d'une semaine à l'autre, à chaque fois dans une autre des 4 séries, à chaque fois écrit par un scénariste différent. Dan Jurgens rappelle que chaque série se focalisait sur un groupe de personnages secondaires différents, avec un angle un peu différent. Mais ici, la transformation progressive de Superman se fait sans solution de continuité d'un épisode d'une série à celui d'une autre, avec une fluidité remarquable. Bien sûr, un lecteur qui découvre ces épisodes sait déjà que cette transformation est passagère. Mais lors de leur parution initiale, le lecteur n'avait aucune idée du temps pendant lequel le personnage serait changé de manière significative. De fait l'histoire complète s'étale sur une cinquantaine d'épisodes, et plus de 6 mois de parution.
Il s'agit d'un récit qui date de 1997/1998, soit plus de 10 ans après la remise à zéro de l'univers partagé DC après Crisis on infinite Earths (1985). La narration n'est plus à destination essentiellement d'enfants ou de jeunes adolescents, mais elle échappe au cynisme de pacotille propre aux années 1990, ainsi qu'aux tics graphiques parfois grotesques de ces années. Le lecteur est frappé par la démarche narrative qui s'attache avant tout à raconter une vraie histoire avec une montée en puissance progressive de la transformation de Superman. Les auteurs respectent les conventions des comics de superhéros en général et de Superman en particulier : au moins un affrontement physique par épisode contre un supercriminel, un altruisme chevillé au corps pour Superman, avec un code moral respectueux de la vie, un amour compréhensif qui unit Lois & Clark, des motivations de supercriminels relativement superficielles, une dramatisation accentuée des émotions et des bouleversements émotionnels, une science-fiction d'anticipation en toc, des apparitions d'autres personnages de l'univers partagé DC. Pour autant, chaque scénariste sait faire passer à sa manière la personnalité des principaux personnages (Clark, Lois, et les seconds rôles). Le parcours de Ceritak est moins manichéen que prévu. Superman doit passer par une phase de découverte et d'apprentissage de sa nouvelle condition, de ses nouveaux pouvoirs. De manière intelligente, il se tourne entre autres vers Ray (Ray Terrill, un superhéros constitué d'énergie) pour bénéficier de son retour expérience. De même, il se fait aider par Atom (Ray Palmer) pour pouvoir accéder à Kandor.
Le lecteur se laisse donc porter par ces aventures hautes en couleur, proposant une version inédite de Superman, ce qui apporte de la nouveauté, sans rien altérer de la personnalité de Clark Kent. Les péripéties sont inventives. Les ennemis sont aussi hauts en couleur. Les valeurs morales sont simples et saines. La dramatisation reste dans des proportions évitant les exagérations grotesques et la situation de plusieurs personnages dépasse la dichotomie bien/mal, pour révéler des ambiguïtés et des possibilités d'évolution. D'un point de vue graphique, le lecteur retrouve l'ordinaire des comics de superhéros, avec un niveau de qualité satisfaisant. Ron Frenz et Tom Grummett réalisent des dessins propres sur eux, descriptifs, avec les exagérations propres aux séquences d'action des comics de superhéros. Ils assurent une narration satisfaisante, claire et lisible pour les séquences en civil, et ils augmentent les effets de dramatisation (cadrages obliques, force des coups portés, manifestation pyrotechnique des superpouvoirs) pour les séquences d'action. Ils réalisent des cases avec un bon niveau de détail, pour une narration qui s'avère assez dense.
Suart Immonen est dans une phase transitoire où il n'a pas encore complètement trouvé le juste équilibre entre l'épure des silhouettes et les aplats de noir fluides et élégants. En fonction des pages, les cases peuvent apparaître comme manquant un peu de consistance, ou déjà très réussies sur un plan esthétique. La comparaison avec les épisodes illustrés par Frenz ou Grummett s'effectue en défaveur d'Immonen du fait de la diminution de la quantité d'informations visuelles dans la description. Les épisodes dessinés par Jon Bogdnanove tranchent avec les autres. Il dessine dans un registre moins réaliste, avec des exagérations des silhouettes, des postures et des mouvements. Il faut un peu de temps pour se rendre compte qu'il ne s'inscrit pas la mouvance des dessinateurs des années 1990, tout en épate et en esbroufe avec des personnages poseurs à la moindre occasion, mais plus dans l'héritage de Jack Kirby. En fonction de sa sensibilité, le lecteur peut regretter que Bogdanove ne s'astreigne pas à rester dans le même registre descriptif passe-partout, ou au contraire apprécier la force qui se dégage de ses pages.
Le tome se termine par un numéro annuel dont le thème était de réaliser un récit dans l'esprit des pulps. Dan Jurgens s'acquitte de sa tâche avec une histoire de culte situé dans le pays fictif du Bhutran, en utilisant les conventions datées du récit d'aventure et d'exploration, avec une touche de surnaturel. Les dessins de Sean Chen sont descriptifs à souhait et plus minutieux que ceux de Frenz et de Grummett. Il s'agit donc d'une aventure rapide qui met surtout en évidence que les histoires de superhéros utilisent toujours les conventions des pulps, et que les 2 ne sont même pas séparés par une mince barrière.
Sous réserve d'avoir à l'esprit le contexte de la parution de ces épisodes, le lecteur prend plaisir à se laisser porter par une histoire qui bouscule le statu quo du personnage de Superman, en changeant son costume et ses pouvoirs, tout en respectant les fondamentaux du personnage de Clark Kent, en mettant en scène des seconds rôles sympathiques, avec une narration visuelle à la fois convenue et conformes au cahier des charges des comics de superhéros mensuels de DC. Les scénaristes ne prétendent pas révolutionner le genre, ou réaliser une œuvre d'auteur. Leur honnêteté dans leur démarche et l'absence même de prétention participent à rendre la lecture très agréable, sans être indispensable.
Dans la cité de Kandor (une cité miniaturisée dans une bouteille) et peuplée de kryptoniens, Ceritak continue de se rebeller en enfreignant la loi. Cerimul (son père, le chef du gouvernement) se voit contraint de le déchoir de ses droits civiques, appliquant la loi de Tolos, étonnement absent lors des actions d'éclat de Ceritak. À Metropolis, Clark Kent est en train de se raser dans la salle de bain, tout en discutant avec Lois Lane son épouse. Ils sont interrompus par des coups frappés à la porte : il s'agit de Dirk Armstrong, un collègue du Daily Planet, qui leur apporte des doughnuts. Clark entend des coups de feu dans la rue : Lois met fermement Armstrong à la porte. Superman intervient pour neutraliser des individus cagoulés armés, mais à sa grande surprise les balles traversent son corps, manquant de peu des civils. Superman décide de se rendre à sa forteresse de solitude en Antarctique en y emmenant pour la première fois Lois Lane. De manière inattendue, Superman se retrouve aspiré dans la bouteille de Kandor après être devenu intangible, puis en est expulsé de manière tout aussi inexplicable. Ceritak est également expulsé mais à l'extérieur de la forteresse, à l'insu de Lois & Clark.
De retour à Metropolis, Clark Kent souffre à nouveau de troubles de la tangibilité et son corps émet parfois des décharges électriques incontrôlées. Il doit affronter Atomic Skull (Joseph Martin) et une décharge d'énergie du supercriminel semble dissiper Superman, laissant Lois Lane seule face à lui. Pendant ce temps-là, Ceritak commence son périple pour gagner Metropolis où se trouve l'individu dont le nom l'obsède : Superman. Au Daily Planet, Clark Kent perd son poste de responsable éditorial car Perry White effectue son retour, malgré le cancer qui le ronge. Simone D'Neige fait tout ce qu'elle peut pour améliorer les ventes, à commencer par donner le feu vert à une dénigrant Superman, et à chercher à faire licencier Clark Kent, trop souvent absent. De son côté, Jimmy Olsen doit lui aussi faire face à la pression de son chef qui exige des reportages plus musclés pour leur chaîne de télévision, quitte à ce qu'il soit contraint à se mettre en danger pour les réaliser.
La couverture et le titre indiquent clairement que ce recueil et les suivants sont consacrés à une phase de la vie de Superman sortant de l'ordinaire. Déjà en 1993, les responsables éditoriaux des séries Superman avaient réussi un coup extraordinaire avec Death of Superman. Ils avaient donc tout naturellement pérennisé le mode de coordination des 4 séries mensuelles consacrées à Superman : 1 scénariste par série, une parution alternée de manière à ce qu'il y ait un nouvel épisode d'une série mettant en scène Superman chaque semaine, une numérotation séquentielle par le biais d'un numéro dans un petit triangle incrémenté d'un chaque semaine, et des réunions régulières de coordination entre les 4 scénaristes. Dans la postface (un texte de 2 pages), Dan Jurgens rappelle ce mode de parution et explique que l'idée d'un Superman bleu (et un rouge, apparus pour la première fois dans Superman 162 en 1963) avait déjà été proposée à plusieurs reprises par le coloriste Glenn Whitmore, mais qu'à chaque fois le contexte ne s'y prêtait pas. En 1997, les conditions sont réunies pour mettre en œuvre cette idée.
S'il n'a jamais lu d'aventures de Superman de cette époque, le lecteur est frappé par les spécificités de la construction narrative. Pour commencer, la coordination éditoriale entre les scénaristes est de haute volée, car il n'y a pas de hiatus lors du passage d'une série à l'autre, pas d'incohérence, alors que de nombreux personnages se retrouvent d'une semaine à l'autre, à chaque fois dans une autre des 4 séries, à chaque fois écrit par un scénariste différent. Dan Jurgens rappelle que chaque série se focalisait sur un groupe de personnages secondaires différents, avec un angle un peu différent. Mais ici, la transformation progressive de Superman se fait sans solution de continuité d'un épisode d'une série à celui d'une autre, avec une fluidité remarquable. Bien sûr, un lecteur qui découvre ces épisodes sait déjà que cette transformation est passagère. Mais lors de leur parution initiale, le lecteur n'avait aucune idée du temps pendant lequel le personnage serait changé de manière significative. De fait l'histoire complète s'étale sur une cinquantaine d'épisodes, et plus de 6 mois de parution.
Il s'agit d'un récit qui date de 1997/1998, soit plus de 10 ans après la remise à zéro de l'univers partagé DC après Crisis on infinite Earths (1985). La narration n'est plus à destination essentiellement d'enfants ou de jeunes adolescents, mais elle échappe au cynisme de pacotille propre aux années 1990, ainsi qu'aux tics graphiques parfois grotesques de ces années. Le lecteur est frappé par la démarche narrative qui s'attache avant tout à raconter une vraie histoire avec une montée en puissance progressive de la transformation de Superman. Les auteurs respectent les conventions des comics de superhéros en général et de Superman en particulier : au moins un affrontement physique par épisode contre un supercriminel, un altruisme chevillé au corps pour Superman, avec un code moral respectueux de la vie, un amour compréhensif qui unit Lois & Clark, des motivations de supercriminels relativement superficielles, une dramatisation accentuée des émotions et des bouleversements émotionnels, une science-fiction d'anticipation en toc, des apparitions d'autres personnages de l'univers partagé DC. Pour autant, chaque scénariste sait faire passer à sa manière la personnalité des principaux personnages (Clark, Lois, et les seconds rôles). Le parcours de Ceritak est moins manichéen que prévu. Superman doit passer par une phase de découverte et d'apprentissage de sa nouvelle condition, de ses nouveaux pouvoirs. De manière intelligente, il se tourne entre autres vers Ray (Ray Terrill, un superhéros constitué d'énergie) pour bénéficier de son retour expérience. De même, il se fait aider par Atom (Ray Palmer) pour pouvoir accéder à Kandor.
Le lecteur se laisse donc porter par ces aventures hautes en couleur, proposant une version inédite de Superman, ce qui apporte de la nouveauté, sans rien altérer de la personnalité de Clark Kent. Les péripéties sont inventives. Les ennemis sont aussi hauts en couleur. Les valeurs morales sont simples et saines. La dramatisation reste dans des proportions évitant les exagérations grotesques et la situation de plusieurs personnages dépasse la dichotomie bien/mal, pour révéler des ambiguïtés et des possibilités d'évolution. D'un point de vue graphique, le lecteur retrouve l'ordinaire des comics de superhéros, avec un niveau de qualité satisfaisant. Ron Frenz et Tom Grummett réalisent des dessins propres sur eux, descriptifs, avec les exagérations propres aux séquences d'action des comics de superhéros. Ils assurent une narration satisfaisante, claire et lisible pour les séquences en civil, et ils augmentent les effets de dramatisation (cadrages obliques, force des coups portés, manifestation pyrotechnique des superpouvoirs) pour les séquences d'action. Ils réalisent des cases avec un bon niveau de détail, pour une narration qui s'avère assez dense.
Suart Immonen est dans une phase transitoire où il n'a pas encore complètement trouvé le juste équilibre entre l'épure des silhouettes et les aplats de noir fluides et élégants. En fonction des pages, les cases peuvent apparaître comme manquant un peu de consistance, ou déjà très réussies sur un plan esthétique. La comparaison avec les épisodes illustrés par Frenz ou Grummett s'effectue en défaveur d'Immonen du fait de la diminution de la quantité d'informations visuelles dans la description. Les épisodes dessinés par Jon Bogdnanove tranchent avec les autres. Il dessine dans un registre moins réaliste, avec des exagérations des silhouettes, des postures et des mouvements. Il faut un peu de temps pour se rendre compte qu'il ne s'inscrit pas la mouvance des dessinateurs des années 1990, tout en épate et en esbroufe avec des personnages poseurs à la moindre occasion, mais plus dans l'héritage de Jack Kirby. En fonction de sa sensibilité, le lecteur peut regretter que Bogdanove ne s'astreigne pas à rester dans le même registre descriptif passe-partout, ou au contraire apprécier la force qui se dégage de ses pages.
Le tome se termine par un numéro annuel dont le thème était de réaliser un récit dans l'esprit des pulps. Dan Jurgens s'acquitte de sa tâche avec une histoire de culte situé dans le pays fictif du Bhutran, en utilisant les conventions datées du récit d'aventure et d'exploration, avec une touche de surnaturel. Les dessins de Sean Chen sont descriptifs à souhait et plus minutieux que ceux de Frenz et de Grummett. Il s'agit donc d'une aventure rapide qui met surtout en évidence que les histoires de superhéros utilisent toujours les conventions des pulps, et que les 2 ne sont même pas séparés par une mince barrière.
Sous réserve d'avoir à l'esprit le contexte de la parution de ces épisodes, le lecteur prend plaisir à se laisser porter par une histoire qui bouscule le statu quo du personnage de Superman, en changeant son costume et ses pouvoirs, tout en respectant les fondamentaux du personnage de Clark Kent, en mettant en scène des seconds rôles sympathiques, avec une narration visuelle à la fois convenue et conformes au cahier des charges des comics de superhéros mensuels de DC. Les scénaristes ne prétendent pas révolutionner le genre, ou réaliser une œuvre d'auteur. Leur honnêteté dans leur démarche et l'absence même de prétention participent à rendre la lecture très agréable, sans être indispensable.
La fin de l'aventure face au club des Damnés/Nemrod/Spirale... une page se tourne et sans que nous nous en rendions compte une aire de grand bouleversement vient de débuter pour les X-men et pour toutes les franchises mutantes de l'époque - X-factor et New Mutants.
On aime : la saga présente dans ce tome, à savoir "le massacre des mutants", premier crossover de l'histoire des équipes X (et au delà...). C'est fort, ça bouleverse le statut quo (et cela aura des répercussions jusqu'à la fin de l'arc "fall of the mutants" en 1988...).
On n'aime moins : les différences de niveau entre les différentes séries....
On termine ce volume sur une note beaucoup plus douce avec un annual qui vaut le détour ! et j'adore les dessins d'Arthur Adams !
On aime : la saga présente dans ce tome, à savoir "le massacre des mutants", premier crossover de l'histoire des équipes X (et au delà...). C'est fort, ça bouleverse le statut quo (et cela aura des répercussions jusqu'à la fin de l'arc "fall of the mutants" en 1988...).
On n'aime moins : les différences de niveau entre les différentes séries....
On termine ce volume sur une note beaucoup plus douce avec un annual qui vaut le détour ! et j'adore les dessins d'Arthur Adams !
Ce tome contient les 6 épisodes de la minisérie du même nom, initialement parus en 1999/2000. Le scénario est de Louise Simonson. Jon J. Muth a réalisé les esquisses (mise en page + crayonnés rapides) du premier épisode, John Buscema a réalisé celles des épisodes 2 à 6. Bill Sienkiewicz a réalisé les finitions, ainsi que l'encrage des esquisses des 6 épisodes. La mise en couleurs a été faite par Christie Scheele.
Dans les confins de l'espace, Galactus dévore une planète (oui, c'est vrai, ce n'est pas vraiment une nouveauté). Depuis quelques temps, il ne se nourrit plus de l'énergie de la planète elle-même (quoi que cela puisse vouloir dire), mais il absorbe l'énergie vitale des êtres dotés de conscience (quoi que cela puisse vouloir dire). Il dispose d'un nouveau héraut Red Shift qui lui trouve des planètes habitées par des êtres doués d'intelligence, sans aucun remord ou arrière pensée.
Sur Terre, Alicia Masters prépare une nouvelle exposition de ses sculptures. Le jour de l'inauguration, des secousses mettent en péril l'immeuble accueillant l'exposition. Silver Surfer (Norrin Radd) et Thing (Ben Grimm) découvrent qu'il s'agit d'une attaque de diversion perpétrée par l'Homme Taupe (Harvey Rupert Elder) pendant qu'il dérobe une station d'épuration. À cette occasion, Alicia Masters découvre qu'elle peut encore utiliser l'armure qui lui a été offerte par une race extraterrestre et qui lui rend artificiellement la vue.
Red Shift amène Galactus vers la Terre pour qu'il se nourrisse de l'énergie vitale des humains. Suite à l'affrontement contre Red Shift, les errements de SIlver Surfer l'amène auprès de Mantis (Mandy Celestine), la Madonne Céleste.
Dès les premières pages, le lecteur se rend compte qu'il a plongé dans un comics à la narration datée, à destination d'un lectorat qui avait besoin qu'on lui mette les points sur les "i" et les barres aux "t". C'est le retour des bulles de pensée, des personnages qui parlent tout seul tout fort pour dire ce qu'ils pensent ou pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Le langage corporel est systématiquement exagéré, et les individus s'expriment avec une emphase qui se veut shakespearienne, mais qui apparaît surtout forcée et ridicule.
En 2000, depuis plusieurs années, Sienkiewicz a arrêté de dessiner des comics, et surtout de réaliser le découpage en cases et la mise en place des personnages. Par contre, il réalise régulièrement l'encrage de dessins d'autres artistes. Il a adopté un rendu un peu griffé qui confère une sorte de spontanéité et d'âpreté aux dessins. Il n'y a pas de jolies courbes, ou de déliés gracieux ; il y a des contours irréguliers, des ombrages déchiquetés.
Pour les épisodes 2 à 6, le lecteur retrouve quelques pauses usuelles de John Buscema, des mouvements gracieux, des bouches grandes ouvertes qui prouvent que c'est bien lui qui a réalisé les esquisses. Il constate aussi une absence très régulière des arrières plans, et qu'ils sont relativement simplistes quand ils existent, Buscema recyclant les mêmes visions qu'il a servies dans les décennies précédentes. Jon J. Muth est un artiste d'exception qui est apparu dans le monde des comics avec Moonshadow écrit par JM DeMatteis, et qui a réalisé plusieurs livres pour enfants absolument magnifiques comme Les trois questions. Il avait déjà illustré une aventure de superhéros (Havok et Wolverine) avec Kent Williams : Meltdown. Leur sensibilité était en totale inadéquation avec l'histoire d'aventures pleines de bruit et de fureur concoctée par Walter Simonson. Pour ce premier épisode, le décalage est moins important, mais l'apport de Jon J. Muth est indiscernable, et la finition de Sienkiewicz écrase la personnalité de Muth, jusqu'à la faire disparaître.
Muth et Buscema s'appliquent pour respecter les costumes des différents personnages, en phase avec la continuité de l'époque. Toutefois ni l'un ni l'autre ne peut rendre visuellement attractive l'armure idiote d'Alicia Masters. Ils sont cependant plus professionnels que Christie Scheele qui n'arrive pas à se souvenir des particularités des personnages qu'elle met en couleur, Hepzibah finissant par avoir une peau rose d'être humain, alors qu'il s'agit d'une créature chat avec un pelage blanc.
Louise Simonson a conçu un récit qui prend grand soin de s'insérer dans la continuité de l'époque, accrochant ainsi cette aventure dans l'histoire des différents personnages. Mais 15 ans plus tard, l'importance de ces points de détail dans la continuité revêt un intérêt très relatif. Sa façon d'écrire le Silver Surfer rend hommage aux transports émotionnels qu'il connaissait sous la plume de Stan Lee (voir Marvel Masterworks: The Silver Surfer 1), une âme tourmentée par ses obligations envers son devoir, ce dernier étant incompatible avec son bonheur. De ce point de vue son interprétation du personnage est un hommage servile, un ersatz. Le récit recèle également quelques moments d'une grande naïveté, tel que Mole Man dérobant une station d'épuration pour l'implanter dans son royaume souterrain (ça ne va pas être facile à raccorder).
L'intrigue repose pourtant sur un postulat intéressant : Galactus ne mange plus pour vivre, il a commencé à vivre pour manger, et il est devenu dépendant de l'énergie des êtres vivants, bien qu'elle ne le sustente pas. Galactus est accro à la junk food. Malheureusement, ce thème n'est jamais développé. Au lieu d'une allégorie sur l'humanité dévorante, se gavant de malbouffe au pris de l'avenir de sa propre planète, Simonson préfère s'appesantir sur le paradoxe idiot qui a conduit Reed Richards à sauver la vie de Galactus pour une raison tellement énorme que personne n'a pu la retenir (si vous ne le croyez pas, plongez vous dans The trial of Galactus). Pourtant il est possible de déceler un ou deux frémissements quand les superhéros sont attablés en train de manger. Sous la plume de Simonson, il ne s'agit que d'un événement anodin, qu'elle ne met pas en parallèle avec l'appétit incontrôlable de Galactus. Impossible de déterminer s'il s'agit d'un manque d'a propos, d'une faute d'étourderie, ou qu'elle n'a pas pris conscience de ce que lui soufflait son inconscient ou sa muse.
Le vieux lecteur de comics, par l'affiche alléché, pouvait espérer découvrir un récit relativement indépendant dans lequel John Buscema aurait pu s'illustrer en ayant disposé de temps et d'un encrage moderne. Il découvre un récit à la narration datée, à l'intrigue poussive, et aux dessins rapidement exécutés. L'encrage de Sienkiewicz est très personnel, mais pas forcément le plus adapté pour mettre en valeurs les courbes harmonieuses créées par John Buscema.
Dans les confins de l'espace, Galactus dévore une planète (oui, c'est vrai, ce n'est pas vraiment une nouveauté). Depuis quelques temps, il ne se nourrit plus de l'énergie de la planète elle-même (quoi que cela puisse vouloir dire), mais il absorbe l'énergie vitale des êtres dotés de conscience (quoi que cela puisse vouloir dire). Il dispose d'un nouveau héraut Red Shift qui lui trouve des planètes habitées par des êtres doués d'intelligence, sans aucun remord ou arrière pensée.
Sur Terre, Alicia Masters prépare une nouvelle exposition de ses sculptures. Le jour de l'inauguration, des secousses mettent en péril l'immeuble accueillant l'exposition. Silver Surfer (Norrin Radd) et Thing (Ben Grimm) découvrent qu'il s'agit d'une attaque de diversion perpétrée par l'Homme Taupe (Harvey Rupert Elder) pendant qu'il dérobe une station d'épuration. À cette occasion, Alicia Masters découvre qu'elle peut encore utiliser l'armure qui lui a été offerte par une race extraterrestre et qui lui rend artificiellement la vue.
Red Shift amène Galactus vers la Terre pour qu'il se nourrisse de l'énergie vitale des humains. Suite à l'affrontement contre Red Shift, les errements de SIlver Surfer l'amène auprès de Mantis (Mandy Celestine), la Madonne Céleste.
Dès les premières pages, le lecteur se rend compte qu'il a plongé dans un comics à la narration datée, à destination d'un lectorat qui avait besoin qu'on lui mette les points sur les "i" et les barres aux "t". C'est le retour des bulles de pensée, des personnages qui parlent tout seul tout fort pour dire ce qu'ils pensent ou pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Le langage corporel est systématiquement exagéré, et les individus s'expriment avec une emphase qui se veut shakespearienne, mais qui apparaît surtout forcée et ridicule.
En 2000, depuis plusieurs années, Sienkiewicz a arrêté de dessiner des comics, et surtout de réaliser le découpage en cases et la mise en place des personnages. Par contre, il réalise régulièrement l'encrage de dessins d'autres artistes. Il a adopté un rendu un peu griffé qui confère une sorte de spontanéité et d'âpreté aux dessins. Il n'y a pas de jolies courbes, ou de déliés gracieux ; il y a des contours irréguliers, des ombrages déchiquetés.
Pour les épisodes 2 à 6, le lecteur retrouve quelques pauses usuelles de John Buscema, des mouvements gracieux, des bouches grandes ouvertes qui prouvent que c'est bien lui qui a réalisé les esquisses. Il constate aussi une absence très régulière des arrières plans, et qu'ils sont relativement simplistes quand ils existent, Buscema recyclant les mêmes visions qu'il a servies dans les décennies précédentes. Jon J. Muth est un artiste d'exception qui est apparu dans le monde des comics avec Moonshadow écrit par JM DeMatteis, et qui a réalisé plusieurs livres pour enfants absolument magnifiques comme Les trois questions. Il avait déjà illustré une aventure de superhéros (Havok et Wolverine) avec Kent Williams : Meltdown. Leur sensibilité était en totale inadéquation avec l'histoire d'aventures pleines de bruit et de fureur concoctée par Walter Simonson. Pour ce premier épisode, le décalage est moins important, mais l'apport de Jon J. Muth est indiscernable, et la finition de Sienkiewicz écrase la personnalité de Muth, jusqu'à la faire disparaître.
Muth et Buscema s'appliquent pour respecter les costumes des différents personnages, en phase avec la continuité de l'époque. Toutefois ni l'un ni l'autre ne peut rendre visuellement attractive l'armure idiote d'Alicia Masters. Ils sont cependant plus professionnels que Christie Scheele qui n'arrive pas à se souvenir des particularités des personnages qu'elle met en couleur, Hepzibah finissant par avoir une peau rose d'être humain, alors qu'il s'agit d'une créature chat avec un pelage blanc.
Louise Simonson a conçu un récit qui prend grand soin de s'insérer dans la continuité de l'époque, accrochant ainsi cette aventure dans l'histoire des différents personnages. Mais 15 ans plus tard, l'importance de ces points de détail dans la continuité revêt un intérêt très relatif. Sa façon d'écrire le Silver Surfer rend hommage aux transports émotionnels qu'il connaissait sous la plume de Stan Lee (voir Marvel Masterworks: The Silver Surfer 1), une âme tourmentée par ses obligations envers son devoir, ce dernier étant incompatible avec son bonheur. De ce point de vue son interprétation du personnage est un hommage servile, un ersatz. Le récit recèle également quelques moments d'une grande naïveté, tel que Mole Man dérobant une station d'épuration pour l'implanter dans son royaume souterrain (ça ne va pas être facile à raccorder).
L'intrigue repose pourtant sur un postulat intéressant : Galactus ne mange plus pour vivre, il a commencé à vivre pour manger, et il est devenu dépendant de l'énergie des êtres vivants, bien qu'elle ne le sustente pas. Galactus est accro à la junk food. Malheureusement, ce thème n'est jamais développé. Au lieu d'une allégorie sur l'humanité dévorante, se gavant de malbouffe au pris de l'avenir de sa propre planète, Simonson préfère s'appesantir sur le paradoxe idiot qui a conduit Reed Richards à sauver la vie de Galactus pour une raison tellement énorme que personne n'a pu la retenir (si vous ne le croyez pas, plongez vous dans The trial of Galactus). Pourtant il est possible de déceler un ou deux frémissements quand les superhéros sont attablés en train de manger. Sous la plume de Simonson, il ne s'agit que d'un événement anodin, qu'elle ne met pas en parallèle avec l'appétit incontrôlable de Galactus. Impossible de déterminer s'il s'agit d'un manque d'a propos, d'une faute d'étourderie, ou qu'elle n'a pas pris conscience de ce que lui soufflait son inconscient ou sa muse.
Le vieux lecteur de comics, par l'affiche alléché, pouvait espérer découvrir un récit relativement indépendant dans lequel John Buscema aurait pu s'illustrer en ayant disposé de temps et d'un encrage moderne. Il découvre un récit à la narration datée, à l'intrigue poussive, et aux dessins rapidement exécutés. L'encrage de Sienkiewicz est très personnel, mais pas forcément le plus adapté pour mettre en valeurs les courbes harmonieuses créées par John Buscema.
À l'origine, ces épisodes sont parus en 92 et 93. À l'époque il y avait quatre titres mensuels de Superman (Superman, Action Comics, Man of Steel et Adventures of Superman). Chaque mois, les épisodes correspondants portait un petit triangle jaune avec un numéro pour que les fans sachent dans quel ordre les lire, les 4 titres étant interdépendants avec une continuité très resserrée. Ce recueil comprend deux mois de parution (soit 8 épisodes, 2 de chaque titre, ainsi qu'un épisode de la JLA. Dan Jurgens signe à lui tout seul les dessins et les scénarios de 3 épisodes.
L'histoire est très simple. Un monstre d'une puissance terrifiante s'échappe d'un lieu mystérieux où il était retenu prisonnier et il se dirige vers Metropolis pour des raisons inconnues. Pendant 9 épisodes Superman et la JLA vont tenter d'arrêter son inexorable progression.
Le scénario est construit crescendo, avec les actes de destruction de Doomsday qui prennent de plus en plus d'ampleur, et Superman qui est de plus en plus inefficace. Aussi linéaire que soit le scénario, l'action reste très prenante. Pour les quatre derniers épisodes les éditeurs ont imposé la mise en page. Le dernier épisode est composé uniquement de pleines pages, pour celui d'avant chaque page ne comporte que 2 cases, celui d'encore avant chaque page ne comporte que 3 cases et celui d'encore avant 4 cases. De même au fur et à mesure de l'avancée de Doomsday, sa combinaison intégrale se déchire révélant à chaque fois un peu plus de sa morphologie.
Coté dessins, on trouve une certaine unité graphique avec les dessins de Dan Jurgens, de Tom Grummet et de Butch Guice dans un style très années 80, propre sur lui, des décors sporadiques sans trop de détails et des expressions corporelles et faciales fortement exagérées. Seul Jon Bogdanove sort vraiment du lot avec un style affirmé, plus éloigné d'un quelconque réalisme que ces collègues, parfois un peu anguleux et caricatural.
L'issue de l'affrontement est clairement annoncée dans le titre et pour autant les affrontements successifs restent intéressants grâce à la progression inexorable du monstre. À l'époque de sa publication le numéro 75 de Superman était sorti sous pellicule noire opaque pour augmenter l'effet marketing. Alors même si cette histoire reste avant tout un coup éditorial, il n'y a pas au fond de raison de bouder son plaisir devant ce divertissement. Le retour de Superman a lui été aussi l'objet d'un traitement et d'une planification éditoriale élaborés et commence dans World Without a Superman, pour s'achever dans The Return of Superman. Et l'ensemble de la saga a été regroupé dans Superman: The Death and Return: Omnibus. Quant aux origines et aux motifs de Doomsday, Dan Jurgens s'en est occupé dans Superman / Doomsday.
L'histoire est très simple. Un monstre d'une puissance terrifiante s'échappe d'un lieu mystérieux où il était retenu prisonnier et il se dirige vers Metropolis pour des raisons inconnues. Pendant 9 épisodes Superman et la JLA vont tenter d'arrêter son inexorable progression.
Le scénario est construit crescendo, avec les actes de destruction de Doomsday qui prennent de plus en plus d'ampleur, et Superman qui est de plus en plus inefficace. Aussi linéaire que soit le scénario, l'action reste très prenante. Pour les quatre derniers épisodes les éditeurs ont imposé la mise en page. Le dernier épisode est composé uniquement de pleines pages, pour celui d'avant chaque page ne comporte que 2 cases, celui d'encore avant chaque page ne comporte que 3 cases et celui d'encore avant 4 cases. De même au fur et à mesure de l'avancée de Doomsday, sa combinaison intégrale se déchire révélant à chaque fois un peu plus de sa morphologie.
Coté dessins, on trouve une certaine unité graphique avec les dessins de Dan Jurgens, de Tom Grummet et de Butch Guice dans un style très années 80, propre sur lui, des décors sporadiques sans trop de détails et des expressions corporelles et faciales fortement exagérées. Seul Jon Bogdanove sort vraiment du lot avec un style affirmé, plus éloigné d'un quelconque réalisme que ces collègues, parfois un peu anguleux et caricatural.
L'issue de l'affrontement est clairement annoncée dans le titre et pour autant les affrontements successifs restent intéressants grâce à la progression inexorable du monstre. À l'époque de sa publication le numéro 75 de Superman était sorti sous pellicule noire opaque pour augmenter l'effet marketing. Alors même si cette histoire reste avant tout un coup éditorial, il n'y a pas au fond de raison de bouder son plaisir devant ce divertissement. Le retour de Superman a lui été aussi l'objet d'un traitement et d'une planification éditoriale élaborés et commence dans World Without a Superman, pour s'achever dans The Return of Superman. Et l'ensemble de la saga a été regroupé dans Superman: The Death and Return: Omnibus. Quant aux origines et aux motifs de Doomsday, Dan Jurgens s'en est occupé dans Superman / Doomsday.
Ce tome contient les épisodes 220 à 227 de la série "Uncanny X-Men" (en abrégé UXM), 340 de "Incredible Hulk", et 55 à 61 de New Mutants, parus en 1987/1988. L'équipe des X-Men se compose de Wolverine, Dazzler (Alison Blair), Longshot, Havok (Alex Summers), Rogue (Anna Marie), et Psylocke (Betsy Braddock). Colossus (Piotr Rasputin) se joint à eux dans les derniers épisodes.
-
UNCANNY X-MEN 200 à 227 (scénario de Chris Claremont, dessins de Marc Silvestri pour les épisodes 220 à 222 & 224 à 227, Kerry Gammill pour 223, avec un encrage ou finitions de Dan Green, sauf pour l'épisode 224 encré par Bob Wiacek) - Storm estime qu'elle doit absolument recouvrer ses pouvoirs (perdus dans Lifedeath, en particulier les épisodes 186 & 198) pour assumer pleinement son rôle de chef des X-Men. Elle a donc entrepris de suivre la trace de Forge (Le faiseur, The Maker) pour qu'il construise un dispositif les rétablissant. Elle commence par se rendre à son dernier domicile connu, un gratte-ciel à Dallas où elle trouve Naze, l'ancien mentor de Forge, également shaman. Ensemble ils remontent sa trace dans les montagnes du Grand Canyon.
De leur coté les X-Men séjournent à San Francisco où ils essayent de défendre Madelyne Pryor contre les Maraudeurs (comprenant Sabretooth et Malice possédant le corps de Polaris, c'est-à-dire Lorna Dane, la compagne d'Alex Summers). Ils sont ensuite attaqués par l'équipe gouvernementale Freedom Force (composée de Pyro, Blob, Mystique, Spiral, Avalanche, Crimson Commando, Stonewall, Super Sabre, et Destiny, avec leur agent de liaison Valerie Cooper).
"Fall of Mutants" se compose de 3 histoires distinctes et indépendantes se déroulant concomitamment : celle des X-Men, celle des New Mutants et celle de X-Factor. Le précédent événement de grande ampleur pour les X-Men se trouve dans Mutant massacre (épisodes 210 à 214 d'Uncanny X-men, 9 à 11 de X-Factor, 46 de New Mutants, 373 & 374 de Mighty Thor, 27 de Power Pack, et 238 de Daredevil).
Chris Claremont a bâti son récit en crescendo, sur 2 fils narratifs se rejoignant dans le dernier épisode. Il y a tout d'abord le parcours initiatique d'Ororo, aux cotés de Naze, pour retrouver l'homme qui l'a trahie, et peut-être ses pouvoirs de mutante. Claremont ne s'est pas facilité la tâche dans la mesure où il a désamorcé tout suspense en révélant dès le départ que Naze est posséder par l'Adversaire. Du coup, les dialogues entre Ororo et lui perdent beaucoup d'intérêt, d'autant plus que les manœuvres de Naze pour la manipuler sont infantiles et transparentes du début jusqu'à la fin.
Claremont a bien du mal à expliquer de manière convaincante pourquoi l'Adversaire ne l'élimine pas purement et simplement une fois qu'elle a rempli son office. Le lecteur doit donc supporter des pages d'échanges creux et artificiels (d'autant plus qu'on est encore à une époque où les personnages se parlent à eux-mêmes à haute voix pour commenter leurs actions, en plus des bulles de pensée où ils expriment leurs réflexions). C'est d'autant plus lassant qu'avec ce même mode d'exposition, Claremont avait réussi à capturer les émotions contradictoires d'Ororo se rappelant la perte de ses pouvoirs dans le premier épisode (les réminiscences des événements de "Lifedeath"). Les dessins de Silvestri et Green manquent du souffle, ou de la vitalité qui pourrait transformer les épreuves de Storm en un spectacle réellement tragique.
Les séquences dévolues à l'équipe des X-Men mettent surtout en avant les doutes de Wolverine quant à ses décisions de chef de l'équipe, les sentiments d'inadéquation d'Alison Blair (X-Woman par défaut), et la vaillance de Rogue. Les autres personnages ne disposent que de peu de temps d'exposition. Claremont impressionne toujours par sa capacité à rendre compte de l'évolution de la place des mutants dans la société, au travers du reportage télé, mais aussi des remarques des gens normaux, que ce soit des vacanciers sur la plage, des policiers prêtant main forte aux X-Men, ou même des enfants parlant franchement de leurs idoles mutantes. Se replonger dans ces épisodes, c'est se rappeler que Claremont avait à cœur de rattacher ses superhéros au monde normal. Il n'hésite pas à consacrer 4 pages à Piotr Rasputin dessinant sur un carnet pour faire plaisir à des enfants, une scène qui permet de développer ce personnage, indépendamment de ses superpouvoirs.
Au travers de ces épisodes, Claremont continue également de bâtir la mythologie des mutants, tout en prenant soin de faire évoluer les situations. C'est ainsi que le gouvernement a créé une équipe de repris de justice (Freedom Force) les plaçant ainsi du coté de la loi, alors que les X-Men sont dans l'illégalité. Ororo Munroe essaye de faire évoluer le statut des X-Men pour passer dans la clandestinité, et ainsi offrir une proie moins facile. La composition même de l'équipe atteste d'une volonté de ne pas se cantonner toujours aux mêmes personnages. Par contre l'histoire souffre du défaut principal de Claremont : des intrigues secondaires étirées sans espoir de résolution.
L'exemple le plus flagrant s'incarne en Madelyne Pryor qui est à la remorque de l'équipe pendant toute l'histoire, sans que jamais le lecteur ne comprenne pourquoi, ou qu'elle apporte quelque chose au récit. Enfin c'est l'occasion pour Claremont d'intégrer la mythologie de Captain Britain développée par Alan Moore et Alan Davis dans Siege of Camelot, avec le personnage de Betsy Braddock et celui de Roma.
Le travail de Marc Silvestri et Dan Green sur ces épisodes est représentatif d'une période de transition. Ils s'éloignent déjà des dessins gentillets à destination des enfants ou jeunes adolescents en insufflant plus de dynamisme dans leurs cases, un encrage un peu plus brut, moins rond, moins immédiatement plaisant à l'œil. Par contre la construction des pages reste encore assez sage, à base de cases rectangulaires sagement juxtaposées, sans décomposition de mouvements chorégraphiés, sans pleine page pour en mettre plein la vue. Il est possible de détecter déjà quelques tics propres à Silvestri telles les femmes toujours très cambrées, systématiquement porteuses de talons hauts (alors que chaque dessin met en évidence l'idiotie de telles chaussures en plein champ de bataille).
Globalement ces dessins remplissent leur fonction de montrer ce qui se passe de manière claire et vivante, avec une proportion de décors satisfaisante, même si certains épisodes sont réalisés plus vite que d'autres (silhouettes et visages parfois approximatifs). Au détour d'une action ou d'une autre, Silvestri et Green arrivent même à créer des images mémorables telles le couteau planté au milieu du visage de Dazzler, ou la souffrance de Blob lorsque son postérieur se retrouve embroché sur les griffes de Wolverine.
Cette partie de "Fall of the Mutants" consacrée aux X-Men souffre d'une structure artificielle partagée entre Ororo d'un coté, et l'équipe des X-Men de l'autre, d'une narration explicative à foison, et d'un enjeu peu palpitant. Par contre, elle met en évidence la capacité de Claremont à ne pas se contenter d'un statu quo confortable et répétitif, sa volonté de ne pas perdre de vue la métaphore que sont les X-Men, son ambition d'inscrire ces intrigues dans une narration au long cours pour le meilleur (l'évolution psychologique d'Ororo) comme pour le pire (les intrigues secondaires qui n'en finissent jamais).
-
INCREDIBLE HULK 340 (scénario de Peter David, dessins et encrage de Todd McFarlane) - Cet épisode s'intercale entre les épisodes 224 & 225 des UXM. Lors de leur voyage vers Dallas, leur route croise celle de Hulk (version grise). Il s'en suit un face à face entre Hulk et Wolverine, évocation de leur première rencontre dans "Incredible Hulk" 180 & 181 de 1974.
Malgré une séquence introductive un peu plus ambitieuse, il s'avère rapidement que Peter David utilise une narration aussi ampoulée que celle de Claremont et que cet épisode est bien ce dont il a l'air : une excuse pour que Hulk frappe brutalement Wolverine, et que ce dernier le taillade avec ses griffes. Bizarrement Todd McFarlane ne semble pas très inspiré et ses dessins souffrent d'un manque de démesure, d'exagération qui aurait pu apporter le plaisir premier degré d'une bonne baston inventive et brutale. Le tout se laisse lire sans déplaisir, mais sans provoquer d'étonnement ou sans impressionner par son panache.
-
NEW MUTANTS 55 à 61 (scénario de Louise Simonson, dessins de Brett Blevins, encrage de Terry Austin, sauf l'épisode 56 dessiné par June Brigman et encré par Austin) - L'équipe se compose de Sam Guthrie (Cannonball), Illyana Rasputin (Magik), Douglas Ramsey (Cypher), Danielle Moonstar (Mirage), et Rahne Sinclair (Wolfsbane). Erik Lehnsherr (Magneto, de son vrai nom Max Eisenhardt) remplit les fonctions de directeur de l'école pour surdoués de Westchester. Roberto da Costa (Sunspot) et Warlock sont momentanément absents, partis batifoler pour former les Fallen Angels. Tout commence par une invitation de Lila Cheney pour la fête de lancement de son nouvel album. Après avoir été drogué, Sam Guthrie libère par inadvertance une sorte d'oiseau anthropoïde (surnommé Bird Brain). Après un affrontement contre les Hellions (les mutants de l'école d'Emma Frost), les New Mutants adoptent Bird Brain, ce qui va les entraîner sur son île d'origine, affronter un généticien fou se surnommant Ani-Mator (le docteur Frederick Animus).
Ces épisodes font suite à New Mutants Classic 7 (épisodes 48 à 54, numéro annuel 4) ; il s'agit des premiers écrits par Louise Simonson qui succède à Chris Claremont. Elle se montre beaucoup moins gauche que lors de sa reprise de la série X-Factor. Le lecteur constate immédiatement qu'elle met à profit son expérience acquise sur Power Pack (équipe d'enfants superhéros crée en 1983) pour donner un ton cohérent aux New Mutants. À la lecture, il s'agit clairement de jeunes adolescents avec des velléités marquées d'indépendance, voire de rébellion contre l'autorité (incarnée par Magneto), mais toujours dépendant d'une forme d'encadrement. Louise Simonson écrit son récit en s'adressant à un lectorat de jeunes adolescents. En particulier, elle met en avant les angoisses des New Mutants, leur comportement fortement dicté par leurs émotions à fleur de peau, et une forme de naïveté dans leurs sentiments, ainsi qu'une partition claire entre le bien et le mal. Dans ce registre d'histoires destinées à un public bien déterminé, elle s'autorise des licences artistiques qui aux yeux d'un adulte relève de facilité scénaristique (degré d'éloignement du réalisme), tout en étant cohérent avec le registre de son récit. Les personnages ont donc tendance à s'emporter, à laisser leurs émotions dicter leur conduite, l'emportant bien souvent sur la raison, ou même sur la discussion.
L'intrigue porte également les stigmates du registre choisi par Louise Simonson : les New Mutants vont porter secours à leur copain Bird Brain (quel nom ! l'équivalent de "cervelle de moineau" en français). Ils vont être confrontés à un savant fou menant des expériences sur les animaux pour créer une armée destinée à effectuer les corvées à la place des humains, avec un discours ahurissant sur l'innocence et la pureté de l'âme, très impressionnant à un jeune âge, un verbiage approximatif pour un adulte. Ce discours défiant l'entendement apparaît encore plus absurde du fait de l'apparence du Docteur Animus. Non seulement son surnom semble provenir d'une série Z (Ani-Mator), mais en plus il est vêtu d'une peau de bête, et affublé de lunettes à verres épais, avec une tête de léopard en guise de couvre-chef et la bave aux lèvres quand il parle, ou plutôt éructe.
Brett Blevins apporte à cette série une forte identité graphique, un peu agressive. D'un coté, il dessine les Nouveaux Mutants comme des adolescents très filiformes, avec une morphologie d'adolescents, ou d'enfant pour Rahne. Il y a donc là une adéquation avec l'approche de Louise Simonson. Il leur donne juste des têtes un tantinet plus grosses que la normale, accentuant par là l'expressivité de leur visage, mais conférant un aspect un peu décalé.
D'un autre coté, l'encrage de Terry Austin (assez différent de celui qu'il réalisait pour Byrne sur UXM), comprend de nombreux petits traits qui rendent chaque surface un peu abrasive. La gestuelle vive et brusque de Bird Brain installe une ambiance désordonnée. La bave aux lèvres d'Ani-Mator fait basculer les visuels dans la série Z parodique. Blevins a également une façon bien à lui de représenter les visages. Il a une propension marquée à agrandir un peu les yeux, et à dessiner des nez effilés, un peu pointus. Par moment cette approche fait penser à celle de Steve Ditko, avec une sensation d'individus entièrement portés par leurs émotions, sans aucun recul. Cela a pour effet d'intensifier chaque réaction émotionnel, et d'être un peu épuisant à la lecture, voire éprouvant et légèrement horrifique. Cette caractéristique devient évidente en comparant les dessins de Blevins à ceux réalisés par June Brigman, plus traditionnels.
Louise Simonson et Brett Blevins réalisent un récit à destination d'un lectorat de jeunes adolescents, à l'exclusion d'autres segments de la population. Il en devient difficile d'apprécier ces aventures un peu infantiles, dans lesquelles les personnages sont la proie de leur émotion, sans capacité de prise de recul. 2 ou 3 étoiles en fonction de la sensibilité du lecteur, et sa tolérance à ce mode de narration.
-
Ce tome est complété par Fall of the Mutants 2 qui contient les épisodes 18 à 26 de "X-Factor", 336 & 337 de "Incredible Hulk", 35 de "Power Pack", 252 de "Daredevil", 339 de "Captain America", et 312 de "Fantastic Four".
Le grand événement suivant pour les X-Men se touve dans Inferno : épisodes 33 à 40 de "X-Factor", numéro annuel 4, les épisodes 239 à 243 de "Uncanny X-men", les épisodes 71 à 73 de "New Mutants", les 4 épisodes de la minisérie "X-Terminators".
-
UNCANNY X-MEN 200 à 227 (scénario de Chris Claremont, dessins de Marc Silvestri pour les épisodes 220 à 222 & 224 à 227, Kerry Gammill pour 223, avec un encrage ou finitions de Dan Green, sauf pour l'épisode 224 encré par Bob Wiacek) - Storm estime qu'elle doit absolument recouvrer ses pouvoirs (perdus dans Lifedeath, en particulier les épisodes 186 & 198) pour assumer pleinement son rôle de chef des X-Men. Elle a donc entrepris de suivre la trace de Forge (Le faiseur, The Maker) pour qu'il construise un dispositif les rétablissant. Elle commence par se rendre à son dernier domicile connu, un gratte-ciel à Dallas où elle trouve Naze, l'ancien mentor de Forge, également shaman. Ensemble ils remontent sa trace dans les montagnes du Grand Canyon.
De leur coté les X-Men séjournent à San Francisco où ils essayent de défendre Madelyne Pryor contre les Maraudeurs (comprenant Sabretooth et Malice possédant le corps de Polaris, c'est-à-dire Lorna Dane, la compagne d'Alex Summers). Ils sont ensuite attaqués par l'équipe gouvernementale Freedom Force (composée de Pyro, Blob, Mystique, Spiral, Avalanche, Crimson Commando, Stonewall, Super Sabre, et Destiny, avec leur agent de liaison Valerie Cooper).
"Fall of Mutants" se compose de 3 histoires distinctes et indépendantes se déroulant concomitamment : celle des X-Men, celle des New Mutants et celle de X-Factor. Le précédent événement de grande ampleur pour les X-Men se trouve dans Mutant massacre (épisodes 210 à 214 d'Uncanny X-men, 9 à 11 de X-Factor, 46 de New Mutants, 373 & 374 de Mighty Thor, 27 de Power Pack, et 238 de Daredevil).
Chris Claremont a bâti son récit en crescendo, sur 2 fils narratifs se rejoignant dans le dernier épisode. Il y a tout d'abord le parcours initiatique d'Ororo, aux cotés de Naze, pour retrouver l'homme qui l'a trahie, et peut-être ses pouvoirs de mutante. Claremont ne s'est pas facilité la tâche dans la mesure où il a désamorcé tout suspense en révélant dès le départ que Naze est posséder par l'Adversaire. Du coup, les dialogues entre Ororo et lui perdent beaucoup d'intérêt, d'autant plus que les manœuvres de Naze pour la manipuler sont infantiles et transparentes du début jusqu'à la fin.
Claremont a bien du mal à expliquer de manière convaincante pourquoi l'Adversaire ne l'élimine pas purement et simplement une fois qu'elle a rempli son office. Le lecteur doit donc supporter des pages d'échanges creux et artificiels (d'autant plus qu'on est encore à une époque où les personnages se parlent à eux-mêmes à haute voix pour commenter leurs actions, en plus des bulles de pensée où ils expriment leurs réflexions). C'est d'autant plus lassant qu'avec ce même mode d'exposition, Claremont avait réussi à capturer les émotions contradictoires d'Ororo se rappelant la perte de ses pouvoirs dans le premier épisode (les réminiscences des événements de "Lifedeath"). Les dessins de Silvestri et Green manquent du souffle, ou de la vitalité qui pourrait transformer les épreuves de Storm en un spectacle réellement tragique.
Les séquences dévolues à l'équipe des X-Men mettent surtout en avant les doutes de Wolverine quant à ses décisions de chef de l'équipe, les sentiments d'inadéquation d'Alison Blair (X-Woman par défaut), et la vaillance de Rogue. Les autres personnages ne disposent que de peu de temps d'exposition. Claremont impressionne toujours par sa capacité à rendre compte de l'évolution de la place des mutants dans la société, au travers du reportage télé, mais aussi des remarques des gens normaux, que ce soit des vacanciers sur la plage, des policiers prêtant main forte aux X-Men, ou même des enfants parlant franchement de leurs idoles mutantes. Se replonger dans ces épisodes, c'est se rappeler que Claremont avait à cœur de rattacher ses superhéros au monde normal. Il n'hésite pas à consacrer 4 pages à Piotr Rasputin dessinant sur un carnet pour faire plaisir à des enfants, une scène qui permet de développer ce personnage, indépendamment de ses superpouvoirs.
Au travers de ces épisodes, Claremont continue également de bâtir la mythologie des mutants, tout en prenant soin de faire évoluer les situations. C'est ainsi que le gouvernement a créé une équipe de repris de justice (Freedom Force) les plaçant ainsi du coté de la loi, alors que les X-Men sont dans l'illégalité. Ororo Munroe essaye de faire évoluer le statut des X-Men pour passer dans la clandestinité, et ainsi offrir une proie moins facile. La composition même de l'équipe atteste d'une volonté de ne pas se cantonner toujours aux mêmes personnages. Par contre l'histoire souffre du défaut principal de Claremont : des intrigues secondaires étirées sans espoir de résolution.
L'exemple le plus flagrant s'incarne en Madelyne Pryor qui est à la remorque de l'équipe pendant toute l'histoire, sans que jamais le lecteur ne comprenne pourquoi, ou qu'elle apporte quelque chose au récit. Enfin c'est l'occasion pour Claremont d'intégrer la mythologie de Captain Britain développée par Alan Moore et Alan Davis dans Siege of Camelot, avec le personnage de Betsy Braddock et celui de Roma.
Le travail de Marc Silvestri et Dan Green sur ces épisodes est représentatif d'une période de transition. Ils s'éloignent déjà des dessins gentillets à destination des enfants ou jeunes adolescents en insufflant plus de dynamisme dans leurs cases, un encrage un peu plus brut, moins rond, moins immédiatement plaisant à l'œil. Par contre la construction des pages reste encore assez sage, à base de cases rectangulaires sagement juxtaposées, sans décomposition de mouvements chorégraphiés, sans pleine page pour en mettre plein la vue. Il est possible de détecter déjà quelques tics propres à Silvestri telles les femmes toujours très cambrées, systématiquement porteuses de talons hauts (alors que chaque dessin met en évidence l'idiotie de telles chaussures en plein champ de bataille).
Globalement ces dessins remplissent leur fonction de montrer ce qui se passe de manière claire et vivante, avec une proportion de décors satisfaisante, même si certains épisodes sont réalisés plus vite que d'autres (silhouettes et visages parfois approximatifs). Au détour d'une action ou d'une autre, Silvestri et Green arrivent même à créer des images mémorables telles le couteau planté au milieu du visage de Dazzler, ou la souffrance de Blob lorsque son postérieur se retrouve embroché sur les griffes de Wolverine.
Cette partie de "Fall of the Mutants" consacrée aux X-Men souffre d'une structure artificielle partagée entre Ororo d'un coté, et l'équipe des X-Men de l'autre, d'une narration explicative à foison, et d'un enjeu peu palpitant. Par contre, elle met en évidence la capacité de Claremont à ne pas se contenter d'un statu quo confortable et répétitif, sa volonté de ne pas perdre de vue la métaphore que sont les X-Men, son ambition d'inscrire ces intrigues dans une narration au long cours pour le meilleur (l'évolution psychologique d'Ororo) comme pour le pire (les intrigues secondaires qui n'en finissent jamais).
-
INCREDIBLE HULK 340 (scénario de Peter David, dessins et encrage de Todd McFarlane) - Cet épisode s'intercale entre les épisodes 224 & 225 des UXM. Lors de leur voyage vers Dallas, leur route croise celle de Hulk (version grise). Il s'en suit un face à face entre Hulk et Wolverine, évocation de leur première rencontre dans "Incredible Hulk" 180 & 181 de 1974.
Malgré une séquence introductive un peu plus ambitieuse, il s'avère rapidement que Peter David utilise une narration aussi ampoulée que celle de Claremont et que cet épisode est bien ce dont il a l'air : une excuse pour que Hulk frappe brutalement Wolverine, et que ce dernier le taillade avec ses griffes. Bizarrement Todd McFarlane ne semble pas très inspiré et ses dessins souffrent d'un manque de démesure, d'exagération qui aurait pu apporter le plaisir premier degré d'une bonne baston inventive et brutale. Le tout se laisse lire sans déplaisir, mais sans provoquer d'étonnement ou sans impressionner par son panache.
-
NEW MUTANTS 55 à 61 (scénario de Louise Simonson, dessins de Brett Blevins, encrage de Terry Austin, sauf l'épisode 56 dessiné par June Brigman et encré par Austin) - L'équipe se compose de Sam Guthrie (Cannonball), Illyana Rasputin (Magik), Douglas Ramsey (Cypher), Danielle Moonstar (Mirage), et Rahne Sinclair (Wolfsbane). Erik Lehnsherr (Magneto, de son vrai nom Max Eisenhardt) remplit les fonctions de directeur de l'école pour surdoués de Westchester. Roberto da Costa (Sunspot) et Warlock sont momentanément absents, partis batifoler pour former les Fallen Angels. Tout commence par une invitation de Lila Cheney pour la fête de lancement de son nouvel album. Après avoir été drogué, Sam Guthrie libère par inadvertance une sorte d'oiseau anthropoïde (surnommé Bird Brain). Après un affrontement contre les Hellions (les mutants de l'école d'Emma Frost), les New Mutants adoptent Bird Brain, ce qui va les entraîner sur son île d'origine, affronter un généticien fou se surnommant Ani-Mator (le docteur Frederick Animus).
Ces épisodes font suite à New Mutants Classic 7 (épisodes 48 à 54, numéro annuel 4) ; il s'agit des premiers écrits par Louise Simonson qui succède à Chris Claremont. Elle se montre beaucoup moins gauche que lors de sa reprise de la série X-Factor. Le lecteur constate immédiatement qu'elle met à profit son expérience acquise sur Power Pack (équipe d'enfants superhéros crée en 1983) pour donner un ton cohérent aux New Mutants. À la lecture, il s'agit clairement de jeunes adolescents avec des velléités marquées d'indépendance, voire de rébellion contre l'autorité (incarnée par Magneto), mais toujours dépendant d'une forme d'encadrement. Louise Simonson écrit son récit en s'adressant à un lectorat de jeunes adolescents. En particulier, elle met en avant les angoisses des New Mutants, leur comportement fortement dicté par leurs émotions à fleur de peau, et une forme de naïveté dans leurs sentiments, ainsi qu'une partition claire entre le bien et le mal. Dans ce registre d'histoires destinées à un public bien déterminé, elle s'autorise des licences artistiques qui aux yeux d'un adulte relève de facilité scénaristique (degré d'éloignement du réalisme), tout en étant cohérent avec le registre de son récit. Les personnages ont donc tendance à s'emporter, à laisser leurs émotions dicter leur conduite, l'emportant bien souvent sur la raison, ou même sur la discussion.
L'intrigue porte également les stigmates du registre choisi par Louise Simonson : les New Mutants vont porter secours à leur copain Bird Brain (quel nom ! l'équivalent de "cervelle de moineau" en français). Ils vont être confrontés à un savant fou menant des expériences sur les animaux pour créer une armée destinée à effectuer les corvées à la place des humains, avec un discours ahurissant sur l'innocence et la pureté de l'âme, très impressionnant à un jeune âge, un verbiage approximatif pour un adulte. Ce discours défiant l'entendement apparaît encore plus absurde du fait de l'apparence du Docteur Animus. Non seulement son surnom semble provenir d'une série Z (Ani-Mator), mais en plus il est vêtu d'une peau de bête, et affublé de lunettes à verres épais, avec une tête de léopard en guise de couvre-chef et la bave aux lèvres quand il parle, ou plutôt éructe.
Brett Blevins apporte à cette série une forte identité graphique, un peu agressive. D'un coté, il dessine les Nouveaux Mutants comme des adolescents très filiformes, avec une morphologie d'adolescents, ou d'enfant pour Rahne. Il y a donc là une adéquation avec l'approche de Louise Simonson. Il leur donne juste des têtes un tantinet plus grosses que la normale, accentuant par là l'expressivité de leur visage, mais conférant un aspect un peu décalé.
D'un autre coté, l'encrage de Terry Austin (assez différent de celui qu'il réalisait pour Byrne sur UXM), comprend de nombreux petits traits qui rendent chaque surface un peu abrasive. La gestuelle vive et brusque de Bird Brain installe une ambiance désordonnée. La bave aux lèvres d'Ani-Mator fait basculer les visuels dans la série Z parodique. Blevins a également une façon bien à lui de représenter les visages. Il a une propension marquée à agrandir un peu les yeux, et à dessiner des nez effilés, un peu pointus. Par moment cette approche fait penser à celle de Steve Ditko, avec une sensation d'individus entièrement portés par leurs émotions, sans aucun recul. Cela a pour effet d'intensifier chaque réaction émotionnel, et d'être un peu épuisant à la lecture, voire éprouvant et légèrement horrifique. Cette caractéristique devient évidente en comparant les dessins de Blevins à ceux réalisés par June Brigman, plus traditionnels.
Louise Simonson et Brett Blevins réalisent un récit à destination d'un lectorat de jeunes adolescents, à l'exclusion d'autres segments de la population. Il en devient difficile d'apprécier ces aventures un peu infantiles, dans lesquelles les personnages sont la proie de leur émotion, sans capacité de prise de recul. 2 ou 3 étoiles en fonction de la sensibilité du lecteur, et sa tolérance à ce mode de narration.
-
Ce tome est complété par Fall of the Mutants 2 qui contient les épisodes 18 à 26 de "X-Factor", 336 & 337 de "Incredible Hulk", 35 de "Power Pack", 252 de "Daredevil", 339 de "Captain America", et 312 de "Fantastic Four".
Le grand événement suivant pour les X-Men se touve dans Inferno : épisodes 33 à 40 de "X-Factor", numéro annuel 4, les épisodes 239 à 243 de "Uncanny X-men", les épisodes 71 à 73 de "New Mutants", les 4 épisodes de la minisérie "X-Terminators".
Je vais cantonner ma critique à la saga principale de ce livre : X-Tinction Agenda qui fait 9 épisodes.La deuxième saga n'est pas entière (2 histoires sur 4).
Commençons par les points positifs car cela sera rapide. Ils sont aux nombres de 2.
En premier L'idée de départ du scenario : Genosha le pays ou les mutants sont lobotomisés et utilisés pour la prospérité du pays veut se venger des X-Men.
En deux Les dessins de Jim Lee, ce point est à double tranchant car il fait ressortir la prestation indigente dans le meilleur des cas des autres dessinateurs. Certaines planches de Rob Liefield et de Jon Bogdanove sont dangereuses pour la santé, une courte exposition peut entrainer un décollement de rétine alors qu'une exposition prolongé risque d'occasionner l'apparition de cataracte. C'est moche, voir très moche...
Passons au scenario, l'idée de départ est plaisante le reste une catastrophe le comportement des personnages est tellement irrationnel pour ne pas dire débile que c'en est offensant. Morceaux choisies et malheureusement non exhaustif :
Tornade, plutôt que de combattre Genosha aux États-unis avec ces amis mutants( X-men et nouveaux mutants) préfère se faire capturer tout en sachant bine que ceux ci vont devoir venir la chercher et donc violer un état souverain.
Wolverine qui était sorti on ne peut plus mal en point de sa dernière visite de ce pays y retourne juste avec deux équipières ( Jubilé et Psylocke) sans se souvenir qu'il y a un mutant capable de supprimer les pouvoirs.
Cable qui fonce tête baisser sans aucune réflexion, seul cyclope semble avoir un semblant de plan
en fait tous ces personnages se comportent comme s'il ont conscience du naufrage littéraire dans lequel ils sont fourrés et veulent quitter ce calvaire par tous les moyens.
Pour finir je vous résume le trajet suivi par Ricto et Big Bang. Ils quittent la prison ou ils sont enfermé en laissant leur amis emprisonnés pour rejoindre l'ambassade des U.S.A. Plus tard changement de plan, ils décident de rejoindre les renforts qui débarquent. Re-changement ils partent dans la direction opposé pour ne pas amener les forces de l'ordre de Genosha vers les renforts. Une fois ceux ci capturés, ils décident de retourner à la prison pour délivrer tout ce beaux monde.
Un livre que je déconseille aux fans des mutants ainsi qu'aux novices, un livre à ne mettre dans aucune main.
Commençons par les points positifs car cela sera rapide. Ils sont aux nombres de 2.
En premier L'idée de départ du scenario : Genosha le pays ou les mutants sont lobotomisés et utilisés pour la prospérité du pays veut se venger des X-Men.
En deux Les dessins de Jim Lee, ce point est à double tranchant car il fait ressortir la prestation indigente dans le meilleur des cas des autres dessinateurs. Certaines planches de Rob Liefield et de Jon Bogdanove sont dangereuses pour la santé, une courte exposition peut entrainer un décollement de rétine alors qu'une exposition prolongé risque d'occasionner l'apparition de cataracte. C'est moche, voir très moche...
Passons au scenario, l'idée de départ est plaisante le reste une catastrophe le comportement des personnages est tellement irrationnel pour ne pas dire débile que c'en est offensant. Morceaux choisies et malheureusement non exhaustif :
Tornade, plutôt que de combattre Genosha aux États-unis avec ces amis mutants( X-men et nouveaux mutants) préfère se faire capturer tout en sachant bine que ceux ci vont devoir venir la chercher et donc violer un état souverain.
Wolverine qui était sorti on ne peut plus mal en point de sa dernière visite de ce pays y retourne juste avec deux équipières ( Jubilé et Psylocke) sans se souvenir qu'il y a un mutant capable de supprimer les pouvoirs.
Cable qui fonce tête baisser sans aucune réflexion, seul cyclope semble avoir un semblant de plan
en fait tous ces personnages se comportent comme s'il ont conscience du naufrage littéraire dans lequel ils sont fourrés et veulent quitter ce calvaire par tous les moyens.
Pour finir je vous résume le trajet suivi par Ricto et Big Bang. Ils quittent la prison ou ils sont enfermé en laissant leur amis emprisonnés pour rejoindre l'ambassade des U.S.A. Plus tard changement de plan, ils décident de rejoindre les renforts qui débarquent. Re-changement ils partent dans la direction opposé pour ne pas amener les forces de l'ordre de Genosha vers les renforts. Une fois ceux ci capturés, ils décident de retourner à la prison pour délivrer tout ce beaux monde.
Un livre que je déconseille aux fans des mutants ainsi qu'aux novices, un livre à ne mettre dans aucune main.
Un très chouette album jeunesse !
Il s'agit d'une adaptation du livre "Histoires comme ça" De Rudyard Kipling, connu également pour son roman "Le livre de la jungle". Je n'avais jamais lu ce livre pour enfant et c'est donc un plaisir de découvrir cette adaptation (chaque histoire est d'un auteur différent) sous forme d'album jeunesse. J'ai d'ailleurs apprécié qu'il y est des citations de poème De Rudyard Kipling.
Nous découvrons donc 4 histoires qui relate en quelque sorte les origines de chaque animal abordé dans ce livre. La première histoire étant sur le Rhinocéros, la 2ème sur le Léopard, la 3ème sur le Chameau et la 4ème sur l'Éléphant. Ce sont des histoires rigolotes qui peuvent plaire autant aux petits qu'aux grands. • Je rajoute que j'ai vraiment adoré les dessins de Pedro Rodriguez. Ils sont jolis à voir, expressifs et détaillés, le tout avec de superbes couleurs qui nous fait voyager au cœur de la savane.
Si vous aimez les histoires drôles animalières, je ne peux que vous recommander cet album.
Il s'agit d'une adaptation du livre "Histoires comme ça" De Rudyard Kipling, connu également pour son roman "Le livre de la jungle". Je n'avais jamais lu ce livre pour enfant et c'est donc un plaisir de découvrir cette adaptation (chaque histoire est d'un auteur différent) sous forme d'album jeunesse. J'ai d'ailleurs apprécié qu'il y est des citations de poème De Rudyard Kipling.
Nous découvrons donc 4 histoires qui relate en quelque sorte les origines de chaque animal abordé dans ce livre. La première histoire étant sur le Rhinocéros, la 2ème sur le Léopard, la 3ème sur le Chameau et la 4ème sur l'Éléphant. Ce sont des histoires rigolotes qui peuvent plaire autant aux petits qu'aux grands. • Je rajoute que j'ai vraiment adoré les dessins de Pedro Rodriguez. Ils sont jolis à voir, expressifs et détaillés, le tout avec de superbes couleurs qui nous fait voyager au cœur de la savane.
Si vous aimez les histoires drôles animalières, je ne peux que vous recommander cet album.
Blake Hoena, Martin Powell, Louise Simonson, Sean Tulien ont écrit chacun une de ces quatre adaptations à partir du livre de 1902 Just so stories for little children de Rudyard Kipling. Quatre adaptations riches en humour et voyages, toutes illustrées et mises en couleurs par Pedro Rodriguez.
Lien : https://www.avoir-alire.com/..
Lien : https://www.avoir-alire.com/..
La jungle en poésie
Première publication originale des tous jeunes Aventuriers de l’Ailleurs, cette adaptation d’Histoires comme ça pour les petits de Rudyard Kipling est un album poétique et plein de fantaisie…
Dans ce premier opus, Martin Powell, Blake A. HoenaA, Sean Tulien et Louise Simonson s’empare chacun d’un chapitre différent de recueil de Kipling pour nous expliquer pourquoi le rhino a une peau si rugueuse, le léopard des tâches, le chameau une bosse et l’éléphant une trompe… Le dessin formidablement expressif de Pedro Rodriguez n’est pas le moindre atout de ces enthousiasmantes Observations Animalières de Rudyard Kipling qui laissent augurer un bien bel avenir aux toutes jeunes Aventuriers de l’Ailleurs !
Hâte de voir comment les auteurs vont s’emparer de la baleine, du papillon et autres tatous et kangourous dans de prochains tomes de la série !
Lien : http://sdimag.fr/index.php?r..
Première publication originale des tous jeunes Aventuriers de l’Ailleurs, cette adaptation d’Histoires comme ça pour les petits de Rudyard Kipling est un album poétique et plein de fantaisie…
Dans ce premier opus, Martin Powell, Blake A. HoenaA, Sean Tulien et Louise Simonson s’empare chacun d’un chapitre différent de recueil de Kipling pour nous expliquer pourquoi le rhino a une peau si rugueuse, le léopard des tâches, le chameau une bosse et l’éléphant une trompe… Le dessin formidablement expressif de Pedro Rodriguez n’est pas le moindre atout de ces enthousiasmantes Observations Animalières de Rudyard Kipling qui laissent augurer un bien bel avenir aux toutes jeunes Aventuriers de l’Ailleurs !
Hâte de voir comment les auteurs vont s’emparer de la baleine, du papillon et autres tatous et kangourous dans de prochains tomes de la série !
Lien : http://sdimag.fr/index.php?r..
L'ouvrage est bien plus homogène que le tome 1, je l'ai lu d'une traite. Sans être extraordinaire, c'est une bonne histoire dont on a envie de connaitre la fin et de comprendre les différents mystères. Coté dessins c'est assez inégale, mais on a l'habitude. Seul les 3 dernières issues sont très en dessous (épilogue 2 et 3), tout le reste étant une seul histoire, contrairement au tome 1, qui avait une bonne histoire sur 50% du volume, puis 50% d'histoires "bouche trou" assez indigeste.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Auteurs proches de Louise Simonson
Lecteurs de Louise Simonson (101)Voir plus
Quiz
Voir plus
En attendant Bojangles
Qui a écrit la chanson Mr Bojangles ?
Whitney Houston
Nina Simone
Amy Winehouse
Edith Piaf
12 questions
586 lecteurs ont répondu
Thème : En attendant Bojangles de
Olivier BourdeautCréer un quiz sur cet auteur586 lecteurs ont répondu