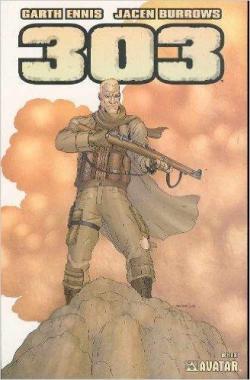>
Critique de Presence
Ce tome regroupe les 6 épisodes d'une histoire complète et indépendante de toute autre, initialement parus en 2004/2005 et publiés par Avatar Press. L'histoire est écrite par Garth Ennis, dessinée et encrée par Jacen Burrows et mise en couleurs par Greg Waller et Andrew Dallhouse.
La première moitié du récit (épisodes 1 à 3) se déroule dans les montagnes d'Afghanistan. Un colonel russe mène une petite troupe soldats des forces spéciales pour une mission de repérage d'un avion américain s'étant écrasé. Il sait que cet accident a également attiré l'attention des anglais qui essaye aussi d'arriver les premiers sur les lieux du crash. Il s'agit d'une course pour récupérer ce que contenait cet avion, et il faut y arriver avant que les américains ne viennent faire disparaître toute trace de ce vol compromettant.
La deuxième partie du récit (épisode 4 à 6) se déroule sur le sol étatsunien, dans un désert proche de la frontière mexicaine. Sam Wallace, le shérif du coin, constate le décès d'un clandestin mexicain, employé de manière illégale dans l'abattoir de la région dont le responsable exploite cette main d'oeuvre bon marché. Non loin de là, le colonel russe est hébergé dans le camp de fortune des clandestins, se remettant lentement d'une jambe cassée, soignée par le médecin de fortune du camp.
Avatar Press est une petite maison d'édition qui publie des récits souvent gores ou ultra-violents d'auteurs ayant toute liberté de création. Ici, Garth Ennis (grand connaisseur des conflits du vingtième siècle) a décidé de raconter une histoire en 2 parties, mettant en scène un vétéran de plusieurs guerre, sans beaucoup d'états d'âme (même s'il lui arrive parfois d'imaginer les cadavres des gens qu'il a tué, soldats comme civils), un professionnel disposant d'un degré d'expertise exceptionnel acquis par des années de pratique sur différents champs de bataille. Dans la première partie, Ennis expose de manière clinique le déroulement de la mission, l'affrontement entre russes et anglais, tout en mettant en scène l'expérience du colonel russe, au travers des ordres et des conseils qu'il donne à sa poignée de soldats, et au travers de son propre comportement dans cet environnement propice aux embuscades. Il développe un thème sur lequel il reviendra à plusieurs reprises : le fait que les nations du monde se sont bâties et développées sur le sang versé par d'innombrables soldats tués au cours de guerre de conquête. Il montre l'absence totale d'honneur et de mérite de cet affrontement sans témoin, sans gloire, pour récupérer quelque chose dont la valeur reste à prouver. le colonel russe se comporte en professionnel accomplissant sa mission en expert, mais sans implication émotionnelle. Il fait son travail en se comportant comme une mécanique bien huilée, sans en retirer aucun plaisir (à tuer son opposant pour assurer sa propre survie), un métier qui consiste à atteindre son objectif aux dépends de la vie de ses ennemis (et de ses propres soldats). L'action est prenante. le lecteur n'a pas la latitude d'éprouver de l'empathie pour cet homme froid, dépassionné, au comportement fonctionnel et efficace, ne tirant aucun plaisir, ni aucune satisfaction dans la tâche accomplie. La survie est la seule récompense, aussi primaire que vitale, la seule chose qui en fasse un être vivant.
Le début de la deuxième partie déconcerte par l'importance de la place accordée à Sam Wallace. le lecteur apprend en cours de route qu'il s'agit d'un ancien militaire revenu à la vie civile. Ennis oppose donc la vie du colonel qui a embrassé une carrière militaire de terrain, à celle de Wallace qui a abandonné la tenue kaki pour revenir à la vie civile. Autant l'attitude du colonel montre l'inanité et la futilité de sa vie professionnelle, autant le comportement de Wallace montre que son métier de shérif est tout aussi générateur de frustration et tout aussi inefficace pour changer le monde, ou tout du moins y apporter un peu d'amélioration.
Au milieu de ces thématiques très noires, Ennis enfonce le clou avec plusieurs évocations de conflits, et de morts de soldats, de civils, de massacres de peuples, dont une séquence onirique glaçante dans ce désert américain. À la première lecture, la mission finale du colonel russe peut sembler grossière et d'un symbolisme idiot (comme s'il suffisait d'abattre cette cible pour résoudre quoi que ce soit, ou même pour obtenir une vengeance). Mais une prise de recul permet de comprendre que l'objectif du colonel tenait autant de la vengeance que de la perpétuation de la guerre, conséquence logique de l'assassinat de sa cible. Ennis augmente encore d'un cran la noirceur du récit en enfonçant le clou : le savoir faire d'un soldat, son champ d'expertise, c'est de tuer l'ennemi, de donner la mort, de faire la guerre, voire de l'entretenir. La guerre est le métier du colonel russe, et il est expert dans sa partie, d'une efficacité sans faille, il donne la mort comme personne. Il est un des agents et des moteurs de la guerre.
Avatar a confié la mise en image de ce récit noir et sans espoir, à Jacen Burrows, un dessinateur ne travaillant que pour cet éditeur. Il avait auparavant dessiné Dark blue (2000) et Scars (2002/2003) de Warren Ellis, et "The courtyard" (2003, réédité dans Neonomicon) une adaptation d'un texte d'Alan Moore. Jacen Burrows réalise tous les contours des personnages comme des éléments de décors, en utilisant un trait assez fin, d'une épaisseur constante, sans variation qui transcrirait des reliefs ou une profondeur de champ, et sans presqu'aucun aplat de noir. Il revient donc aux metteurs en couleurs d'intégrer les notions de reliefs et de luminosité par le biais de variations de teintes dans les couleurs. Ils font preuve d'habilité dans le choix de leurs couleurs pour privilégier une teinte qui instaure l'ambiance de chaque scène. Par contre, malgré un outil informatique performant, ils n'arrivent pas à transcrire les volumes, répétant systématiquement les mêmes répartitions de couleurs, indépendamment des sources lumineuses (défaut particulièrement criant dans la manière de disposer les touches blanches sur les montagnes). Ils réussissent dont à nourrir les contours établis par Burrows, sans pallier l'absence de volume ou de relief.
En 2004/2005, Burrows est encore un dessinateur avec peu d'expérience et cela se ressent dans la qualité de ses dessins. Son découpage des séquences est très lisible et le trait fin uniforme assure une lecture rapide et une compréhension immédiate de chaque case. Au-delà de ces qualités, ces dessins restent très fonctionnels, sans qualité esthétique, sans nuances. Les expressions des visages sont toutes caricaturales, ne rendant compte que de 3 émotions (visage fermé indéchiffrable, surprise/étonnement, visage détendu sans émotion particulière). Au-delà des actions et des mouvements, le lecteur se retrouve dans l'impossibilité d'éprouver quelque émotion que ce soit pour les personnages qui eux-mêmes n'expriment rien. Burrows n'a aucune notion de langage corporel dans cette histoire. Ce manque de savoir faire aboutit à des images qui finissent par relever de l'amateurisme, le pire étant atteint pour le dessin en double page décrivant les clandestins en train de travailler dans l'intérieur de l'abattoir, une image descriptive dépourvue d'impact (malgré l'horreur des conditions de travail et la nature des tâches à exécuter) du fait de postures artificielles, et d'un aménagement ne correspondant à rien de réaliste.
Le manque de consistance des images atténue la force du récit de manière significative. Ennis a construit un récit en 2 temps un peu déconcertant dans sa structure (le personnage de Sam Wallace était-il vraiment indispensable ? Fallait-il vraiment incarner l'alternative de vie du colonel ?), d'une noirceur sans fond, avec de véritables audaces sur l'absence de justification de tuer son semblable même dans le cadre d'affrontements découlant d'un conflit armée. La fin de l'histoire promet un bain de sang à venir d'une ampleur sans précédant (une condamnation sans appel de la politique post 11 septembre), dans une perpétuation de l'état de guerre s'auto-entretenant. Mais le passage le plus cynique et cruel est peut-être dans ce débat télévisé où un intervenant défend l'impossibilité d'adopter une position de neutralité avec des arguments impossibles à réfuter. Malgré ses réels défauts, ce récit possède des qualités indéniables et Ennis propose un point de vue dérangeant au possible sur la guerre, les conflits armés, en tant que réalité inéluctable, consubstantielle des sociétés humaines.
La première moitié du récit (épisodes 1 à 3) se déroule dans les montagnes d'Afghanistan. Un colonel russe mène une petite troupe soldats des forces spéciales pour une mission de repérage d'un avion américain s'étant écrasé. Il sait que cet accident a également attiré l'attention des anglais qui essaye aussi d'arriver les premiers sur les lieux du crash. Il s'agit d'une course pour récupérer ce que contenait cet avion, et il faut y arriver avant que les américains ne viennent faire disparaître toute trace de ce vol compromettant.
La deuxième partie du récit (épisode 4 à 6) se déroule sur le sol étatsunien, dans un désert proche de la frontière mexicaine. Sam Wallace, le shérif du coin, constate le décès d'un clandestin mexicain, employé de manière illégale dans l'abattoir de la région dont le responsable exploite cette main d'oeuvre bon marché. Non loin de là, le colonel russe est hébergé dans le camp de fortune des clandestins, se remettant lentement d'une jambe cassée, soignée par le médecin de fortune du camp.
Avatar Press est une petite maison d'édition qui publie des récits souvent gores ou ultra-violents d'auteurs ayant toute liberté de création. Ici, Garth Ennis (grand connaisseur des conflits du vingtième siècle) a décidé de raconter une histoire en 2 parties, mettant en scène un vétéran de plusieurs guerre, sans beaucoup d'états d'âme (même s'il lui arrive parfois d'imaginer les cadavres des gens qu'il a tué, soldats comme civils), un professionnel disposant d'un degré d'expertise exceptionnel acquis par des années de pratique sur différents champs de bataille. Dans la première partie, Ennis expose de manière clinique le déroulement de la mission, l'affrontement entre russes et anglais, tout en mettant en scène l'expérience du colonel russe, au travers des ordres et des conseils qu'il donne à sa poignée de soldats, et au travers de son propre comportement dans cet environnement propice aux embuscades. Il développe un thème sur lequel il reviendra à plusieurs reprises : le fait que les nations du monde se sont bâties et développées sur le sang versé par d'innombrables soldats tués au cours de guerre de conquête. Il montre l'absence totale d'honneur et de mérite de cet affrontement sans témoin, sans gloire, pour récupérer quelque chose dont la valeur reste à prouver. le colonel russe se comporte en professionnel accomplissant sa mission en expert, mais sans implication émotionnelle. Il fait son travail en se comportant comme une mécanique bien huilée, sans en retirer aucun plaisir (à tuer son opposant pour assurer sa propre survie), un métier qui consiste à atteindre son objectif aux dépends de la vie de ses ennemis (et de ses propres soldats). L'action est prenante. le lecteur n'a pas la latitude d'éprouver de l'empathie pour cet homme froid, dépassionné, au comportement fonctionnel et efficace, ne tirant aucun plaisir, ni aucune satisfaction dans la tâche accomplie. La survie est la seule récompense, aussi primaire que vitale, la seule chose qui en fasse un être vivant.
Le début de la deuxième partie déconcerte par l'importance de la place accordée à Sam Wallace. le lecteur apprend en cours de route qu'il s'agit d'un ancien militaire revenu à la vie civile. Ennis oppose donc la vie du colonel qui a embrassé une carrière militaire de terrain, à celle de Wallace qui a abandonné la tenue kaki pour revenir à la vie civile. Autant l'attitude du colonel montre l'inanité et la futilité de sa vie professionnelle, autant le comportement de Wallace montre que son métier de shérif est tout aussi générateur de frustration et tout aussi inefficace pour changer le monde, ou tout du moins y apporter un peu d'amélioration.
Au milieu de ces thématiques très noires, Ennis enfonce le clou avec plusieurs évocations de conflits, et de morts de soldats, de civils, de massacres de peuples, dont une séquence onirique glaçante dans ce désert américain. À la première lecture, la mission finale du colonel russe peut sembler grossière et d'un symbolisme idiot (comme s'il suffisait d'abattre cette cible pour résoudre quoi que ce soit, ou même pour obtenir une vengeance). Mais une prise de recul permet de comprendre que l'objectif du colonel tenait autant de la vengeance que de la perpétuation de la guerre, conséquence logique de l'assassinat de sa cible. Ennis augmente encore d'un cran la noirceur du récit en enfonçant le clou : le savoir faire d'un soldat, son champ d'expertise, c'est de tuer l'ennemi, de donner la mort, de faire la guerre, voire de l'entretenir. La guerre est le métier du colonel russe, et il est expert dans sa partie, d'une efficacité sans faille, il donne la mort comme personne. Il est un des agents et des moteurs de la guerre.
Avatar a confié la mise en image de ce récit noir et sans espoir, à Jacen Burrows, un dessinateur ne travaillant que pour cet éditeur. Il avait auparavant dessiné Dark blue (2000) et Scars (2002/2003) de Warren Ellis, et "The courtyard" (2003, réédité dans Neonomicon) une adaptation d'un texte d'Alan Moore. Jacen Burrows réalise tous les contours des personnages comme des éléments de décors, en utilisant un trait assez fin, d'une épaisseur constante, sans variation qui transcrirait des reliefs ou une profondeur de champ, et sans presqu'aucun aplat de noir. Il revient donc aux metteurs en couleurs d'intégrer les notions de reliefs et de luminosité par le biais de variations de teintes dans les couleurs. Ils font preuve d'habilité dans le choix de leurs couleurs pour privilégier une teinte qui instaure l'ambiance de chaque scène. Par contre, malgré un outil informatique performant, ils n'arrivent pas à transcrire les volumes, répétant systématiquement les mêmes répartitions de couleurs, indépendamment des sources lumineuses (défaut particulièrement criant dans la manière de disposer les touches blanches sur les montagnes). Ils réussissent dont à nourrir les contours établis par Burrows, sans pallier l'absence de volume ou de relief.
En 2004/2005, Burrows est encore un dessinateur avec peu d'expérience et cela se ressent dans la qualité de ses dessins. Son découpage des séquences est très lisible et le trait fin uniforme assure une lecture rapide et une compréhension immédiate de chaque case. Au-delà de ces qualités, ces dessins restent très fonctionnels, sans qualité esthétique, sans nuances. Les expressions des visages sont toutes caricaturales, ne rendant compte que de 3 émotions (visage fermé indéchiffrable, surprise/étonnement, visage détendu sans émotion particulière). Au-delà des actions et des mouvements, le lecteur se retrouve dans l'impossibilité d'éprouver quelque émotion que ce soit pour les personnages qui eux-mêmes n'expriment rien. Burrows n'a aucune notion de langage corporel dans cette histoire. Ce manque de savoir faire aboutit à des images qui finissent par relever de l'amateurisme, le pire étant atteint pour le dessin en double page décrivant les clandestins en train de travailler dans l'intérieur de l'abattoir, une image descriptive dépourvue d'impact (malgré l'horreur des conditions de travail et la nature des tâches à exécuter) du fait de postures artificielles, et d'un aménagement ne correspondant à rien de réaliste.
Le manque de consistance des images atténue la force du récit de manière significative. Ennis a construit un récit en 2 temps un peu déconcertant dans sa structure (le personnage de Sam Wallace était-il vraiment indispensable ? Fallait-il vraiment incarner l'alternative de vie du colonel ?), d'une noirceur sans fond, avec de véritables audaces sur l'absence de justification de tuer son semblable même dans le cadre d'affrontements découlant d'un conflit armée. La fin de l'histoire promet un bain de sang à venir d'une ampleur sans précédant (une condamnation sans appel de la politique post 11 septembre), dans une perpétuation de l'état de guerre s'auto-entretenant. Mais le passage le plus cynique et cruel est peut-être dans ce débat télévisé où un intervenant défend l'impossibilité d'adopter une position de neutralité avec des arguments impossibles à réfuter. Malgré ses réels défauts, ce récit possède des qualités indéniables et Ennis propose un point de vue dérangeant au possible sur la guerre, les conflits armés, en tant que réalité inéluctable, consubstantielle des sociétés humaines.