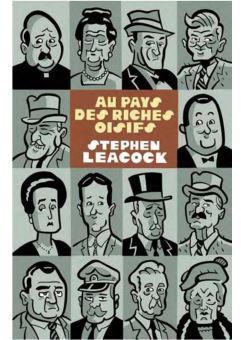>
Critique de CDemassieux
C'est l'histoire de Plutoria, une ville idéale des États-Unis – exclusivement dans les quartiers tenus par « l'élite des citoyens », car ailleurs vivent ces « larbins trop gâtés » qui, un jour, se « soulèveront contre la tyrannie des classes aisées », provoquant la chute d'une société si bien huilée, comme le souligne fort justement un homme bien né et révolté qu'on lui apporte des asperges froides.
Or donc, dans ce Pleasantville pour nantis, il existe une artère sacrée où toute la bonne société s'épanouit : Plutoria Avenue. Là se font les spéculations douteuses et les fusions non moins douteuses, qui frappent partout, même dans les églises, dont le produit des quêtes sert à gaver les détenteurs d'actions et obligations de cette entreprise finalement comme les autres. Ainsi, les aides aux pauvres ne sont plus des dons désintéressés mais des « charges ». Fallait y penser !
Parce que dans cet univers décomplexé de l'argent-roi, on peut bien perdre son temps mais pas son argent ! Sauf s'il s'agit d'une dématérialisation de bijoux pratiquée par un escroc aux pouvoirs « occultes » – on dit « désastraliser », ce qui est joliment formulé pour un vol ! Ces dames du beau monde sont effectivement prêtes à croire n'importe quelles sornettes bien maquillées pour tuer l'ennui. Un ennui qu'on traîne de somptueuses propriétés en très somptueuses propriétés, à la ville ou à la campagne, lorsqu'on est prêt, dans ce dernier cas, à « vivre à la dure » en se contentant d'un luxe (dé)raisonnable au beau milieu d'une nature privatisée.
Il se trouve bien, parfois, un révérend pour moraliser ce petit monde, prêchant avec une abnégation et un désintérêt qui forcent le respect, sauf quand on lui propose une place mieux rémunérée ailleurs et qu'il lance les enchères, ce qu'il appelle « attendre la lumière ». Quelle compréhension fine des Saintes Écritures ! Eh oui, tout est argent à Plutoria Avenue, même dans la maison de Dieu, où les fidèles s'inclinent, « le visage contrit, en songeant à toutes ces fusions qu'ils n'ont pas effectuées et à tous ces actifs immobiliers qu'ils n'ont pas acquis par manque de foi ». C'est beau le repentir, tout de même ! Quant aux indigents, on peut les traiter de « propres à rien », ça devient une « invective splendide ».
Et puis il y a l'université, dotée de grandes salles vides et de plus petites remplies à ras-bord, évoluant au gré de la folie des grandeurs de son recteur, avec des enseignants qui n'aiment pas les grands groupes d'étudiants et d'autres les petits, et surtout où il faut veiller à ne pas poser de questions aux éminents professeurs, certains d'entre eux risquant une crise d'apoplexie.
Parlons aussi de l'intérêt géologique de ces gens-là, lorsqu'ils croient trouver un gisement d'or sur le terrain d'un pauvre gars soudain enrichi et qui n'en demandait pas tant, à tel point qu'il fait tout son possible pour perdre sa fortune car sa colline et sa modeste demeure lui manquent. Un imbécile qui ignore les bienfaits de l'oisiveté opulente qu'on vient étaler dans le club du Mausolée et à l'hôtel Grand Palaver, en brassant du vent et toujours de l'argent.
Enfin, il y a l'apothéose du « Grand ménage », où l'auteur démonte les supercheries des puissants qui, sous couvert de moralisation de la vie politique – ça vous parle ?! –, s'arrogent le pouvoir politique pour l'extirper de la corruption qui le gangrène afin de lui substituer…une autre corruption ! Ceci, bien entendu, accompli dans les règles de l'art démocratique, ce qui donne « les élections les plus honnêtes et les plus libres jamais tenues dans la ville de Plutoria » où « des groupes d'étudiants armés de battes de base-ball entourèrent les bureaux de vote pour s'assurer que tout le monde jouerait franc-jeu ».
Vous l'aurez compris, ce roman truculent, commis par un professeur d'économie politique au début du XXe siècle, dresse une galerie de portraits hauts en couleur à seule fin de démontrer l'inanité du capitalisme débridé. Cependant, au lieu d'infliger un récit moralisateur, Stephen Leacock prend le parti d'en rire. Un rire qui nous fait grincer des dents, nous autres au XXIe siècle. Et de chanter en choeur le tube des Poppys : « Non, non, rien n'a changé »… !
Car cette horde de malfaisants propres sur eux règne encore sur nos têtes besogneuses et soumises à ce grand tout qu'est l'ultralibéralisme, dont on mesure année après année les bénéfices !
Dans sa postface datée de 1989 – en fin de volume –, Gerald Lynch résume remarquablement la démarche de Leacock, qui décrit si prophétiquement les maux dont nous sommes, aujourd'hui, accablés : « Au pays des riches oisifs nous révèle le genre de monde moderne qui résulte de la perte des valeurs non matérialistes, telles que le sens communautaire, la charité, le romantisme et la solidarité familiale. » C'est-à-dire un monde où tout se consomme et se pense en termes de profits.
Il n'empêche, c'est désespérant de lire un roman écrit il y a plus d'un siècle et de s'y voir dedans comme dans un miroir…
PS : la lecture de ce livre devrait être obligatoire pour tous ceux qui n'ont pas encore vendu leur conscience morale sur le Bon Coin !
(J'adresse mes remerciements à Babelio et aux éditions Wombat pour le présent ouvrage)
Or donc, dans ce Pleasantville pour nantis, il existe une artère sacrée où toute la bonne société s'épanouit : Plutoria Avenue. Là se font les spéculations douteuses et les fusions non moins douteuses, qui frappent partout, même dans les églises, dont le produit des quêtes sert à gaver les détenteurs d'actions et obligations de cette entreprise finalement comme les autres. Ainsi, les aides aux pauvres ne sont plus des dons désintéressés mais des « charges ». Fallait y penser !
Parce que dans cet univers décomplexé de l'argent-roi, on peut bien perdre son temps mais pas son argent ! Sauf s'il s'agit d'une dématérialisation de bijoux pratiquée par un escroc aux pouvoirs « occultes » – on dit « désastraliser », ce qui est joliment formulé pour un vol ! Ces dames du beau monde sont effectivement prêtes à croire n'importe quelles sornettes bien maquillées pour tuer l'ennui. Un ennui qu'on traîne de somptueuses propriétés en très somptueuses propriétés, à la ville ou à la campagne, lorsqu'on est prêt, dans ce dernier cas, à « vivre à la dure » en se contentant d'un luxe (dé)raisonnable au beau milieu d'une nature privatisée.
Il se trouve bien, parfois, un révérend pour moraliser ce petit monde, prêchant avec une abnégation et un désintérêt qui forcent le respect, sauf quand on lui propose une place mieux rémunérée ailleurs et qu'il lance les enchères, ce qu'il appelle « attendre la lumière ». Quelle compréhension fine des Saintes Écritures ! Eh oui, tout est argent à Plutoria Avenue, même dans la maison de Dieu, où les fidèles s'inclinent, « le visage contrit, en songeant à toutes ces fusions qu'ils n'ont pas effectuées et à tous ces actifs immobiliers qu'ils n'ont pas acquis par manque de foi ». C'est beau le repentir, tout de même ! Quant aux indigents, on peut les traiter de « propres à rien », ça devient une « invective splendide ».
Et puis il y a l'université, dotée de grandes salles vides et de plus petites remplies à ras-bord, évoluant au gré de la folie des grandeurs de son recteur, avec des enseignants qui n'aiment pas les grands groupes d'étudiants et d'autres les petits, et surtout où il faut veiller à ne pas poser de questions aux éminents professeurs, certains d'entre eux risquant une crise d'apoplexie.
Parlons aussi de l'intérêt géologique de ces gens-là, lorsqu'ils croient trouver un gisement d'or sur le terrain d'un pauvre gars soudain enrichi et qui n'en demandait pas tant, à tel point qu'il fait tout son possible pour perdre sa fortune car sa colline et sa modeste demeure lui manquent. Un imbécile qui ignore les bienfaits de l'oisiveté opulente qu'on vient étaler dans le club du Mausolée et à l'hôtel Grand Palaver, en brassant du vent et toujours de l'argent.
Enfin, il y a l'apothéose du « Grand ménage », où l'auteur démonte les supercheries des puissants qui, sous couvert de moralisation de la vie politique – ça vous parle ?! –, s'arrogent le pouvoir politique pour l'extirper de la corruption qui le gangrène afin de lui substituer…une autre corruption ! Ceci, bien entendu, accompli dans les règles de l'art démocratique, ce qui donne « les élections les plus honnêtes et les plus libres jamais tenues dans la ville de Plutoria » où « des groupes d'étudiants armés de battes de base-ball entourèrent les bureaux de vote pour s'assurer que tout le monde jouerait franc-jeu ».
Vous l'aurez compris, ce roman truculent, commis par un professeur d'économie politique au début du XXe siècle, dresse une galerie de portraits hauts en couleur à seule fin de démontrer l'inanité du capitalisme débridé. Cependant, au lieu d'infliger un récit moralisateur, Stephen Leacock prend le parti d'en rire. Un rire qui nous fait grincer des dents, nous autres au XXIe siècle. Et de chanter en choeur le tube des Poppys : « Non, non, rien n'a changé »… !
Car cette horde de malfaisants propres sur eux règne encore sur nos têtes besogneuses et soumises à ce grand tout qu'est l'ultralibéralisme, dont on mesure année après année les bénéfices !
Dans sa postface datée de 1989 – en fin de volume –, Gerald Lynch résume remarquablement la démarche de Leacock, qui décrit si prophétiquement les maux dont nous sommes, aujourd'hui, accablés : « Au pays des riches oisifs nous révèle le genre de monde moderne qui résulte de la perte des valeurs non matérialistes, telles que le sens communautaire, la charité, le romantisme et la solidarité familiale. » C'est-à-dire un monde où tout se consomme et se pense en termes de profits.
Il n'empêche, c'est désespérant de lire un roman écrit il y a plus d'un siècle et de s'y voir dedans comme dans un miroir…
PS : la lecture de ce livre devrait être obligatoire pour tous ceux qui n'ont pas encore vendu leur conscience morale sur le Bon Coin !
(J'adresse mes remerciements à Babelio et aux éditions Wombat pour le présent ouvrage)