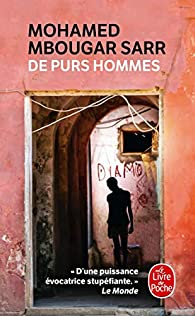>
Critique de 4bis
Comme beaucoup, j'imagine, j'ai découvert Mohamed Mbougar Sarr depuis que La plus secrète mémoire des hommes a obtenu le Goncourt. Quelques-uns, ici et là, m'ayant recommandé la lecture de purs hommes, c'est donc par ce roman que j'ai poursuivi ma rencontre avec ce jeune auteur. J'étais curieuse de savoir si je retrouverais là le style puissant mais parfois un peu enflé qui anime son roman primé. Et j'avais entendu parler de la polémique qui a resurgi au Sénégal autour de l'apologie que ferait Mbougar Sarr de l'homosexualité.
Avec tant d'attentes et de biais de lecture, j'aurais pu être déçue. Il n'en a rien été. le roman est beaucoup plus sobre dans son écriture mais on trouve déjà à l'oeuvre les grands motifs de la plus secrète mémoire des hommes : quête identitaire, écartèlement entre les attentes de la société et les impressions intimes, tourments à savoir ce qu'être juste veut dire. En un certain sens, c'est presque deux fois le même roman. Ou deux variations de la même partition, l'une avec l'écriture comme thème et l'autre non pas l'homosexualité mais plutôt le rapport entre destinée individuelle et regard social normatif.
C'est ce qui m'a plu d'ailleurs, que ce ne soit pas bêtement une apologie de la tolérance pour toutes les pratiques et orientations sexuelles. Que l'universalisme des valeurs soit bien plus subtilement interrogé. le personnage du professeur M Coly l'explique d'ailleurs très bien : la culture sénégalaise faisait une place aux pratiques homosexuelles dans son fonctionnement traditionnel. C'est la flamboyance provocatrices des pratiques homosexuelles à l'occidentale qui ont crispé les esprits et rompu le fragile équilibre de tolérance. Evidemment, il ne faudrait pas comprendre que l'homosexualité ne peut être que tolérée à la marge. Mais plutôt que la manière différente d'aborder ces orientations sexuelles individuelles entre deux sociétés ne pose problème qu'à partir du moment où les deux modèles entrent en collision, voire lorsque l'un s'arroge une supériorité morale sur l'autre. Encore une fois, c'est bien de colonisation des esprits et de difficile quête identitaire qu'il s'agit ici.
J'ai aimé aussi l'ambivalence que recouvre le terme de goor-jigéen, « homme-femme » : travesti, homosexuel, la distinction n'est pas précise et le fait qu'elle n'ait pas besoin de l'être montre aussi une culture où il n'est pas besoin de rentrer dans ces détails là pour trouver une place à qui n'affiche pas exactement ce que la religion musulmane telle qu'elle est pratiquée au Sénégal attendrait d'un bon croyant. Dans l'hypothèse où il y aurait eu, avant l'influence occidentale, une effective acceptation de ces goor-jigéen, qui auraient eu leur place et auraient bénéficié d'une forme d'acceptation, c'est intéressant aussi d'imaginer qu'on ne soit pas obligé de rentrer minutieusement dans la taxinomie des comportements. Que la société recouvre d'un seul terme ce qu'elle peut ostensiblement voir, un homme qui a aussi l'apparence d'une femme, et qu'elle ne cherche pas à clarifier ce qu'une telle allure signifie de ses pratiques intimes. Une forme de pudeur possible, d'intimité préservée du regard publique.
Pour amener à cette réflexion, le roman met en scène différents moments cruciaux : l'exhumation, la visite à la mère du défunt maudit, le reniement par le père du narrateur, la tentation, le sacrifice ultime. La dimension christique de l'itinéraire ainsi parcouru est évidente. C'est ce qui fait peut-être de de purs hommes un livre juste, une prise de position courageuse qui brille davantage par la pertinence de son analyse que par la subtilité des moyens utilisés pour la soumettre à son lecteur.
Avec tant d'attentes et de biais de lecture, j'aurais pu être déçue. Il n'en a rien été. le roman est beaucoup plus sobre dans son écriture mais on trouve déjà à l'oeuvre les grands motifs de la plus secrète mémoire des hommes : quête identitaire, écartèlement entre les attentes de la société et les impressions intimes, tourments à savoir ce qu'être juste veut dire. En un certain sens, c'est presque deux fois le même roman. Ou deux variations de la même partition, l'une avec l'écriture comme thème et l'autre non pas l'homosexualité mais plutôt le rapport entre destinée individuelle et regard social normatif.
C'est ce qui m'a plu d'ailleurs, que ce ne soit pas bêtement une apologie de la tolérance pour toutes les pratiques et orientations sexuelles. Que l'universalisme des valeurs soit bien plus subtilement interrogé. le personnage du professeur M Coly l'explique d'ailleurs très bien : la culture sénégalaise faisait une place aux pratiques homosexuelles dans son fonctionnement traditionnel. C'est la flamboyance provocatrices des pratiques homosexuelles à l'occidentale qui ont crispé les esprits et rompu le fragile équilibre de tolérance. Evidemment, il ne faudrait pas comprendre que l'homosexualité ne peut être que tolérée à la marge. Mais plutôt que la manière différente d'aborder ces orientations sexuelles individuelles entre deux sociétés ne pose problème qu'à partir du moment où les deux modèles entrent en collision, voire lorsque l'un s'arroge une supériorité morale sur l'autre. Encore une fois, c'est bien de colonisation des esprits et de difficile quête identitaire qu'il s'agit ici.
J'ai aimé aussi l'ambivalence que recouvre le terme de goor-jigéen, « homme-femme » : travesti, homosexuel, la distinction n'est pas précise et le fait qu'elle n'ait pas besoin de l'être montre aussi une culture où il n'est pas besoin de rentrer dans ces détails là pour trouver une place à qui n'affiche pas exactement ce que la religion musulmane telle qu'elle est pratiquée au Sénégal attendrait d'un bon croyant. Dans l'hypothèse où il y aurait eu, avant l'influence occidentale, une effective acceptation de ces goor-jigéen, qui auraient eu leur place et auraient bénéficié d'une forme d'acceptation, c'est intéressant aussi d'imaginer qu'on ne soit pas obligé de rentrer minutieusement dans la taxinomie des comportements. Que la société recouvre d'un seul terme ce qu'elle peut ostensiblement voir, un homme qui a aussi l'apparence d'une femme, et qu'elle ne cherche pas à clarifier ce qu'une telle allure signifie de ses pratiques intimes. Une forme de pudeur possible, d'intimité préservée du regard publique.
Pour amener à cette réflexion, le roman met en scène différents moments cruciaux : l'exhumation, la visite à la mère du défunt maudit, le reniement par le père du narrateur, la tentation, le sacrifice ultime. La dimension christique de l'itinéraire ainsi parcouru est évidente. C'est ce qui fait peut-être de de purs hommes un livre juste, une prise de position courageuse qui brille davantage par la pertinence de son analyse que par la subtilité des moyens utilisés pour la soumettre à son lecteur.