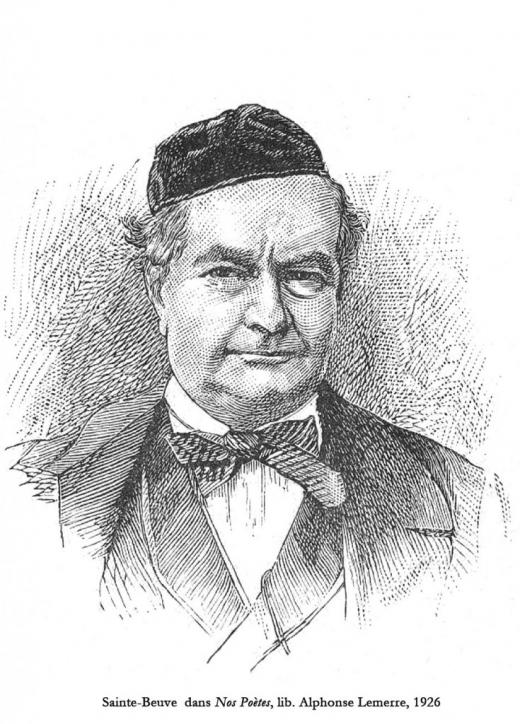Citation de EtienneBernardLivres
La Chartreuse de Parme (1839) est de tous les romans de Beyle celui qui a donné à quelques personnes la plus grande idée de son talent dans ce genre.
Le début est plein de grâce et d’un vrai charme. On y voit Milan depuis 1796, époque de la première campagne d’Italie, jusqu’en 1813, la fin des beaux jours de la Cour du prince Eugène.
C’est une idée heureuse que celle de ce jeune Fabrice, enthousiaste de la gloire, qui, à la nouvelle du débarquement de Napoléon en 1815, se sauve de chez son père avec l’agrément de sa mère et de sa tante pour aller combattre en France sous les aigles reparues.
Son odyssée bizarre a pourtant beaucoup de naturel ; il existe an anglais un livre qui a donné à Beyle son idée : ce sont les Mémoires d’un soldat du 71e régiment qui a assisté à la bataille de Vittoria sans y rien comprendre, à peu près comme Fabrice assise à celle de Waterloo en se demandant après si c’est bien à une bataille qu’il s’est trouvé et s’il peut dire qu’il se soit réellement battu.
Beyle a combiné avec les souvenirs de sa lecture d’autres souvenirs personnels de sa jeunesse, quand il parvenait à cheval de Genève pour assister à la bataille de Marengo.
J’aime beaucoup ce commencement ; je n’en dirai pas autant de ce qui suit.
Le roman est moins un roman que des mémoires sur la vie de Fabrice et de sa tante, madame de Pietranera, devenue duchesse de Sansevrina.
La morale italienne, dont Beyle abuse un peu, est décidément trop loin de la nôtre.
Fabrice, d’après ces débuts et son éclair d’enthousiasme en 1815, pouvait devenir un de ces italiens distingués, de ces libéraux aristocrates, nobles amis d’une régénération peut-être impossible, mais tenant par leurs voeux, par leurs études et par la générosité de leurs désirs, à ce qui nous élève en idée et à ce que nous comprenons (Santa-Rosa, Cesare Balbo, Capponi).
Mais Beyle, en posant ainsi son héros, aurait eu trop peur de retomber dans le lieu commun d’en deçà des Alpes.
Il a fait de Fabrice un italien de pur sang, tel qu’il le conçoit, destiné sans vocation à devenir archevêque, bientôt coadjuteur, médiocrement et mollement spirituel, libertin, faible (lâche, on peut dire), courant chaque matin à la chasse du bonheur ou du plaisir, amoureux d’une Marietta, comédienne de campagne, s’affichant avec elle sans honte, sans égards pour lui-même et pour son état, sans délicatesse pour sa famille et pour cette tante qui l’aime trop.
Je sais bien que Beyle a posé en principe qu’un Italien pur ne ressemble en rien à un Français et n’a pas de vanité, qu’il ne feint pas l’amour quand il ne le ressent pas, qu’il ne cherche ni à plaire, ni à étonner, ni à paraître, et qu’il se contente d’être lui-même en liberté ; mais ce que Fabrice est et parait dans presque tout le roman, malgré son visage et sa jolie tournure, est fort laid, fort plat, fort vulgaire ; il ne se conduit nulle part comme un homme, mais comme un animal livré à ses appétits, ou un enfant libertin qui suit ses caprices.
Aucune morale, aucun principe d’honneur : il est seulement déterminé à ne pas simuler de l’amour quand il n’en a pas ; de même qu’à la fin, quand cet amour lui est venu pour Clélia, la fille du triste général Fabio Conti, il y sacrifiera tout, même la délicatesse et la reconnaissance envers sa tante.
Beyle, dans ses écrits antérieurs, a donné la définition de l’amour passionné qu’il attribue presque en propre à l’Italien et aux natures du Midi : Fabrice est un personnage à l’appui de sa théorie ; il le fait sortir chaque matin à la recherche de cet amour, et ce n’est que tout à la fin qu’il le lui fait éprouver ; celui-ci alors y sacrifie tout, comme du reste il faisait précédemment au plaisir.
Les jolies descriptions de paysage, les vues si bien présentées du lac de Côme et de ses environs, ne sauraient par leur cadre et leur reflet ennoblir un personnage si peu digne d’intérêt, si peu formé pour l’honneur, et si prêt à tout faire, même à assassiner, pour son utilité du moment et sa passion.
Il y a un moment où Fabrice tue quelqu’un, en effet ; il est vrai que, cette fois, c’est à son corps défendant. Il se bat d’une manière assez ignoble sur la grande route avec un certain Giletti, comédien et protecteur de la Marietta dont Fabrice est l’ami de choix.
S’il fallait discuter la vraisemblance de l’action dans le roman, on pourrait se demander comment il se fait que cet accident de grande route ait une si singulière influence sur la destinée future de Fabrice ; on se demanderait pourquoi celui-ci, ami (ou qui peut se croire tel) du prince de Parme et de son premier ministre, coadjuteur et très en crédit dans ce petit Etat, prend la fuite comme un malfaiteur, parce qu’il lui est arrivé de tuer devant témoins, en se défendant, un comédien de bas étage qui l’a menacé et attaqué le premier.
La conduite de Fabrice, sa fuite extravagante, et les conséquences que l’auteur en a tirées, seraient inexplicables si l’on recherchait, je le répète, la vraisemblance et la suite dans ce roman, qui n’est guère d’un bout à l’autre (j’en excepte le commencement) qu’une spirituelle mascarade italienne.
Les scènes de passion, dont quelques-unes sont assez belles, entre la duchesse tante de Fabrice et la jeune Clélia, ne rachètent qu’à demi ces impossibilités qui sautent aux yeux et qui heurtent le bon sens.
La part de vérité de détail, qui peut y être mêlée, ne me fera jamais prendre ce monde-là pour être chose que pour un monde de fantaisie, fabriqué tout autant qu’observé par un homme de beaucoup d’esprit qui fait, à sa manière, du marivaudage italien.
Le début est plein de grâce et d’un vrai charme. On y voit Milan depuis 1796, époque de la première campagne d’Italie, jusqu’en 1813, la fin des beaux jours de la Cour du prince Eugène.
C’est une idée heureuse que celle de ce jeune Fabrice, enthousiaste de la gloire, qui, à la nouvelle du débarquement de Napoléon en 1815, se sauve de chez son père avec l’agrément de sa mère et de sa tante pour aller combattre en France sous les aigles reparues.
Son odyssée bizarre a pourtant beaucoup de naturel ; il existe an anglais un livre qui a donné à Beyle son idée : ce sont les Mémoires d’un soldat du 71e régiment qui a assisté à la bataille de Vittoria sans y rien comprendre, à peu près comme Fabrice assise à celle de Waterloo en se demandant après si c’est bien à une bataille qu’il s’est trouvé et s’il peut dire qu’il se soit réellement battu.
Beyle a combiné avec les souvenirs de sa lecture d’autres souvenirs personnels de sa jeunesse, quand il parvenait à cheval de Genève pour assister à la bataille de Marengo.
J’aime beaucoup ce commencement ; je n’en dirai pas autant de ce qui suit.
Le roman est moins un roman que des mémoires sur la vie de Fabrice et de sa tante, madame de Pietranera, devenue duchesse de Sansevrina.
La morale italienne, dont Beyle abuse un peu, est décidément trop loin de la nôtre.
Fabrice, d’après ces débuts et son éclair d’enthousiasme en 1815, pouvait devenir un de ces italiens distingués, de ces libéraux aristocrates, nobles amis d’une régénération peut-être impossible, mais tenant par leurs voeux, par leurs études et par la générosité de leurs désirs, à ce qui nous élève en idée et à ce que nous comprenons (Santa-Rosa, Cesare Balbo, Capponi).
Mais Beyle, en posant ainsi son héros, aurait eu trop peur de retomber dans le lieu commun d’en deçà des Alpes.
Il a fait de Fabrice un italien de pur sang, tel qu’il le conçoit, destiné sans vocation à devenir archevêque, bientôt coadjuteur, médiocrement et mollement spirituel, libertin, faible (lâche, on peut dire), courant chaque matin à la chasse du bonheur ou du plaisir, amoureux d’une Marietta, comédienne de campagne, s’affichant avec elle sans honte, sans égards pour lui-même et pour son état, sans délicatesse pour sa famille et pour cette tante qui l’aime trop.
Je sais bien que Beyle a posé en principe qu’un Italien pur ne ressemble en rien à un Français et n’a pas de vanité, qu’il ne feint pas l’amour quand il ne le ressent pas, qu’il ne cherche ni à plaire, ni à étonner, ni à paraître, et qu’il se contente d’être lui-même en liberté ; mais ce que Fabrice est et parait dans presque tout le roman, malgré son visage et sa jolie tournure, est fort laid, fort plat, fort vulgaire ; il ne se conduit nulle part comme un homme, mais comme un animal livré à ses appétits, ou un enfant libertin qui suit ses caprices.
Aucune morale, aucun principe d’honneur : il est seulement déterminé à ne pas simuler de l’amour quand il n’en a pas ; de même qu’à la fin, quand cet amour lui est venu pour Clélia, la fille du triste général Fabio Conti, il y sacrifiera tout, même la délicatesse et la reconnaissance envers sa tante.
Beyle, dans ses écrits antérieurs, a donné la définition de l’amour passionné qu’il attribue presque en propre à l’Italien et aux natures du Midi : Fabrice est un personnage à l’appui de sa théorie ; il le fait sortir chaque matin à la recherche de cet amour, et ce n’est que tout à la fin qu’il le lui fait éprouver ; celui-ci alors y sacrifie tout, comme du reste il faisait précédemment au plaisir.
Les jolies descriptions de paysage, les vues si bien présentées du lac de Côme et de ses environs, ne sauraient par leur cadre et leur reflet ennoblir un personnage si peu digne d’intérêt, si peu formé pour l’honneur, et si prêt à tout faire, même à assassiner, pour son utilité du moment et sa passion.
Il y a un moment où Fabrice tue quelqu’un, en effet ; il est vrai que, cette fois, c’est à son corps défendant. Il se bat d’une manière assez ignoble sur la grande route avec un certain Giletti, comédien et protecteur de la Marietta dont Fabrice est l’ami de choix.
S’il fallait discuter la vraisemblance de l’action dans le roman, on pourrait se demander comment il se fait que cet accident de grande route ait une si singulière influence sur la destinée future de Fabrice ; on se demanderait pourquoi celui-ci, ami (ou qui peut se croire tel) du prince de Parme et de son premier ministre, coadjuteur et très en crédit dans ce petit Etat, prend la fuite comme un malfaiteur, parce qu’il lui est arrivé de tuer devant témoins, en se défendant, un comédien de bas étage qui l’a menacé et attaqué le premier.
La conduite de Fabrice, sa fuite extravagante, et les conséquences que l’auteur en a tirées, seraient inexplicables si l’on recherchait, je le répète, la vraisemblance et la suite dans ce roman, qui n’est guère d’un bout à l’autre (j’en excepte le commencement) qu’une spirituelle mascarade italienne.
Les scènes de passion, dont quelques-unes sont assez belles, entre la duchesse tante de Fabrice et la jeune Clélia, ne rachètent qu’à demi ces impossibilités qui sautent aux yeux et qui heurtent le bon sens.
La part de vérité de détail, qui peut y être mêlée, ne me fera jamais prendre ce monde-là pour être chose que pour un monde de fantaisie, fabriqué tout autant qu’observé par un homme de beaucoup d’esprit qui fait, à sa manière, du marivaudage italien.