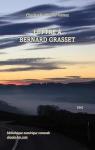Citation de dourvach
« Nous n’avons pas eu de 17ème siècle ; car alors nous étions Bernois, c’est-à-dire complètement muets, inexistants. Et c’est précisément pendant ce temps, que la langue « française » prenait sa forme définitive. J’aime votre 17ème siècle, j’aime le français, un certain « français » dont il a définitivement sanctionné l’usage, mais n’y puis voir pourtant (parce que je viens du dehors) qu’un phénomène tout occasionnel, tout contingent (qui aurait pu ne pas se produire), et qui précisément, pour ce qui est de nous et de moi, ne s’est pas produit. Précisément pour ces mêmes raisons, je me refuse de voir dans cette langue « classique » la langue unique, ayant servi, devant servir encore, en tant que langue codifiée une fois pour toutes, à tous ceux qui s’expriment en français.
Car il y a eu, il y a encore des centaines de français ; qui, bien mieux, sont sans cesse en train de se défaire et de se refaire, c’est-à-dire vivent, c’est-à-dire deviennent tandis qu’elle (cette langue « littéraire ») tend de plus en plus à s’immobiliser et à mourir, imposant arbitrairement à ceux qui s’en servent, tout un ensemble de règles.
J’aurais voulu montrer qu’elles étaient l’émanation d’une société qui n’était plus la nôtre, qu’elle a exprimé vraiment une hiérarchie humaine, une hiérarchie naturellement acceptée dans les idées et dans les mœurs. Et admettons encore que ce français dit « classique » soit valable même aujourd’hui pour un certain nombre de Français, il n’en reste pas moins que je ne vois pas très bien comment il serait valable pour moi : il nous faut l’apprendre.
Le pays qui est le mien parle « son » français de plein droit parce que c’est sa langue maternelle, qu’il n’a pas besoin de l’apprendre, qu’il le tire d’une chair vivante. Et mon pays a eu deux langues : une qu’il lui fallait apprendre, l’autre dont il se servait par droit de naissance. Il a longtemps parlé son patois (son patois franco-provençal) ; puis, sous l’influence de l’école, comme beaucoup d’autres provinces, il l’a peu à peu abandonné, mais sans perdre son accent, de sorte qu’il parle avec l’accent vaudois un certain français redevenu très authentiquement vaudois quand même ; plein de tournures, plein de mots à lui, et bien entendu par rapport au français de l’école « plein de fautes ».
Je me rappelle l’inquiétude qui s’était emparée de moi en voyant combien ce fameux « bon français » était incapable de nous exprimer et de m’exprimer, parce qu’il y avait traduction et traduction mal réussie. Je me suis mis à essayer d’écrire comme ils (les paysans, les gens du peuple) parlaient, parce qu’ils parlaient bien, parlant eux-mêmes sans modèles ; à tâcher de les exprimer comme eux-mêmes s’étaient exprimés, de les exprimer par des mots comme ils s’étaient exprimés par des gestes, par des mots qui fussent encore des gestes, leurs gestes.
Cette langue-suite-de-gestes, où la logique cède le pas au rythme même des images, n’est pas très loin de ce que cherche à réaliser avec ses moyens à lui le cinéma. Ces critiques qu’on me fait sont peut-être bien, tout au fond, plus sociales que littéraires ou esthétiques : on fait valoir en somme que j’appartiens à une « classe », que je suis devenu un bourgeois, que je suis devenu un « lettré », que je n’ai pas le droit de me déclasser volontairement. Ce qui suppose qu’un intellectuel est nécessairement supérieur à un non-intellectuel en ce qu’il a appris plus de choses. »
[C.F. RAMUZ, "Lettre à Bernard Grasset", 1941 - publié par la Librairie numérique romande (e-books)]
Car il y a eu, il y a encore des centaines de français ; qui, bien mieux, sont sans cesse en train de se défaire et de se refaire, c’est-à-dire vivent, c’est-à-dire deviennent tandis qu’elle (cette langue « littéraire ») tend de plus en plus à s’immobiliser et à mourir, imposant arbitrairement à ceux qui s’en servent, tout un ensemble de règles.
J’aurais voulu montrer qu’elles étaient l’émanation d’une société qui n’était plus la nôtre, qu’elle a exprimé vraiment une hiérarchie humaine, une hiérarchie naturellement acceptée dans les idées et dans les mœurs. Et admettons encore que ce français dit « classique » soit valable même aujourd’hui pour un certain nombre de Français, il n’en reste pas moins que je ne vois pas très bien comment il serait valable pour moi : il nous faut l’apprendre.
Le pays qui est le mien parle « son » français de plein droit parce que c’est sa langue maternelle, qu’il n’a pas besoin de l’apprendre, qu’il le tire d’une chair vivante. Et mon pays a eu deux langues : une qu’il lui fallait apprendre, l’autre dont il se servait par droit de naissance. Il a longtemps parlé son patois (son patois franco-provençal) ; puis, sous l’influence de l’école, comme beaucoup d’autres provinces, il l’a peu à peu abandonné, mais sans perdre son accent, de sorte qu’il parle avec l’accent vaudois un certain français redevenu très authentiquement vaudois quand même ; plein de tournures, plein de mots à lui, et bien entendu par rapport au français de l’école « plein de fautes ».
Je me rappelle l’inquiétude qui s’était emparée de moi en voyant combien ce fameux « bon français » était incapable de nous exprimer et de m’exprimer, parce qu’il y avait traduction et traduction mal réussie. Je me suis mis à essayer d’écrire comme ils (les paysans, les gens du peuple) parlaient, parce qu’ils parlaient bien, parlant eux-mêmes sans modèles ; à tâcher de les exprimer comme eux-mêmes s’étaient exprimés, de les exprimer par des mots comme ils s’étaient exprimés par des gestes, par des mots qui fussent encore des gestes, leurs gestes.
Cette langue-suite-de-gestes, où la logique cède le pas au rythme même des images, n’est pas très loin de ce que cherche à réaliser avec ses moyens à lui le cinéma. Ces critiques qu’on me fait sont peut-être bien, tout au fond, plus sociales que littéraires ou esthétiques : on fait valoir en somme que j’appartiens à une « classe », que je suis devenu un bourgeois, que je suis devenu un « lettré », que je n’ai pas le droit de me déclasser volontairement. Ce qui suppose qu’un intellectuel est nécessairement supérieur à un non-intellectuel en ce qu’il a appris plus de choses. »
[C.F. RAMUZ, "Lettre à Bernard Grasset", 1941 - publié par la Librairie numérique romande (e-books)]