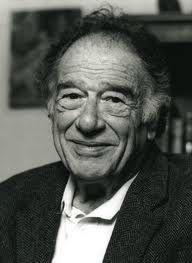Citation de Partemps
2/RM : En 2006, vous avez publié un livre la Malscène, comme un cri de colère face à des productions qui dénaturaient les œuvres que nous aimions. Cet hiver deux productions avec le même metteur en scène, Benjamin Lazar, Il Sant’Alessio sous la direction artistique de William Christie et Cadmus et Hermione sous la direction artistique de Vincent Dumestre, vous redonnent-elles l’espoir d’un renouveau ?
PB : Philippe Lénaël, il y a 20 ans, avait tenté la même expérience que Benjamin Lazar, mais à l’époque il n’y avait pas le public pour cela. Aujourd’hui, sur la plupart des grandes scènes nationales, le public siffle le metteur en scène. Il se montre exigeant, il est demandeur. Mais cela dépendra surtout des directeurs de théâtre. Mon expérience du Théâtre baroque de France a été un échec, contrairement au Cmbv dans la mesure où il était totalement à contre-courant. Jamais un représentant du Ministère de la Culture de ces années là ne s’y est intéréssé. Un certain nombre de spectacles à venir semble nous annoncer une éclaircie, mais sera-t-elle durable, les directeurs de théâtre entendront-ils les attentes des spectateurs ? Il est certain en tout cas que le public baroque est là et de plus en plus large.
RM : Vous avez connu et accompagné la première renaissance du baroque ? La génération actuelle c’est un peu vos enfants ?
PB : « Mes petits-enfants » vous voulez dire. J’ai eu la chance de connaître toutes les générations qui ont fait le renouveau baroque. Celui qui m’a le plus marqué, c’est bien sûr Jean- Claude Malgoire. Un jour, j’entre durant une répétition d’Alceste dans l’Eglise de Saint-Maximin. Cela a été le choc de ma vie. Et j’insiste, cette rencontre avec Lully et Malgoire a vraiment été le choc de ma vie. Cela dit tous les « anciens » méritent d’être cités : de Jordi Savall à Herreweghe de Leonhardt à Christie en passant par Jacobs et Minkowski.
La génération actuelle est inventive. Elle a retrouvé quelque chose de spécifique au baroque, sa diversité, sa vivacité. Elle ne s’arrête pas aux grands noms du baroque et souhaite redécouvrir tous les baroques.
RM : Quels territoires baroques restent-ils à explorer selon vous ?
PB : Plein. On n’a pas entendu tout Lully. Je m’étonne et m’émerveille aussi de cette Europe Baroque. Schutz fait le voyage de Venise pour entendre Monteverdi et suivre son enseignement. En retour, il transpose dans son austère pensée luthérienne ce que l’Italie catholique plus expansive lui avait appris. Et puis, il y a Telemann qui a écrit plus d’ouvertures à la française que tous les compositeurs français de son époque.
Il y a également l’influence du baroque espagnol via l’Italie.
RM : L’ingrédient secret qui rend vos livres si fluides à la lecture ?
PB : Je n’écris que sur des choses que j’aime. Je suis un vieux prof. Une de mes anciennes élèves (de 4e /3e, vous voyez cela ne date pas d’hier), m’a dit un jour qu’à l’époque où j’étais son professeur, elle sentait la différence entre les cours où je parlais de ce que j’aimais et ceux où je m’ennuyais. Je parle et j’écris ce que j’aime et j’aime ce que j’écris.
RM : Qu’est-ce qui vous a intéressé dans l’Orfeo de Monteverdi ?
PB : Il est celui que je ressens en ce moment, celui dont je me sens le plus proche
RM : Vous avez beaucoup écrit sur Louis XIV et lors du colloque sur le Prince et la Musique, à Versailles cet automne, je vous ai senti presque déçu, lorsque les orateurs disaient que le goût du Roi, ne révélait en rien sa personnalité ? Pourquoi ce roi ? Quel secret cache-t-il ?
PB : Je vais essayer de résumer cela en quelques mots. Il faut souligner tout d’abord qu’il ne s’est guère trompé, contrairement à ce qu’on peut croire, dans ses choix. Je prends un ou deux exemples. Tout le monde adorait Thomas Corneille et Philippe Quinault mais Louis préférait Pierre Corneille et Racine. Ce n’est pas une erreur et il en est de même dans beaucoup d’autres domaines. Que ce soit son goût personnel ou lorsqu’il agit en position de chef d’état, qui a de bons conseillers, ce qui somme toute est parfaitement normal pour un chef d’état, il y a certainement un lien entre son goût personnel et l’influence de ses conseillers. Par ailleurs, il accompagne malgré tout l’évolution du goût de son temps. Ce qui a l’air contradictoire avec ce que je viens de dire, mais en fait ne l’est qu’à moitié. Les arts, tous les arts évoluent, changent. Quant on est un personnage qui règne jusqu’à l’âge de 75 ans, il est normal que l’on bouge. Ce que je veux dire par là, c’est que le jeune Louis XIV de 20 ans qui danse des ballets de cour est exactement dans le goût de ses contemporains, de son temps. Il n’a pas beaucoup pratiqué les arts à quelques détails prêts : la guitare et la danse. Mais, tout laisse supposer qu’il a été un virtuose de la danse et lorsqu’en 1670, il arrête de danser, il a 35 ans, l’âge de la retraite dans ce « métier » là. Il aime le ballet de cour quand il a 20 ans, il aime l’opéra quand il en a 35/40, il aime la tragédie et plus tard il va aimer François Couperin (c’est ce dernier qui l’écrit dans une préface), qui jouera le dimanche dans la chambre du Roi. Louis XIV accompagne l’évolution de l’art de son temps.
Enfin, il faut souligner qu’en ce qui concerne la danse et ce que l’on sait de sa manière de jouer de la guitare, il était bon. Louis XIV artiste, je le crois profondément. Trouvez-moi une grave erreur dans ce qu’il a fait dans ses choix, concernant les arts de son temps. Construire Versailles, était-ce une erreur ? Rire avec Molière puis se passionner pour Racine (et Esther), était-ce une erreur ? A mon avis, non !
Il y a bien une ombre au soleil, il faut bien qu’il y en ait une que je subodore sans pouvoir aller jusqu’au bout, j’en parle au début de Louis XIV, artiste. Il est curieux de voir que Molière que Louis XIV a adoré et soutenu profondément, y compris dans l’épisode de Tartuffe ce qui n’était pas évident … On a l’impression que dans sa dernière année, il l’a complètement délaissé. Louis XIV ne lui fait aucune commande en 73, le Malade Imaginaire ne sera pas représenté à Versailles du vivant de Molière. Il me semble que Molière meurt assez désespéré de cette sorte d’abandon et ce sera exactement la même chose avec Lully. Et le plus étrange, c’est que celle que l’on a accusé d’être parfois responsable de l’abandon de la fête à Versailles, Mme de Maintenon, ramènera Louis XIV à son goût pour la tragédie, chrétienne certes, avec Esther de Racine.
PB : Philippe Lénaël, il y a 20 ans, avait tenté la même expérience que Benjamin Lazar, mais à l’époque il n’y avait pas le public pour cela. Aujourd’hui, sur la plupart des grandes scènes nationales, le public siffle le metteur en scène. Il se montre exigeant, il est demandeur. Mais cela dépendra surtout des directeurs de théâtre. Mon expérience du Théâtre baroque de France a été un échec, contrairement au Cmbv dans la mesure où il était totalement à contre-courant. Jamais un représentant du Ministère de la Culture de ces années là ne s’y est intéréssé. Un certain nombre de spectacles à venir semble nous annoncer une éclaircie, mais sera-t-elle durable, les directeurs de théâtre entendront-ils les attentes des spectateurs ? Il est certain en tout cas que le public baroque est là et de plus en plus large.
RM : Vous avez connu et accompagné la première renaissance du baroque ? La génération actuelle c’est un peu vos enfants ?
PB : « Mes petits-enfants » vous voulez dire. J’ai eu la chance de connaître toutes les générations qui ont fait le renouveau baroque. Celui qui m’a le plus marqué, c’est bien sûr Jean- Claude Malgoire. Un jour, j’entre durant une répétition d’Alceste dans l’Eglise de Saint-Maximin. Cela a été le choc de ma vie. Et j’insiste, cette rencontre avec Lully et Malgoire a vraiment été le choc de ma vie. Cela dit tous les « anciens » méritent d’être cités : de Jordi Savall à Herreweghe de Leonhardt à Christie en passant par Jacobs et Minkowski.
La génération actuelle est inventive. Elle a retrouvé quelque chose de spécifique au baroque, sa diversité, sa vivacité. Elle ne s’arrête pas aux grands noms du baroque et souhaite redécouvrir tous les baroques.
RM : Quels territoires baroques restent-ils à explorer selon vous ?
PB : Plein. On n’a pas entendu tout Lully. Je m’étonne et m’émerveille aussi de cette Europe Baroque. Schutz fait le voyage de Venise pour entendre Monteverdi et suivre son enseignement. En retour, il transpose dans son austère pensée luthérienne ce que l’Italie catholique plus expansive lui avait appris. Et puis, il y a Telemann qui a écrit plus d’ouvertures à la française que tous les compositeurs français de son époque.
Il y a également l’influence du baroque espagnol via l’Italie.
RM : L’ingrédient secret qui rend vos livres si fluides à la lecture ?
PB : Je n’écris que sur des choses que j’aime. Je suis un vieux prof. Une de mes anciennes élèves (de 4e /3e, vous voyez cela ne date pas d’hier), m’a dit un jour qu’à l’époque où j’étais son professeur, elle sentait la différence entre les cours où je parlais de ce que j’aimais et ceux où je m’ennuyais. Je parle et j’écris ce que j’aime et j’aime ce que j’écris.
RM : Qu’est-ce qui vous a intéressé dans l’Orfeo de Monteverdi ?
PB : Il est celui que je ressens en ce moment, celui dont je me sens le plus proche
RM : Vous avez beaucoup écrit sur Louis XIV et lors du colloque sur le Prince et la Musique, à Versailles cet automne, je vous ai senti presque déçu, lorsque les orateurs disaient que le goût du Roi, ne révélait en rien sa personnalité ? Pourquoi ce roi ? Quel secret cache-t-il ?
PB : Je vais essayer de résumer cela en quelques mots. Il faut souligner tout d’abord qu’il ne s’est guère trompé, contrairement à ce qu’on peut croire, dans ses choix. Je prends un ou deux exemples. Tout le monde adorait Thomas Corneille et Philippe Quinault mais Louis préférait Pierre Corneille et Racine. Ce n’est pas une erreur et il en est de même dans beaucoup d’autres domaines. Que ce soit son goût personnel ou lorsqu’il agit en position de chef d’état, qui a de bons conseillers, ce qui somme toute est parfaitement normal pour un chef d’état, il y a certainement un lien entre son goût personnel et l’influence de ses conseillers. Par ailleurs, il accompagne malgré tout l’évolution du goût de son temps. Ce qui a l’air contradictoire avec ce que je viens de dire, mais en fait ne l’est qu’à moitié. Les arts, tous les arts évoluent, changent. Quant on est un personnage qui règne jusqu’à l’âge de 75 ans, il est normal que l’on bouge. Ce que je veux dire par là, c’est que le jeune Louis XIV de 20 ans qui danse des ballets de cour est exactement dans le goût de ses contemporains, de son temps. Il n’a pas beaucoup pratiqué les arts à quelques détails prêts : la guitare et la danse. Mais, tout laisse supposer qu’il a été un virtuose de la danse et lorsqu’en 1670, il arrête de danser, il a 35 ans, l’âge de la retraite dans ce « métier » là. Il aime le ballet de cour quand il a 20 ans, il aime l’opéra quand il en a 35/40, il aime la tragédie et plus tard il va aimer François Couperin (c’est ce dernier qui l’écrit dans une préface), qui jouera le dimanche dans la chambre du Roi. Louis XIV accompagne l’évolution de l’art de son temps.
Enfin, il faut souligner qu’en ce qui concerne la danse et ce que l’on sait de sa manière de jouer de la guitare, il était bon. Louis XIV artiste, je le crois profondément. Trouvez-moi une grave erreur dans ce qu’il a fait dans ses choix, concernant les arts de son temps. Construire Versailles, était-ce une erreur ? Rire avec Molière puis se passionner pour Racine (et Esther), était-ce une erreur ? A mon avis, non !
Il y a bien une ombre au soleil, il faut bien qu’il y en ait une que je subodore sans pouvoir aller jusqu’au bout, j’en parle au début de Louis XIV, artiste. Il est curieux de voir que Molière que Louis XIV a adoré et soutenu profondément, y compris dans l’épisode de Tartuffe ce qui n’était pas évident … On a l’impression que dans sa dernière année, il l’a complètement délaissé. Louis XIV ne lui fait aucune commande en 73, le Malade Imaginaire ne sera pas représenté à Versailles du vivant de Molière. Il me semble que Molière meurt assez désespéré de cette sorte d’abandon et ce sera exactement la même chose avec Lully. Et le plus étrange, c’est que celle que l’on a accusé d’être parfois responsable de l’abandon de la fête à Versailles, Mme de Maintenon, ramènera Louis XIV à son goût pour la tragédie, chrétienne certes, avec Esther de Racine.