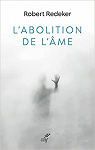Critiques de Robert Redeker (17)
Avant que le dernier livre de Robert Redeker n'apparaisse dans la liste des livres d'une masse critique et que je le coche avec d'autres, j'avais entendu l'auteur le présenter dans une émission de radio. Il était alors face à un ancien footballeur, un consultant et un journaliste et ces trois-là n'étaient pas nécessairement en phase avec sa pensée.
Choisi pour lire et critiquer Peut-on encore aimer le football ?* - peut-être parce que j'ai déjà quelques lectures et critiques de livres sur le football - j'en ai commencé la lecture en arrêtant celle d'autres livres - et notamment pour les livres consacrés au football, Une histoire populaire du football de Mickael Correia. À un moment donné, j'étais sur le point d'arrêter ma lecture pour certaines raisons que j'expliquerai plus tard mais je l'ai poursuivi pour une expérience finale plutôt positive.
Pour paraphraser le titre de son livre, je me suis alors demandé « Peut-on (encore) aimer le livre de Robert Redeker ? ». Au fur et à mesure de ma lecture de cet essai à l'écriture fluide et érudite, sans être pédante pour autant, invariablement, je lisais sous les mots de l'auteur la critique (virulente) du capitalisme contemporain dont le football ne serait que « la fable du monde » (chapitre I), que « la saga impudique du monde réel » (chapitre XXVI).
Une nuit, dans un rêve - reproduisant la même expérience que Robert Redeker visité dans un de ces rêves par Karl Marx et Spinoza - à la manière d'un Aimé Jacquet (le sélectionneur de l'équipe de France en 1998) conseillant à un autre Robert (en l'occurence Pires) : « Robert, muscle ton jeu », du banc de touche, je criais « Robert, muscle ton écriture », écris ta critique du système capitaliste et laisse le football tranquille.
Ce que Redeker critique, c'est ce qu'il appelle le football-spectacle, l'après football ou le post football - il ne va pas jusqu'à ce qu'Enki Billal décrit dans Hors jeu - et que d'autres appellent le football-business - « Le football est-il encore le football, ou bien assistons-nous au développement de quelque autre chose qui continue de porter le même nom tout en étant radicalement une autre chose ? » (p. 144). Nostalgique du football de Platini, Pelé, Cruyff ou Rocheteau, Robert Redeker n'aime pas le football des Neymar, Mbappé, du « mercato ou la disparition du football » (chapitre XVI), de la récupération par le politique du football, de ce que les footballeurs - mais aussi les musiciens et d'autres artistes - se substituent aux scientifiques, philosophes, écrivains dans l'imagerie et la représentation populaires et les exemples à suivre pour la jeunesse. Comme il l'avait déjà écrit à propos du sport* : « Le sport est une propagande permanente pour le libéralisme économique. Il exalte bien sûr les marques, la consommation débridée, le fétichisme de la marchandise, mais aussi la loi du plus fort, le mépris des plus faibles, le culte de la performance, de l'évaluation, de la maximisation des forces, de la concurrence forcenée. Son idéal : les hommes sont des loups pour les hommes, homo homini lupus. »**, Robert Redeker le spécifie dans ce livre avec le football.
Contrairement à d'autres livres sur le football adoptant la même lecture et la même ligne d'attaque - Les Cahiers du Football ou Une histoire populaire du football de Mickael Correia -, il ne dit que tardivement son « désamour » du football-spectacle et son « amour » du football - voir le chapitre XXV intitulé « Amants du football » dans lequel il évoque ses souvenirs de jeunesse de pur football, de jeu pour rien si ce n'est être. C'est cet aspect-là qui m'a dérangé dans le courant de ma lecture. Par ailleurs, certaines de ses analyses - celle sur le mercato (chapitre XVI), ce troisième temps « le plus important - le temps où tout se joue, où tout se perd, où tout se gagne, par rapport auquel les matchs ne seront qu'un excitant supplément d'âme » (p. 147), sur « Héros, saint, génie, footballeur » (XXII) ou sur « L'improvisation en en football » (chapitre XXIV) - sont intéressantes et différentes de celles d'autres livres sur le football - notamment par le détour par la philosophie.
Même s'il ne le cite jamais et l'écrit de manière différente, le point de vue de Robert Redeker se retrouve globalement dans ce qu'écrivait Eduardo Galeano dans Football, ombre et Lumière :
« L'histoire du football est un voyage triste, du plaisir au devoir. À mesure que le sport s'est transformé en industrie, il a banni la beauté qui naît de la joie de jouer pour jouer. En ce monde de fin de siècle, le football professionnel condamne ce qui est inutile, et est inutile ce qui n'est pas rentable. Il ne permet à personne cette folie qui pousse l'homme à redevenir enfant un instant, en jouant comme un enfant joue avec un ballon de baudruche et comme un chat avec une pelote de laine : danseur qui évolue avec une balle aussi légère que la baudruche qui s'envole et que la pelote qui roule, jouant sans savoir qu'il joue, sans raison, sans chronomètre et sans arbitre.
Le jeu est devenu spectacle, avec peu de protagonistes et beaucoup de spectateurs, football à voir, et le spectacle est devenu l'une des affaires les plus lucratives du monde, qu'on ne monte pas pour jouer mais pour empêcher qu'on ne joue. La technocratie du sport professionnel a peu à peu imposé un football de pure vitesse et de grande force, qui renonce à la joie, atrophie la fantaisie et proscrit l'audace.
Par bonheur, on voit encore sur les terrains, très rarement il est vrai, un chenapan effronté qui s'écarte du livret et commet l'extravagance de feinter toute l'équipe rivale, et l'arbitre, et le public dans les tribunes, pour le simple plaisir du corps qui se jette dans l'aventure interdite de la liberté. »
Au final, il est bien possible d'encore aimer le football et d'aimer le livre de Robert Redecker pour peu que l'on s'intéresse au football, à la philosophie et à la critique du capitalisme.
* Je remercie l'éditeur, les Éditions du Rocher, et les organisateurs de l'opération Masse Critique.
** http://evene.lefigaro.fr/celebre/actualite/robert-redeker-le-foot-se-substitue-a-la-culture-1011764.php
Choisi pour lire et critiquer Peut-on encore aimer le football ?* - peut-être parce que j'ai déjà quelques lectures et critiques de livres sur le football - j'en ai commencé la lecture en arrêtant celle d'autres livres - et notamment pour les livres consacrés au football, Une histoire populaire du football de Mickael Correia. À un moment donné, j'étais sur le point d'arrêter ma lecture pour certaines raisons que j'expliquerai plus tard mais je l'ai poursuivi pour une expérience finale plutôt positive.
Pour paraphraser le titre de son livre, je me suis alors demandé « Peut-on (encore) aimer le livre de Robert Redeker ? ». Au fur et à mesure de ma lecture de cet essai à l'écriture fluide et érudite, sans être pédante pour autant, invariablement, je lisais sous les mots de l'auteur la critique (virulente) du capitalisme contemporain dont le football ne serait que « la fable du monde » (chapitre I), que « la saga impudique du monde réel » (chapitre XXVI).
Une nuit, dans un rêve - reproduisant la même expérience que Robert Redeker visité dans un de ces rêves par Karl Marx et Spinoza - à la manière d'un Aimé Jacquet (le sélectionneur de l'équipe de France en 1998) conseillant à un autre Robert (en l'occurence Pires) : « Robert, muscle ton jeu », du banc de touche, je criais « Robert, muscle ton écriture », écris ta critique du système capitaliste et laisse le football tranquille.
Ce que Redeker critique, c'est ce qu'il appelle le football-spectacle, l'après football ou le post football - il ne va pas jusqu'à ce qu'Enki Billal décrit dans Hors jeu - et que d'autres appellent le football-business - « Le football est-il encore le football, ou bien assistons-nous au développement de quelque autre chose qui continue de porter le même nom tout en étant radicalement une autre chose ? » (p. 144). Nostalgique du football de Platini, Pelé, Cruyff ou Rocheteau, Robert Redeker n'aime pas le football des Neymar, Mbappé, du « mercato ou la disparition du football » (chapitre XVI), de la récupération par le politique du football, de ce que les footballeurs - mais aussi les musiciens et d'autres artistes - se substituent aux scientifiques, philosophes, écrivains dans l'imagerie et la représentation populaires et les exemples à suivre pour la jeunesse. Comme il l'avait déjà écrit à propos du sport* : « Le sport est une propagande permanente pour le libéralisme économique. Il exalte bien sûr les marques, la consommation débridée, le fétichisme de la marchandise, mais aussi la loi du plus fort, le mépris des plus faibles, le culte de la performance, de l'évaluation, de la maximisation des forces, de la concurrence forcenée. Son idéal : les hommes sont des loups pour les hommes, homo homini lupus. »**, Robert Redeker le spécifie dans ce livre avec le football.
Contrairement à d'autres livres sur le football adoptant la même lecture et la même ligne d'attaque - Les Cahiers du Football ou Une histoire populaire du football de Mickael Correia -, il ne dit que tardivement son « désamour » du football-spectacle et son « amour » du football - voir le chapitre XXV intitulé « Amants du football » dans lequel il évoque ses souvenirs de jeunesse de pur football, de jeu pour rien si ce n'est être. C'est cet aspect-là qui m'a dérangé dans le courant de ma lecture. Par ailleurs, certaines de ses analyses - celle sur le mercato (chapitre XVI), ce troisième temps « le plus important - le temps où tout se joue, où tout se perd, où tout se gagne, par rapport auquel les matchs ne seront qu'un excitant supplément d'âme » (p. 147), sur « Héros, saint, génie, footballeur » (XXII) ou sur « L'improvisation en en football » (chapitre XXIV) - sont intéressantes et différentes de celles d'autres livres sur le football - notamment par le détour par la philosophie.
Même s'il ne le cite jamais et l'écrit de manière différente, le point de vue de Robert Redeker se retrouve globalement dans ce qu'écrivait Eduardo Galeano dans Football, ombre et Lumière :
« L'histoire du football est un voyage triste, du plaisir au devoir. À mesure que le sport s'est transformé en industrie, il a banni la beauté qui naît de la joie de jouer pour jouer. En ce monde de fin de siècle, le football professionnel condamne ce qui est inutile, et est inutile ce qui n'est pas rentable. Il ne permet à personne cette folie qui pousse l'homme à redevenir enfant un instant, en jouant comme un enfant joue avec un ballon de baudruche et comme un chat avec une pelote de laine : danseur qui évolue avec une balle aussi légère que la baudruche qui s'envole et que la pelote qui roule, jouant sans savoir qu'il joue, sans raison, sans chronomètre et sans arbitre.
Le jeu est devenu spectacle, avec peu de protagonistes et beaucoup de spectateurs, football à voir, et le spectacle est devenu l'une des affaires les plus lucratives du monde, qu'on ne monte pas pour jouer mais pour empêcher qu'on ne joue. La technocratie du sport professionnel a peu à peu imposé un football de pure vitesse et de grande force, qui renonce à la joie, atrophie la fantaisie et proscrit l'audace.
Par bonheur, on voit encore sur les terrains, très rarement il est vrai, un chenapan effronté qui s'écarte du livret et commet l'extravagance de feinter toute l'équipe rivale, et l'arbitre, et le public dans les tribunes, pour le simple plaisir du corps qui se jette dans l'aventure interdite de la liberté. »
Au final, il est bien possible d'encore aimer le football et d'aimer le livre de Robert Redecker pour peu que l'on s'intéresse au football, à la philosophie et à la critique du capitalisme.
* Je remercie l'éditeur, les Éditions du Rocher, et les organisateurs de l'opération Masse Critique.
** http://evene.lefigaro.fr/celebre/actualite/robert-redeker-le-foot-se-substitue-a-la-culture-1011764.php
Le philosophe a raison. J'en suis peiné, moi qui suis un passionné de football. Justement, il faut s'entendre : Redeker ne dit pas qu'il n'aime pas le football. Ce qu'il exècre, c'est le post-football, qui n'a plus rien à voir avec le jeu. Lorsqu'il montre que le mercato, à la fois absurde et scandaleux, absorbe le football, qui peut lui donner tort ?
Redeker surprend parfois, parce qu'il traduit ce scandale et ses conséquences en termes philosophiques. Sa réflexion ne m'empêchera pas d'aller soutenir mon club amateur, mais elle confirme tout le mal que je pense du football hyper-professionnel, qui détruit peu à peu cet amateurisme.
Redeker surprend parfois, parce qu'il traduit ce scandale et ses conséquences en termes philosophiques. Sa réflexion ne m'empêchera pas d'aller soutenir mon club amateur, mais elle confirme tout le mal que je pense du football hyper-professionnel, qui détruit peu à peu cet amateurisme.
Robert Redeker fait, dans cet essai, un constat très pessimiste de l'Ecole française actuelle. Et la lecture de son livre en est assez pénible car à aucun moment, un espoir ne semble apparaître pour remédier à cet affreuse situation. Dès l'introduction, l'auteur semble me prendre de haut en expliquant que personne (ni politique, media, etc...) ne sait parler correctement et je pense donc faire partie de ce groupe d'incultes.
Sa démonstration se base presque uniquement sur l'enseignement de la littérature et des langues qui deviennent dans l'Ecole d'aujourd'hui des outils de communication. Les sciences sont tout juste évoquées.
Mais surtout, je ne suis pas persuadée "qu'avant c'était mieux", que tous les élèves lisaient Charles Peguy et que l'Ecole réussissait à transmettre des savoirs à d'autres personnes qu'une élite intellectuelle.
Il n'empêche qu'il y a de quoi critiquer l'enseignement actuel et essayer d'apporter des solutions. Je ne suis pas certaine que cet essai en donne... il m'a juste donné envie de... me lamenter!!!
Sa démonstration se base presque uniquement sur l'enseignement de la littérature et des langues qui deviennent dans l'Ecole d'aujourd'hui des outils de communication. Les sciences sont tout juste évoquées.
Mais surtout, je ne suis pas persuadée "qu'avant c'était mieux", que tous les élèves lisaient Charles Peguy et que l'Ecole réussissait à transmettre des savoirs à d'autres personnes qu'une élite intellectuelle.
Il n'empêche qu'il y a de quoi critiquer l'enseignement actuel et essayer d'apporter des solutions. Je ne suis pas certaine que cet essai en donne... il m'a juste donné envie de... me lamenter!!!
Il aura fallu quatorze chapitres à Robert Redeker pour nous livrer sa vision aussi fataliste que délirante de l'Ecole républicaine du XXIème siècle. Le premier coup de hache frappe les usages de la langue (française) comme «écho de la crise de l'Ecole.» Partant de l'idée qu'elle est devenue un vulgaire moyen de communication, il poursuit ses chapitres sur le même ton. Car pour lui, « la communication change le monde et la vérité en matière gélatineuse et liquide. Elle s'emploie à ramener le réel et la vie à la consistance des méduses.» Et dans ce livre, tout le monde paie le prix de la colère froide de notre philosophe vivant dans le souvenir et la nostalgie de l'école d'antan. Cette dernière aurait transformé, selon lui, les enseignants (que nous devrions appeler professeur !) en animateurs socioculturels; autrement dit, en moins que rien.
D'autres sujets suivent: la mort, l'économie, le diversement, la vie … mais ils ne suffisent pas à nous faire oublier les relents nauséabonds d'une conception de l'éducation marquée par le sceau de l'élitisme républicain et de la distinction nationale.
Dans ce brûlot contre l'Education nationale, on aura bien senti une pincé de Finkielkraut et un soupçon de Zemmour. Dans le deuxième chapitre notamment, il joue au funambule avec le balancier du national-assimilationnisme. Il évoque Jeanne d'Arc. Pourquoi pas. Il rebondit avec aisance et réjouissance sur le verbe (les "inhéritiers") de Renaud Camus qu'il semble tenir en estime. Et là, c'est plus inquiétant. Mais, Redeker évite de justesse la chute raciale. Il n'est donc pas à balancer dans la catégorie des fascistes. Nous dirons qu'il n'aime tout simplement pas le cosmopolitisme, le multiculturalisme et les petits élèves épicés, originaires des anciennes colonies, nés sur le territoire français.
Il apparaît également que cet ancien professeur de philosophie ne tire aucun avantage de la modernité; le numérique l'exècre. Il n'aime pas non plus les pédagogues (comme Philippe Meirieu) et encore moins les sociologues (comme Pierre Bourdieu).
Il alimente la confusion entre inégalité et injustice. Pour lui, l'inégalité peut trouver des formes de justifications puisque tout ne se vaut pas. le raisonnement est curieux et les comparaisons douteuses. On retrouve les mêmes confusions entre la « fraternité » et le « vivre-ensemble »: rien de très stimulant pour penser la différence dans un monde globalisé.
Redeker nous aura finalement laissé le sentiment qu'il n'y de transmission du savoir qu'accompagnée d'une bonne dose d'autoritarisme (du maître), de celui qui sait sur celui qui ignore; une instruction hiérarchique et insipide qui soumet au lieu d'émanciper, qui humilie au lieu d'élever, qui enferme au lieu d'élargir la pensée, qui fracture au lieu de chercher les moyens d'unir.
Ce philosophe aussi érudit soit-il nous aura au moins transmis l'expression d'un mal-être et d'un profond regret d'un passé enterré. Espérons qu'il ne bascule pas un jour, si ce n'est déjà fait, du côté des penseurs du "Grand remplacement" !
Je remercie l'équipe du site Babelio, à travers l'opération « Masse critique », de m'avoir donné l'occasion, malgré tout, de lire et de donner mon point de vue sur cet essai.
D'autres sujets suivent: la mort, l'économie, le diversement, la vie … mais ils ne suffisent pas à nous faire oublier les relents nauséabonds d'une conception de l'éducation marquée par le sceau de l'élitisme républicain et de la distinction nationale.
Dans ce brûlot contre l'Education nationale, on aura bien senti une pincé de Finkielkraut et un soupçon de Zemmour. Dans le deuxième chapitre notamment, il joue au funambule avec le balancier du national-assimilationnisme. Il évoque Jeanne d'Arc. Pourquoi pas. Il rebondit avec aisance et réjouissance sur le verbe (les "inhéritiers") de Renaud Camus qu'il semble tenir en estime. Et là, c'est plus inquiétant. Mais, Redeker évite de justesse la chute raciale. Il n'est donc pas à balancer dans la catégorie des fascistes. Nous dirons qu'il n'aime tout simplement pas le cosmopolitisme, le multiculturalisme et les petits élèves épicés, originaires des anciennes colonies, nés sur le territoire français.
Il apparaît également que cet ancien professeur de philosophie ne tire aucun avantage de la modernité; le numérique l'exècre. Il n'aime pas non plus les pédagogues (comme Philippe Meirieu) et encore moins les sociologues (comme Pierre Bourdieu).
Il alimente la confusion entre inégalité et injustice. Pour lui, l'inégalité peut trouver des formes de justifications puisque tout ne se vaut pas. le raisonnement est curieux et les comparaisons douteuses. On retrouve les mêmes confusions entre la « fraternité » et le « vivre-ensemble »: rien de très stimulant pour penser la différence dans un monde globalisé.
Redeker nous aura finalement laissé le sentiment qu'il n'y de transmission du savoir qu'accompagnée d'une bonne dose d'autoritarisme (du maître), de celui qui sait sur celui qui ignore; une instruction hiérarchique et insipide qui soumet au lieu d'émanciper, qui humilie au lieu d'élever, qui enferme au lieu d'élargir la pensée, qui fracture au lieu de chercher les moyens d'unir.
Ce philosophe aussi érudit soit-il nous aura au moins transmis l'expression d'un mal-être et d'un profond regret d'un passé enterré. Espérons qu'il ne bascule pas un jour, si ce n'est déjà fait, du côté des penseurs du "Grand remplacement" !
Je remercie l'équipe du site Babelio, à travers l'opération « Masse critique », de m'avoir donné l'occasion, malgré tout, de lire et de donner mon point de vue sur cet essai.
En fait, je n'ai pas choisi de lire cet ouvrage: j'ai été amené à le lire dans le cadre de mes activités associatives – sans a priori. A ma grande surprise, j'ai découvert une sorte de pamphlet sur notre société en général, et sur le traitement réservé aux "vieux" en particulier. L'auteur s'appuie parfois sur des observations exactes et même bien connues: la société vit de plus en plus vite, le monde contemporain se réfère de moins en moins au passé et au futur, le jeunisme (ou « pétrification dans l'adolescence ») a le vent en poupe, la mort est occultée, etc. Le propos de Robert Redecker se focalise sur la vieillesse, qui a perdu le respect dont elle aurait joui autrefois et qui serait maintenant menacée par un « géronticide » (sic). En effet, l'idéologie jeuniste, les impératifs économiques ainsi que la pression démographique conduiraient inévitablement à une (réelle) condamnation des personnes âgées. Les critiques acerbes de l'auteur visent aussi, chez les seniors, les tentations de "singer" les jeunes par l'utilisation des cosmétiques ou du Viagra, par exemple. Et la crémation est décriée, par opposition à l'inhumation, etc, etc…
Ce mélange de bon sens et d'inepties m'a paru très irritant, d'autant plus que l'auteur rabâche sans vergogne les mêmes idées. Et quelle solution propose-t-il, finalement, à cette décadence actuelle ? l'acceptation de leur condition par les vieux, le retour à la sagesse des aînés (comme l'ont prôné Cicéron et Sénèque), la rupture avec l'idéologie jeuniste: autant dire absolument rien de concret et réaliste…
Moi-même, je n'aime pas du tout l'évolution de notre société. Mais l'analyse de Redeker me semble, à la fois, mal ciblée et inutilement outrancière. Entre autres choses, il faudra qu'il m'explique pourquoi il ose parler de géronticide, alors que les médecins font tout leur possible pour sauver des malades nonagénaires (qui pourtant ne se sentent pas particulièrement jeunistes !). Il faudra qu'il justifie pourquoi il serait criminel de soigner son apparence et de pallier aux manques liés à l'âge, quand on arrive à la vieillesse, etc.
J'aurais beaucoup d'autres questions à lui poser, mais ce serait peut-être lui faire trop d'honneur… Surpris par cet auteur, je me suis renseigné à son sujet, sur Wikipedia. D'abord actif dans les milieux de l'extrême-gauche, puis professeur de philosophie, intellectuel (qui a beaucoup publié) et membre de la rédaction de Marianne, il a été impliqué en 2006 dans une polémique (au sujet de l'Islam) qu'il avait lui-même lancée. Bof…
Ce mélange de bon sens et d'inepties m'a paru très irritant, d'autant plus que l'auteur rabâche sans vergogne les mêmes idées. Et quelle solution propose-t-il, finalement, à cette décadence actuelle ? l'acceptation de leur condition par les vieux, le retour à la sagesse des aînés (comme l'ont prôné Cicéron et Sénèque), la rupture avec l'idéologie jeuniste: autant dire absolument rien de concret et réaliste…
Moi-même, je n'aime pas du tout l'évolution de notre société. Mais l'analyse de Redeker me semble, à la fois, mal ciblée et inutilement outrancière. Entre autres choses, il faudra qu'il m'explique pourquoi il ose parler de géronticide, alors que les médecins font tout leur possible pour sauver des malades nonagénaires (qui pourtant ne se sentent pas particulièrement jeunistes !). Il faudra qu'il justifie pourquoi il serait criminel de soigner son apparence et de pallier aux manques liés à l'âge, quand on arrive à la vieillesse, etc.
J'aurais beaucoup d'autres questions à lui poser, mais ce serait peut-être lui faire trop d'honneur… Surpris par cet auteur, je me suis renseigné à son sujet, sur Wikipedia. D'abord actif dans les milieux de l'extrême-gauche, puis professeur de philosophie, intellectuel (qui a beaucoup publié) et membre de la rédaction de Marianne, il a été impliqué en 2006 dans une polémique (au sujet de l'Islam) qu'il avait lui-même lancée. Bof…
Redeker a une vue très pessimiste de la modernité. Selon lui, elle est incapable de penser la mort : “La crise du monde moderne se résume (sic) au fait que nous sommes séparés d’avec la mort”, notamment “parce que les symboles sont submergés par les images industrielles”. Il méprise “les âmes de second rang”. Il glorifie les maladies : “Les maladies détruisent le moi et libèrent l’âme”, “elles sont une répétition de la mort”, “elle nous offrent la chance de vivre comme un mort”. Il consacre deux chapitres à vitupérer contre la crémation, vue comme “haine de la matière”, “vie biologique passée au Kärcher”, “refus d’être livré en pâture à l’univers”. Il s’emporte également contre l’euthanasie. Il admire Heidegger, saint Augustin et Thérèse de Lisieux (“La vraie femme libre, ce n’est pas Simone de Beauvoir, c’est Thérèse de Lisieux”). Le livre contient un nombre saisissant de généralités de ce genre : “La sexualité peut légitimement être définie comme le désir d’un retour à l’indifférencié originaire, ce qu’est toujours la mort”, “L’âme festive masque la dépression”, “A force de regarder la TV et de naviguer sur internet, nous risquons d’oublier de mourir”, “Pour les terroristes la mort n’est qu’une péripétie de jeu video”.
Je mets deux étoiles : une pour le style très soigné et une pour la précision des références infrapaginales. Aucune pour le contenu.
Je mets deux étoiles : une pour le style très soigné et une pour la précision des références infrapaginales. Aucune pour le contenu.
Face à ce réquisitoire qui pourrait paraître alarmiste, Robert Redeker appelle de ses vœux à un sursaut spirituel salvateur. Réhabiliter le goût de l’intériorité loin de la frénésie technologique, réapprendre les sillons secrets de l’âme : tels sont à ses yeux les impératifs absolus si l’on veut éviter une complète déshumanisation. Pour l’auteur, le salut passe d’abord par un retour à des pratiques délaissées, comme la lecture patiente, la marche atemporelle ou le silence fécond. Autant d’espaces propices à la renaissance d’une authentique vie intérieure. Il en appelle ainsi à une vigoureuse “écologie de l’âme” pour faire renaître une spiritualité digne de ce nom et conjurer la déshumanisation numérique. Ainsi s’achève le cri d’alarme poignant d’un penseur unique et d’un immense philosophe, refusant de voir l’homme renoncer à son âme. Derrière la rigueur de l’analyse percent l’émotion et l’inquiétude face à l’oubli de cette part essentielle de notre humanité. Peut-être même la dernière…
Lien : https://marenostrum.pm/labol..
Lien : https://marenostrum.pm/labol..
Le foot a été décliné à toutes les sauces durant le mois de juillet dernier. Coupe du monde oblige ! Noir, jaune, rouge. Bleu, blanc, rouge. Et j’en passe ! Il a ébloui le début de l’été des supporters sous amphétamines et pourri les vacances des autres ? Quoi qu’il en a été, il a phagocyté les esprits au point de ne plus entendre parler que de lui au cœur de la canicule : presse écrite, télé, radio, etc. Serait-il le descendant de ces jeux qui hypnotisaient les Romains pour leur faire oublier les soucis du quotidien ? Qu’on le souhaite ou non, au XXIe siècle, le monde fonctionne au tempo des matches et focalise toutes les attentions, remplaçant le dieu des religions par les idoles des stades. Cependant, où en est le rêve du sport pur et des rencontres disputées pour la seule beauté des prouesses sur la pelouse ? Robert Redeker ose la question qui fâche : Peut-on encore aimer le football ? Reste-t-il une évasion comme le théâtre et le cinéma ? Est-il devenu une drogue qui lamine les cerveaux ? La terre (où qu’on aille) est peuplée d’images de joueurs, de buts et de scores. L’auteur pose un triste constat. Si ce sport est certes addictif, il demeure tristement vide, comme une foi sans assises sérieuses ni réflexion intime. Le bonheur que le foot était censé nous offrir demeure d’une inanité confondante, avec une absence effrayante de contenu et un vernis qui se veut le reflet de notre abrutissement. Un peu à l’image de la société de consommation, qui brûle ses idoles d’hier pour encenser de nouvelles en fonction des modes, du beau temps qu’il fait ou ne fait pas. Un essai édifiant !
Peut-on encore aimer le football ? La question posée par le philosophe Robert Redeker laisse penser que son essai analysera les raisons d’aimer le football et les raisons de le détester. Le problème est que l’auteur se concentre quasi exclusivement sur ce 2ème point. Très critique envers le football et ses nombreux travers : libéralisme, marchandisation des joueurs, abrutissement des foules,... Le tableau noir dressé par le philosophe est sans équivoque. Toutefois, si on ne peut que déplorer la direction prise par le football durant ces deux dernières décennies, il faut néanmoins lui reconnaître un rôle social encore fort. Il aurait été intéressant que Robert Redeker nuance plus son propos plutôt que se concentrer sur sa logorrhée anti-football. Heureusement, la France vient d’être sacrée championne du monde et cet événement a démontré qu’il était le seul à rassembler les Français dans la rue pour un moment de joie et de bonheur partagé. Est-ce vraiment nécessaire de détester un sport - malgré ses innombrables défauts - capable de transcender les foules ? Je ne pense pas M. Redeker.
L’auteur expose dans cet ouvrage les différents « fléaux » qui selon lui ont contribué au délitement de l’Ecole (toujours avec un E majuscule traduisant son respect pour cette institution). Il pose l’obsession de la « communication » comme le point de départ du phénomène. La communication a une approche fonctionnaliste et utilitariste de la langue, c'est-à-dire comme un outil servant à véhiculer des informations. Et non plus la langue en tant que vecteur de la pensée, de la réflexion, du raisonnement et de la culture. « La communication engourdit l’exercice du jugement. » dit-il. Quant à la désastreuse Loi Jospin de 1989, elle instaure le principe d’une haine de l’excellence.
Il aborde ensuite les vulgates du pédagogisme qui, en pervertissant la pédagogie, cherchent à formater aussi bien les instituteurs et les professeurs que les élèves. L’Ecole aux mains des idéologues, l’Ecole en tant que « instance de pacification sociale »… L’auteur n’hésite pas à affirmer que les visées anthropologiques des pédagogistes relèvent de la même haine de l’intelligence et des intellectuels que celle des Khmers rouges ou de la révolution culturelle chinoise. C’est ainsi que l’Ecole est devenue une « entreprise de destruction, ordonnée au fanatisme de la table rase ». Et les principaux ennemis – et premières victimes – du pédagogisme sont les instituteurs, les professeurs, les maîtres, nommés désormais « enseignants ». Sociologie et idéologie secrètent le poison qui détruit l’Ecole, anéantissant sa vocation « d’élever » et d’instruire.
Sont ensuite passés en revue de nombreux exemples dans les domaines économique, politique, du divertissement, du travail etc. qui permettent de recenser différents courants agissant insidieusement sur la finalité de l’éducation. Pour aboutir à la conclusion que la crise de l’Ecole est, non pas une crise sociétale, mais une crise de la vie humaine : « C’est parce qu’on ne sait plus ce que c’est qu’un homme, ce que c’est que la vie humaine, ni non plus ce que c’est que la mort humaine, qu’on ne sait plus ce que c’est que l’Ecole, ce que c’est que l’éducation. »
A la fin de ce constat tragique et lucide, on aimerait trouver des propositions, une lueur d’espoir. Mais celle-ci est minime : le livre se termine simplement sur le vœu que ce livre contribue – puisque le fantôme exige la réincarnation - à la « réincarnation » de l’Ecole
Une réflexion intelligente et passionnée, où chaque page contient au moins un morceau de bravoure qui mériterait de figurer dans la rubrique « citations ». Nombreuses références et annotations : littéraires, historiques ou philosophiques.
Il aborde ensuite les vulgates du pédagogisme qui, en pervertissant la pédagogie, cherchent à formater aussi bien les instituteurs et les professeurs que les élèves. L’Ecole aux mains des idéologues, l’Ecole en tant que « instance de pacification sociale »… L’auteur n’hésite pas à affirmer que les visées anthropologiques des pédagogistes relèvent de la même haine de l’intelligence et des intellectuels que celle des Khmers rouges ou de la révolution culturelle chinoise. C’est ainsi que l’Ecole est devenue une « entreprise de destruction, ordonnée au fanatisme de la table rase ». Et les principaux ennemis – et premières victimes – du pédagogisme sont les instituteurs, les professeurs, les maîtres, nommés désormais « enseignants ». Sociologie et idéologie secrètent le poison qui détruit l’Ecole, anéantissant sa vocation « d’élever » et d’instruire.
Sont ensuite passés en revue de nombreux exemples dans les domaines économique, politique, du divertissement, du travail etc. qui permettent de recenser différents courants agissant insidieusement sur la finalité de l’éducation. Pour aboutir à la conclusion que la crise de l’Ecole est, non pas une crise sociétale, mais une crise de la vie humaine : « C’est parce qu’on ne sait plus ce que c’est qu’un homme, ce que c’est que la vie humaine, ni non plus ce que c’est que la mort humaine, qu’on ne sait plus ce que c’est que l’Ecole, ce que c’est que l’éducation. »
A la fin de ce constat tragique et lucide, on aimerait trouver des propositions, une lueur d’espoir. Mais celle-ci est minime : le livre se termine simplement sur le vœu que ce livre contribue – puisque le fantôme exige la réincarnation - à la « réincarnation » de l’Ecole
Une réflexion intelligente et passionnée, où chaque page contient au moins un morceau de bravoure qui mériterait de figurer dans la rubrique « citations ». Nombreuses références et annotations : littéraires, historiques ou philosophiques.
est-ce un essai? pcq je dois trouver un essai pour mon cours de francais....
L'ouvrage de Robert Redeker est […] une charge contre le sport contemporain qui transforme le sportif en mutant, sorte d'homme nouveau renouant parfois dangereusement avec les idéologies totalitaires qui exploitaient l'euphorie collective.
Lien : http://www.telerama.fr/criti..
Lien : http://www.telerama.fr/criti..
Dans le n° 1 des «Cahiers de l'In-nocence», les Français parlent aux Français.
Lien : http://rss.nouvelobs.com/c/3..
Lien : http://rss.nouvelobs.com/c/3..
C'est dans le cadre de la Masse critique de Babelio que j'ai reçu ce livre de Robert Redecker. Je tiens déjà à remercier les éditions du Rocher.
Peut-on encore aimer le football ? C'est une question d'actualité, puisque, pour ceux qui me liront plus tard, nous sommes au lendemain de la très belle victoire des Français sur l'Argentine de la légende Messi, en coupe du Monde.
Donc peut-on encore aimer le football ? D'emblée, et à titre personnel, je réponds oui. Du haut de ma passion pour la lecture, le cinéma d'art et d'essai ou la peinture contemporaine, je revendique mon amour du beau geste et du sport.
Alors que dire de ce livre ? Quel est le propos ?
Robert Redecker analyse le football actuel, avec ses vices d'argents et d'anti-jeu, sous le prisme du philosophe. Fustigeant les réflexions de comptoir il est n'est pas rare de voir des références à Marx, Kant, Spinoza et autres, dans les analyses et la critique qu'émet l'auteur sur le football moderne.
On sent chez Robert Redecker un amour du jeu, à l'ancienne, il décrit par exemple le jeu de Dominique Rocheteau de manière très artistique, il y a même tout un chapitre où il explique avoir beaucoup joué au foot adolescent. Mais il n'a aucune pitié pour Neymar et consort. En fait le livre m'a donné l'impression, d'une manière générale, de ne pas vraiment répondre à la question. Il donne des arguments pour dire, en gros, que le foot est le nouvel opium du peuple, qu'il est pourri par l'argent et l'égo, que le foot est devenu un spectacle et non plus un sport...
Alors une fois ce constat fait, qu'en dire ? Plusieurs choses me viennent à l'esprit, d'abord je pensais que le sujet serait traité d'une manière un peu plus légère. Pas que le style de l'auteur soit mauvais mais on est face à un intellectuel qui maitrise les codes et la langue de la philosophie. Ce qui n'est pas mon cas, donc parfois un peu dur à suivre.
Les avis me semblent également très tranchés, sans trop de nuance, j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur répondait à la question par un NON frappé du sceau de l'éloquence intellectuelle. En fait il ne donne pas vraiment de contre argument, ou si peu que je n'ai pas su les déceler.
C'est une lecture intelligente, ça fait du bien surtout sur le sujet en question, et qui n'est pas facile car il faut maitriser des notions qui pour beaucoup, moi y compris, proviennent de vieux cours de philo oubliés. Mais je crois sincérement que le propos aurait gagné avec plus de simplicité.
Peut-on encore aimer le football ? C'est une question d'actualité, puisque, pour ceux qui me liront plus tard, nous sommes au lendemain de la très belle victoire des Français sur l'Argentine de la légende Messi, en coupe du Monde.
Donc peut-on encore aimer le football ? D'emblée, et à titre personnel, je réponds oui. Du haut de ma passion pour la lecture, le cinéma d'art et d'essai ou la peinture contemporaine, je revendique mon amour du beau geste et du sport.
Alors que dire de ce livre ? Quel est le propos ?
Robert Redecker analyse le football actuel, avec ses vices d'argents et d'anti-jeu, sous le prisme du philosophe. Fustigeant les réflexions de comptoir il est n'est pas rare de voir des références à Marx, Kant, Spinoza et autres, dans les analyses et la critique qu'émet l'auteur sur le football moderne.
On sent chez Robert Redecker un amour du jeu, à l'ancienne, il décrit par exemple le jeu de Dominique Rocheteau de manière très artistique, il y a même tout un chapitre où il explique avoir beaucoup joué au foot adolescent. Mais il n'a aucune pitié pour Neymar et consort. En fait le livre m'a donné l'impression, d'une manière générale, de ne pas vraiment répondre à la question. Il donne des arguments pour dire, en gros, que le foot est le nouvel opium du peuple, qu'il est pourri par l'argent et l'égo, que le foot est devenu un spectacle et non plus un sport...
Alors une fois ce constat fait, qu'en dire ? Plusieurs choses me viennent à l'esprit, d'abord je pensais que le sujet serait traité d'une manière un peu plus légère. Pas que le style de l'auteur soit mauvais mais on est face à un intellectuel qui maitrise les codes et la langue de la philosophie. Ce qui n'est pas mon cas, donc parfois un peu dur à suivre.
Les avis me semblent également très tranchés, sans trop de nuance, j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur répondait à la question par un NON frappé du sceau de l'éloquence intellectuelle. En fait il ne donne pas vraiment de contre argument, ou si peu que je n'ai pas su les déceler.
C'est une lecture intelligente, ça fait du bien surtout sur le sujet en question, et qui n'est pas facile car il faut maitriser des notions qui pour beaucoup, moi y compris, proviennent de vieux cours de philo oubliés. Mais je crois sincérement que le propos aurait gagné avec plus de simplicité.
"Plus vite, plus haut, plus fort", la juste devise olympique a dégénéré en pitoyable slogan d'entreprise. Robert Redeker, pamphlétaire mordant, a mille fois raison.
Lien : http://rss.feedsportal.com/c..
Lien : http://rss.feedsportal.com/c..
À l’heure de la sacro-sainte dette, nous sommes tous coupables. Tâchons d’avoir un bon mental...
Lien : http://www.humanite.fr/cultu..
Lien : http://www.humanite.fr/cultu..
Robert Redeker de retour sur l’inhumanité d’un divertissement roi.
Lien : http://www.lalibre.be/cultur..
Lien : http://www.lalibre.be/cultur..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Lecteurs de Robert Redeker (57)Voir plus
Quiz
Voir plus
Clavel ou Frison-Roche ?
Les fruits de l'hiver
Bernard Clavel
Roger Frison-Roche
18 questions
32 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, culture générale
, montagnes
, desertsCréer un quiz sur cet auteur32 lecteurs ont répondu