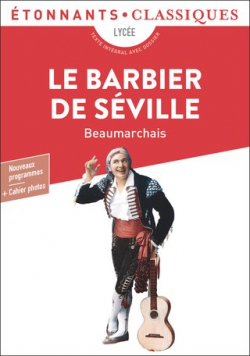>
Critique de AMR_La_Pirate
Depuis mon inscription sur Babelio, je prends plaisir à replonger dans d'anciennes lectures et je retrouve toujours avec plaisir mes prises de notes de l'époque afin d'en publier un petit billet.
Ainsi, je relis le Barbier de Séville de Beaumarchais, une pièce de théâtre comique qui fait partie de nos incontournables classiques du XVIIIème siècle.
Avant d'écrire le Barbier de Séville, Beaumarchais était connu à partir de 1760 pour ses « parades du théâtre de société » ; à l'origine, les « parades » étaient des pièces courtes et drôles que l'on jouait dans les fêtes foraines, un genre populaire, outrancier et caricatural. Peu à peu, des codes ont été élaborés pour obéir aux goûts de l'élite de la société et aux exigences des petits comités choisis devant lesquels elles étaient jouées. Beaumarchais proposait donc des saynètes à l'intrigue minimaliste et aux personnages stéréotypés, sans analyse psychologique ni but moral, organisées à partir de jeux de mots et d'allusions lestes et scabreuses sans cependant tomber dans la grossièreté ou l'obscénité. Puis, comme Diderot, il est passé au drame bourgeois et enfin à la théorie littéraire vers 1767.
On retrouve quelques-unes des caractéristiques de la parade du théâtre de société dans le Barbier de Séville, qui a d'abord été un intermède, puis un opéra-comique avant de devenir la pièce comique définitive jouée pour la première fois en 1775.
Le Barbier de Séville revisite de manière novatrice une intrigue très conventionnelle servie par les personnages-types traditionnels du genre comique : un vieux barbon veut se marier avec sa pupille, une jeune et belle ingénue, mais l'amant de celle-ci parvient à l'épouser avant grâce à l'aide de son valet.
C'est surtout le personnage du valet qui est mis à l'honneur et enrichi : il est non seulement rusé, intrigant et cupide mais il a aussi une véritable épaisseur sociologique et romanesque, un parcours et un vécu qui va au-delà de la pièce. Il est à la fois barbier, apothicaire, chirurgien, auteur dramatique méconnu, le représentant en quelque sorte des gens de lettres désargentés de la bohème littéraire. Dès la deuxième scène, il fait le récit de sa vie passée qui n'apporte rien à l'intrigue à venir mais étoffe son personnage. Quand on pense à cette pièce, c'est souvent une citation de Figaro qui vient à l'esprit : « je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer » (acte I, scène 2).
En outre, contrairement aux usages, Bartholo est particulièrement rusé et difficile à manipuler ; rien ne lui échappe. Il symbolise tout ce qui est contraire à l'esprit des Lumières, dans sa posture autoritaire et supérieure.
Le Comte Almaviva doit beaucoup payer de sa personne, se déguiser par exemple, et ne pas se contenter de profiter des ficelles mises en place par son valet pour parvenir à ses fins.
Rosine, enfin, prend des initiatives et nous parle de la condition des femmes, toujours considérées comme mineures et dépendantes de l'autorité masculine.
En effet, tout cela déroge un peu si l'on considère les codes habituels de la comédie où les barbons ne sont pas très malins, les jeunes amoureux sont plutôt ternes et les ingénues restent à leur place. Beaumarchais, tout en gardant le canevas d'origine, brode une pièce plus complexe qu'il n'y paraît. Il joue également avec les espaces, entre une rue de Séville et la maison de Bartholo dont la frontière est symbolisée par la fameuse jalousie, un dispositif de fermeture de fenêtre au travers duquel on pouvait voir sans être vu.
Beaumarchais renouvèle la grande comédie, amusante et de bon goût, en crise depuis 1730.
Sa pièce est avant tout gaie et optimiste ; son comique n'est pas cruel mais lié aux jeux de l'enfance, à l'insouciance et à la vitalité d'une innocente jeunesse pour laquelle rien n'est impossible : « quand la jeunesse et l'amour sont d'accord pour tromper un vieillard, tout ce qu'il fait pour l'empêcher peut s'appeler à bon droit la précaution inutile » (acte IV, scène 8).
L'ensemble est très vivant, particulièrement dynamique dans la mise en scène et dans la rapidité des répliques, les interruptions, la manière dont parfois les acteurs semblent s'adresser aux spectateurs, les prendre à témoin dans une recherche de proximité et de complicité.
Certains bons mots méritent d'être cités car ils portent la réflexion bien au-delà de la situation jouée : « aux vertus qu'on exige dans un domestique, votre excellence connaît-elle beaucoup de maître qui fussent dignes d'être valets ? » (acte I, scène 2). Beaumarchais recherche une véritable connivence avec les spectateurs en mêlant à son intrigue des réflexions sur l'actualité et les polémiques de son époque.
Je conseille évidemment la lecture de la fameuse « lettre modérée » dans laquelle l'auteur présente sa pièce au lecteur, véritable préface donnée dans la plupart des éditions, qui reprend les tenants et aboutissants et le contexte de cette oeuvre. Beaumarchais y revendique à la fois « une pièce légère, amusante et sans fatigue » et « une espèce d'imbroille » c'est à dire une oeuvre pleine d'imbroglios, à l'intrigue compliquée.
Et, naturellement, il faut lire aussi le Mariage de Figaro et La Mère coupable qui reprennent et développent certaines thématiques comme la condition des femmes et les abus de pouvoir.
Un grand plaisir de relecture et de souvenir d'études.
Ainsi, je relis le Barbier de Séville de Beaumarchais, une pièce de théâtre comique qui fait partie de nos incontournables classiques du XVIIIème siècle.
Avant d'écrire le Barbier de Séville, Beaumarchais était connu à partir de 1760 pour ses « parades du théâtre de société » ; à l'origine, les « parades » étaient des pièces courtes et drôles que l'on jouait dans les fêtes foraines, un genre populaire, outrancier et caricatural. Peu à peu, des codes ont été élaborés pour obéir aux goûts de l'élite de la société et aux exigences des petits comités choisis devant lesquels elles étaient jouées. Beaumarchais proposait donc des saynètes à l'intrigue minimaliste et aux personnages stéréotypés, sans analyse psychologique ni but moral, organisées à partir de jeux de mots et d'allusions lestes et scabreuses sans cependant tomber dans la grossièreté ou l'obscénité. Puis, comme Diderot, il est passé au drame bourgeois et enfin à la théorie littéraire vers 1767.
On retrouve quelques-unes des caractéristiques de la parade du théâtre de société dans le Barbier de Séville, qui a d'abord été un intermède, puis un opéra-comique avant de devenir la pièce comique définitive jouée pour la première fois en 1775.
Le Barbier de Séville revisite de manière novatrice une intrigue très conventionnelle servie par les personnages-types traditionnels du genre comique : un vieux barbon veut se marier avec sa pupille, une jeune et belle ingénue, mais l'amant de celle-ci parvient à l'épouser avant grâce à l'aide de son valet.
C'est surtout le personnage du valet qui est mis à l'honneur et enrichi : il est non seulement rusé, intrigant et cupide mais il a aussi une véritable épaisseur sociologique et romanesque, un parcours et un vécu qui va au-delà de la pièce. Il est à la fois barbier, apothicaire, chirurgien, auteur dramatique méconnu, le représentant en quelque sorte des gens de lettres désargentés de la bohème littéraire. Dès la deuxième scène, il fait le récit de sa vie passée qui n'apporte rien à l'intrigue à venir mais étoffe son personnage. Quand on pense à cette pièce, c'est souvent une citation de Figaro qui vient à l'esprit : « je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer » (acte I, scène 2).
En outre, contrairement aux usages, Bartholo est particulièrement rusé et difficile à manipuler ; rien ne lui échappe. Il symbolise tout ce qui est contraire à l'esprit des Lumières, dans sa posture autoritaire et supérieure.
Le Comte Almaviva doit beaucoup payer de sa personne, se déguiser par exemple, et ne pas se contenter de profiter des ficelles mises en place par son valet pour parvenir à ses fins.
Rosine, enfin, prend des initiatives et nous parle de la condition des femmes, toujours considérées comme mineures et dépendantes de l'autorité masculine.
En effet, tout cela déroge un peu si l'on considère les codes habituels de la comédie où les barbons ne sont pas très malins, les jeunes amoureux sont plutôt ternes et les ingénues restent à leur place. Beaumarchais, tout en gardant le canevas d'origine, brode une pièce plus complexe qu'il n'y paraît. Il joue également avec les espaces, entre une rue de Séville et la maison de Bartholo dont la frontière est symbolisée par la fameuse jalousie, un dispositif de fermeture de fenêtre au travers duquel on pouvait voir sans être vu.
Beaumarchais renouvèle la grande comédie, amusante et de bon goût, en crise depuis 1730.
Sa pièce est avant tout gaie et optimiste ; son comique n'est pas cruel mais lié aux jeux de l'enfance, à l'insouciance et à la vitalité d'une innocente jeunesse pour laquelle rien n'est impossible : « quand la jeunesse et l'amour sont d'accord pour tromper un vieillard, tout ce qu'il fait pour l'empêcher peut s'appeler à bon droit la précaution inutile » (acte IV, scène 8).
L'ensemble est très vivant, particulièrement dynamique dans la mise en scène et dans la rapidité des répliques, les interruptions, la manière dont parfois les acteurs semblent s'adresser aux spectateurs, les prendre à témoin dans une recherche de proximité et de complicité.
Certains bons mots méritent d'être cités car ils portent la réflexion bien au-delà de la situation jouée : « aux vertus qu'on exige dans un domestique, votre excellence connaît-elle beaucoup de maître qui fussent dignes d'être valets ? » (acte I, scène 2). Beaumarchais recherche une véritable connivence avec les spectateurs en mêlant à son intrigue des réflexions sur l'actualité et les polémiques de son époque.
Je conseille évidemment la lecture de la fameuse « lettre modérée » dans laquelle l'auteur présente sa pièce au lecteur, véritable préface donnée dans la plupart des éditions, qui reprend les tenants et aboutissants et le contexte de cette oeuvre. Beaumarchais y revendique à la fois « une pièce légère, amusante et sans fatigue » et « une espèce d'imbroille » c'est à dire une oeuvre pleine d'imbroglios, à l'intrigue compliquée.
Et, naturellement, il faut lire aussi le Mariage de Figaro et La Mère coupable qui reprennent et développent certaines thématiques comme la condition des femmes et les abus de pouvoir.
Un grand plaisir de relecture et de souvenir d'études.