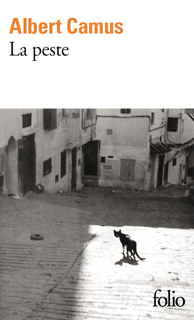>
Critique de Lesaloes
Échos lointains de nos tourments
Le décor idéal d'une tragédie. Pour parler universalité, il fallait à Camus la banalité, la neutralité et l'anonymat d'une cité solitaire. Il choisira Oran, ville de la côte algérienne « sans pittoresque, sans végétation et sans âme », sans transcendance métaphysique ou épaisseur historique, au contraire de Florence, Paris ou Madrid ; Oran minérale, jumelle et écho lointain des célèbres cités de la Grèce antique, l'Athènes de Thucidyde ou la Thèbes de l'Oedipe roi de Sophocle, frappées toutes deux, mythe et réalité, d'une épidémie de peste. Oran, fréquentée par Camus, natif d'Alger la rivale, qui y enseigna et y résida en 1941-42 dans l'appartement de son épouse, en plein coeur de ville, au 67 de la célèbre rue d'Arzew.
L'épidémie est présentée ici dans tout son froid réalisme, pullulement des rats, prostrations, drames et morts atroces, comptabilités macabres et mise en terre des victimes. Avec de gros plans du paroxysme, décès de l'interprète d'Orphée et Eurydice sur la scène du théâtre ou la bouleversante agonie de l'enfant « Et je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés » en une pathétique révolte du docteur Rieux face au père Paneloux, prêtre officiant à la grande cathédrale.
Certes, le fléau reste ici la transparente métaphore de nos imperfections « Oui, j'ai appris cela que nous étions tous dans la peste » ou de l'absolu du Mal, nazisme, persécutions, inquisitions et grandes guerres ; certes, le roman moraliste/moralisateur de l'état de siège, de l'enfermement de « prisonniers dans l'attente de leur délivrance », représente la parabole de notre humanité, faite de pestiférés exilés dans le confinement de leur ville-caverne platonicienne sur leur îlot d'univers ; livrés au huis clos, à l'entre-soi et à la nécessaire solidarité de citoyens émancipés de la tutelle d'un Dieu, de la peur ou de la résignation pour construire une terre des hommes, sous un azur vidé de sa divinité « sans lever les yeux vers ce ciel où il se tait. »
Mais les personnages sont plus que de simples prototypes porte-voix de leur maître. Faits de chair et de sang, libres de la tutelle d'un romancier jouant à dessein l'effacement, donnant libre cours à ses créatures, ils livrent, dans le cours du récit, la pleine mesure de leur libre arbitre, autonomie et liberté ; et, comme souvent dans les cas extrêmes des cours d'une vie, le drame va les révéler à eux-mêmes, oublieux de leur égoïsme dans l'abnégation de leurs actes face au drame et au danger.
C'est au premier chef le docteur Bernard Rieux, tout en tension contenue, historien incognito de la peste, préservant ainsi doublement l'anonymat de Camus l'écrivain, se voulant dans ses chroniques objectif et sans effets de l'art - utilisant en fait toutes les formes du récit, dialogues, monologue intérieur, paysages et sons du monde glissés dans le corps du roman - héros du quotidien à la recherche du sérum salvateur, s'épuisant obstinément à maintenir des vies promises au bonheur. Celui, privilège pour lui et son ami Tarrou, du bain d'une nuit, dans les eaux lustrales de la Méditerranée, « loin du monde, libérés enfin de la ville et de la peste. »
C'est le journaliste Rambert pris au piège de « cette ville déserte, blanchie de poussière, saturée d'odeurs marines, toute sonore des cris du vent, gémissant alors comme une île malheureuse. » (, cherchant à fuir son exil forcé pour rejoindre à Paris l'être aimé : il finira par se mobiliser au coeur de l'été en première ligne pour lutter contre le fléau, se sacrifiant pour l'histoire collective.
Tarrou complétant par ses carnets le récit du chroniqueur, témoignera de son engagement par la pathétique confession de sa vie ; il mourra avec Rieux en larmes d'impuissance à ses côtés « Cette forme humaine qui lui avait été si proche, percée maintenant de coups d'épieu, brûlée par un mal surhumain, tordue par tous les vents haineux du ciel, s'immergeait à ses yeux dans les eaux de la peste et il ne pouvait rien contre ce naufrage ».
A l'opposé de Cottard, cynique combinard et salaud, un vieil homme, Grand, « héros insignifiant et effacé », pleurant sa vie ratée et sa Jeanne perdue, collaborera au labeur harassant des équipes sanitaires, s'évadant dans son grand oeuvre, une cinquantaine de pages d'une même phrase répétée à l'infini, clichés et lieux communs, comme le double d'un Camus confronté aux souffrances de l'écriture. Il sera, lui, sauvé. C'est enfin la grande armée des 200.000 habitants étourdis après leur claustration par la joie des retrouvailles et des portes rouvertes enfin.
Échos lointains de nos angoisses contemporaines, le chef-d'oeuvre de Camus, poignant de détresse, élève à hauteur de l'universalité d'un mythe le fléau qui frappe Oran, capitale de la douleur, immortalisée par la grâce de l'écrivain à l'égal des plus célèbres cités de la littérature. Un très grand livre de sagesse et d'humanité, pour temps de tourments, le nôtre. Paix, la peste défaite mais « le bacille ne meurt jamais », tout est bien désormais sur la terre d'hommes de volonté.
Le décor idéal d'une tragédie. Pour parler universalité, il fallait à Camus la banalité, la neutralité et l'anonymat d'une cité solitaire. Il choisira Oran, ville de la côte algérienne « sans pittoresque, sans végétation et sans âme », sans transcendance métaphysique ou épaisseur historique, au contraire de Florence, Paris ou Madrid ; Oran minérale, jumelle et écho lointain des célèbres cités de la Grèce antique, l'Athènes de Thucidyde ou la Thèbes de l'Oedipe roi de Sophocle, frappées toutes deux, mythe et réalité, d'une épidémie de peste. Oran, fréquentée par Camus, natif d'Alger la rivale, qui y enseigna et y résida en 1941-42 dans l'appartement de son épouse, en plein coeur de ville, au 67 de la célèbre rue d'Arzew.
L'épidémie est présentée ici dans tout son froid réalisme, pullulement des rats, prostrations, drames et morts atroces, comptabilités macabres et mise en terre des victimes. Avec de gros plans du paroxysme, décès de l'interprète d'Orphée et Eurydice sur la scène du théâtre ou la bouleversante agonie de l'enfant « Et je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés » en une pathétique révolte du docteur Rieux face au père Paneloux, prêtre officiant à la grande cathédrale.
Certes, le fléau reste ici la transparente métaphore de nos imperfections « Oui, j'ai appris cela que nous étions tous dans la peste » ou de l'absolu du Mal, nazisme, persécutions, inquisitions et grandes guerres ; certes, le roman moraliste/moralisateur de l'état de siège, de l'enfermement de « prisonniers dans l'attente de leur délivrance », représente la parabole de notre humanité, faite de pestiférés exilés dans le confinement de leur ville-caverne platonicienne sur leur îlot d'univers ; livrés au huis clos, à l'entre-soi et à la nécessaire solidarité de citoyens émancipés de la tutelle d'un Dieu, de la peur ou de la résignation pour construire une terre des hommes, sous un azur vidé de sa divinité « sans lever les yeux vers ce ciel où il se tait. »
Mais les personnages sont plus que de simples prototypes porte-voix de leur maître. Faits de chair et de sang, libres de la tutelle d'un romancier jouant à dessein l'effacement, donnant libre cours à ses créatures, ils livrent, dans le cours du récit, la pleine mesure de leur libre arbitre, autonomie et liberté ; et, comme souvent dans les cas extrêmes des cours d'une vie, le drame va les révéler à eux-mêmes, oublieux de leur égoïsme dans l'abnégation de leurs actes face au drame et au danger.
C'est au premier chef le docteur Bernard Rieux, tout en tension contenue, historien incognito de la peste, préservant ainsi doublement l'anonymat de Camus l'écrivain, se voulant dans ses chroniques objectif et sans effets de l'art - utilisant en fait toutes les formes du récit, dialogues, monologue intérieur, paysages et sons du monde glissés dans le corps du roman - héros du quotidien à la recherche du sérum salvateur, s'épuisant obstinément à maintenir des vies promises au bonheur. Celui, privilège pour lui et son ami Tarrou, du bain d'une nuit, dans les eaux lustrales de la Méditerranée, « loin du monde, libérés enfin de la ville et de la peste. »
C'est le journaliste Rambert pris au piège de « cette ville déserte, blanchie de poussière, saturée d'odeurs marines, toute sonore des cris du vent, gémissant alors comme une île malheureuse. » (, cherchant à fuir son exil forcé pour rejoindre à Paris l'être aimé : il finira par se mobiliser au coeur de l'été en première ligne pour lutter contre le fléau, se sacrifiant pour l'histoire collective.
Tarrou complétant par ses carnets le récit du chroniqueur, témoignera de son engagement par la pathétique confession de sa vie ; il mourra avec Rieux en larmes d'impuissance à ses côtés « Cette forme humaine qui lui avait été si proche, percée maintenant de coups d'épieu, brûlée par un mal surhumain, tordue par tous les vents haineux du ciel, s'immergeait à ses yeux dans les eaux de la peste et il ne pouvait rien contre ce naufrage ».
A l'opposé de Cottard, cynique combinard et salaud, un vieil homme, Grand, « héros insignifiant et effacé », pleurant sa vie ratée et sa Jeanne perdue, collaborera au labeur harassant des équipes sanitaires, s'évadant dans son grand oeuvre, une cinquantaine de pages d'une même phrase répétée à l'infini, clichés et lieux communs, comme le double d'un Camus confronté aux souffrances de l'écriture. Il sera, lui, sauvé. C'est enfin la grande armée des 200.000 habitants étourdis après leur claustration par la joie des retrouvailles et des portes rouvertes enfin.
Échos lointains de nos angoisses contemporaines, le chef-d'oeuvre de Camus, poignant de détresse, élève à hauteur de l'universalité d'un mythe le fléau qui frappe Oran, capitale de la douleur, immortalisée par la grâce de l'écrivain à l'égal des plus célèbres cités de la littérature. Un très grand livre de sagesse et d'humanité, pour temps de tourments, le nôtre. Paix, la peste défaite mais « le bacille ne meurt jamais », tout est bien désormais sur la terre d'hommes de volonté.