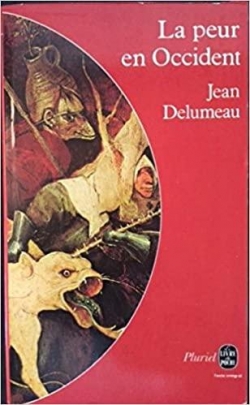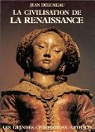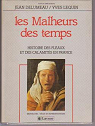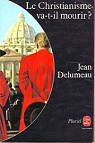Citations sur La peur en Occident (28)
Voici maintenant la cité assiégée par la maladie, mise en quarantaine, au besoin ceinturée par la troupe, confrontée à l'angoisse quotidienne et contrainte à un style d'existence en rupture avec celui auquel elle était habituée. Les cadres familiers sont abolis. L'insécurité ne naît pas seulement de la présence de la maladie, mais aussi d'une destructuration des éléments qui construisaient l'environnement quotidien. Tout est autre. Et d'abord la ville est anormalement déserte et silencieuse. Beaucoup de maisons sont désormais inhabitées.
Il est utile de distinguer méthodologiquement deux types de peur.
La peur DANS l'obscurité est celle qu'éprouvaient les premiers hommes quand ils se trouvaient exposés la nuit aux attaques des bêtes féroces sans pouvoir deviner leur approche dans les ténèbres. Aussi devaient-ils éloigner par des feux ces "dangers objectifs". Ces peurs qui revenaient chaque soir ont sans doute sensibilisé l'humanité et lui ont appris à redouter les pièges de la nuit. La peur DANS l'obscurité, c'est aussi celle que ressent tout d'un coup un enfant qui s'est endormi sans difficulté, mais s'éveille ensuite une ou plusieurs fois, pris de terreurs nocturnes. Les yeux ouverts, il semble encore regarder les images épouvantables de son rêve. Cette fois il s'agit de "dangers subjectifs". Et ceux-ci constituent peut-être la principale explication des peurs qui nous envahissent la nuit.
[...] Que les "dangers objectifs" de la nuit aient amené l'humanité, par accumulation au cours des âges, à la peupler de "périls subjectifs", c'est plus que probable. Et de cette façon déjà la peur DANS l'obscurité a pu devenir plus intensément et plus généralement une peur DE l'obscurité. Mais cette dernière existe aussi pour d'autres raisons plus intérieures et qui tiennent à notre condition. La vue de l'homme est plus aigüe que celle de beaucoup d'animaux, par exemple le chien et le chat ; aussi les ténèbres le laissent-elles plus désemparé que beaucoup de mammifères. En outre, la privation de lumière met en veilleuse les "réducteurs" de l'activité imaginative. Celle-ci, libérée, confond plus facilement que durant le jour le réel et la fiction et risque de s'égarer hors des chemins sûrs.
La peur DANS l'obscurité est celle qu'éprouvaient les premiers hommes quand ils se trouvaient exposés la nuit aux attaques des bêtes féroces sans pouvoir deviner leur approche dans les ténèbres. Aussi devaient-ils éloigner par des feux ces "dangers objectifs". Ces peurs qui revenaient chaque soir ont sans doute sensibilisé l'humanité et lui ont appris à redouter les pièges de la nuit. La peur DANS l'obscurité, c'est aussi celle que ressent tout d'un coup un enfant qui s'est endormi sans difficulté, mais s'éveille ensuite une ou plusieurs fois, pris de terreurs nocturnes. Les yeux ouverts, il semble encore regarder les images épouvantables de son rêve. Cette fois il s'agit de "dangers subjectifs". Et ceux-ci constituent peut-être la principale explication des peurs qui nous envahissent la nuit.
[...] Que les "dangers objectifs" de la nuit aient amené l'humanité, par accumulation au cours des âges, à la peupler de "périls subjectifs", c'est plus que probable. Et de cette façon déjà la peur DANS l'obscurité a pu devenir plus intensément et plus généralement une peur DE l'obscurité. Mais cette dernière existe aussi pour d'autres raisons plus intérieures et qui tiennent à notre condition. La vue de l'homme est plus aigüe que celle de beaucoup d'animaux, par exemple le chien et le chat ; aussi les ténèbres le laissent-elles plus désemparé que beaucoup de mammifères. En outre, la privation de lumière met en veilleuse les "réducteurs" de l'activité imaginative. Celle-ci, libérée, confond plus facilement que durant le jour le réel et la fiction et risque de s'égarer hors des chemins sûrs.
" Qui a bon voisin a bon matin " répètent les proverbes, non sans insister de façon significative sur la vérité opposée : " Qui a félon voisin par maintes faiz en a mavez matin." (XIIIe siècle, Roman de Fierabras.). "On dit qui a mal voisin que il a souvent mal matin." (XIIIe siècle, Roman du Renart, vers 3527.)
Première partie : Les peurs du plus grand nombre
Chapitre I. Omniprésence de la peur
§2. Le lointain et le prochain; le nouveau et l'ancien
Première partie : Les peurs du plus grand nombre
Chapitre I. Omniprésence de la peur
§2. Le lointain et le prochain; le nouveau et l'ancien
Le voisin est d'autant plus redoutable que rien ne lui échappe. Son oeil inquisiteur fouille votre existence à longueur de journée et d'année. (...) Dans l'univers d'aujourd'hui, le sentiment dominant entre voisins est l'indifférence; dans celui de jadis, c'était la méfiance; donc la crainte. Aussi convenait-il de surveiller autrui et de se tenir en état d'alerte constante vis-à-vis de lui.
Première partie : Les peurs du plus grand nombre
Chapitre I. Omniprésence de la peur
§2. Le lointain et le prochain; le nouveau et l'ancien
Première partie : Les peurs du plus grand nombre
Chapitre I. Omniprésence de la peur
§2. Le lointain et le prochain; le nouveau et l'ancien
Quand apparaît le danger de la contagion, on essaie d'abord de ne pas le voir. Les chroniques relatives aux pestes font ressortir la fréquente négligence des autorités à prendre les mesures qu'imposait l'imminence du péril, étant vrai toutefois que le mécanisme de défense une fois déclenché, les moyens de protection allèrent en se perfectionnant au cours des siècles. [...] Certes, on trouve à une telle attitude des justifications raisonnables : on voulait ne pas affoler la population - d'où les multiples interdictions de manifestations de deuil au début des épidémies - et surtout ne pas interrompre les relations économiques avec l'extérieur. Car la quarantaine pour une ville signifiait difficulté de ravitaillement, effondrement des affaires, chômage, désordres probables dans la rue, etc. Tant que l'épidémie ne causait encore qu'un nombre limité de décès on pouvait encore espérer qu'elle régresserait d'elle-même avant d'avoir ravagé toute la cité. Mais, plus profondes que ces raisons avouées ou avouables, existaient certainement des motivations moins conscientes : la peur légitime de la peste conduisait à retarder le plus longtemps possible le moment où on la regarderait en face. Médecins et autorités cherchaient donc à se tromper eux-mêmes. Rassurant les populations, ils se rassuraient à leur tour.
On constate donc, dans le temps et dans l'espace, une sorte d'unanimité dans le refus de mots regardés comme tabous.
On évitait de les prononcer. Ou, si on le faisait au début d'une épidémie, c'était dans une locution négative et rassurante telle que "ce n'est pas la peste à proprement parler".
Nommer le mal, c'eût été l'attirer et abattre l'ultime rempart qui le tenait en respect.
Arrivait toutefois un moment où on ne pouvait plus éviter d'appeler la contagion par son horrible nom. Alors la panique déferlait sur la ville.
La solution raisonnable était de fuir.
On évitait de les prononcer. Ou, si on le faisait au début d'une épidémie, c'était dans une locution négative et rassurante telle que "ce n'est pas la peste à proprement parler".
Nommer le mal, c'eût été l'attirer et abattre l'ultime rempart qui le tenait en respect.
Arrivait toutefois un moment où on ne pouvait plus éviter d'appeler la contagion par son horrible nom. Alors la panique déferlait sur la ville.
La solution raisonnable était de fuir.
L'idée que la divinité punit les hommes coupables est sans doute aussi vieille que la civilisation.
6. Un Dieu vengeur et un monde vieilli
Deuxième partie. La culture dirigeante de la peur.
VI l'attente de Dieu
6. Un Dieu vengeur et un monde vieilli
Deuxième partie. La culture dirigeante de la peur.
VI l'attente de Dieu
Le lointain, la nouveauté et l'altérité faisaient peur. Mais on redoutait tout autant le prochain, c'est-à-dire le voisin. Dans tous les grands ensembles de notre univers concentrationnaire, on s'ignore souvent d'une porte à l'autre d'un même palier. On connait mieux les bruits de l'appartement proche que le visage de ses habitants. Aussi vit-on dans la grisaille et la monotonie d'un anonymat cent fois répété. Autrefois, au contraire -dans "ce monde que nous avons (en grande partie) perdu"- on connaissait le voisin et dans bien des cas on le connaissait trop. Il pesait sur vous. Un horizon étroit ramenait perpétuellement les mêmes gens les uns près des autres délimitant un cercle de passions tenaces, de haines réciproques, sans cesse alimentées de nouvelles rancoeurs. Aussi était-ce une chance hautement appréciée d'avoir un ami à portée de la main.
Première partie : Les peurs du plus grand nombre
Chapitre I. Omniprésence de la peur
§2. Le lointain et le prochain; le nouveau et l'ancien
Première partie : Les peurs du plus grand nombre
Chapitre I. Omniprésence de la peur
§2. Le lointain et le prochain; le nouveau et l'ancien
Derrière ces croyances légendaires ou ces exagérations affolantes, on devine la peur de l'autre, c'est-à-dire de tout ce qui appartient à un univers différent du sien. Certes, les aspects extraordinaires qu'on prêtait aux pays lointains pouvaient aussi constituer un attrait puissant. L'imagination collective de l'Europe au Moyen Age et à la Renaissance inventait au-delà des mers de luxuriants pays de cocagne dont les mirages tirèrent hors des horizons familiers découvreurs et aventuriers. le lointain -l'autre- fut aussi un aimant qui permit à l'Europe de sortir d'elle-même.
Première partie : Les peurs du plus grand nombre
Chapitre I. Omniprésence de la peur
§2. Le lointain et le prochain; le nouveau et l'ancien
Première partie : Les peurs du plus grand nombre
Chapitre I. Omniprésence de la peur
§2. Le lointain et le prochain; le nouveau et l'ancien
Ouvrant sur le lointain, la mer aboutissait autrefois à des pays insolites où tout était possible et où l'étrange était la règle -un étrange souvent effrayant.. De Pline l'Ancien à Simone Majolo, en passant par Vincent de Beauvais, Mandeville et les Mille et une Nuits, se maintint la croyance en une montagne aimantée située quelque part sur la route de l'Inde : elle attirait irrésistiblement les navires porteurs d'objets métalliques et notamment de clous, les gardait prisonniers ou même provoquait leur dislocation et leur naufrage.
Première partie : Les peurs du plus grand nombre
Chapitre I. Omniprésence de la peur
§2. Le lointain et le prochain; le nouveau et l'ancien
Première partie : Les peurs du plus grand nombre
Chapitre I. Omniprésence de la peur
§2. Le lointain et le prochain; le nouveau et l'ancien
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean Delumeau (46)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3231 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3231 lecteurs ont répondu