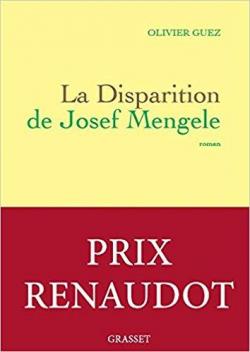>
Critique de Ahoi242
Dans son essai le perdant radical : Essai sur les hommes de la terreur, Enzensberger écrivait : « On est conduit à penser que ce que voulaient profondément Hitler et ses fidèles, c'était moins la victoire que la radicalisation et la perpétuation de leur statut de perdants. Certes, la rage accumulée s'est déchaînée dans une guerre d'extermination sans précédent contre tous ceux qu'ils tenaient pour responsables de leurs propres défaites - il s'agissait d'abord d'anéantir les Juifs et le camp qui avait imposé sa loi en 1919 -, mais ils ne songeaient pas un seul instant à épargner les Allemands. Leur véritable but n'était pas la victoire, mais l'extermination, l'effondrement, le suicide collectif, la fin dans l'effroi. Il n'y a pas d'autre explication au fait qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale les Allemands ont continué à se battre à Berlin, jusqu'au dernier bâtiment en ruines. Hitler lui-même a confirmé ce diagnostic en affirmant que le peuple allemand ne méritait pas de survivre. Au prix de sacrifices inouïs, il a obtenu ce qu'i voulait : perdre. Mais malgré tout, les Juifs, les Polonais, les Russes, les Allemands et tous les autres sont encore là. »
En cette rentrée littéraire 2017 où les Nazis sont à la mode - Magda Goebbels, la femme de Joseph Goebbels dans Ces rêves qu'on piétine, de Sébastien Spitzer, Josef Mengele dans Mischling d'Affinity K, …-, Olivier Guez traite d'un perdant radical - il utilise le terme (p. 137) sans citer pour autant Enzensberger dans les sources et la bibliographie - Josef Mengele en s'intéressant essentiellement sinon exclusivement à La disparition de Josef Mengele, aux trente années s'étalant de 1949, date de son arrivée en Argentine, à sa « mort mystérieuse sur une plage en 1979 » (4ème de couverture) au Brésil, en passant par le Paraguay.
Plutôt bien écrit avec quelques très belles formules littéraires et bien référencé même si les explications sont (trop) courtes sur le processus de fabrication du livre, Olivier Guez relate bien la disparition de l'Ange de la Mort, et même les longueurs (que j'ai ressenties) dans la description du quotidien de Mengele (notamment dans la période brésilienne) font finalement écho à la longueur de cette disparition. À l'exception des crimes contre l'humanité dont il s'est rendu coupable et de son idéologie mortifère, Mengele apparaît comme un homme banal - jaloux de son frère, d'Eichman, sous la tutelle de son propre père qui faisait tourner l'entreprise familiale Mengele Agrartechnik,… - mais qui n'émettra ni regret, ni remords pour sa contribution à la « production de cadavres » (Leszek Kolakowski dans Comment être conservateur + socialiste + libéral).
Dans le livre de Guez, le plus intéressant à mes yeux restera paradoxalement ce qui ne concerne pas Mengele directement. Ainsi, les évocations du recyclage par les époux Péron des Nazis, de la « nazi society de Buenos Aires » (p. 46), de Hans-Uli Rudel, militaire allemand le plus décoré de la seconde guerre mondiale, nazi et antisémite patenté mais jamais inquiété dans l'après-guerre, des tentatives des Nazis planqués en Amérique du Sud de raviver le nazisme, la minimisation du rôle de Simon Wiesenthal, la visite du fils de Mengele à son père, la construction des enfants de perdants radicaux,... sont autant sinon plus intéressantes que les pages sur Mengele même lorsque ces thèmes sont à peine effleurés.
Après comme l'écrit Guez lui-même « En ce milieu des années 1960, James Bond triomphe sur les écrans et Docteur Mengele devient une marque dont l'évocation glace le sang et fait grimper les tirages des livres et des magazines : l'archétype du nazi froid et sadique, un monstre » (p. 165) ; en 2017, Mengele fait toujours grimper les tirages des livres, bien davantage qu'un « Gerhard Bohne, le directeur administratif du programme d'euthanaisie T4 (deux millions de stérilisés, soixante-dix mille handicapés gazés) » (p. 42) ou qu'un « Walter Rauff (quatre-ving-dix-sept mille homicides), l'inventeur du camion à gaz, le prototype des chambres dans les camps d'extermination à l'est » (p. 85).
En cette rentrée littéraire 2017 où les Nazis sont à la mode - Magda Goebbels, la femme de Joseph Goebbels dans Ces rêves qu'on piétine, de Sébastien Spitzer, Josef Mengele dans Mischling d'Affinity K, …-, Olivier Guez traite d'un perdant radical - il utilise le terme (p. 137) sans citer pour autant Enzensberger dans les sources et la bibliographie - Josef Mengele en s'intéressant essentiellement sinon exclusivement à La disparition de Josef Mengele, aux trente années s'étalant de 1949, date de son arrivée en Argentine, à sa « mort mystérieuse sur une plage en 1979 » (4ème de couverture) au Brésil, en passant par le Paraguay.
Plutôt bien écrit avec quelques très belles formules littéraires et bien référencé même si les explications sont (trop) courtes sur le processus de fabrication du livre, Olivier Guez relate bien la disparition de l'Ange de la Mort, et même les longueurs (que j'ai ressenties) dans la description du quotidien de Mengele (notamment dans la période brésilienne) font finalement écho à la longueur de cette disparition. À l'exception des crimes contre l'humanité dont il s'est rendu coupable et de son idéologie mortifère, Mengele apparaît comme un homme banal - jaloux de son frère, d'Eichman, sous la tutelle de son propre père qui faisait tourner l'entreprise familiale Mengele Agrartechnik,… - mais qui n'émettra ni regret, ni remords pour sa contribution à la « production de cadavres » (Leszek Kolakowski dans Comment être conservateur + socialiste + libéral).
Dans le livre de Guez, le plus intéressant à mes yeux restera paradoxalement ce qui ne concerne pas Mengele directement. Ainsi, les évocations du recyclage par les époux Péron des Nazis, de la « nazi society de Buenos Aires » (p. 46), de Hans-Uli Rudel, militaire allemand le plus décoré de la seconde guerre mondiale, nazi et antisémite patenté mais jamais inquiété dans l'après-guerre, des tentatives des Nazis planqués en Amérique du Sud de raviver le nazisme, la minimisation du rôle de Simon Wiesenthal, la visite du fils de Mengele à son père, la construction des enfants de perdants radicaux,... sont autant sinon plus intéressantes que les pages sur Mengele même lorsque ces thèmes sont à peine effleurés.
Après comme l'écrit Guez lui-même « En ce milieu des années 1960, James Bond triomphe sur les écrans et Docteur Mengele devient une marque dont l'évocation glace le sang et fait grimper les tirages des livres et des magazines : l'archétype du nazi froid et sadique, un monstre » (p. 165) ; en 2017, Mengele fait toujours grimper les tirages des livres, bien davantage qu'un « Gerhard Bohne, le directeur administratif du programme d'euthanaisie T4 (deux millions de stérilisés, soixante-dix mille handicapés gazés) » (p. 42) ou qu'un « Walter Rauff (quatre-ving-dix-sept mille homicides), l'inventeur du camion à gaz, le prototype des chambres dans les camps d'extermination à l'est » (p. 85).