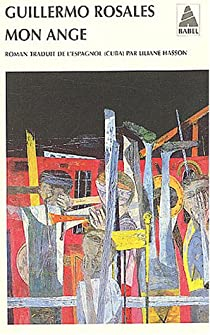>
Critique de oblo
Pour qui croirait à la chance, au destin, aux faveurs des astres, il ne serait pas à douter que Guillermo Rosales n'a pas goûté leurs faveurs. Arrivé à Miami, en Floride, après avoir connu les tourments du régime castriste sur son île natale, Cuba, il fut placé par sa famille au sein de l'une de ces maisons d'accueil appelée boarding home ou halfway house, et qui n'ont d'accueil que le nom. C'est dans ce type d'endroits qu'il demeura une majeure partie du temps qu'il passa sur le sol américain, de 1979 à sa mort, en 1993. Mon ange relate son arrivée à Miami, dans le boarding home d'un certain M. Curbelo, et l'on est surpris par le choix de ce titre qui, en comparaison avec le propos du livre, lui confère une puissante valeur oxymorique. Car rien, dans ce récit auto-fictionnel, ne relève de la douceur éthérée ou de la grâce angélique. Tout y est monstrueusement sale, violent, désespérant. Cruelle description du sort réservé à une partie des migrants cubains arrivés sur le sol floridien, le récit tord net le cou à l'imaginaire reluisant du rêve américain, sans pour autant indiquer un quelconque regret de l'île quittée. L'homme, où qu'il se trouve, et Rosales en témoigne, n'est jamais qu'une proie pour ses semblables.
Quel mot pourrait le mieux résumer ce qu'est un boarding home, si ce n'est le mot "enfer" ? Habitée autrefois par une famille américaine, la maison que découvre Rosales est devenue tant un cloaque qu'une prison et un asile où vivent, isolés et oubliés du monde, ceux et celles dont ne peuvent ni ne veulent s'occuper les familles. Là, une vingtaine de personnes sont placées sous l'autorité omnipotente de M. Curbelo et d'un gardien tyrannique, Arsenio. Là est abandonnée toute idée de dignité humaine ; la crasse, la sueur, l'urine et la merde imprègnent chaque parcelle de tissu, chaque mètre carré de ces chambres où les résidents dorment par deux. Toilettes bouchées, excréments à même le sol et compagnie des blattes font l'ordinaire de cette maison dont M. Curbelo tire des revenus très confortables, lesquels lui permettent de côtoyer la bonne société de Miami. Confisquant leur aide sociale, M. Curbelo tient à sa disposition ces malades mentaux - schizophrènes, attardés, bipolaires - dont la société ne veut pas. D'ailleurs, William Figueras - l'alter ego littéraire de Guillermo Rosales - a été placé là par sa propre famille, puisqu'il "n'y a plus rien à faire", dixit sa tante. Dans ce microcosme où il n'est aucun échappatoire, il se développe des habitudes et des rituels auxquels Figueras finit par se conformer. Ainsi du petit déjeuner, en fait un verre de lait froid, distribué le matin par Arsenio qui, l'annonçant, ameute l'ensemble de la maisonnée. Ainsi cette habitude d'uriner et de déféquer sur ce que les résidents auront placé dans la cuvette des WC : rideau, maillot sale, imperméable. Plus encore, Figueras fait sienne la loi du plus fort, qui établit une hiérarchie stricte entre les résidents, dont le sommet est Arsenio, homme de confiance de M. Curbelo et tyran redoutable pour chacun. Cette forme de gouvernance des affaires internes à la maisonnée autorise ainsi la brutalisation des plus faibles et les attouchements et autres viols ses femmes. Arsenio couche ainsi avec Hilda qu'il contraint à des pratiques qu'elle ne désire pas. Figueras, qui finit par nouer, sinon une amitié, du moins une certaine connivence avec Arsenio, prend aussi le vil pli d'imposer sa personne et sa volonté aux autres par la force. On le voit alors voler son camarade de chambrée, qui travaille de nuit dans une pizzeria ; on le voit frapper le vieux Pépé, fragile et incontinent. La maison de fous - au sens propre comme au figuré - semble être la reproduction miniaturisée du monde extérieur où, sans égards pour les faibles, les malades, ceux que la vie aura outragés et brisés, ceux qui détiennent quelque chose ressemblant à du pouvoir - la force physique suffit - exerce celui-ci pour tout accaparer.
L'arrivée dans le boarding home d'une nouvelle résidente, Francine, - dont la litanie des "mon ange" donne son titre au livre - constitue l'acmé et le dénouement du récit. Acmé, parce que Figueras accueille cette femme comme il a déjà pris l'habitude de traiter les autres résidents. Dans un mélange de frustration et d'adoration, d'envie de destruction et de protection, Figueras tantôt caresse et baise le corps de cette femme, tantôt le pince et l'étrangle. Sur ce corps, il peut exercer une volonté tyrannique et une force qui ne rencontre aucune résistance ; mais cette âme, qu'il devine bouleversée par des événements brutaux, lui ouvre aussi un avenir possible et paisible, une histoire d'amour d'apparence banale, une vie en dehors du boarding home et des méchancetés quotidiennes. Seulement, des deux âmes, l'une qui conserve encore un peu de force, l'autre complètement résignée et qui s'accroche au moindre morceau d'humanité, l'une - Figueras - parvient à se détacher de l'emprise de M. Curbelo quand l'autre retourne entre les griffes de quelque lointaine famille.
Mon ange signe ainsi la fin d'une illusion. Nulle part, la vie n'est meilleure pour l'homme de peu. Nulle part - ni dans l'île communiste, ni dans le grand pays où tout est prétendument possible -, l'homme qui a montré quelque faiblesse n'est protégé. Pis, il est exposé à toutes les maltraitances, physiques comme psychologiques. La galerie de personnages qui se trouvent au boarding home est un échantillon de ces hommes et femmes qui, un jour, ont cru : à la littérature comme Figueras (qui a lu tous les grands auteurs à quinze ans), à la dignité de la bourgeoisie comme Hida, à la possibilité d'une vie meilleure, comme certainement quelques-uns des résidents. Au moins, si le rêve américain semble sérieusement ébréché, l'expérience cubaine l'est tout autant. Ce qui est pris là-bas - la liberté, la dignité - n'est pas permis ici. L'expérience de Figueras / Rosales doit donc être comprise au-delà des lectures idéologiques. Aucun système de pensée, aucun parti-pris sociologique ou économique ne saurait justifier le traitement réservé à ces hommes et femmes. Au début du roman, Guillermo Rosales écrit d'ailleurs que ce livre n'a rien à voir avec la politique. Exilé total, c'est bien au tombeau qu'il est promis.
Quel mot pourrait le mieux résumer ce qu'est un boarding home, si ce n'est le mot "enfer" ? Habitée autrefois par une famille américaine, la maison que découvre Rosales est devenue tant un cloaque qu'une prison et un asile où vivent, isolés et oubliés du monde, ceux et celles dont ne peuvent ni ne veulent s'occuper les familles. Là, une vingtaine de personnes sont placées sous l'autorité omnipotente de M. Curbelo et d'un gardien tyrannique, Arsenio. Là est abandonnée toute idée de dignité humaine ; la crasse, la sueur, l'urine et la merde imprègnent chaque parcelle de tissu, chaque mètre carré de ces chambres où les résidents dorment par deux. Toilettes bouchées, excréments à même le sol et compagnie des blattes font l'ordinaire de cette maison dont M. Curbelo tire des revenus très confortables, lesquels lui permettent de côtoyer la bonne société de Miami. Confisquant leur aide sociale, M. Curbelo tient à sa disposition ces malades mentaux - schizophrènes, attardés, bipolaires - dont la société ne veut pas. D'ailleurs, William Figueras - l'alter ego littéraire de Guillermo Rosales - a été placé là par sa propre famille, puisqu'il "n'y a plus rien à faire", dixit sa tante. Dans ce microcosme où il n'est aucun échappatoire, il se développe des habitudes et des rituels auxquels Figueras finit par se conformer. Ainsi du petit déjeuner, en fait un verre de lait froid, distribué le matin par Arsenio qui, l'annonçant, ameute l'ensemble de la maisonnée. Ainsi cette habitude d'uriner et de déféquer sur ce que les résidents auront placé dans la cuvette des WC : rideau, maillot sale, imperméable. Plus encore, Figueras fait sienne la loi du plus fort, qui établit une hiérarchie stricte entre les résidents, dont le sommet est Arsenio, homme de confiance de M. Curbelo et tyran redoutable pour chacun. Cette forme de gouvernance des affaires internes à la maisonnée autorise ainsi la brutalisation des plus faibles et les attouchements et autres viols ses femmes. Arsenio couche ainsi avec Hilda qu'il contraint à des pratiques qu'elle ne désire pas. Figueras, qui finit par nouer, sinon une amitié, du moins une certaine connivence avec Arsenio, prend aussi le vil pli d'imposer sa personne et sa volonté aux autres par la force. On le voit alors voler son camarade de chambrée, qui travaille de nuit dans une pizzeria ; on le voit frapper le vieux Pépé, fragile et incontinent. La maison de fous - au sens propre comme au figuré - semble être la reproduction miniaturisée du monde extérieur où, sans égards pour les faibles, les malades, ceux que la vie aura outragés et brisés, ceux qui détiennent quelque chose ressemblant à du pouvoir - la force physique suffit - exerce celui-ci pour tout accaparer.
L'arrivée dans le boarding home d'une nouvelle résidente, Francine, - dont la litanie des "mon ange" donne son titre au livre - constitue l'acmé et le dénouement du récit. Acmé, parce que Figueras accueille cette femme comme il a déjà pris l'habitude de traiter les autres résidents. Dans un mélange de frustration et d'adoration, d'envie de destruction et de protection, Figueras tantôt caresse et baise le corps de cette femme, tantôt le pince et l'étrangle. Sur ce corps, il peut exercer une volonté tyrannique et une force qui ne rencontre aucune résistance ; mais cette âme, qu'il devine bouleversée par des événements brutaux, lui ouvre aussi un avenir possible et paisible, une histoire d'amour d'apparence banale, une vie en dehors du boarding home et des méchancetés quotidiennes. Seulement, des deux âmes, l'une qui conserve encore un peu de force, l'autre complètement résignée et qui s'accroche au moindre morceau d'humanité, l'une - Figueras - parvient à se détacher de l'emprise de M. Curbelo quand l'autre retourne entre les griffes de quelque lointaine famille.
Mon ange signe ainsi la fin d'une illusion. Nulle part, la vie n'est meilleure pour l'homme de peu. Nulle part - ni dans l'île communiste, ni dans le grand pays où tout est prétendument possible -, l'homme qui a montré quelque faiblesse n'est protégé. Pis, il est exposé à toutes les maltraitances, physiques comme psychologiques. La galerie de personnages qui se trouvent au boarding home est un échantillon de ces hommes et femmes qui, un jour, ont cru : à la littérature comme Figueras (qui a lu tous les grands auteurs à quinze ans), à la dignité de la bourgeoisie comme Hida, à la possibilité d'une vie meilleure, comme certainement quelques-uns des résidents. Au moins, si le rêve américain semble sérieusement ébréché, l'expérience cubaine l'est tout autant. Ce qui est pris là-bas - la liberté, la dignité - n'est pas permis ici. L'expérience de Figueras / Rosales doit donc être comprise au-delà des lectures idéologiques. Aucun système de pensée, aucun parti-pris sociologique ou économique ne saurait justifier le traitement réservé à ces hommes et femmes. Au début du roman, Guillermo Rosales écrit d'ailleurs que ce livre n'a rien à voir avec la politique. Exilé total, c'est bien au tombeau qu'il est promis.