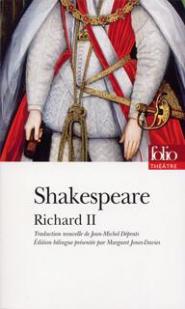>
Critique de Nastasia-B
Ah ! C'est sûr, c'est pas du Game of Thrones™, ce truc-là ! C'est pas demain que l'insignifiant Shakespeare, avec ses faibles moyens (même pas labellisé HBO, c'est tout dire !), arrivera à la cheville du GRAND monsieur Martin™, et fera pulser le coeur de toutes les midinettes à coup de dragons et de morts-vivants !
Ah ! C'est sûr, c'est pas non plus un crac, ici, l'ami Shakespeare, en fratrie de loups extralucides, en hémoglobine bon marché, en têtes virilement sectionnées, en bacchanales baisatoires (voilà ce qui plait aux jouvenceaux, n'est-ce pas, Monsieur Martin™, c'est ça qu'est tout bon), ni en tout ce qui fait le fond de comm… euh ! la valeur artistique, voulais-je écrire, du Trône de fer ™ & associés. (Car tout le monde ne peut pas être aussi subtil que le grand, GRAND monsieur Martin™…)
(Quoique, quoique, dans le théâtre élisabéthain, j'en connais deux ou trois qui se défendent assez bien sur le registre subtil de l'hémoglobine, notamment un obscur Christopher Marlowe dans Massacre à Paris ou l'insignifiant Shakespeare, toujours lui, dans Titus Andronicus, et quoique, quoique notre inimitable et génialissime monsieur Martin™ ait peut-être un tout petit peu emprunté, oh si peu !, à l'insignifiant Shakespeare son Falstaff pour imaginer son gros roi Baratheon. Et peut-être même quelques autres… Ah ! Qui sait ? Qui sait ?…
Bref ! Triste époque que la nôtre qui porte aux nues du réchauffé de bas aloi et qui s'extasie sur des livres pour ado ! Qu'en restera-t-il dans 400 ans ?… Dormez tranquille, Messire Shakespeare.)
Bien sûr, il faut tout de même connaître un peu l'histoire anglaise du Moyen-Âge pour savourer pleinement toute les subtilités de cette tragédie historique. Basée sur des faits réels (enjolivés ou modifiés au besoin), cette pièce en cinq actes nous représente une usurpation du pouvoir légitime d'un roi par un prétendant aux dents longues, en l'espèce, son propre cousin.
C'est une fois encore chez Shakespeare très finement observé et cette pièce, dans son style, — n'ayons pas peur des mots — est un petit bijou, mais lequel style ou lequel bijou ne sont pas forcément très en vogue en ce moment, la faute à qui vous savez. La pièce s'ouvre sur un Richard II triomphant, respecté ou craint, c'est selon, et dont la légitimité ne fait aucun doute.
Très habilement, par petites touches, William Shakespeare s'applique à nous le montrer volontiers inique ou quelque peu tyran. Du moins, un roi faible, qui sait mal s'entourer et surtout mal distinguer, parmi la horde de ses courtisans, ceux qui le veulent bien conseiller de ceux qui misent pour leur propre compte.
Il s'ensuit que l'état des finances royales est un désastre et qu'il faut puiser à toutes les sources possibles pour réinjecter de l'argent frais afin de faire fonctionner l'appareil royal. La pièce débute sur un différend, une dénonciation d'un notable par un notable où seul l'arbitrage du roi pourra sceller la sentence.
Or, c'est dans cet exercice que Richard II se montre peu ferme, peu sûr et peu fiable. Le plaignant, c'est Henry Bolingbroke, le propre cousin du roi, fils de Jean de Gand, le frère du père du roi. L'accusé est un important lord — l'un des plus puissants —, en la personne de Thomas Mowbray, duc de Norfolk, comte de Nottingham, homme de confiance du roi. Henry Bolingbroke accuse Thomas Mowbray d'avoir fomenté l'assassinat de leur oncle commun au roi et à lui-même, à savoir, Thomas Woodstock, ainsi que d'avoir détourné des fonds royaux.
Le roi se révèle incapable de juger et de mettre un terme à cette querelle, probablement par un reste de scrupule religieux, car il sait très bien que c'est lui-même le commanditaire de l'assassinat en question et que s'il autorise ce qui semble être le plus naturel, à savoir un duel en bonne et due forme, le sang d'un innocent va couler inutilement.
Il va donc prendre deux mauvaises décisions : le bannissement respectif des deux plaignants, créant un fort sentiment d'injustice, notamment vis-à-vis de Bolingbroke, même si, témoin encore de sa faiblesse, le père Jean de Gand obtient facilement un amenuisement de la peine de son fils.
Gestion financière calamiteuse, écoute de mauvais conseils, décisions douteuses et jugées injustes, grogne populaire en raison de l'élévation des taxes et impôts divers destinés à combler les trésoreries du roi. Il ne manquait plus que deux petits éléments déclencheurs pour conduire un tel roi à sa propre perte : une rébellion des Irlandais à aller mater et un cruel manque d'argent pour mener cette guerre qui oblige à dépouiller les cousins bannis, par exemple.
Arrive donc un Henry Bolingbroke dans son bon droit, jouissant d'un support populaire important et victime d'une visible injustice. Peu à peu, les rouages s'enclenchent, les rats engraissés sous le règne de Richard quittent vite le navire quand le vent du changement souffle.
Très habilement, l'auteur sait nous dépeindre les mutations psychologiques réciproques qui s'opèrent chez chacun des deux cousins, l'un devenant peu à peu martyr et l'autre peu à peu tyran, c'est marrant (N. B. : il s'agit d'un calembour mathématique dont l'équation est la suivante : MARTYR — TYRAN = MARRANT car TYR — TYR = 0 … bon, OK, je sors…).
C'est étonnant comme cette histoire d'une usurpation du pouvoir m'a fait penser, toutes proportions gardées, à l'ascension de Hitler aux dépens de Hindenburg, thème qu'a exploité Bertolt Brecht dans La Résistible Ascension d'Arturo Ui. Lequel usurpateur, Henry Bolingbroke, sera sacré sous le titre de Henry IV, et deviendra le sujet d'une autre pièce de Shakespeare.
J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette pièce, qui m'a permis de mesurer mon niveau d'inculture en matière d'histoire médiévale britannique, mais je conçois qu'on ne soit pas forcément féru de ce genre de recherches historiques pour mieux comprendre sa lecture, d'où mon appréciation mesurée. Mais c'est pourtant, selon moi, une pièce qui vaut le détour.
Intéressante psychologiquement et politiquement, tout en étant également intéressante à replacer dans son contexte d'écriture : Elisabeth Ière n'ayant, elle non plus, pas d'héritier. Elle ne s'est d'ailleurs pas méprise sur la signification profonde de cette pièce ; à savoir semer la discorde, parmi les prétendants au trône (qui n'était pas en fer), comme ce fût le cas plus tard chez les Plantagenet, descendants d'Henry IV et ceux du duc d'York. Mais ceci est une autre histoire qui nous mènerait bien trop loin.
En somme, voici une bien belle tragédie, sans hémoglobine, sans pathos excessif, sans scène de cul, tout en nuance et en réflexion, de la belle ouvrage, loin, loin, loin du racolage trône de ferresque, mais ce n'est, bien évidemment, que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
P. S. : je ne doute pas que mes prises de positions au détriment de Game of Thrones risquent d'offusquer certains lecteurs ou lectrices. Mais comme je mets un point d'honneur à argumenter mes points de vue, je vous demande, avant de me jeter quelques pleines cagettes de tomates pourries d'aller lire, ne serait-ce que Titus Andronicus, pour vous faire votre propre opinion et constater que, grosso modo, le destin d'Eddard Stark et de sa famille dans le Trône de fer est une resucée quasi intégrale de Shakespeare.
Les fameux « changements de point de vue » tant vantés par les admirateurs de monsieur Martin™, ne sont rien d'autre, rien de plus que ce que Shakespeare a opéré en écrivant Hamlet d'un côté et Macbeth de l'autre. Le personnage de Cersei Lannister/Baratheon est un remake de Lady Macbeth. J'ai déjà parlé de Falstaff mais on retrouve également dans la série l'équivalent du personnage de Iago (Othello). Quant à Jon Snow, de ce que j'en ai compris (Je vous concède que je me suis arrêtée à la première saison quand j'ai compris que jamais décidément jamais je n'accrocherai à cette mélasse.), c'est plus ou moins un Hamlet.
Le titre même du premier bouquin de Martin™, « Le Trône de fer » est un quasi plagiat de celui des Rois maudits de Maurice Druon dont le premier volume s'intitulait « Le Roi de fer ». Et si vous regardez bien, point par point, pratiquement tout a été pompé à droite ou à gauche mais en n'omettant jamais d'y adjoindre une petite touche bien racoleuse, comme ce que fait un peu Quentin Tarentino dans ses derniers films.
Là où William Shakespeare fait de la littérature, au sens le plus noble du terme, quitte à utiliser le sang ou les plus bas instincts de l'homme, George R. R. Martin fait, lui, de la soupe, une vieille bouillabaisse qui pue, pas le poisson, malheureusement, ça ce serait encore tenable, mais bien plus puant encore : le côté obscur de la littérature, sa négation absolue contaminée par le kitsch et le retour sur investissement. Du bien bon commercial qui tache…
LUKE LITERATUREWALKER : Est-ce que le côté obscur est le plus fort ?
GUSTAVE YODA : Plus facile, plus rapide, plus séduisant est le côté obscur de la littérature, mais pas meilleur il est. Si par le côté obscur de la littérature tu te laisses séduire, jamais plus tu ne…
… et vous connaissez la suite.
Ah ! C'est sûr, c'est pas non plus un crac, ici, l'ami Shakespeare, en fratrie de loups extralucides, en hémoglobine bon marché, en têtes virilement sectionnées, en bacchanales baisatoires (voilà ce qui plait aux jouvenceaux, n'est-ce pas, Monsieur Martin™, c'est ça qu'est tout bon), ni en tout ce qui fait le fond de comm… euh ! la valeur artistique, voulais-je écrire, du Trône de fer ™ & associés. (Car tout le monde ne peut pas être aussi subtil que le grand, GRAND monsieur Martin™…)
(Quoique, quoique, dans le théâtre élisabéthain, j'en connais deux ou trois qui se défendent assez bien sur le registre subtil de l'hémoglobine, notamment un obscur Christopher Marlowe dans Massacre à Paris ou l'insignifiant Shakespeare, toujours lui, dans Titus Andronicus, et quoique, quoique notre inimitable et génialissime monsieur Martin™ ait peut-être un tout petit peu emprunté, oh si peu !, à l'insignifiant Shakespeare son Falstaff pour imaginer son gros roi Baratheon. Et peut-être même quelques autres… Ah ! Qui sait ? Qui sait ?…
Bref ! Triste époque que la nôtre qui porte aux nues du réchauffé de bas aloi et qui s'extasie sur des livres pour ado ! Qu'en restera-t-il dans 400 ans ?… Dormez tranquille, Messire Shakespeare.)
Bien sûr, il faut tout de même connaître un peu l'histoire anglaise du Moyen-Âge pour savourer pleinement toute les subtilités de cette tragédie historique. Basée sur des faits réels (enjolivés ou modifiés au besoin), cette pièce en cinq actes nous représente une usurpation du pouvoir légitime d'un roi par un prétendant aux dents longues, en l'espèce, son propre cousin.
C'est une fois encore chez Shakespeare très finement observé et cette pièce, dans son style, — n'ayons pas peur des mots — est un petit bijou, mais lequel style ou lequel bijou ne sont pas forcément très en vogue en ce moment, la faute à qui vous savez. La pièce s'ouvre sur un Richard II triomphant, respecté ou craint, c'est selon, et dont la légitimité ne fait aucun doute.
Très habilement, par petites touches, William Shakespeare s'applique à nous le montrer volontiers inique ou quelque peu tyran. Du moins, un roi faible, qui sait mal s'entourer et surtout mal distinguer, parmi la horde de ses courtisans, ceux qui le veulent bien conseiller de ceux qui misent pour leur propre compte.
Il s'ensuit que l'état des finances royales est un désastre et qu'il faut puiser à toutes les sources possibles pour réinjecter de l'argent frais afin de faire fonctionner l'appareil royal. La pièce débute sur un différend, une dénonciation d'un notable par un notable où seul l'arbitrage du roi pourra sceller la sentence.
Or, c'est dans cet exercice que Richard II se montre peu ferme, peu sûr et peu fiable. Le plaignant, c'est Henry Bolingbroke, le propre cousin du roi, fils de Jean de Gand, le frère du père du roi. L'accusé est un important lord — l'un des plus puissants —, en la personne de Thomas Mowbray, duc de Norfolk, comte de Nottingham, homme de confiance du roi. Henry Bolingbroke accuse Thomas Mowbray d'avoir fomenté l'assassinat de leur oncle commun au roi et à lui-même, à savoir, Thomas Woodstock, ainsi que d'avoir détourné des fonds royaux.
Le roi se révèle incapable de juger et de mettre un terme à cette querelle, probablement par un reste de scrupule religieux, car il sait très bien que c'est lui-même le commanditaire de l'assassinat en question et que s'il autorise ce qui semble être le plus naturel, à savoir un duel en bonne et due forme, le sang d'un innocent va couler inutilement.
Il va donc prendre deux mauvaises décisions : le bannissement respectif des deux plaignants, créant un fort sentiment d'injustice, notamment vis-à-vis de Bolingbroke, même si, témoin encore de sa faiblesse, le père Jean de Gand obtient facilement un amenuisement de la peine de son fils.
Gestion financière calamiteuse, écoute de mauvais conseils, décisions douteuses et jugées injustes, grogne populaire en raison de l'élévation des taxes et impôts divers destinés à combler les trésoreries du roi. Il ne manquait plus que deux petits éléments déclencheurs pour conduire un tel roi à sa propre perte : une rébellion des Irlandais à aller mater et un cruel manque d'argent pour mener cette guerre qui oblige à dépouiller les cousins bannis, par exemple.
Arrive donc un Henry Bolingbroke dans son bon droit, jouissant d'un support populaire important et victime d'une visible injustice. Peu à peu, les rouages s'enclenchent, les rats engraissés sous le règne de Richard quittent vite le navire quand le vent du changement souffle.
Très habilement, l'auteur sait nous dépeindre les mutations psychologiques réciproques qui s'opèrent chez chacun des deux cousins, l'un devenant peu à peu martyr et l'autre peu à peu tyran, c'est marrant (N. B. : il s'agit d'un calembour mathématique dont l'équation est la suivante : MARTYR — TYRAN = MARRANT car TYR — TYR = 0 … bon, OK, je sors…).
C'est étonnant comme cette histoire d'une usurpation du pouvoir m'a fait penser, toutes proportions gardées, à l'ascension de Hitler aux dépens de Hindenburg, thème qu'a exploité Bertolt Brecht dans La Résistible Ascension d'Arturo Ui. Lequel usurpateur, Henry Bolingbroke, sera sacré sous le titre de Henry IV, et deviendra le sujet d'une autre pièce de Shakespeare.
J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette pièce, qui m'a permis de mesurer mon niveau d'inculture en matière d'histoire médiévale britannique, mais je conçois qu'on ne soit pas forcément féru de ce genre de recherches historiques pour mieux comprendre sa lecture, d'où mon appréciation mesurée. Mais c'est pourtant, selon moi, une pièce qui vaut le détour.
Intéressante psychologiquement et politiquement, tout en étant également intéressante à replacer dans son contexte d'écriture : Elisabeth Ière n'ayant, elle non plus, pas d'héritier. Elle ne s'est d'ailleurs pas méprise sur la signification profonde de cette pièce ; à savoir semer la discorde, parmi les prétendants au trône (qui n'était pas en fer), comme ce fût le cas plus tard chez les Plantagenet, descendants d'Henry IV et ceux du duc d'York. Mais ceci est une autre histoire qui nous mènerait bien trop loin.
En somme, voici une bien belle tragédie, sans hémoglobine, sans pathos excessif, sans scène de cul, tout en nuance et en réflexion, de la belle ouvrage, loin, loin, loin du racolage trône de ferresque, mais ce n'est, bien évidemment, que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
P. S. : je ne doute pas que mes prises de positions au détriment de Game of Thrones risquent d'offusquer certains lecteurs ou lectrices. Mais comme je mets un point d'honneur à argumenter mes points de vue, je vous demande, avant de me jeter quelques pleines cagettes de tomates pourries d'aller lire, ne serait-ce que Titus Andronicus, pour vous faire votre propre opinion et constater que, grosso modo, le destin d'Eddard Stark et de sa famille dans le Trône de fer est une resucée quasi intégrale de Shakespeare.
Les fameux « changements de point de vue » tant vantés par les admirateurs de monsieur Martin™, ne sont rien d'autre, rien de plus que ce que Shakespeare a opéré en écrivant Hamlet d'un côté et Macbeth de l'autre. Le personnage de Cersei Lannister/Baratheon est un remake de Lady Macbeth. J'ai déjà parlé de Falstaff mais on retrouve également dans la série l'équivalent du personnage de Iago (Othello). Quant à Jon Snow, de ce que j'en ai compris (Je vous concède que je me suis arrêtée à la première saison quand j'ai compris que jamais décidément jamais je n'accrocherai à cette mélasse.), c'est plus ou moins un Hamlet.
Le titre même du premier bouquin de Martin™, « Le Trône de fer » est un quasi plagiat de celui des Rois maudits de Maurice Druon dont le premier volume s'intitulait « Le Roi de fer ». Et si vous regardez bien, point par point, pratiquement tout a été pompé à droite ou à gauche mais en n'omettant jamais d'y adjoindre une petite touche bien racoleuse, comme ce que fait un peu Quentin Tarentino dans ses derniers films.
Là où William Shakespeare fait de la littérature, au sens le plus noble du terme, quitte à utiliser le sang ou les plus bas instincts de l'homme, George R. R. Martin fait, lui, de la soupe, une vieille bouillabaisse qui pue, pas le poisson, malheureusement, ça ce serait encore tenable, mais bien plus puant encore : le côté obscur de la littérature, sa négation absolue contaminée par le kitsch et le retour sur investissement. Du bien bon commercial qui tache…
LUKE LITERATUREWALKER : Est-ce que le côté obscur est le plus fort ?
GUSTAVE YODA : Plus facile, plus rapide, plus séduisant est le côté obscur de la littérature, mais pas meilleur il est. Si par le côté obscur de la littérature tu te laisses séduire, jamais plus tu ne…
… et vous connaissez la suite.