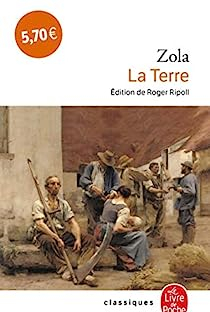>
Critique de Lamifranz
Comme le titre le suggère, « La Terre », quinzième roman de la série des Rougon-Macquart, se présente comme un roman rural. Rural, mais pas rustique, encore moins champêtre : ici ce n'est seulement un simple décor – même réaliste – devant lequel se déroule une histoire. La Terre est à la fois le lieu de l'action, elle en affirme la temporalité (avec le retour des saisons) et elle en est même le personnage principal : le mot « terre désigne aussi bien le sol, terre nourricière, qui est aussi une « propriété » et a une valeur monnayable, et la matière, qui avec l'herbe et les rochers, est un composant de la Nature. Plus une dimension poétique et même philosophique que l'auteur ajoute, par petites doses. On s'attend donc à une histoire humaine, primitive, presque animale : au coeur du roman est la vie, la vie débordante, et souvent excessive : le roman abonde en scènes fortes, parfois choquantes (outrancières pour une bonne partie de la critique : bestialité, viol, inceste, parricide…) qui valurent à l'auteur les pires commentaires de sa carrière (qui pourtant n'en manquait pas).
Le héros du roman est Jean Macquart (le frère de Gervaise et de Lisa). En fait, il est là pour justifier le rattachement du roman à la série, puisqu'il intervient surtout en tant que témoin, son rôle en tant que personnage étant important mais pas déterminant.
Nous sommes sur une grande propriété de la Beauce. le vieux Fouan décide de partager ses biens entre ses trois enfants Hyacinthe (dit Jésus-Christ), Fanny (mariée à Delhomme) et Buteau. Il y a aussi deux cousines, Lise que Buteau a violée puis épousée, et Françoise qu'il poursuit de ses assiduités. Françoise se rapproche de Jean Macquart. Buteau la viole (avec l'aide obligeante de sa femme) puis cette dernière l'empale sur une faux. Après quoi ils brûlent le vieux Fouan qui a assisté à la scène. le pauvre Jean se dit que décidément il n'y a rien à tirer de ces gens-là, et quitte le domaine.
Vous comprenez maintenant ce qui a fait tiquer les critiques bien-pensants. Et quand la critique tique, la critique tacle : « cas pathologique », « monomanie de l'ordure », obsession du bestial », j'en passe et des pires. Il faut dire qu'Emile avait mis dans le mille. Venant après Balzac et Sand qu'il accuse de n'avoir qu'une vision faussée du monde paysan (« les paysans de George Sand sont bons, honnêtes, sages, prévoyants, nobles, en un mot ils sont parfaits… Il faut vivre longtemps avec lui – le paysan – pour le voir dans sa ressemblance et le peindre. Balzac a essayé et n'a réussi qu'en partie… » Zola a accumulé comme à son habitude une immense documentation. Et toujours comme d'habitude il n'a mis dans son roman que des choses vraies (même si c'est avec une certaine complaisance).
La « bronca » qui a accueilli le roman, toute énorme qu'elle fut (y compris dans la mouvance naturaliste) fit long feu. Zola était blindé contre ces attaques, et, comme d'habitude encore, le scandale fit augmenter les ventes.
« La Terre » est sans doute un des romans les plus durs de l'auteur, des plus cruels, mais également un des plus attachants. le propos général des Rougon-Macquart semble ici s'être légèrement déporté : paradoxalement Jean Macquart est un des rares personnages de la saga à ne pas avoir de tare héréditaire, il est même relativement honnête et plutôt sympathique. En revanche tout le côté malsain, vénal, pourri est rassemblé dans la famille Fouan où on a du mal de trouver des personnages positifs, à part la malheureuse Françoise. Il y a même une vieille tante qu'on appelle La Grande, qui est une incarnation de la malignité, une nouvelle Cousine Bette…
Souvent déprécié à cause de ces « outrances » qui finalement n'en sont pas, « La Terre » est un roman majeur des « Rougon-Macquart ». A mettre au même plan que « L'Assommoir » ou « Germinal ».
Le héros du roman est Jean Macquart (le frère de Gervaise et de Lisa). En fait, il est là pour justifier le rattachement du roman à la série, puisqu'il intervient surtout en tant que témoin, son rôle en tant que personnage étant important mais pas déterminant.
Nous sommes sur une grande propriété de la Beauce. le vieux Fouan décide de partager ses biens entre ses trois enfants Hyacinthe (dit Jésus-Christ), Fanny (mariée à Delhomme) et Buteau. Il y a aussi deux cousines, Lise que Buteau a violée puis épousée, et Françoise qu'il poursuit de ses assiduités. Françoise se rapproche de Jean Macquart. Buteau la viole (avec l'aide obligeante de sa femme) puis cette dernière l'empale sur une faux. Après quoi ils brûlent le vieux Fouan qui a assisté à la scène. le pauvre Jean se dit que décidément il n'y a rien à tirer de ces gens-là, et quitte le domaine.
Vous comprenez maintenant ce qui a fait tiquer les critiques bien-pensants. Et quand la critique tique, la critique tacle : « cas pathologique », « monomanie de l'ordure », obsession du bestial », j'en passe et des pires. Il faut dire qu'Emile avait mis dans le mille. Venant après Balzac et Sand qu'il accuse de n'avoir qu'une vision faussée du monde paysan (« les paysans de George Sand sont bons, honnêtes, sages, prévoyants, nobles, en un mot ils sont parfaits… Il faut vivre longtemps avec lui – le paysan – pour le voir dans sa ressemblance et le peindre. Balzac a essayé et n'a réussi qu'en partie… » Zola a accumulé comme à son habitude une immense documentation. Et toujours comme d'habitude il n'a mis dans son roman que des choses vraies (même si c'est avec une certaine complaisance).
La « bronca » qui a accueilli le roman, toute énorme qu'elle fut (y compris dans la mouvance naturaliste) fit long feu. Zola était blindé contre ces attaques, et, comme d'habitude encore, le scandale fit augmenter les ventes.
« La Terre » est sans doute un des romans les plus durs de l'auteur, des plus cruels, mais également un des plus attachants. le propos général des Rougon-Macquart semble ici s'être légèrement déporté : paradoxalement Jean Macquart est un des rares personnages de la saga à ne pas avoir de tare héréditaire, il est même relativement honnête et plutôt sympathique. En revanche tout le côté malsain, vénal, pourri est rassemblé dans la famille Fouan où on a du mal de trouver des personnages positifs, à part la malheureuse Françoise. Il y a même une vieille tante qu'on appelle La Grande, qui est une incarnation de la malignité, une nouvelle Cousine Bette…
Souvent déprécié à cause de ces « outrances » qui finalement n'en sont pas, « La Terre » est un roman majeur des « Rougon-Macquart ». A mettre au même plan que « L'Assommoir » ou « Germinal ».