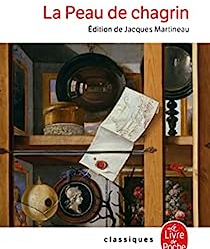>
Critique de Ascyltus
Peut-on vivre sans désirer ?
C'est autant pour cette réflexion que pour ses qualités romanesques que cette oeuvre m'a intéressé (Balzac l'a classée parmi ses « Études philosophiques »). En suivant le parcours du jeune marquis Raphaël de Valentin, ponctué souvent par des rencontres symboliques avec de mystérieux vieillards, Balzac fait l'analyse de différents modes de vie (l'étude, la vie mondaine, la débauche, la vie rurale…), tout en offrant des réflexions sur le suicide, la pitié, les insuffisances de la science, etc.
Le roman est divisé en trois parties. La première installe de façon remarquable l'atmosphère fantastique, avec l'emploi d'une langue foisonnante et suggestive. Les personnages sont croqués en quelques lignes, de façon très convaincante. C'est une très belle trouvaille romanesque que le tourbillon qui emporte le lecteur et le personnage principal quand ce dernier, au bord du suicide, est accosté et entraîné par ses amis. Alors qu'on reproche souvent à Balzac ses interminables descriptions en début de roman (personnellement, je les apprécie), seules des bribes d'informations sont données au lecteur au profit d'un rythme effréné captivant. de même, la dernière partie offre des pages admirables et offre un portrait plus nuancé du personnage principal.
En revanche, quelle purge que la deuxième partie, où Raphaël raconte son propre parcours ! On y trouve des répétitions exaspérantes et c'est complètement invraisemblable (c'est censé être une confession faite à un ami pendant une nuit d'orgie, mais c'est beaucoup trop long !). Surtout, et je sais que c'est une lecture anachronique, le personnage principal m'y semble très antipathique pour un lecteur du XXIe siècle. Raphaël est présenté comme un homme de génie : on doit donc l'admirer. Peu importe si le génie, qui consacre trois ans de sa vie à deux oeuvres, n'en finit aucune. Sa pauvre logeuse et sa fille multiplient les sacrifices pour qu'il poursuive son oeuvre : cela donne des scènes touchantes, mais qui ne font pas oublier que Raphaël a fait des études de droit qui auraient pu lui fournir un emploi et que son génie, stérile, repose sur beaucoup d'égoïsme.
Son amour pour Feodora le rend plus antipathique encore : il semble que Balzac cherche à nous faire condamner comme cruelle l'indifférence de cette femme, alors qu'elle annonce dès leur rencontre qu'elle ne veut ni mari ni amant. Mais comme ce génie admirable l'aime, la distrait et lui rend quelques services, il conviendrait tout de même qu'elle cède au bout d'un moment, comprenez-vous… le pire est atteint quand Raphaël raconte qu'il a été tenté de la violer (mais il s'est retenu car il est marquis et génial), et il semble qu'on doit y voir la juste expression de sa passion… Il y a donc dans cette deuxième partie des passages très pénibles et très gênants.
En somme, c'est toujours la même chose avec Balzac : il est capable du pire comme du meilleur, mais celui-ci l'emporte presque toujours sur celui-là, et il y a dans La Peau de chagrin des pages inoubliables.
Enfin, si vous comptez acheter ce livre, évitez l'édition « Étonnants Classiques » conçue pour les élèves de première préparant le bac, truffée d'erreurs.
C'est autant pour cette réflexion que pour ses qualités romanesques que cette oeuvre m'a intéressé (Balzac l'a classée parmi ses « Études philosophiques »). En suivant le parcours du jeune marquis Raphaël de Valentin, ponctué souvent par des rencontres symboliques avec de mystérieux vieillards, Balzac fait l'analyse de différents modes de vie (l'étude, la vie mondaine, la débauche, la vie rurale…), tout en offrant des réflexions sur le suicide, la pitié, les insuffisances de la science, etc.
Le roman est divisé en trois parties. La première installe de façon remarquable l'atmosphère fantastique, avec l'emploi d'une langue foisonnante et suggestive. Les personnages sont croqués en quelques lignes, de façon très convaincante. C'est une très belle trouvaille romanesque que le tourbillon qui emporte le lecteur et le personnage principal quand ce dernier, au bord du suicide, est accosté et entraîné par ses amis. Alors qu'on reproche souvent à Balzac ses interminables descriptions en début de roman (personnellement, je les apprécie), seules des bribes d'informations sont données au lecteur au profit d'un rythme effréné captivant. de même, la dernière partie offre des pages admirables et offre un portrait plus nuancé du personnage principal.
En revanche, quelle purge que la deuxième partie, où Raphaël raconte son propre parcours ! On y trouve des répétitions exaspérantes et c'est complètement invraisemblable (c'est censé être une confession faite à un ami pendant une nuit d'orgie, mais c'est beaucoup trop long !). Surtout, et je sais que c'est une lecture anachronique, le personnage principal m'y semble très antipathique pour un lecteur du XXIe siècle. Raphaël est présenté comme un homme de génie : on doit donc l'admirer. Peu importe si le génie, qui consacre trois ans de sa vie à deux oeuvres, n'en finit aucune. Sa pauvre logeuse et sa fille multiplient les sacrifices pour qu'il poursuive son oeuvre : cela donne des scènes touchantes, mais qui ne font pas oublier que Raphaël a fait des études de droit qui auraient pu lui fournir un emploi et que son génie, stérile, repose sur beaucoup d'égoïsme.
Son amour pour Feodora le rend plus antipathique encore : il semble que Balzac cherche à nous faire condamner comme cruelle l'indifférence de cette femme, alors qu'elle annonce dès leur rencontre qu'elle ne veut ni mari ni amant. Mais comme ce génie admirable l'aime, la distrait et lui rend quelques services, il conviendrait tout de même qu'elle cède au bout d'un moment, comprenez-vous… le pire est atteint quand Raphaël raconte qu'il a été tenté de la violer (mais il s'est retenu car il est marquis et génial), et il semble qu'on doit y voir la juste expression de sa passion… Il y a donc dans cette deuxième partie des passages très pénibles et très gênants.
En somme, c'est toujours la même chose avec Balzac : il est capable du pire comme du meilleur, mais celui-ci l'emporte presque toujours sur celui-là, et il y a dans La Peau de chagrin des pages inoubliables.
Enfin, si vous comptez acheter ce livre, évitez l'édition « Étonnants Classiques » conçue pour les élèves de première préparant le bac, truffée d'erreurs.