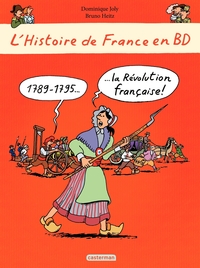>
Critique de simoncailloux
Livre lu à la suite de : « Henri IV et les guerres de religion" du même scénariste et même graphiste (dessinateur). En faire la comparaison allait de soi. Autant j'avais trouvé les explications des guerres de religion, de la prise de pouvoir d'Henri IV et de sa gestion limpide ; il n'en fut pas de même pour le récit de la révolution française que j'ai trouvée confus. A quelques exceptions près ce sont des textes lisibles dans les vignettes car sur fonds de couleur pastel. Les dessins sont en couleur. Les dessins vont dans le détail. En fin de volume on retrouve des dates clés. Il y a également quelques portraits d'acteurs clés de la révolution française et des explications sous forme de textes.
Lorsque Louis XV très impopulaire meurt, la population fonde ses espoirs dans son petit-fils le duc de Berry qui prendra le nom de Lois XVI. Après la mort de son père puis de son frère ainé, c'est lui qui va succéder à Louis XV.
Louis XVI a épousé Marie-Antoinette, princesse autrichienne. Ce mariage scelle l'alliance de deux royaumes qui ont été pendant longtemps ennemis.
On appelle les philosophe « Hommes des lumières » car ils apportent un éclairage nouveau sur le monde et la société. Les philosophes critiquent le poids de la religion, le pouvoir absolu des rois, l'influence des puissants. Ils défendent les libertés de penser et d'entreprendre.
La société comprend le clergé qui jouit de privilèges, la noblesse qui perçoit des taxes sur ses domaines. Clergé et noblesse sont dispensés de payer l'impôt. le tiers état regroupe 95% de la population. On y retrouve de riches marchands, des industriels et surtout de pauvres artisans et paysans fortement soumis à l'impôt. La France est en crise économiques. Pour faire face à la crise financière, le roi Louis XVI convoque une assemblée générale où les représentants de chaque ordre (noblesse, clergé et tiers état) se rencontrent. On appelle cette réunion les États généraux. Ils débuteront le 5 mai 1789. Afin de se préparer à cette importante rencontre, le roi demande à ses citoyens de mettre par écrit leurs demandes et leurs suggestions. Toutes ces idées sont écrites dans des livres qu'on appelle les cahiers de doléances. On y critique le fait que seuls les membres du tiers état paient des impôts et on demande que les membres des deux autres ordres en paient également. Évidemment, cette proposition, malgré qu'elle soit appuyée par le roi, n'est pas acceptée par la noblesse et le clergé. Tout est en place pour que le peuple se révolte.
Tout au long des États généraux, des émeutes et des manifestations éclatent un peu partout en France. le tiers état revendique une société plus juste. Ses représentants, les bourgeois, se voyant refuser leurs demandes par la noblesse et le clergé, décident de tenir une réunion en dehors des États généraux. Elle aura lieu le 17 juin 1789. Ils y concluent une entente : ils resteront ensemble tant qu'ils n'auront pas doté la France d'une nouvelle constitution qui supprimera les privilèges de la noblesse et du clergé. Cette nouvelle assemblée constituante, portée par les valeurs humanistes des philosophes des Lumières, représente une menace pour le pouvoir du roi et pour l'Ancien Régime.
Des émeutes ont lieu depuis le début des États généraux, mais le 14 juillet 1789 marque un tournant dans l'histoire de la France. Durant cette journée, des membres du tiers état attaquent et prennent possession de la prison de la Bastille. Cet acte est très représentatif. Bien qu'il n'y ait que peu de prisonniers à l'intérieur de cette prison, elle est un symbole du pouvoir absolu du roi qui peut enfermer qui il veut.
Une monarchie constitutionnelle est un système politique dans lequel les pouvoirs du monarque, qui est le chef de l'État, sont limités par un gouvernement élu et des lois.
Le 4 août 1789, les députés, sous la pression du peuple français, n'ont d'autre choix que d'abolir les privilèges de la noblesse et du clergé. le 26 août de la même année, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un texte officiel protégeant les libertés de tous et de chacun, est mise en place. C'est la fin de l'Ancien Régime. Un peu plus tard, la monarchie absolue est remplacée par une monarchie constitutionnelle. Toutefois, Louis XVI tente de garder des pouvoirs pour lui seul. Finalement, la monarchie tombe et Louis XVI est guillotiné en janvier 1793.
Une république est un système politique dans lequel le peuple détient le pouvoir et l'exerce directement ou par l'intermédiaire de représentants.
La monarchie constitutionnelle est remplacée par une république. Ce changement ne se fait pas sans heurt. La Révolution qui était censée apporter la liberté et l'égalité au peuple est maintenant source de peur, de violence et de pauvreté. Les membres du Comité du salut public, ainsi que d'autres révolutionnaires, sont exécutés à leur tour. La France se retrouve donc dans un état d'instabilité politique et financière, ce qui permettra à Napoléon Bonaparte et à son armée de prendre le pouvoir en 1799. Cet évènement marque la fin de la République.
Lorsque Louis XV très impopulaire meurt, la population fonde ses espoirs dans son petit-fils le duc de Berry qui prendra le nom de Lois XVI. Après la mort de son père puis de son frère ainé, c'est lui qui va succéder à Louis XV.
Louis XVI a épousé Marie-Antoinette, princesse autrichienne. Ce mariage scelle l'alliance de deux royaumes qui ont été pendant longtemps ennemis.
On appelle les philosophe « Hommes des lumières » car ils apportent un éclairage nouveau sur le monde et la société. Les philosophes critiquent le poids de la religion, le pouvoir absolu des rois, l'influence des puissants. Ils défendent les libertés de penser et d'entreprendre.
La société comprend le clergé qui jouit de privilèges, la noblesse qui perçoit des taxes sur ses domaines. Clergé et noblesse sont dispensés de payer l'impôt. le tiers état regroupe 95% de la population. On y retrouve de riches marchands, des industriels et surtout de pauvres artisans et paysans fortement soumis à l'impôt. La France est en crise économiques. Pour faire face à la crise financière, le roi Louis XVI convoque une assemblée générale où les représentants de chaque ordre (noblesse, clergé et tiers état) se rencontrent. On appelle cette réunion les États généraux. Ils débuteront le 5 mai 1789. Afin de se préparer à cette importante rencontre, le roi demande à ses citoyens de mettre par écrit leurs demandes et leurs suggestions. Toutes ces idées sont écrites dans des livres qu'on appelle les cahiers de doléances. On y critique le fait que seuls les membres du tiers état paient des impôts et on demande que les membres des deux autres ordres en paient également. Évidemment, cette proposition, malgré qu'elle soit appuyée par le roi, n'est pas acceptée par la noblesse et le clergé. Tout est en place pour que le peuple se révolte.
Tout au long des États généraux, des émeutes et des manifestations éclatent un peu partout en France. le tiers état revendique une société plus juste. Ses représentants, les bourgeois, se voyant refuser leurs demandes par la noblesse et le clergé, décident de tenir une réunion en dehors des États généraux. Elle aura lieu le 17 juin 1789. Ils y concluent une entente : ils resteront ensemble tant qu'ils n'auront pas doté la France d'une nouvelle constitution qui supprimera les privilèges de la noblesse et du clergé. Cette nouvelle assemblée constituante, portée par les valeurs humanistes des philosophes des Lumières, représente une menace pour le pouvoir du roi et pour l'Ancien Régime.
Des émeutes ont lieu depuis le début des États généraux, mais le 14 juillet 1789 marque un tournant dans l'histoire de la France. Durant cette journée, des membres du tiers état attaquent et prennent possession de la prison de la Bastille. Cet acte est très représentatif. Bien qu'il n'y ait que peu de prisonniers à l'intérieur de cette prison, elle est un symbole du pouvoir absolu du roi qui peut enfermer qui il veut.
Une monarchie constitutionnelle est un système politique dans lequel les pouvoirs du monarque, qui est le chef de l'État, sont limités par un gouvernement élu et des lois.
Le 4 août 1789, les députés, sous la pression du peuple français, n'ont d'autre choix que d'abolir les privilèges de la noblesse et du clergé. le 26 août de la même année, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un texte officiel protégeant les libertés de tous et de chacun, est mise en place. C'est la fin de l'Ancien Régime. Un peu plus tard, la monarchie absolue est remplacée par une monarchie constitutionnelle. Toutefois, Louis XVI tente de garder des pouvoirs pour lui seul. Finalement, la monarchie tombe et Louis XVI est guillotiné en janvier 1793.
Une république est un système politique dans lequel le peuple détient le pouvoir et l'exerce directement ou par l'intermédiaire de représentants.
La monarchie constitutionnelle est remplacée par une république. Ce changement ne se fait pas sans heurt. La Révolution qui était censée apporter la liberté et l'égalité au peuple est maintenant source de peur, de violence et de pauvreté. Les membres du Comité du salut public, ainsi que d'autres révolutionnaires, sont exécutés à leur tour. La France se retrouve donc dans un état d'instabilité politique et financière, ce qui permettra à Napoléon Bonaparte et à son armée de prendre le pouvoir en 1799. Cet évènement marque la fin de la République.