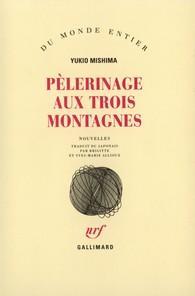>
Critique de RogerRaynal
Ce recueil regroupe sept nouvelles. Bien qu'il soit souvent présenté comme une « oeuvre de jeunesse », leur rédaction s'étale de 1946 à 1965, et la majorité d'entre elles ont été écrites entre 1963 et 1965, alors que Mishima approchait la quarantaine. J'ai déjà chronique ici même le mini recueil « martyre », paru chez folio, qui reprend les nouvelles « Martyre » (de 1964) et Ken (écrite en 1963). Je parlerai donc surtout des autres récits.
On peut lire que ce recueil se consacre au thème de l'adolescence. Nous en sommes, en réalité, très loin. Seuls deux récits (Martyre et La cigarette) concernent des adolescents. Les autres mettent en scène de jeunes adultes, voire des personnages aux rives de la vieillesse.
Il en est ainsi pour Tsuneko, l'héroïne de « Pèlerinage aux trois montagnes ». Cette femme entre deux âges s'est dévouée à servir Fujimiya, poète renommé et professeur célèbre. Elle-même s'essaye, sans grand succès, à la poésie. Avec une obséquiosité qui confine à la servilité, Tsuneko, veuve, a consumé toutes ses chances de bonheur dans l'admiration qu'elle porte à Fujimiya. Un jour, ce dernier, d'ordinaire distant, la convie à l'accompagner dans un pèlerinage qu'il effectue dans la région de Kumano, abritant trois temples célèbres. Au cours de ce voyage, elle aura l'occasion de découvrir les ressorts qui animent son impénétrable maître et de sonder les tréfonds ses propres sentiments.
La situation décrite dans cette nouvelle n'est pas sans rappeler, dans la soumission volontaire de l'héroïne, celle développée dans le roman « après le banquet », où cette fois c'est l'amour, et non l'admiration, qui est le moteur d'un renoncement à vivre féminin.
« La mer et le couchant », courte nouvelle dédiée aux beautés de la nature, met en scène, en 1272, un moine vénérable, accompagné, d'un enfant, dont nous découvrirons l'étonnante histoire, qui se manifeste à sa mémoire par chacune des splendeurs qu'il peut contempler lors d'un coucher de soleil sur la mer.
« La cigarette » est une nouvelle célèbre : Mishima l'écrivit en 1945, alors qu'il n'ait que 20 ans, et en janvier 1946, il l'apportera, ainsi qu'une autre (« histoire sur un promontoire »), à Kawabata, auquel il rendra visite à Kamakura. Ce dernier les recommandera pour le nouveau journal littéraire « Ningen », de haute tenue, dans lequel elles seront publiées six mois plus tard.
« La cigarette » raconte les découvertes d'un adolescent, Nagasaki, à qui des « grands » offrent une cigarette. Jusqu'alors intellectuel assez terne, ce jeune homme va alors utiliser cette cigarette comme une clé lui permettant d'entrouvrir la porte d'un univers inconnu : celui des jeunes hommes sur d'eux, pleins de vigueur et de force, sportifs accomplis, pour lesquels il ressent une trouble attirance. Les questions auxquelles il devra répondre ne sont pas sans annoncer « Confession d'un masque », le roman qui suivra, trois ans plus tard, cette nouvelle, établissant Mishima comme un écrivain majeur.
Les deux premières nouvelles de l'ouvrage, quant à elles, décrivent les histoires amoureuses de la jeunesse japonaise « américanisée », dans un quotidien quelque peu glauque (« Pain aux raisins,1963) ou s'attachent aux difficultés de communication au sein d'un jeune couple en perdition qui n'a jamais été qu'un faux semblant. Dans cette nouvelle, Akio repousse Masako dans le seul but de se démontrer sa propre puissance, disséquant les réactions de la jeune femme sans laisser place un seul instant aux sentiments de cette dernière.
En conclusion, ce recueil présente une belle variété d'histoires de qualité, d'une écriture rigoureuse, précise et évocatrice, qui se fait volontiers poétique, avec des moments de grâce. À partir d''un coucher de soleil, d'un couple sous la pluie, Mishima peut élaborer non seulement un récit intéressant, mais s'en servir pour révéler les dimensions cachées de l'âme humaine. Une citation achèvera de montrer qu'il ne s'agit en rien dune « oeuvre de jeunesse » : « la chute d'eau appelait des souffles d'air tout autour d'elle. Aux flancs de la montagne voisine, la végétation, les bambous nains frissonnaient perpétuellement dans le vent, et les feuilles, sous les éclaboussures, étincelaient d'un éclat si subtil qu'il en devenait périlleux. Parcourus de bruissements, les arbres, d'une étonnante diversité dans leurs feuillages nimbés de soleil, paraissaient comme fous, mais cette démence même les rendait incomparablement beaux. » (p. 225) »
La traduction est d'une grande qualité. Elle a été réalisée par Brigitte et Yves marie Allioux en 1997. Tous deux enseignent à l'université de Toulouse (poésie japonaise moderne et contemporaine, influences et les traductions de la poésie française au Japon). Ils ont aussi traduit, de Mishima, « L'école de la chair » ; ainsi que de nombreux poètes japonais (Chûya Nakahara, Issa Kobayashi — Brigitte Allioux ayant obtenu pour sa traduction des haïkus de « Mon année de printemps » le 14e Prix de la Fondation Konishi pour la Traduction de la Littérature japonaise).
On peut lire que ce recueil se consacre au thème de l'adolescence. Nous en sommes, en réalité, très loin. Seuls deux récits (Martyre et La cigarette) concernent des adolescents. Les autres mettent en scène de jeunes adultes, voire des personnages aux rives de la vieillesse.
Il en est ainsi pour Tsuneko, l'héroïne de « Pèlerinage aux trois montagnes ». Cette femme entre deux âges s'est dévouée à servir Fujimiya, poète renommé et professeur célèbre. Elle-même s'essaye, sans grand succès, à la poésie. Avec une obséquiosité qui confine à la servilité, Tsuneko, veuve, a consumé toutes ses chances de bonheur dans l'admiration qu'elle porte à Fujimiya. Un jour, ce dernier, d'ordinaire distant, la convie à l'accompagner dans un pèlerinage qu'il effectue dans la région de Kumano, abritant trois temples célèbres. Au cours de ce voyage, elle aura l'occasion de découvrir les ressorts qui animent son impénétrable maître et de sonder les tréfonds ses propres sentiments.
La situation décrite dans cette nouvelle n'est pas sans rappeler, dans la soumission volontaire de l'héroïne, celle développée dans le roman « après le banquet », où cette fois c'est l'amour, et non l'admiration, qui est le moteur d'un renoncement à vivre féminin.
« La mer et le couchant », courte nouvelle dédiée aux beautés de la nature, met en scène, en 1272, un moine vénérable, accompagné, d'un enfant, dont nous découvrirons l'étonnante histoire, qui se manifeste à sa mémoire par chacune des splendeurs qu'il peut contempler lors d'un coucher de soleil sur la mer.
« La cigarette » est une nouvelle célèbre : Mishima l'écrivit en 1945, alors qu'il n'ait que 20 ans, et en janvier 1946, il l'apportera, ainsi qu'une autre (« histoire sur un promontoire »), à Kawabata, auquel il rendra visite à Kamakura. Ce dernier les recommandera pour le nouveau journal littéraire « Ningen », de haute tenue, dans lequel elles seront publiées six mois plus tard.
« La cigarette » raconte les découvertes d'un adolescent, Nagasaki, à qui des « grands » offrent une cigarette. Jusqu'alors intellectuel assez terne, ce jeune homme va alors utiliser cette cigarette comme une clé lui permettant d'entrouvrir la porte d'un univers inconnu : celui des jeunes hommes sur d'eux, pleins de vigueur et de force, sportifs accomplis, pour lesquels il ressent une trouble attirance. Les questions auxquelles il devra répondre ne sont pas sans annoncer « Confession d'un masque », le roman qui suivra, trois ans plus tard, cette nouvelle, établissant Mishima comme un écrivain majeur.
Les deux premières nouvelles de l'ouvrage, quant à elles, décrivent les histoires amoureuses de la jeunesse japonaise « américanisée », dans un quotidien quelque peu glauque (« Pain aux raisins,1963) ou s'attachent aux difficultés de communication au sein d'un jeune couple en perdition qui n'a jamais été qu'un faux semblant. Dans cette nouvelle, Akio repousse Masako dans le seul but de se démontrer sa propre puissance, disséquant les réactions de la jeune femme sans laisser place un seul instant aux sentiments de cette dernière.
En conclusion, ce recueil présente une belle variété d'histoires de qualité, d'une écriture rigoureuse, précise et évocatrice, qui se fait volontiers poétique, avec des moments de grâce. À partir d''un coucher de soleil, d'un couple sous la pluie, Mishima peut élaborer non seulement un récit intéressant, mais s'en servir pour révéler les dimensions cachées de l'âme humaine. Une citation achèvera de montrer qu'il ne s'agit en rien dune « oeuvre de jeunesse » : « la chute d'eau appelait des souffles d'air tout autour d'elle. Aux flancs de la montagne voisine, la végétation, les bambous nains frissonnaient perpétuellement dans le vent, et les feuilles, sous les éclaboussures, étincelaient d'un éclat si subtil qu'il en devenait périlleux. Parcourus de bruissements, les arbres, d'une étonnante diversité dans leurs feuillages nimbés de soleil, paraissaient comme fous, mais cette démence même les rendait incomparablement beaux. » (p. 225) »
La traduction est d'une grande qualité. Elle a été réalisée par Brigitte et Yves marie Allioux en 1997. Tous deux enseignent à l'université de Toulouse (poésie japonaise moderne et contemporaine, influences et les traductions de la poésie française au Japon). Ils ont aussi traduit, de Mishima, « L'école de la chair » ; ainsi que de nombreux poètes japonais (Chûya Nakahara, Issa Kobayashi — Brigitte Allioux ayant obtenu pour sa traduction des haïkus de « Mon année de printemps » le 14e Prix de la Fondation Konishi pour la Traduction de la Littérature japonaise).