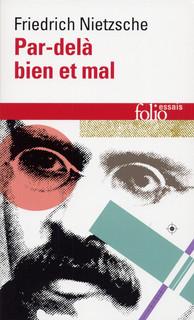>
Critique de Pitchval
Ouvrons tout de suite par le titre. Nietzsche se place au delà des valeurs, de cette opposition manichéenne du bien opposé au mal. Il adresse aux philosophes le reproche suivant : leur stupide croyance en l'existence d'un bien ou d'un mal en soi. Il s'annonce donc, par opposition, en penseur d'un nouveau type : « l'esprit libre », capable de créer des valeurs nouvelles, tout à fait détachées de morale. Ce que l'on a nommé philosophie jusqu'à présent ne serait qu'un amoncellement de préjugés. C'est hautement paradoxal, quand on y songe. Un philosophe n'est-il pas, par définition, l'ennemi des préjugés ? En quoi Nietzsche suggère implicitement que les philosophes... ne sont pas des philosophes. Ces penseurs, ces chercheurs de vérité, qui ont recherché l'absolu, ont eu peur de la vie à tel point qu'ils n'ont pas voulu la considérer par delà le bien et le mal. Ils ont nié la vie.
La morale appauvrit la diversité des hommes, en les réduisant tous à deux qualificatifs : « bien » ou « mal ». Alors que l'homme est multiple de nature, est riche, empli de forces contradictoires. Ou, du moins, il devrait l'être. Voilà ce que serait l'homme détaché de morale, l'homme par delà le bien et le mal : un être de pulsions, de désirs, de domination. Seulement, cette catégorisation de l'homme sur ce seul critère mièvre (bon ou mauvais) flatte hautement le moraliste. Celui-ci, comme tout homme incapable d'objectivité et de lucidité, se choisit bien entendu pour modèle. Ne compare-t-on pas son prochain à soi ? Ne le juge-t-on pas par rapport à soi-même ? Évidemment si. On se croit naturellement bien plus valeureux que ce que l'on est, on aime à se rehausser, à s'imaginer être un modèle. Ainsi, nos actes sont forcément « le bien ». Et leur inverse ne peut point être une différence intéressante, une saine altérité, la preuve d'une enrichissante variété d'êtres. Non, la différence d'avec soi ne peut être que « le mal ». le moraliste trouvera légitime alors de penser que corriger l'autre, c'est le faire agir à sa manière. Seuls ceux qui agissent comme lui seront jugés « bons ». La société étant composée, dans sa grande majorité, d'êtres peu réfléchis, peu lucides ni objectifs, voilà comment nous arrivons à une homogénéité factice et terne non seulement, à une masse veule et grégaire, quand l'humanité devrait être une richesse de différences. Mais pire : c'est ainsi que l'homme stagne et jamais ne s'élève. Il prend pour modèle le bien moral, c'est à dire le commun, et s'efforce d'en suivre les lois et préceptes sans jamais n'interroger cette loi ni tenter de surpasser quiconque. Toute sa vie, il s'efforcera d'être le plus fidèle non pas à ce qu'il est intrinsèquement, mais à ce que son semblable attend de lui. Il ne fera de son existence qu'une stricte copie du commun et du piètre. Il est gouverné par les lois morales, et tous ses choix, tous ses actes, ne sont décidés qu'en fonction de cette crainte d'être différent, de ne point se conformer et d'être jugé « mauvais ». Il s'évertue donc à ne jamais se distinguer. Il ne peut se démarquer, faire montre d'une personnalité atypique, d'un élan de génie, d'un noble et sain orgueil, d'une belle et vive cruauté, d'un juste mépris. Il ne peut tout simplement et naturellement pas obéir à ses instincts. Il les refoule par automatisme, en sorte qu'il mourra sans jamais ne s'être rencontré lui-même. Il ne se connaît pas et ignore même qu'il pourrait devenir quelqu'un. Il est le commun, comme l'est son voisin, son frère, comme l'était son père. Il aura tout de même la prétention de se distinguer et de se croire différent, bien à tort : il aura peut-être gagné plus d'argent, épousé une plus belle femme, amassé plus de connaissances universitaires. N'importe : tout cela n'est qu'apparences et vêtements. L'homme nu, lui, est strictement le même qu'un autre. Il est tout le monde et il n'est personne.
Voilà en quoi la morale s'oppose à la vie. Elle tue la vie, elle étouffe l'instinct de vie et de vitalité qui constitue pourtant l'homme naturel. Les philosophes moralistes ont donc nié, renié la vie elle-même, quand le vrai philosophe doit nier la morale et donc dépasser le « bien » et le « mal » au profit de l'humanité, de la saine et naturelle humanité. Ceci est pour le titre.
La suite me fut un peu éreintante. J'ai été surprise de certaines positions de Nietzsche qui m'ont parues, pour la première fois depuis que je le lis, un peu confuses et paradoxales. Nietzsche remet en question, toujours en évoquant les « philosophes », la philosophie de la volonté. Il cherche à déceler ce que suppose le « libre-arbitre » et soulève un paradoxe. Si l'on a cherché, depuis que la philosophie existe, à considérer que l'homme était libre (de ses actes notamment), c'est pour mieux lui montrer comme il commet des « fautes », et donc comme il mérite d'être jugé et puni pour ces fautes, puisqu'elles étaient évitables par son libre-arbitre. L'affirmation selon laquelle l'homme est libre n'aurait, selon Nietzsche qu'une intention : la recherche de sa culpabilité. La conscience (morale) est cruelle et même contre-nature, ce que j'admets volontiers. La morale n'est pas raisonnable, et encore moins naturelle. Elle va à l'encontre de l'instinct, de la vitalité, de ce qui constitue l'homme. Elle étouffe l'Homme en l'homme. Cependant, de là à prétendre que la notion de libre-arbitre est en tort... il m'a fallu une longue gymnastique mentale pour pouvoir me le figurer comme Nietzsche l'entendait. En effet, si l'on admet que l'homme dispose de son libre-arbitre, qu'il a le choix entre faire le bien et le mal (seul choix proposé par la morale), on peut lui reprocher tout manquement moral (un acte d'égoïsme, par exemple). Pour Nietzsche, l'homme n'a pas de libre-arbitre. Il est dominé, dirigé, commandé par sa puissance et son instinct, par sa condition d'homme, par sa naissance. Ainsi, on ne peut le juger responsable d'actes jugés moralement inacceptables. Il s'est écouté, voilà tout. Comment aurait-il fait autrement que d'obéir à ses instincts ? Est-ce qu'on juge le lion de manger une gazelle ? Il a été l'homme naturel, non soumis aux lois morales. C'est qu'il faut comprendre que Nietzsche n'a pas la même définition de « libre-arbitre ». Il l'associe seulement au choix entre bien et mal, sur des critères dictés par la religion notamment.
Nietzsche est le philosophe qui refuse l'idée du libre-arbitre. Il y oppose la force vitale. La volonté n'est pas libre, elle est seulement forte ou faible. La liberté est une illusion causée par la religion. L'homme détaché de morale agit selon ses instincts, ses pulsions, ses réflexions propres, son jugement non biaisé.
« La névrose religieuse » serait à l'origine du libre-arbitre, et par extension de ce sentiment de mauvaise conscience qui rend l'homme malade alors qu'il n'a fait que suivre ses instincts. Voilà pour la névrose : l'homme se créer une maladie lui-même, dont il souffre sa vie durant. Il étouffe ce qui est grand en lui, et quand il ne l'étouffe pas, il en éprouve une grande culpabilité, qui est illégitime et évitable : il suffit de ne pas vouloir se conformer aux préceptes moraux pour n'éprouver aucune culpabilité, pour ne point se rendre malade, donc, et enfin s'épanouir en tant qu'Homme. Cependant, il ne se rend pas malade seul, on l'y aide. La notion de « péché », insidieusement rabâchée par les prêtres, constitue pour eux une forte manière de domination. La « niaiserie religieuse » introduit la culpabilité en l'homme, le tient fermement attaché. L'homme coupable doit alors racheter sa faute ... par la religion justement. C'est ainsi que les religieux fidélisent ce que l'on nomme à juste titre les fidèles.
Ce que l'on nomme les vertus, c'est à dire les qualités suggérées par la morale telles que l'altruisme, la bonté, la chasteté, ne sont que des dérèglements. Les vertus contrarient les instincts, dénaturent les hommes, empêchent leur puissance de s'exprimer.
Il faut donc, selon Nietzsche, que Dieu meurt, et une fois qu'il sera mort, réinventer une morale en rejetant ce dualisme bien/mal. La nouvelle morale - et j'ignore pourquoi Nietzsche a gardé ce mot, qu'à mon sens il aurait dû tout à fait exclure - doit rendre à l'homme tout son potentiel, quand la moralité chrétienne l'étouffe et le maintient dans un état de faiblesse et d'impuissance (la morale des esclaves).
Il y a quelques mois encore, j'aurais été d'accord avec Nietzsche sur ce point. Je l'aurais approuvé inconditionnellement. Seulement, j'ai lu depuis un texte très profond qui est allé bien au-delà. Nietzsche s'est trompé d'ennemi en citant Dieu. La mort de Dieu n'aurait rien changé. le Dieu chrétien est sans doute arrivé bien à propos, dans une société qui l'attendait pour excuser tous ses travers. Mais je m'arrête là. Cette idée n'est pas de moi, j'y adhère seulement, et le texte n'est point encore paru. Dommage. Cette idée est probablement tout à fait inédite et révolutionnaire.
J'ai été surprise de trouver dans cette oeuvre un début d'analyse du rôle de la femme, qui devrait rester très éloigné de celui de l'homme, et avant tout pour son bien. Selon Nietzsche, le combat pour l'égalité homme/femme conduit irrémédiablement la femme à l'esclavage elle aussi. C'est que Nietzsche poursuit sa réflexion au sujet de l'asservissement causé par le libre-arbitre. le femme lutterait pour devenir aussi libre que son époux, et donc aussi asservie qu'il l'est en fin de compte. Dominée avant par le seul mari, qu'elle peut malgré tout et assez facilement manipuler à sa guise, de par ses attributs, ses jeux de séduction, ses qualités presque naturelles de manipulation (et Nietzsche le dit sans affect ni vengeance. C'est à peine un défaut), elle le serait bien plus si on lui accordait son libre-arbitre : elle deviendrait soumise aux lois religieuses et morales au même titre que ce dernier, et elle en serait tout aussi écrasée de sotte culpabilité que l'est son mari. de même, la femme lutte pour avoir le droit de travailler, quand ce droit est avant tout, lui aussi, une domination, non plus de son mari mais d'entités bien plus écrasantes et avilissantes : de la société, du pouvoir, de l'argent. Par ailleurs, la femme lui apparaît comme dénaturée par ces combats futiles que sont les luttes pour l'égalité des sexes. Ainsi, Nietzsche trouve évidemment que la femme est stupide de réclamer une plus grande servitude que celle qui est la sienne. Ne vaut-il pas mieux n'être dirigée que par un seul sot que par une multitude ? Elle serait donc bien bête d'envier le sort de son époux, plus stupide et avili qu'elle ne l'est.
Par delà le bien et le mal est probablement l'une des oeuvres où Nietzsche fait le plus référence à la femme. Il enchaine en arguant que la femme est dénaturée par ses nouveaux combats. Contrairement à ce qu'il est logique de penser au sujet de Nietzsche, il ne dénigre pas entièrement la femme. Il la présente même comme le plus sacré des mystères, comme une énigme qu'aucun homme ne peut résoudre. de nature fragile, d'une distinction biologique indépassable - puisqu'elle porte l'enfant- la femme naturelle (c'est à dire non dénaturée par de stupides combats et des prétentions à devenir aussi sotte que ne l'est un homme) est un être qui nécessite et mérite une protection. Elle aurait tout à fait tort de ne point vouloir garder cette position. Cependant, il ne reconnaît à cette femme aucun rôle intellectuel évidemment, hormis celui de compléter son mari. Une bonne alliance serait donc l'alliance entre un homme brillant et une femme favorisant son génie, en l'aidant à s'accomplir et au dépassement de l'humanité, ce qu'il nomme « trouver une profondeur à sa surface ». La femme idéale doit pouvoir pressentir la puissance de l'homme, même si elle ne la comprend pas, et l'aider à s'épanouir. « le bonheur de l'homme est : je veux ; le bonheur de la femme est : il veut ». Une femme doit avoir une première qualité, pour le bien commun : elle doit savoir élire. Et surtout une femme intelligente. Elle devra choisir un mari qui lui est supérieur, de sorte que leurs enfants, si elle les élève bien, seront un apport intellectuel qu'elle fera à la société tout entière.
J'entends déjà les bien-pensants hurler au scandale. Tant pis. Si je ne me sens pas le moins du monde inférieure intellectuellement à l'homme - et surtout pas à l'homme contemporain - j'admets que je préfère être l'assistante et la facilitatrice d'un génie que la féministe qui parvient par un savant calcul de parité. C'est dit. Je songe à Anais Nin qui a tenu ce rôle pour Miller, mais également à la première épouse de Steinbeck, femmes qui j'ai enviées et admirées mille fois, alors qu'aucune féministe n'a réussi à produire cet effet sur moi. Il ne s'agit pas là de renoncement, ni d'abnégation conne, mais d'une belle capacité à élire, à reconnaître le génie, il s'agit d'une capacité encore à admirer, à s'imprégner de ce qui est supérieur et à l'aider à s'épanouir. Par pour le bien-être de son compagnon mais pour le bien de l'humanité, ainsi que pour sa propre élévation. Comment s'élever plus haut et plus vite qu'en vivant à la droite de Dieu ? Il n'y a finalement pas de plus bel égoïsme que de vouloir être l'assistante d'un génie.
N'importe, Nietzsche n'était pas un goujat misogyne particulièrement. Il était misanthrope, voilà tout. Les hommes aussi sont, selon lui, limités et faibles, mais à d'autres niveaux. Voici pourquoi il n'entend pas que la femme envie leur position. Son oeuvre montre ainsi l'une des conditions nécessaires à la naissance du surhomme: deux parents sains, intègres, puissants. En quoi cette humanité renouvelée n'exclût pas du tout la femme. Elle y a son rôle à jouer. À la nuance près que Nietzsche ne parle de la femme que par rapport à l'homme. Il exclut d'emblée toute autonomie de pensée, tout rôle individuel. Peut-on seulement lui reprocher ? A-t-il connu ne serait-ce qu'une ou deux femmes admirables et autonomes ?
C'est tout logiquement que cette réflexion sur la femme le conduit à parler d'amour. Nietzsche se refuse à distinguer convoitise et amour. Il s'agit pour lui de la même pulsion. Et j'ai souri, vraiment, à lire son explication. L'homme marié considérera qu'on convoite sa femme. Il usera d'un terme péjoratif parce qu'il craindra pour son avoir, pour son trophée. Il s'estimera volé par avance si on ose aimer sa femme ! Et comme il n'est point admirable, il a besoin de ce qui le rassurerait quant à ses chances de la garder, il a besoin que l'autre ne soit qu'un voleur, un envieux, un méchant. En revanche, l'homme non marié qualifiera la même pensée d'amour, parce qu'insatisfait et assoiffé, il voudra forcément glorifier son appétit sous la forme du bien : amour. Cette réflexion amusante se vérifie tous les jours. N'est-ce pas touchant, Mesdames, que l'une de vos amies tombe amoureuse et parle élogieusement d'un homme ? Elle l'aime, n'est-ce pas ? C'est si beau ! Mais si la même amie parle en ces termes de votre mari, cela devient tout de suite inacceptable. C'est une envieuse, pour ne pas dire une salope, pas vrai ? N'est-ce pourtant pas le même sentiment éprouvé ?
L'amour est donc avant tout une possession, ou un désir de possession. Rien de plus. Tous les amours, d'ailleurs. L'amour du savoir n'est-il pas l'envie d'en accumuler plus, de posséder le savoir ? Appelons-nous un savant autrement que : Maître ? L'amour de la vérité est, lui, une aspiration à la nouveauté, sans cesse renouvelée. Nous avons possédé une vérité, l'avons faite nôtre. À présent qu'elle est acquise, nous nous en lassons (et c'est heureux !) et partons en quête d'une vérité encore plus grandiose et éloquente. On se sera donné du mal pour parvenir à cerner une vérité, pour mettre le doigt sur une idée neuve. Cela nous aura pris tout notre temps et notre énergie. Mais seule la quête compte. La possession de cette vérité la rétrécit. Elle ne suffit pas à combler le véritable chercheur de vérités. Il lui en faut chercher une autre. Il lui faut se métamorphoser avant de se lasser de lui-même.
Il en est de même pour les bienfaiteurs. L'homme compatissant au malheur d'autrui nomme aussi cela : amour. Alors qu'il ne saisit qu'une occasion de prendre possession du malheureux, qui sera toujours son obligé.
Tout amour est une possession. C'est généralement un prétexte pour dominer l'âme de l'autre. Et d'ailleurs, en ce sens, ce n'est pas péjoratif selon Nietzsche. Il suffit de sortir de la mièvrerie morale et galante pour exploiter l'amour en tant que force vitale. Etre l'élu d'une femme, c'est l'avoir conquise, et donc être un conquérant. C'est donc appauvrir et spolier tous les autres, c'est écraser ses concurrents par la possession de la femme. C'est être un redoutable prédateur, du moins pendant la chasse. Pourquoi avoir fait de la fidélité une loi morale ? C'est que le prédateur doute de ses talents à pouvoir garder sa proie bien longtemps. La loi morale rend légitime son long sommeil. Jamais plus il n'a ensuite à se battre, à rivaliser, à écraser ses adversaires. Jamais plus, une fois marié, il n'a à être un conquérant. C'est très pratique. Cependant, Nietzsche évoque quand même un amour idéal, suprême, magnifique, entre deux être, qu'il nomme amitié et qu'il avait parfaitement décrit dans le gai Savoir : « une soif supérieure et commune d'idéal qui les dépasse : mais qui connaît cet amour? Qui l'a vécu? Son véritable nom est : amitié ».
Cette chronique diffère un peu de ce que je propose d'habitude. Je ne la nomme d'ailleurs pas une « critique » ni même une note. J'aurais pu écrire : hommage. C'est qu'il faut une forte confiance en ses capacités intellectuelles pour « critiquer » Nietzsche. Moi, lorsque je le lis, lui et un ou deux autres seulement, je m'assoie et prends des notes, écrasée d'intelligence et humiliée presque de ne point avoir réfléchi suffisamment. Cependant, l'humiliation ne m'est jamais une importunité, bien au contraire. J'aime être écrasée. Je n'as
La morale appauvrit la diversité des hommes, en les réduisant tous à deux qualificatifs : « bien » ou « mal ». Alors que l'homme est multiple de nature, est riche, empli de forces contradictoires. Ou, du moins, il devrait l'être. Voilà ce que serait l'homme détaché de morale, l'homme par delà le bien et le mal : un être de pulsions, de désirs, de domination. Seulement, cette catégorisation de l'homme sur ce seul critère mièvre (bon ou mauvais) flatte hautement le moraliste. Celui-ci, comme tout homme incapable d'objectivité et de lucidité, se choisit bien entendu pour modèle. Ne compare-t-on pas son prochain à soi ? Ne le juge-t-on pas par rapport à soi-même ? Évidemment si. On se croit naturellement bien plus valeureux que ce que l'on est, on aime à se rehausser, à s'imaginer être un modèle. Ainsi, nos actes sont forcément « le bien ». Et leur inverse ne peut point être une différence intéressante, une saine altérité, la preuve d'une enrichissante variété d'êtres. Non, la différence d'avec soi ne peut être que « le mal ». le moraliste trouvera légitime alors de penser que corriger l'autre, c'est le faire agir à sa manière. Seuls ceux qui agissent comme lui seront jugés « bons ». La société étant composée, dans sa grande majorité, d'êtres peu réfléchis, peu lucides ni objectifs, voilà comment nous arrivons à une homogénéité factice et terne non seulement, à une masse veule et grégaire, quand l'humanité devrait être une richesse de différences. Mais pire : c'est ainsi que l'homme stagne et jamais ne s'élève. Il prend pour modèle le bien moral, c'est à dire le commun, et s'efforce d'en suivre les lois et préceptes sans jamais n'interroger cette loi ni tenter de surpasser quiconque. Toute sa vie, il s'efforcera d'être le plus fidèle non pas à ce qu'il est intrinsèquement, mais à ce que son semblable attend de lui. Il ne fera de son existence qu'une stricte copie du commun et du piètre. Il est gouverné par les lois morales, et tous ses choix, tous ses actes, ne sont décidés qu'en fonction de cette crainte d'être différent, de ne point se conformer et d'être jugé « mauvais ». Il s'évertue donc à ne jamais se distinguer. Il ne peut se démarquer, faire montre d'une personnalité atypique, d'un élan de génie, d'un noble et sain orgueil, d'une belle et vive cruauté, d'un juste mépris. Il ne peut tout simplement et naturellement pas obéir à ses instincts. Il les refoule par automatisme, en sorte qu'il mourra sans jamais ne s'être rencontré lui-même. Il ne se connaît pas et ignore même qu'il pourrait devenir quelqu'un. Il est le commun, comme l'est son voisin, son frère, comme l'était son père. Il aura tout de même la prétention de se distinguer et de se croire différent, bien à tort : il aura peut-être gagné plus d'argent, épousé une plus belle femme, amassé plus de connaissances universitaires. N'importe : tout cela n'est qu'apparences et vêtements. L'homme nu, lui, est strictement le même qu'un autre. Il est tout le monde et il n'est personne.
Voilà en quoi la morale s'oppose à la vie. Elle tue la vie, elle étouffe l'instinct de vie et de vitalité qui constitue pourtant l'homme naturel. Les philosophes moralistes ont donc nié, renié la vie elle-même, quand le vrai philosophe doit nier la morale et donc dépasser le « bien » et le « mal » au profit de l'humanité, de la saine et naturelle humanité. Ceci est pour le titre.
La suite me fut un peu éreintante. J'ai été surprise de certaines positions de Nietzsche qui m'ont parues, pour la première fois depuis que je le lis, un peu confuses et paradoxales. Nietzsche remet en question, toujours en évoquant les « philosophes », la philosophie de la volonté. Il cherche à déceler ce que suppose le « libre-arbitre » et soulève un paradoxe. Si l'on a cherché, depuis que la philosophie existe, à considérer que l'homme était libre (de ses actes notamment), c'est pour mieux lui montrer comme il commet des « fautes », et donc comme il mérite d'être jugé et puni pour ces fautes, puisqu'elles étaient évitables par son libre-arbitre. L'affirmation selon laquelle l'homme est libre n'aurait, selon Nietzsche qu'une intention : la recherche de sa culpabilité. La conscience (morale) est cruelle et même contre-nature, ce que j'admets volontiers. La morale n'est pas raisonnable, et encore moins naturelle. Elle va à l'encontre de l'instinct, de la vitalité, de ce qui constitue l'homme. Elle étouffe l'Homme en l'homme. Cependant, de là à prétendre que la notion de libre-arbitre est en tort... il m'a fallu une longue gymnastique mentale pour pouvoir me le figurer comme Nietzsche l'entendait. En effet, si l'on admet que l'homme dispose de son libre-arbitre, qu'il a le choix entre faire le bien et le mal (seul choix proposé par la morale), on peut lui reprocher tout manquement moral (un acte d'égoïsme, par exemple). Pour Nietzsche, l'homme n'a pas de libre-arbitre. Il est dominé, dirigé, commandé par sa puissance et son instinct, par sa condition d'homme, par sa naissance. Ainsi, on ne peut le juger responsable d'actes jugés moralement inacceptables. Il s'est écouté, voilà tout. Comment aurait-il fait autrement que d'obéir à ses instincts ? Est-ce qu'on juge le lion de manger une gazelle ? Il a été l'homme naturel, non soumis aux lois morales. C'est qu'il faut comprendre que Nietzsche n'a pas la même définition de « libre-arbitre ». Il l'associe seulement au choix entre bien et mal, sur des critères dictés par la religion notamment.
Nietzsche est le philosophe qui refuse l'idée du libre-arbitre. Il y oppose la force vitale. La volonté n'est pas libre, elle est seulement forte ou faible. La liberté est une illusion causée par la religion. L'homme détaché de morale agit selon ses instincts, ses pulsions, ses réflexions propres, son jugement non biaisé.
« La névrose religieuse » serait à l'origine du libre-arbitre, et par extension de ce sentiment de mauvaise conscience qui rend l'homme malade alors qu'il n'a fait que suivre ses instincts. Voilà pour la névrose : l'homme se créer une maladie lui-même, dont il souffre sa vie durant. Il étouffe ce qui est grand en lui, et quand il ne l'étouffe pas, il en éprouve une grande culpabilité, qui est illégitime et évitable : il suffit de ne pas vouloir se conformer aux préceptes moraux pour n'éprouver aucune culpabilité, pour ne point se rendre malade, donc, et enfin s'épanouir en tant qu'Homme. Cependant, il ne se rend pas malade seul, on l'y aide. La notion de « péché », insidieusement rabâchée par les prêtres, constitue pour eux une forte manière de domination. La « niaiserie religieuse » introduit la culpabilité en l'homme, le tient fermement attaché. L'homme coupable doit alors racheter sa faute ... par la religion justement. C'est ainsi que les religieux fidélisent ce que l'on nomme à juste titre les fidèles.
Ce que l'on nomme les vertus, c'est à dire les qualités suggérées par la morale telles que l'altruisme, la bonté, la chasteté, ne sont que des dérèglements. Les vertus contrarient les instincts, dénaturent les hommes, empêchent leur puissance de s'exprimer.
Il faut donc, selon Nietzsche, que Dieu meurt, et une fois qu'il sera mort, réinventer une morale en rejetant ce dualisme bien/mal. La nouvelle morale - et j'ignore pourquoi Nietzsche a gardé ce mot, qu'à mon sens il aurait dû tout à fait exclure - doit rendre à l'homme tout son potentiel, quand la moralité chrétienne l'étouffe et le maintient dans un état de faiblesse et d'impuissance (la morale des esclaves).
Il y a quelques mois encore, j'aurais été d'accord avec Nietzsche sur ce point. Je l'aurais approuvé inconditionnellement. Seulement, j'ai lu depuis un texte très profond qui est allé bien au-delà. Nietzsche s'est trompé d'ennemi en citant Dieu. La mort de Dieu n'aurait rien changé. le Dieu chrétien est sans doute arrivé bien à propos, dans une société qui l'attendait pour excuser tous ses travers. Mais je m'arrête là. Cette idée n'est pas de moi, j'y adhère seulement, et le texte n'est point encore paru. Dommage. Cette idée est probablement tout à fait inédite et révolutionnaire.
J'ai été surprise de trouver dans cette oeuvre un début d'analyse du rôle de la femme, qui devrait rester très éloigné de celui de l'homme, et avant tout pour son bien. Selon Nietzsche, le combat pour l'égalité homme/femme conduit irrémédiablement la femme à l'esclavage elle aussi. C'est que Nietzsche poursuit sa réflexion au sujet de l'asservissement causé par le libre-arbitre. le femme lutterait pour devenir aussi libre que son époux, et donc aussi asservie qu'il l'est en fin de compte. Dominée avant par le seul mari, qu'elle peut malgré tout et assez facilement manipuler à sa guise, de par ses attributs, ses jeux de séduction, ses qualités presque naturelles de manipulation (et Nietzsche le dit sans affect ni vengeance. C'est à peine un défaut), elle le serait bien plus si on lui accordait son libre-arbitre : elle deviendrait soumise aux lois religieuses et morales au même titre que ce dernier, et elle en serait tout aussi écrasée de sotte culpabilité que l'est son mari. de même, la femme lutte pour avoir le droit de travailler, quand ce droit est avant tout, lui aussi, une domination, non plus de son mari mais d'entités bien plus écrasantes et avilissantes : de la société, du pouvoir, de l'argent. Par ailleurs, la femme lui apparaît comme dénaturée par ces combats futiles que sont les luttes pour l'égalité des sexes. Ainsi, Nietzsche trouve évidemment que la femme est stupide de réclamer une plus grande servitude que celle qui est la sienne. Ne vaut-il pas mieux n'être dirigée que par un seul sot que par une multitude ? Elle serait donc bien bête d'envier le sort de son époux, plus stupide et avili qu'elle ne l'est.
Par delà le bien et le mal est probablement l'une des oeuvres où Nietzsche fait le plus référence à la femme. Il enchaine en arguant que la femme est dénaturée par ses nouveaux combats. Contrairement à ce qu'il est logique de penser au sujet de Nietzsche, il ne dénigre pas entièrement la femme. Il la présente même comme le plus sacré des mystères, comme une énigme qu'aucun homme ne peut résoudre. de nature fragile, d'une distinction biologique indépassable - puisqu'elle porte l'enfant- la femme naturelle (c'est à dire non dénaturée par de stupides combats et des prétentions à devenir aussi sotte que ne l'est un homme) est un être qui nécessite et mérite une protection. Elle aurait tout à fait tort de ne point vouloir garder cette position. Cependant, il ne reconnaît à cette femme aucun rôle intellectuel évidemment, hormis celui de compléter son mari. Une bonne alliance serait donc l'alliance entre un homme brillant et une femme favorisant son génie, en l'aidant à s'accomplir et au dépassement de l'humanité, ce qu'il nomme « trouver une profondeur à sa surface ». La femme idéale doit pouvoir pressentir la puissance de l'homme, même si elle ne la comprend pas, et l'aider à s'épanouir. « le bonheur de l'homme est : je veux ; le bonheur de la femme est : il veut ». Une femme doit avoir une première qualité, pour le bien commun : elle doit savoir élire. Et surtout une femme intelligente. Elle devra choisir un mari qui lui est supérieur, de sorte que leurs enfants, si elle les élève bien, seront un apport intellectuel qu'elle fera à la société tout entière.
J'entends déjà les bien-pensants hurler au scandale. Tant pis. Si je ne me sens pas le moins du monde inférieure intellectuellement à l'homme - et surtout pas à l'homme contemporain - j'admets que je préfère être l'assistante et la facilitatrice d'un génie que la féministe qui parvient par un savant calcul de parité. C'est dit. Je songe à Anais Nin qui a tenu ce rôle pour Miller, mais également à la première épouse de Steinbeck, femmes qui j'ai enviées et admirées mille fois, alors qu'aucune féministe n'a réussi à produire cet effet sur moi. Il ne s'agit pas là de renoncement, ni d'abnégation conne, mais d'une belle capacité à élire, à reconnaître le génie, il s'agit d'une capacité encore à admirer, à s'imprégner de ce qui est supérieur et à l'aider à s'épanouir. Par pour le bien-être de son compagnon mais pour le bien de l'humanité, ainsi que pour sa propre élévation. Comment s'élever plus haut et plus vite qu'en vivant à la droite de Dieu ? Il n'y a finalement pas de plus bel égoïsme que de vouloir être l'assistante d'un génie.
N'importe, Nietzsche n'était pas un goujat misogyne particulièrement. Il était misanthrope, voilà tout. Les hommes aussi sont, selon lui, limités et faibles, mais à d'autres niveaux. Voici pourquoi il n'entend pas que la femme envie leur position. Son oeuvre montre ainsi l'une des conditions nécessaires à la naissance du surhomme: deux parents sains, intègres, puissants. En quoi cette humanité renouvelée n'exclût pas du tout la femme. Elle y a son rôle à jouer. À la nuance près que Nietzsche ne parle de la femme que par rapport à l'homme. Il exclut d'emblée toute autonomie de pensée, tout rôle individuel. Peut-on seulement lui reprocher ? A-t-il connu ne serait-ce qu'une ou deux femmes admirables et autonomes ?
C'est tout logiquement que cette réflexion sur la femme le conduit à parler d'amour. Nietzsche se refuse à distinguer convoitise et amour. Il s'agit pour lui de la même pulsion. Et j'ai souri, vraiment, à lire son explication. L'homme marié considérera qu'on convoite sa femme. Il usera d'un terme péjoratif parce qu'il craindra pour son avoir, pour son trophée. Il s'estimera volé par avance si on ose aimer sa femme ! Et comme il n'est point admirable, il a besoin de ce qui le rassurerait quant à ses chances de la garder, il a besoin que l'autre ne soit qu'un voleur, un envieux, un méchant. En revanche, l'homme non marié qualifiera la même pensée d'amour, parce qu'insatisfait et assoiffé, il voudra forcément glorifier son appétit sous la forme du bien : amour. Cette réflexion amusante se vérifie tous les jours. N'est-ce pas touchant, Mesdames, que l'une de vos amies tombe amoureuse et parle élogieusement d'un homme ? Elle l'aime, n'est-ce pas ? C'est si beau ! Mais si la même amie parle en ces termes de votre mari, cela devient tout de suite inacceptable. C'est une envieuse, pour ne pas dire une salope, pas vrai ? N'est-ce pourtant pas le même sentiment éprouvé ?
L'amour est donc avant tout une possession, ou un désir de possession. Rien de plus. Tous les amours, d'ailleurs. L'amour du savoir n'est-il pas l'envie d'en accumuler plus, de posséder le savoir ? Appelons-nous un savant autrement que : Maître ? L'amour de la vérité est, lui, une aspiration à la nouveauté, sans cesse renouvelée. Nous avons possédé une vérité, l'avons faite nôtre. À présent qu'elle est acquise, nous nous en lassons (et c'est heureux !) et partons en quête d'une vérité encore plus grandiose et éloquente. On se sera donné du mal pour parvenir à cerner une vérité, pour mettre le doigt sur une idée neuve. Cela nous aura pris tout notre temps et notre énergie. Mais seule la quête compte. La possession de cette vérité la rétrécit. Elle ne suffit pas à combler le véritable chercheur de vérités. Il lui en faut chercher une autre. Il lui faut se métamorphoser avant de se lasser de lui-même.
Il en est de même pour les bienfaiteurs. L'homme compatissant au malheur d'autrui nomme aussi cela : amour. Alors qu'il ne saisit qu'une occasion de prendre possession du malheureux, qui sera toujours son obligé.
Tout amour est une possession. C'est généralement un prétexte pour dominer l'âme de l'autre. Et d'ailleurs, en ce sens, ce n'est pas péjoratif selon Nietzsche. Il suffit de sortir de la mièvrerie morale et galante pour exploiter l'amour en tant que force vitale. Etre l'élu d'une femme, c'est l'avoir conquise, et donc être un conquérant. C'est donc appauvrir et spolier tous les autres, c'est écraser ses concurrents par la possession de la femme. C'est être un redoutable prédateur, du moins pendant la chasse. Pourquoi avoir fait de la fidélité une loi morale ? C'est que le prédateur doute de ses talents à pouvoir garder sa proie bien longtemps. La loi morale rend légitime son long sommeil. Jamais plus il n'a ensuite à se battre, à rivaliser, à écraser ses adversaires. Jamais plus, une fois marié, il n'a à être un conquérant. C'est très pratique. Cependant, Nietzsche évoque quand même un amour idéal, suprême, magnifique, entre deux être, qu'il nomme amitié et qu'il avait parfaitement décrit dans le gai Savoir : « une soif supérieure et commune d'idéal qui les dépasse : mais qui connaît cet amour? Qui l'a vécu? Son véritable nom est : amitié ».
Cette chronique diffère un peu de ce que je propose d'habitude. Je ne la nomme d'ailleurs pas une « critique » ni même une note. J'aurais pu écrire : hommage. C'est qu'il faut une forte confiance en ses capacités intellectuelles pour « critiquer » Nietzsche. Moi, lorsque je le lis, lui et un ou deux autres seulement, je m'assoie et prends des notes, écrasée d'intelligence et humiliée presque de ne point avoir réfléchi suffisamment. Cependant, l'humiliation ne m'est jamais une importunité, bien au contraire. J'aime être écrasée. Je n'as