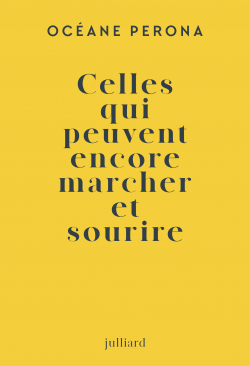>
Critique de Cigale17
[Lu dans le cadre du Grand Prix des Lectrices de Elle 2024]
Tous les chapitres de Celles qui peuvent encore marcher et sourire sauf le dernier, le huitième, sont construits de la même façon. D'abord « tu » parle à Héloïse. Par cet artifice, on entend les pensées d'Héloïse, ses peurs, ses certitudes et ses doutes, ses regrets, les reproches qu'elle se fait, etc. Elle s'avoue souvent les déconvenues de son boulot de flic. Elle travaille au groupe Violences et, quand elle n'est pas sur le terrain pour enquêter, elle recueille les témoignages de victimes qui ont subi agressions sexuelles ou viols. Un travail exigeant, difficile et parfois déprimant pour elle, la seule femme de l'équipe, comme pour ses collègues masculins. La deuxième narratrice est un « je », Ophélie, doctorante en sociologie, qui fait un stage de trois mois dans ce service afin de recueillir des données pour sa thèse. Elle joue le rôle de la profane, celle à qui on explique comment ça se passe, ce qu'elle doit savoir pour comprendre la situation. Ces éléments lui serviront pour sa thèse et le lecteur profite de ces mises au point, bien sûr. La dernière narratrice, « vous », est une victime qui explique dès le premier chapitre ce qui lui est arrivé. On connaîtra son identité au dernier chapitre seulement. Chaque chapitre est titré du nom d'un agresseur : X pour le premier puisqu'on ne sait pas qui il est, suivi de Dylan, Babacar, etc. le dernier chapitre est intitulé « Vous ». Si ce n'était ce travail sur la narration, on pourrait croire qu'on lit un documentaire sur les violences faites aux femmes…
***
Le regard que posent Héloïse et Ophélie sur le travail du groupe diffère souvent. Héloïse vit les difficultés de l'intérieur. Elle connaît les faiblesses et les forces de ses collègues. Ophélie découvre ce milieu : si les hommes du groupe Violences sont sensibilisés aux horreurs que subissent les femmes, ce n'est pas le cas des autres groupes, par exemple les CRS ou la BAC avec leurs indécrottables machos, « surtout les vieux » lui confie Héloïse. C'est l'occasion pour Océane Perona de réutiliser certains des aspects de sa propre thèse de sociologie qui portait sur « la place du consentement dans les enquêtes policières pour violences sexuelles ». Elle est donc parfaitement au fait de ce qu'elle met en scène. Son roman nous plonge avec réalisme dans ces moments particulièrement délicats, incroyablement difficiles à aborder qu'elle traite avec une grande sensibilité tout en collant au plus près à la réalité : elle a sans doute assisté à certaines de ces rencontres et, bien qu'elle prenne la peine de signaler que « Toute ressemblance avec… » etc., on comprend que c'est du vécu. le fictionnel n'est pas absent de ce récit. L'autrice embarque le lecteur dans plusieurs quêtes : l'identité du « vous », celle du X du premier chapitre, et puis l'explication du départ d'Anaïs, l'autre femme du groupe qui est partie du jour au lendemain sans que quiconque parmi les policiers qu'Ophélie côtoie n'ait envie de lui expliquer pourquoi… J'ai bien aimé ce texte dont les deux aspects, documentaire et fiction, sont très maîtrisés, ce qui s'avère d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'un premier roman.
Tous les chapitres de Celles qui peuvent encore marcher et sourire sauf le dernier, le huitième, sont construits de la même façon. D'abord « tu » parle à Héloïse. Par cet artifice, on entend les pensées d'Héloïse, ses peurs, ses certitudes et ses doutes, ses regrets, les reproches qu'elle se fait, etc. Elle s'avoue souvent les déconvenues de son boulot de flic. Elle travaille au groupe Violences et, quand elle n'est pas sur le terrain pour enquêter, elle recueille les témoignages de victimes qui ont subi agressions sexuelles ou viols. Un travail exigeant, difficile et parfois déprimant pour elle, la seule femme de l'équipe, comme pour ses collègues masculins. La deuxième narratrice est un « je », Ophélie, doctorante en sociologie, qui fait un stage de trois mois dans ce service afin de recueillir des données pour sa thèse. Elle joue le rôle de la profane, celle à qui on explique comment ça se passe, ce qu'elle doit savoir pour comprendre la situation. Ces éléments lui serviront pour sa thèse et le lecteur profite de ces mises au point, bien sûr. La dernière narratrice, « vous », est une victime qui explique dès le premier chapitre ce qui lui est arrivé. On connaîtra son identité au dernier chapitre seulement. Chaque chapitre est titré du nom d'un agresseur : X pour le premier puisqu'on ne sait pas qui il est, suivi de Dylan, Babacar, etc. le dernier chapitre est intitulé « Vous ». Si ce n'était ce travail sur la narration, on pourrait croire qu'on lit un documentaire sur les violences faites aux femmes…
***
Le regard que posent Héloïse et Ophélie sur le travail du groupe diffère souvent. Héloïse vit les difficultés de l'intérieur. Elle connaît les faiblesses et les forces de ses collègues. Ophélie découvre ce milieu : si les hommes du groupe Violences sont sensibilisés aux horreurs que subissent les femmes, ce n'est pas le cas des autres groupes, par exemple les CRS ou la BAC avec leurs indécrottables machos, « surtout les vieux » lui confie Héloïse. C'est l'occasion pour Océane Perona de réutiliser certains des aspects de sa propre thèse de sociologie qui portait sur « la place du consentement dans les enquêtes policières pour violences sexuelles ». Elle est donc parfaitement au fait de ce qu'elle met en scène. Son roman nous plonge avec réalisme dans ces moments particulièrement délicats, incroyablement difficiles à aborder qu'elle traite avec une grande sensibilité tout en collant au plus près à la réalité : elle a sans doute assisté à certaines de ces rencontres et, bien qu'elle prenne la peine de signaler que « Toute ressemblance avec… » etc., on comprend que c'est du vécu. le fictionnel n'est pas absent de ce récit. L'autrice embarque le lecteur dans plusieurs quêtes : l'identité du « vous », celle du X du premier chapitre, et puis l'explication du départ d'Anaïs, l'autre femme du groupe qui est partie du jour au lendemain sans que quiconque parmi les policiers qu'Ophélie côtoie n'ait envie de lui expliquer pourquoi… J'ai bien aimé ce texte dont les deux aspects, documentaire et fiction, sont très maîtrisés, ce qui s'avère d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'un premier roman.