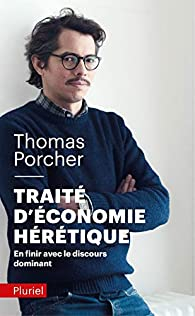Citations sur Traité d'économie hérétique (63)
Au départ, l'Union européenne fut tiraillée entre deux voies : l'une plus interventionniste et l'autre plus confiante dans le marché. Lors des négociations concernant le marché unique au début des années 1980, l'European round table - un puissant lobby du patronat - était divisé sur la voie à suivre. Une partie de ses membres défendait l'idée que le marché unique devait être un espace de concurrence, l'autre partie prônait qu'il fallait créer des champions européens en les protégeant, au départ, de la concurrence mondiale (type Airbus mais élargi à tous les champs : énergie, transports, etc.). C'est Jacques Delors, président de la Commission européenne (et socialiste), qui, au milieu des années 1980, fera pencher la balance en faveur de la concurrence.
Dès lors, la dynamique libérale va s'enclencher fortement avec la création du marché unique, la libre circulation des biens, des services et des personnes, la monnaie unique et enfin l'ouverture du marché européen aux échanges mondiaux. L'Union européenne est ainsi devenue la zone au monde la moins couverte par des tarifs douaniers. Gangrénée par les lobbies, elle ne sera qu'un bouclier de verre face à la financiarisation de l'économie, la spéculation, la malbouffe ou la pollution. L'Union européenne, plutôt que de protéger ses citoyens des effets délétères de la mondialisation, en est devenue la principale courroie de transmission.
Il n'est donc pas étonnant qu'en 2006, suivant cette idéologie, l'Union européenne mette en place une stratégie nommée "Global-Europe : Competing in the World" visant à signer des accords de libre-échange de nouvelle génération avec ses principaux partenaires commerciaux. Le terme "nouvelle génération" signifie que ces accords traitent des obstacles du commerce derrière les frontières, c'est-à-dire sur les normes établies à l'intérieur d'un pays, contrairement aux anciens traités qui se focalisaient sur les barrières douanières. Or, les normes peuvent être différentes d'un pays à un autre et elles représentent des obstacles ; le but est d'harmoniser ces normes afin qu'il n'y ait plus aucune (ou quasiment) entrave à la libre circulation des biens et des services. C'est dans le cadre de cette stratégie que s'inscrivent les fameux traités transatlantiques avec les Etats-Unis et le Canada dénommés TAFTA et CETA... (p.204-206)
Dès lors, la dynamique libérale va s'enclencher fortement avec la création du marché unique, la libre circulation des biens, des services et des personnes, la monnaie unique et enfin l'ouverture du marché européen aux échanges mondiaux. L'Union européenne est ainsi devenue la zone au monde la moins couverte par des tarifs douaniers. Gangrénée par les lobbies, elle ne sera qu'un bouclier de verre face à la financiarisation de l'économie, la spéculation, la malbouffe ou la pollution. L'Union européenne, plutôt que de protéger ses citoyens des effets délétères de la mondialisation, en est devenue la principale courroie de transmission.
Il n'est donc pas étonnant qu'en 2006, suivant cette idéologie, l'Union européenne mette en place une stratégie nommée "Global-Europe : Competing in the World" visant à signer des accords de libre-échange de nouvelle génération avec ses principaux partenaires commerciaux. Le terme "nouvelle génération" signifie que ces accords traitent des obstacles du commerce derrière les frontières, c'est-à-dire sur les normes établies à l'intérieur d'un pays, contrairement aux anciens traités qui se focalisaient sur les barrières douanières. Or, les normes peuvent être différentes d'un pays à un autre et elles représentent des obstacles ; le but est d'harmoniser ces normes afin qu'il n'y ait plus aucune (ou quasiment) entrave à la libre circulation des biens et des services. C'est dans le cadre de cette stratégie que s'inscrivent les fameux traités transatlantiques avec les Etats-Unis et le Canada dénommés TAFTA et CETA... (p.204-206)
Les politiques d'ajustement structurel ont fait un retour fracassant en Grèce. Plus question de les cacher derrière un habillage, le FMI affiche clairement la couleur en dictant la politique grecque : hausse de la TVA, baisse des pensions de retraite, arrêt de l'aide aux plus petites pensions et vastes programmes de privatisation. Par contre, refus des hausses d'impôts sur les plus riches et les entreprises alors que le gouvernement grec était prêt à les mettre en place. Les résultats de cette politique d'austérité sont catastrophiques, autant du point de vue économique qu'humain. Depuis 2008, la Grèce a perdu un quart de son PIB, le chômage y a augmenté de 190,5 %, la dette de 36,5 % et le revenu par ménage a diminué de 30 % ; la mortalité infantile y a augmenté de 42,8 %, les suicides de 44 % et la dépression de 272,7 %. Pourtant, la Commission européenne persiste dans l'acharnement en continuant à demander plus à l'économie grecque.
Christine Lagarde, directrice du FMI, appelant même les Grecs à se prendre en main et ajoutant que les enfants démunis d'Afrique ont davantage besoin d'aide qu'eux. (200-201)
Christine Lagarde, directrice du FMI, appelant même les Grecs à se prendre en main et ajoutant que les enfants démunis d'Afrique ont davantage besoin d'aide qu'eux. (200-201)
Lorsqu'un pays pauvre a besoin d'emprunter, rares sont les banques qui sont disposées à lui prêter. La plupart du temps, il est obligé de se tourner vers le Fonds monétaire international, qualifié souvent de prêteur de dernier recours. Or le FMI, à défaut de pouvoir exiger des garanties financières aux pays pauvres, leur impose de mettre en place des réformes structurelles. Se spécialiser dans les biens à export, privatiser, diminuer les protections (prestations chômage, retraites), réduire la sphère publique, ouvrir les marchés à l'international : tels sont les critères imposés aux pays en échange d'un prêt. Et comme ces pays, souvent très endettés, ont besoin de fonds urgemment, ils acceptent sans broncher les conditions du FMI. (p.193)
Le libre-échange a entraîné un conflit d'intérêts entre travailleurs qualifiés - qui bénéficiaient des effets de la mondialisation - et les moins qualifiés - qui en étaient directement les victimes. Les cadres avaient des qualifications que les pays en développement n'avaient pas, l'internationalisation leur a permis de décrocher des contrats et donc des activités supplémentaires. Quant aux ouvriers, ils étaient directement mis en concurrence avec les travailleurs chinois (et même roumains car ce petit jeu existe de manière réduite en Europe) et ont vu leurs usines fermer pour s'installer dans d'autres contrées où le coût du travail était plus faible. Très rapidement, les élus locaux ont été confrontés à ces fermetures d'usines condamnant des régions entières. Pourtant, aucune politique publique n'a été mise en place pour empêcher ces délocalisations ou pour assurer plus de sécurité à ces perdants de la mondialisation. Bien au contraire, les prestations publiques ont été de plus en plus rabotées, le traitement politique à leur égard de plus en plus méprisant. Une forme de connivence s'est même installée entre les grands patrons et les politiques, les uns retardant la fermeture des usines avant les élections, les autres se déplaçant pour permettre monts et merveilles, puis... rien. Lâchés par l'Etat et jugées trop coûteuses pour leurs entreprises, des millions de vies ont été broyées. Dans l'indifférence générale, des pans entiers de notre industrie ont disparu. (p.189-190)
En économie, le libre-échange ne signifie que l'interdiction de protection : interdiction pour un Etat de protéger sa production, ses emplois, ses habitants, ses normes de consommation, sa sécurité, sa culture. Initiée par Adam Smith au XVIIIè siècle, la théorie du libre-échange est apprise par tous les étudiants d'économie (dès la terminale) et justifie les politiques économiques mises en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans "Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations" (1776), Smith expliquait que chaque pays a intérêt à importer un produit s'il est obtenu à un coût plus faible que son coût de production. Pour utiliser au mieux l'ensemble des ressources disponibles, il prône que chaque pays se spécialise dans la production où il a un avantage absolu (donc un coût de production d'un bien plus faible que ses voisins). [...]
Dès lors, pour obtenir des financements, notamment via le FMI, il est demandé aux pays les plus pauvres de se spécialiser dans une production où ils ont un avantage (le pétrole pour le Congo, le cacao pour la Côte d'Ivoire, etc.) et d'ouvrir leurs économies au commerce international. Pourtant, l'histoire montre que la plupart des pays riches ont joué du protectionnisme quand cela les arrangeait et qu'ils n'ont été des fervents défenseurs du libre-échange que lorsqu'ils se trouvaient en position de force. (p.178-180)
Dès lors, pour obtenir des financements, notamment via le FMI, il est demandé aux pays les plus pauvres de se spécialiser dans une production où ils ont un avantage (le pétrole pour le Congo, le cacao pour la Côte d'Ivoire, etc.) et d'ouvrir leurs économies au commerce international. Pourtant, l'histoire montre que la plupart des pays riches ont joué du protectionnisme quand cela les arrangeait et qu'ils n'ont été des fervents défenseurs du libre-échange que lorsqu'ils se trouvaient en position de force. (p.178-180)
L'Union européenne fondée sur le principe de la libre concurrence a entraîné une mise en compétition des modèles social et fiscal des Etats membres. Ce jeu à somme négative a mené l'ensemble des pays vers le moins-disant et il est à craindre que rapidement la fiscalité et les protections des salariés seront réduites à peau de chagrin dans l'ensemble des pays d'Europe. La construction européenne a également été jalonnée d'une méfiance entre pays faisant des membres de l'Union des concurrents plutôt que des partenaires (avec cette idée que la concurrence engendrerait le bonheur). L'euro n'a fait que renforcer cette tendance en imposant des critères identiques à dix-neuf pays ayant des niveaux de développement différents. Le bilan humain est aujourd'hui désastreux. Dix ans après la crise, des millions de vies ont été brisées par l'austérité, les jeunes générations ont le choix entre le chômage de masse ou les emplois précaires, des partis nationalistes et xénophobes sont de plus en plus puissants. (p.175-176)
La conséquence de cette politique est la montée de l'extrême droite partout en Europe. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, alors même qu'il est maître de sa monnaie et avait limité ses contributions au budget de l'Union, montre que le projet européen, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, est perçu par certaines classes sociales comme un danger. Le fonctionnement de l'Europe, en jouant sur la concurrence sociale et fiscale entre pays membres et en ouvrant toujours plus largement son économie via des traités de libre-échange, n'a fait qu'amplifier les effets négatifs de la mondialisation. Le non-respect du référendum sur la Constitution de 2005 en France tout comme l'application du CETA (traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada) avant le vote des parlements nationaux montrent que l'Europe est plus technocratique que démocratique. Et pour preuve, face au Brexit et à la montée des extrêmes en Europe, aucune alternative n'a été proposée par les institutions européennes. Elles poursuivent leur logique concurrentielle et austéritaire malgré de nombreux signaux d'alerte. (p.172)
Les prétendus défenseurs de l'Europe, s'accommodant que la partie sud de l'Europe soit broyée par l'austérité, aiment mettre en avant le modèle allemand. Il est vrai que l'Allemagne a un excédent budgétaire, que sa dette est revenue à son niveau de 2005 et qu'elle a un excédent commercial. Trois indicateurs qui font rêver les économistes. Mais le revers de la médaille de ce succès n'est pas glorieux. L'Allemagne est le pays où les inégalités ont le plus progressé entre 2000 et 2010, le taux de pauvreté y a augmenté de 54 % en dix ans, le taux de travailleurs pauvres a doublé, les personnes cumulant deux emplois ont augmenté de 80,7 % et le nombre de retraités pauvres de 30 %. Enfin, le manque d'investissement de l'Etat a engendré une dégradation des infrastructures publiques. L'Allemagne est en fait un pays riche... avec beaucoup de pauvres. Mais le plus grave est que la politique économique de l'Allemagne se soit imposée à toute l'Europe, notamment via les institutions européennes. Comme le rappelle Steve Ohana, professeur de finance : "L'Europe s'est transformée en maison de redressement dont l'Allemagne a pris le contrôle sans partage, détournant à son profit les principales institutions européennes." (p.170-171)
Concrètement, un plan efficace pour le climat devrait reposer sur quatre piliers : développer massivement les énergies renouvelables ; investir dans l'efficacité et la maîtrise de notre consommation d'énergie (notamment avec la rénovation des bâtiments) ; consommer le plus localement possible (et donc en finir avec les traités de libre-échange) ; développer l'économie circulaire (notamment en élargissant le recyclage des déchets). Pourtant, plutôt que de mettre en place des politiques volontaristes, les dispositifs actuels reposent principalement sur des mécanismes incitatifs de marché : prix du carbone, subventions, fiscalité, crédit d'impôt. Ces instruments ont une certaine efficacité, mais force est de constater qu'ils sont largement insuffisants pour porter une transition énergétique ambitieuse. Dans le fond, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique mais personne ne veut le faire directement et préfère passer par des chemins détournés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne faudrait pas heurter certains intérêts financiers importants comme ceux des grandes compagnies pétro-gazières ou des grandes banques qui ont prêté des sommes énormes à ces compagnies et qui veulent récupérer leur mise. Tout ce beau monde fait un lobbying énorme pour que le changement soit lent et repose majoritairement sur le consommateur. La lutte contre le réchauffement climatique est devenu un slogan publicitaire pour les compagnies comme pour les politiques. Jamais une réalité. (p.149-151)
La justification de la suppression de l'ISF sur les placements financiers bat tous les records de mauvaise foi. Le gouvernement avance la fuite des riches et la volonté d'orienter l'épargne vers l'investissement. Or, sur le premier argument, la fuite des riches, les chiffres de l'administration fiscale montrent que les départs sont de l'ordre de 800 par an et les retours de 300, soit un solde de départs nets de 500 ménages (0,2 des assujettis à l'ISF) pour un manque à gagner moyen s'élevant à 170 millions d'euros par an pour les finances publiques. C'est donc pour éviter de perdre 170 millions d'euros par an que le gouvernement a décidé d'exonérer une partie de l'ISF et de perdre 3,5 milliards d'euros par an ! Quant au second argument de l'épargne qui financerait l'investissement, il faut noter que lorsque l'épargne se dirige vers la Bourse, dans 99 % des cas elle permet l'acquisition d'actions déjà émises. Cet argent ne profitera donc pas aux entreprises mais à l'épargnant qui la vend. (p.139-140)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Thomas Porcher (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Histoire et généralités sur la Normandie
TOUS CONNAISSENT LA TAPISSERIE DE BAYEUX, QUI EN EST LE HÉROS ?
RICHARD COEUR DE LION
ROLLON
MATHILDE
GUILLAUME LE CONQUERANT
GUILLAUME LE ROUX
20 questions
72 lecteurs ont répondu
Thèmes :
histoire
, célébrité
, économieCréer un quiz sur ce livre72 lecteurs ont répondu