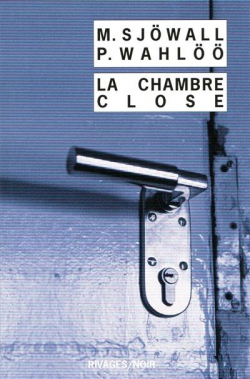>
Critique de Rodin_Marcel
Sjöwall Maj et Wahlöö Per – "La chambre close" – rééd. Rivages/noir, 2009 (ISBN 978-2-7436-2028-8)
– original suédois publié en 1972
– Première édition française publiée en 1987
- Roman traduit directement du suédois par Philippe Bouquet.
– Deux préfaces, l’une de Michael Connelly (cop. 2009), l’autre de Hakan Nesser (cop. 2009).
Ce livre présente à mes yeux deux aspects forts différents. En effet, de prime abord, il s’agit d’un roman policier, reprenant d’ailleurs l’un des thèmes classiques du genre, à savoir le mystère autour d’une victime retrouvée morte assassinée dans une chambre close depuis l’extérieur, thème conjugué avec celui d’un hold-up dans une agence bancaire qui fait une victime parmi les clients présents, l’agresseur parvenant à s’enfuir sans laisser de traces. Bien entendu, les deux intrigues finissent par se rejoindre, et nos auteurs ajoutent alors un autre thème plus original, celui du malfaiteur qu’il s’avère impossible, faute de preuves, de condamner pour son crime réellement commis mais qui du même coup est condamné pour l’autre crime qu’il n’a pas commis mais dont il ne peut plus se dépêtrer de par ses propres déclarations.
Tout cela est mené avec une grande dextérité par nos deux auteurs (qui fournissent même une sorte de théorie du thème de la chambre close en page 354), mais (il convient de le souligner) en fondant leur récit sur la conviction – maintes fois réitérée au cours du récit – que la police serait dans sa quasi-totalité composée d’imbéciles et de crétins, à la seule exception des deux ou trois enquêteurs dont le héros Martin Beck (exemple pp. 85, 241). Ce fondement engendre certes des scènes cocasses (surtout autour de l’équipe placée sous les ordres de «Bulldozer Olsson»), mais aussi et surtout des situations caricaturales peu crédibles.
L’autre aspect est (toujours à mes yeux, nostalgie, nostalgie) beaucoup plus intéressant : ce roman policier constitue un véritable compendium des croyances, attitudes, discours et modes de vie de cette frange gauchiste de la population principalement intellectuelle qui s’agitait régulièrement dans ces années-là.
Dès le chapitre 3, page 34, les auteurs spécifient que le récit commence précisément à la date du 3 juillet 1972 (le chapitre 19 est daté tout aussi précisément du 6 juillet 1972) : nous sommes dans les années d’agitation post-soixante-huitarde, avec les posters de Lénine et Mao (page 225) et les manifestations contre la guerre menée par les Etats-Unis au Vietnam (pp. 87, 307).
En Suède comme en France et dans les pays occidentaux, ces cercles intellectuels ne s’embarrassaient pas de nuances excessives, usant et abusant d’un vocabulaire outrancier comme par exemple en page 90 :
« Que peut-on faire quand on voit sa propre organisation se décomposer sous ses yeux ? Quand on entend les rats du fascisme courir derrière la cloison ? »
(en France, on se souvient du stupide « CRS-SS » hurlé à plein poumons à la vue du moindre képi par des gens qui n’avaient aucune conscience de ce que fut réellement le nazisme).
Ainsi, la presse en prend pour son grade (p. 79), les hommes d’affaire se voient portraiturés en «grands criminels» (p. 127 – il faut convenir que le coup des «parachutes dorés» défraie encore aujourd’hui la chronique), la loi est «conçue afin de protéger certaines classes sociales et leurs intérêts douteux» (p. 221), et de toute façon «en Suède, quand les classes supérieures boivent, on parle de culture œnologique, tandis que les autres sont immédiatement qualifiés d’alcooliques et de cas médicaux, ce sur quoi on s’empresse de la abandonner à leur triste sort» (toujours p. 221), la pilule va libérer la sexualité des jeunes (p. 236), le transport par containers sert à frauder à grande échelle (p. 350), les compagnies d’assurance sont des monstres assoiffées de profits (p. 379). Et ce ne sont là que des thèmes brièvement esquissés.
L’une des obsessions majeures des cercles intellectuels gauchistes de toute nationalité occidentale, résidait dans «la violence policière», la mise en place d’une société dominée par «l’idéologie sécuritaire» obsédée par la chasse aux communistes ou autres gens de gauche. Dans ce registre, nos auteurs atteignent des sommets : les pôvres manifestants pacifiques se font matraqués (p. 87) par des policiers avides de sang, «armés jusqu’aux dents» (p. 88), bientôt tous à la solde d’un «Etat dans l’Etat» (p. 201) s’incarnant dans un nouvel immeuble qui «devait abriter une direction centralisée et planifiée de type totalitaire» (p. 202), le tout sous la coupe de la Sûreté d’Etat «qui au fond ne servait à rien puisqu’elle s’obstinait à mettre en fiche les communistes tout en ignorant diverses organisations fascistes plus ou moins exotiques» (p. 219) et dont la description sommaire atteint tout simplement au ridicule (p. 307).
Un autre thème typique de l’extrême-gauche de cette période est abordé plus succinctement, celui du rapport entre la délinquance criminelle de droit commun et son rôle éventuellement «révolutionnaire» : il est esquissé par Monita, la complice involontaire du trafiquant Mauritzon (page 278), puis il est largement développé dans un dialogue (pp. 288-291), le personnage du récit faisant appel à Lundkvist (récipiendaire en 1958 du glorieux prix Lénine, quelle référence !) et à son «anthologie intitulé L’Homme socialiste» ; cet interlocuteur va encore plus loin en énonçant benoîtement (p. 290) l’un des crédos de cette époque : dans la toute belle société socialiste, il n’y a plus de bandits ni de voleurs car «pourquoi les gens attaqueraient-ils ce qui leur appartient, là-bas ?»
Il se trouve par ailleurs que ce roman effleure çà et là des thèmes nouveaux, dont on ignorait à l’époque l’importance qu’ils allaient prendre jusqu’aujourd’hui : ainsi du passage poignant (pp. 102-107) dans lequel Martin Beck découvre le nouvel état de sa mère âgée, reléguée dans ce que l’on venait de nommer une «maison de retraite» ou l’allusion (p. 137) à cette pornographie qui déferle aujourd’hui à plein régime via Internet et dont la Suède fut à cette époque le foyer, ou encore le chômage endémique très bien illustré par le destin de Monita (pp. 266-273).
Ceci étant, j’ai bien sûr gardé le meilleur pour la fin, à savoir le tableau du milieu gauchiste lui-même, magnifiquement rendu ici par la rencontre de Beck avec Rhea Nielsen (qui apparaît d’abord de façon anodine en p. 210). La première rencontre est longuement décrite (pp. 223-247), la deuxième plus succinctement (pp. 351-358) et la troisième (pp. 377-378) n’a plus besoin de commentaire superflu. Dans la réalité de ces années-là, il a réellement existé des gens comme cette Rhea Nielsen imaginaire, il a réellement existé des maisons dont nul ne songeait à fermer la porte à clé, où tout un chacun venait sonner à toute heure à la porte du voisin pour demander tel ou tel service…
Pour conclure, la préface émanant de Michael Connelly ne présente que fort peu d’intérêt, alors que celle de Hakan Nesser rejoint tout à fait mes propres constatations : Sjöwall et Wahlöö vivaient à une époque où les gens se croyant «de gauche» se racontaient de belles histoires et se berçaient de jolis rêves tout roses, c’était avant que cette «gauche» ne se voit phagocytée puis supplantée par la «gôôôche» bien-pensante d’aujourd’hui, celle des bobos arrogants.
– original suédois publié en 1972
– Première édition française publiée en 1987
- Roman traduit directement du suédois par Philippe Bouquet.
– Deux préfaces, l’une de Michael Connelly (cop. 2009), l’autre de Hakan Nesser (cop. 2009).
Ce livre présente à mes yeux deux aspects forts différents. En effet, de prime abord, il s’agit d’un roman policier, reprenant d’ailleurs l’un des thèmes classiques du genre, à savoir le mystère autour d’une victime retrouvée morte assassinée dans une chambre close depuis l’extérieur, thème conjugué avec celui d’un hold-up dans une agence bancaire qui fait une victime parmi les clients présents, l’agresseur parvenant à s’enfuir sans laisser de traces. Bien entendu, les deux intrigues finissent par se rejoindre, et nos auteurs ajoutent alors un autre thème plus original, celui du malfaiteur qu’il s’avère impossible, faute de preuves, de condamner pour son crime réellement commis mais qui du même coup est condamné pour l’autre crime qu’il n’a pas commis mais dont il ne peut plus se dépêtrer de par ses propres déclarations.
Tout cela est mené avec une grande dextérité par nos deux auteurs (qui fournissent même une sorte de théorie du thème de la chambre close en page 354), mais (il convient de le souligner) en fondant leur récit sur la conviction – maintes fois réitérée au cours du récit – que la police serait dans sa quasi-totalité composée d’imbéciles et de crétins, à la seule exception des deux ou trois enquêteurs dont le héros Martin Beck (exemple pp. 85, 241). Ce fondement engendre certes des scènes cocasses (surtout autour de l’équipe placée sous les ordres de «Bulldozer Olsson»), mais aussi et surtout des situations caricaturales peu crédibles.
L’autre aspect est (toujours à mes yeux, nostalgie, nostalgie) beaucoup plus intéressant : ce roman policier constitue un véritable compendium des croyances, attitudes, discours et modes de vie de cette frange gauchiste de la population principalement intellectuelle qui s’agitait régulièrement dans ces années-là.
Dès le chapitre 3, page 34, les auteurs spécifient que le récit commence précisément à la date du 3 juillet 1972 (le chapitre 19 est daté tout aussi précisément du 6 juillet 1972) : nous sommes dans les années d’agitation post-soixante-huitarde, avec les posters de Lénine et Mao (page 225) et les manifestations contre la guerre menée par les Etats-Unis au Vietnam (pp. 87, 307).
En Suède comme en France et dans les pays occidentaux, ces cercles intellectuels ne s’embarrassaient pas de nuances excessives, usant et abusant d’un vocabulaire outrancier comme par exemple en page 90 :
« Que peut-on faire quand on voit sa propre organisation se décomposer sous ses yeux ? Quand on entend les rats du fascisme courir derrière la cloison ? »
(en France, on se souvient du stupide « CRS-SS » hurlé à plein poumons à la vue du moindre képi par des gens qui n’avaient aucune conscience de ce que fut réellement le nazisme).
Ainsi, la presse en prend pour son grade (p. 79), les hommes d’affaire se voient portraiturés en «grands criminels» (p. 127 – il faut convenir que le coup des «parachutes dorés» défraie encore aujourd’hui la chronique), la loi est «conçue afin de protéger certaines classes sociales et leurs intérêts douteux» (p. 221), et de toute façon «en Suède, quand les classes supérieures boivent, on parle de culture œnologique, tandis que les autres sont immédiatement qualifiés d’alcooliques et de cas médicaux, ce sur quoi on s’empresse de la abandonner à leur triste sort» (toujours p. 221), la pilule va libérer la sexualité des jeunes (p. 236), le transport par containers sert à frauder à grande échelle (p. 350), les compagnies d’assurance sont des monstres assoiffées de profits (p. 379). Et ce ne sont là que des thèmes brièvement esquissés.
L’une des obsessions majeures des cercles intellectuels gauchistes de toute nationalité occidentale, résidait dans «la violence policière», la mise en place d’une société dominée par «l’idéologie sécuritaire» obsédée par la chasse aux communistes ou autres gens de gauche. Dans ce registre, nos auteurs atteignent des sommets : les pôvres manifestants pacifiques se font matraqués (p. 87) par des policiers avides de sang, «armés jusqu’aux dents» (p. 88), bientôt tous à la solde d’un «Etat dans l’Etat» (p. 201) s’incarnant dans un nouvel immeuble qui «devait abriter une direction centralisée et planifiée de type totalitaire» (p. 202), le tout sous la coupe de la Sûreté d’Etat «qui au fond ne servait à rien puisqu’elle s’obstinait à mettre en fiche les communistes tout en ignorant diverses organisations fascistes plus ou moins exotiques» (p. 219) et dont la description sommaire atteint tout simplement au ridicule (p. 307).
Un autre thème typique de l’extrême-gauche de cette période est abordé plus succinctement, celui du rapport entre la délinquance criminelle de droit commun et son rôle éventuellement «révolutionnaire» : il est esquissé par Monita, la complice involontaire du trafiquant Mauritzon (page 278), puis il est largement développé dans un dialogue (pp. 288-291), le personnage du récit faisant appel à Lundkvist (récipiendaire en 1958 du glorieux prix Lénine, quelle référence !) et à son «anthologie intitulé L’Homme socialiste» ; cet interlocuteur va encore plus loin en énonçant benoîtement (p. 290) l’un des crédos de cette époque : dans la toute belle société socialiste, il n’y a plus de bandits ni de voleurs car «pourquoi les gens attaqueraient-ils ce qui leur appartient, là-bas ?»
Il se trouve par ailleurs que ce roman effleure çà et là des thèmes nouveaux, dont on ignorait à l’époque l’importance qu’ils allaient prendre jusqu’aujourd’hui : ainsi du passage poignant (pp. 102-107) dans lequel Martin Beck découvre le nouvel état de sa mère âgée, reléguée dans ce que l’on venait de nommer une «maison de retraite» ou l’allusion (p. 137) à cette pornographie qui déferle aujourd’hui à plein régime via Internet et dont la Suède fut à cette époque le foyer, ou encore le chômage endémique très bien illustré par le destin de Monita (pp. 266-273).
Ceci étant, j’ai bien sûr gardé le meilleur pour la fin, à savoir le tableau du milieu gauchiste lui-même, magnifiquement rendu ici par la rencontre de Beck avec Rhea Nielsen (qui apparaît d’abord de façon anodine en p. 210). La première rencontre est longuement décrite (pp. 223-247), la deuxième plus succinctement (pp. 351-358) et la troisième (pp. 377-378) n’a plus besoin de commentaire superflu. Dans la réalité de ces années-là, il a réellement existé des gens comme cette Rhea Nielsen imaginaire, il a réellement existé des maisons dont nul ne songeait à fermer la porte à clé, où tout un chacun venait sonner à toute heure à la porte du voisin pour demander tel ou tel service…
Pour conclure, la préface émanant de Michael Connelly ne présente que fort peu d’intérêt, alors que celle de Hakan Nesser rejoint tout à fait mes propres constatations : Sjöwall et Wahlöö vivaient à une époque où les gens se croyant «de gauche» se racontaient de belles histoires et se berçaient de jolis rêves tout roses, c’était avant que cette «gauche» ne se voit phagocytée puis supplantée par la «gôôôche» bien-pensante d’aujourd’hui, celle des bobos arrogants.