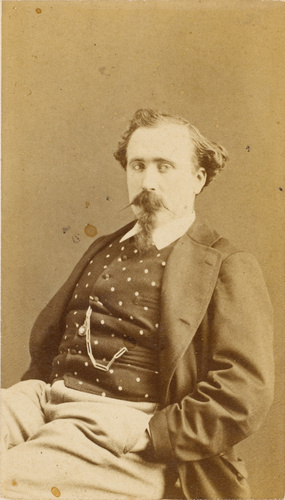Citations de Pierre Véron (183)
Chateaubriand arrivait au milieu de cette absurde littérature du premier empire qui fut le plus hideux mélange de prétention et de platitude.
Du premier coup, il fut écoeuré et rompit avec ses contemporains.
Mais il y avait du mauvais goût dans l’air ; il en respira sans le vouloir, sans le savoir.
Doit-on pour cela le démolir, comme font ces critiques d’estaminet qui ont cru tuer un homme d’un mot en vous disant :
Lamartine !… Peuh !… Un geigneur !
Ou bien :
Ne me parlez pas de Chateaubriand… Une ganache !
Tachez donc d’être ganaches ainsi, eunuques de lettres, qui ne faites rien et décriez tous ceux qui ont fait quelque chose !
La vérité est que beaucoup de choses ont vieilli dans le bagage de Chateaubriand.
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus lire sans écoeurement certaines tirades ampoulées de René ou Atala. Mais ce n’est pas la faute de Chateaubriand, c’est la faute de son époque.
Il peut y avoir un corps vigoureux et harmonieux sous un costume ridicule.
D’ailleurs, les Mémoires et les Fragments poétiques suffiraient à faire vivre Chateaubriand.
Quant à l’homme privé, il fut, il faut bien le dire, pétri d’un amour-propre intolérable.
C’était un pape qui croyait à son infaillibilité.
Aussi fut-il profondément irrité par le succès des nouveaux venus dont la réputation vint disputer le soleil à la sienne.
On nous contait à ce propos une anecdote inédite qui est tout à fait caractéristique.
C’était à l’Abbaye Aux Bois, où Chateaubriand trônait d’ordinaire. On avait annoncé pour ce soir-là la venue d’un jeune poète qui en était à ses débuts, mais dont on commençait à affirmer le talent. Le jeune poète arriva, en effet, et, avec une certaine recherche de timidité, se met à réciter trois ou quatre pièces de vers à la fois simples et passionnées, rejetant les vieux moules et les emphases banales.
Ce jeune homme, c’était Alfred de Musset.
Quand il eut fini, Chateaubriand, qui avait écouté d’un air mécontent, fut questionné par quelqu’un sur ce qu’il pensait de ce qu’il avait entendu.
Et plissant dédaigneusement la lèvre :
- Je n’aime pas, fit-il, qu’on mène la Muse à la guinguette.
La prétendue guinguette vivra plus longtemps que le temple où Chateaubriand s’adorait lui-même.
Du premier coup, il fut écoeuré et rompit avec ses contemporains.
Mais il y avait du mauvais goût dans l’air ; il en respira sans le vouloir, sans le savoir.
Doit-on pour cela le démolir, comme font ces critiques d’estaminet qui ont cru tuer un homme d’un mot en vous disant :
Lamartine !… Peuh !… Un geigneur !
Ou bien :
Ne me parlez pas de Chateaubriand… Une ganache !
Tachez donc d’être ganaches ainsi, eunuques de lettres, qui ne faites rien et décriez tous ceux qui ont fait quelque chose !
La vérité est que beaucoup de choses ont vieilli dans le bagage de Chateaubriand.
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus lire sans écoeurement certaines tirades ampoulées de René ou Atala. Mais ce n’est pas la faute de Chateaubriand, c’est la faute de son époque.
Il peut y avoir un corps vigoureux et harmonieux sous un costume ridicule.
D’ailleurs, les Mémoires et les Fragments poétiques suffiraient à faire vivre Chateaubriand.
Quant à l’homme privé, il fut, il faut bien le dire, pétri d’un amour-propre intolérable.
C’était un pape qui croyait à son infaillibilité.
Aussi fut-il profondément irrité par le succès des nouveaux venus dont la réputation vint disputer le soleil à la sienne.
On nous contait à ce propos une anecdote inédite qui est tout à fait caractéristique.
C’était à l’Abbaye Aux Bois, où Chateaubriand trônait d’ordinaire. On avait annoncé pour ce soir-là la venue d’un jeune poète qui en était à ses débuts, mais dont on commençait à affirmer le talent. Le jeune poète arriva, en effet, et, avec une certaine recherche de timidité, se met à réciter trois ou quatre pièces de vers à la fois simples et passionnées, rejetant les vieux moules et les emphases banales.
Ce jeune homme, c’était Alfred de Musset.
Quand il eut fini, Chateaubriand, qui avait écouté d’un air mécontent, fut questionné par quelqu’un sur ce qu’il pensait de ce qu’il avait entendu.
Et plissant dédaigneusement la lèvre :
- Je n’aime pas, fit-il, qu’on mène la Muse à la guinguette.
La prétendue guinguette vivra plus longtemps que le temple où Chateaubriand s’adorait lui-même.
On parlait poésie, l'autre soir, dans un des salons encore ouverts. Et la conversation tomba sur un maîtres de la rime, qui a malheureusement le défaut d'être toujours porté à l'exagération et à l'emphase.
- Grand talent, fit un des causeurs, mais quel dommage qu'il se serve toujours de vers grossissants !
(Le Monde illustré, 3 juillet 1897, p.3)
- Grand talent, fit un des causeurs, mais quel dommage qu'il se serve toujours de vers grossissants !
(Le Monde illustré, 3 juillet 1897, p.3)
Décidément le système des consultations plus ou moins littéraires va se propageant de plus en plus.
Une de ses dernières applications visait les dames et demoiselles, et leur posait cette question :
— Quel était votre idéal à vingt ans ?
Avec beaucoup de bonne volonté, les interrogées ont répondu.
Quelques-unes même, à cette bonne volonté-là, ont ajouté une prolixité qui dépassait peut-être un peu les bornes.
Mais c’est à un autre point de vue que la nouvelle mode me paraît stérilisée d'avance.
Quand on pose de ces demandes-là, est-il possible que la réponse soit sincère, surtout à une époque aussi faisandée que la nôtre ?
— Quel était votre idéal à vingt ans ? Comment voulez-vous qu’on réplique en toute franchise ?
Voyez-vous une correspondante écrivant :
« Monsieur, Mon idéal, quand j’étais jeune fille mineure, était de conquérir le plus vite possible mon indépendance afin de pouvoir, si bon me semblait, me livrer à une noce effrénée. »
Ou bien : « Monsieur, À vingt ans, je ne pensais qu’à une chose : c’était à épouser un homme très riche qui me fournirait les moyens de changer au moins trois fois par jour de toilettes et de rouler en voiture. »
Ou bien encore : « Monsieur, Mon idéal, dans ma prime jeunesse, était d’épouser un monsieur très vieux et d'être, par un décès rapide, délivrée de lui pour pouvoir vivre à ma guise."
Il est évident que de semblables réponses sont impossibles.
Il est des choses qu’on pense, mais qu’on ne dit ni n'écrit jamais.
(Journal Amusant, 1er octobre 1898, p.2)
Une de ses dernières applications visait les dames et demoiselles, et leur posait cette question :
— Quel était votre idéal à vingt ans ?
Avec beaucoup de bonne volonté, les interrogées ont répondu.
Quelques-unes même, à cette bonne volonté-là, ont ajouté une prolixité qui dépassait peut-être un peu les bornes.
Mais c’est à un autre point de vue que la nouvelle mode me paraît stérilisée d'avance.
Quand on pose de ces demandes-là, est-il possible que la réponse soit sincère, surtout à une époque aussi faisandée que la nôtre ?
— Quel était votre idéal à vingt ans ? Comment voulez-vous qu’on réplique en toute franchise ?
Voyez-vous une correspondante écrivant :
« Monsieur, Mon idéal, quand j’étais jeune fille mineure, était de conquérir le plus vite possible mon indépendance afin de pouvoir, si bon me semblait, me livrer à une noce effrénée. »
Ou bien : « Monsieur, À vingt ans, je ne pensais qu’à une chose : c’était à épouser un homme très riche qui me fournirait les moyens de changer au moins trois fois par jour de toilettes et de rouler en voiture. »
Ou bien encore : « Monsieur, Mon idéal, dans ma prime jeunesse, était d’épouser un monsieur très vieux et d'être, par un décès rapide, délivrée de lui pour pouvoir vivre à ma guise."
Il est évident que de semblables réponses sont impossibles.
Il est des choses qu’on pense, mais qu’on ne dit ni n'écrit jamais.
(Journal Amusant, 1er octobre 1898, p.2)
En attendant les multiples révolutions dont on ne cesse de nous parler, il en est une qui paraît se préparer avec une insistance croissante.
Tout s'enchaîne.
Le jour où le féminisme a dit : "Nous serons hommes aussi,"
il n'y avait plus de raison pour que le masculinisme ne clamât pas :
"Et nous, nous deviendrons femmes, si cela nous plaît."
Le chassé-croisé est en train de s'opérer.
On a vu ses premières tentatives au point de vue social.
Maintenant, c'est en matière de mode qu'on travaille à la mutation des sexes.
Tout dernièrement on nous assurait qu'en Angleterre le suprême chic pour les apprentis gentlemen consistait à porter les manchons.
Comme contrepartie on certifie que nos élégantes sont décidées à inaugurer la canne, dès que la saison excursionniste aura donné un prétexte à la tentative.
Après quoi, on persistera à s'orner de cet accessoire dans la circulation.
Paris s'amuse...
La canne fut jadis en honneur — voir les tableaux des musées rétrospectifs — parmi les très grandes dames de la cour.
Mais, en conscience, le modeste et peu décoratif riflard (parapluie) paraît mieux cadrer avec la vie moderne.
Même en s'étayant sur une canne, celles qui ont l'habitude de ne pas marcher droit ne changeraient rien à leurs zigzags folâtres.
Tout ce qu'on y pourrait gagner, ce seraient des rencontres à coups de badines entre les demoiselles du boulevard et leur clientèle.
La perspective n'a rien d'affriolant.
Puis, en conscience, ces interventions risqueraient trop de faire ressembler le vingtième siècle, qui s'avance, à un perpétuel carnaval.
Voyez vous les rues sillonnées par des dames avec culotte et smoking, pendant que les messieurs circuleraient enjuponnés, manchonnés et ornés de corset ?
La toquade elle-même a ses limites, et il ne faut pas abuser de l'extravagance, car elle tourne alors à la banalité.
(Le Journal Amusant, 22 avril 1899, p.2)
Tout s'enchaîne.
Le jour où le féminisme a dit : "Nous serons hommes aussi,"
il n'y avait plus de raison pour que le masculinisme ne clamât pas :
"Et nous, nous deviendrons femmes, si cela nous plaît."
Le chassé-croisé est en train de s'opérer.
On a vu ses premières tentatives au point de vue social.
Maintenant, c'est en matière de mode qu'on travaille à la mutation des sexes.
Tout dernièrement on nous assurait qu'en Angleterre le suprême chic pour les apprentis gentlemen consistait à porter les manchons.
Comme contrepartie on certifie que nos élégantes sont décidées à inaugurer la canne, dès que la saison excursionniste aura donné un prétexte à la tentative.
Après quoi, on persistera à s'orner de cet accessoire dans la circulation.
Paris s'amuse...
La canne fut jadis en honneur — voir les tableaux des musées rétrospectifs — parmi les très grandes dames de la cour.
Mais, en conscience, le modeste et peu décoratif riflard (parapluie) paraît mieux cadrer avec la vie moderne.
Même en s'étayant sur une canne, celles qui ont l'habitude de ne pas marcher droit ne changeraient rien à leurs zigzags folâtres.
Tout ce qu'on y pourrait gagner, ce seraient des rencontres à coups de badines entre les demoiselles du boulevard et leur clientèle.
La perspective n'a rien d'affriolant.
Puis, en conscience, ces interventions risqueraient trop de faire ressembler le vingtième siècle, qui s'avance, à un perpétuel carnaval.
Voyez vous les rues sillonnées par des dames avec culotte et smoking, pendant que les messieurs circuleraient enjuponnés, manchonnés et ornés de corset ?
La toquade elle-même a ses limites, et il ne faut pas abuser de l'extravagance, car elle tourne alors à la banalité.
(Le Journal Amusant, 22 avril 1899, p.2)
LA NUIT DES MORTS
HALLUCINATION
La scène se passe au cimetière Montparnasse, le soir du Jour des Morts.
La foule — il faudrait dire peut-être : la cohue — qui n'a cessé d'encombrer, durant toute la journée, les lugubres avenues, s'est dispersée avec la nuit.
Une épaisse obscurité enveloppe le funèbre enclos. Un silence profond règne dans le champ de repos, si étrangement populeux tout à l'heure.
Peu à peu, cependant, le calme nocturne est troublé par des chuchotements, confus comme un murmure. Les chuchotements deviennent de plus en plus distincts ; d'autres bruits leur répondent, et bientôt un dialogue général s'engage entre les tombes.
UN TOMBEAU PHILOSOPHE : « Enfin !... Le voilà passé encore une fois, ce jour où nous sommes expropriés de notre paix suprême — pour cause de fête publique. »
UN MAUSOLÉE VANITEUX : « Il me semble qu'il n'y a pas de quoi se plaindre... Cela change un peu, de voir du monde ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE : « Vous confondez, mon noble voisin... Ce qui vous charme, ce n'est pas de voir, mais d'être vu... Vous qui avez — jusque dans la mort — voulu posséder pignon sur rue. »
LE MAUSOLÉE VANITEUX : « C'est la jalousie qui vous fait parler... Parce que vous n'avez qu'un simple entourage de bois blanc. »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE : « Jaloux ! Moi !... Et de quoi, mon pauvre ami ?... Je n'eus jamais le goût de la propriété. Je suis locataire d'un humble coin après comme pendant la vie... Affaire d'habitude. Seulement, après comme pendant, j'aime ma tranquillité. Autrefois je n'allais jamais dans le monde... Aujourd'hui je regrette que le monde vienne à moi ! »
LE MAUSOLÉE VANITEUX : « Et pourquoi, s'il vous plaît ? »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE : « Pourquoi ?... Parce qu'à distance on peut encore se faire illusion sur les vivants, tandis que de près... Que voulez-vous ? Je ne comprends pas les douleurs de commande et les désespoirs à heure fixe... À regarder tous ces promeneurs gantés, pommadés, endimanchés, il m'a semblé que ces gens-là venaient faire ici un petit tour pour s'ouvrir l'appétit, et que notre dernière demeure était pour eux un bois de Boulogne comme un autre !... »
LE TOMBEAU D’UN LITTÉRAIRE.— « Vous avez raison ! Mille fois raison ! Les hommes ne sont que des ingrats et des oublieux. »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Je n'ai pas tout à fait voulu dire cela... Il y a des exceptions à la règle. »
LE TOMBEAU D’UN LITTÉRAIRE. — « Non ! Il n'y en a pas ! Quand je pense, moi qui vous parle, que, de mon vivant, je fus une célébrité académique ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Et qu'on a l'imprudence de ne plus s'occuper de vous ! »
LE TOMBEAU D’UN LITTÉRAIRE. — « Comment ? Ne plus s'occuper ! C'est bien pis encore ! Ils ne se rappellent même plus mon nom ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Et vous croyiez pourtant bien vous en être fait un ! »
LE TOMBEAU D’UN LITTÉRAIRE.— « Mais, il y a vingt ans, on ne parlait que de moi ! Mes ouvrages faisaient prime... Mon antichambre était assiégée d'admirateurs... Lorsqu'on m'a conduit ici, l'Institut entier faisait cortège ! On a prononcé sur ma dépouille six discours, six, où l'on déclarait que la littérature ne me remplacerait jamais ! Eh bien ! aujourd'hui, trois mille personnes au moins sont passées devant ma tombe ; et, en lisant l'inscription qui la décore, chacun de s'écrier : « Trois Étoiles ! Connais pas ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Ce qui prouve que la littérature a tenu parole. Elle ne vous a pas remplacé, elle se passe de vous. »
LE TOMBEAU D’UNE MÈRE. — « Mon pauvre cher enfant ! comme il est grandi ! Ah ! si j'avais pu m'échapper un instant de ma froide prison, quand il était là, à genoux sur le gazon ! comme je l'aurais embrassé ! Ils me l'ont laissé si peu de temps, ces étrangers qui ont, par charité, recueilli le malheureux orphelin... mon Dieu ! mon Dieu ! ils ne le rendent peut-être pas heureux ! Son mignon visage m'a semblé tout pâle ! Ils me le tueront de travail... »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Bienfaisance à 25% de rendement, il y en a beaucoup comme cela. »
LE TOMBEAU D’UNE MÈRE.— « Ah ! maintenant je regrette presque de l'avoir vu ! mieux aurait valu ignorer ce qui se passait après moi ! »
LE TOMBEAU D’UNE JEUNE FILLE. — « Elles étaient belles, ces deux riches demoiselles qui se sont arrêtées un instant devant ma pierre tumulaire... Belles ! je l'étais aussi ! je méritais d'être aimée, autant qu'elles le méritent... Mais est-ce qu'on est aimée sans dot ? celui que mon coeur avait choisi a préféré l'ambition à l'amour... il a eu raison, et moi j'ai bien fait de mourir, puisqu'il ne s'est pas même souvenu aujourd'hui ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Ainsi va le monde ! si j'avais rencontré cette âme-là là-haut, il y aurait peut-être ici deux habitants de moins ! »
LE TOMBEAU D’UN VIEIL ONCLE. — « Le sacripant ! le vaurien ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « De la colère posthume ? Qui va là ? »
LE TOMBEAU D’UN VIEIL ONCLE. — « Dire que j'ai été assez sot pour me laisser trépasser en instituant ce coquin mon légataire universel ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Alors c'est un neveu qui a omis de se rendre à ses devoirs ? »
LE TOMBEAU D’UN VIEIL ONCLE. — « Au contraire ! Il s'y est rendu, et je l'aurais volontiers tenu quitte de sa visite. Venir me narguer par son luxe, c'est-à-dire qu'il avait un costume qui lui avait au moins coûté cinq cents livres ! ce que je dépensais en toute une année ! Malédiction ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Tout beau ! Calmez-vous. »
LE TOMBEAU D’UN VIEIL ONCLE. — Me calmer ? Quand je pense que j'ai vécu cinquante ans de privations, que j'ai entassé sou sur sou pour que ce mécréant gaspille en prodigalités mes chères économies ! Je parie qu'il avait une voiture qui l'attendait à la porte ! Moi qui n'en ai jamais pris, de voiture, que le jour où l'on m'a amené ici ; encore parce que je ne pouvais pas m'y opposer... J'en mourrais de rage, si ce n'était déjà fait.
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — Les extrêmes se succèdent et se punissent. Il serait à souhaiter que votre exemple apprît à vivre... aux autres.
PLUSIEURS TOMBES. — Délaissées ! Délaissées ! Délaissées !
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — Oui, c'est vrai... L'abandon paraît plus dur le jour des Morts que les autres, à cause de la comparaison... mais mieux vaut souvent l'oubli complet qu'un souvenir hypocrite. Tout à l'heure encore, n'entendiez-vous pas d'ici les échos d'un bal voisin ? C'étaient les regrets éternels de Paris qui faisaient un avant-deux, et, dans les quadrilles comme au théâtre, on aurait pu reconnaître plus d'un visage que nous avions vu le matin !
LE TOMBEAU D’UN VIEIL ONCLE. — Scélérat de neveu !
LE TOMBEAU D’UNE MÈRE.— Mon cher petit !
LE TOMBEAU D’UN LITTÉRAIRE. — Ne pas connaître un ancien académicien !
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — Allons, camarades, voici le jour qui se lève... silence et résignation !
LE TOMBEAU D’UNE JEUNE FEMME. — Le jour ! Il va venir, lui ! Car il n'a pas voulu se mêler à la multitude des indifférents ! Car il sait me pleurer, mon bien aimé ! Car il comprend que les larmes ont leur pudeur !
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — Vous l'entendez, mes amis... Il y a encore de nobles cœurs sur terre... voilà qui doit nous consoler. Quant aux autres... (La cloche du cimetière annonce un premier convoi.) Quant aux autres... voici qui nous venge ! »
HALLUCINATION
La scène se passe au cimetière Montparnasse, le soir du Jour des Morts.
La foule — il faudrait dire peut-être : la cohue — qui n'a cessé d'encombrer, durant toute la journée, les lugubres avenues, s'est dispersée avec la nuit.
Une épaisse obscurité enveloppe le funèbre enclos. Un silence profond règne dans le champ de repos, si étrangement populeux tout à l'heure.
Peu à peu, cependant, le calme nocturne est troublé par des chuchotements, confus comme un murmure. Les chuchotements deviennent de plus en plus distincts ; d'autres bruits leur répondent, et bientôt un dialogue général s'engage entre les tombes.
UN TOMBEAU PHILOSOPHE : « Enfin !... Le voilà passé encore une fois, ce jour où nous sommes expropriés de notre paix suprême — pour cause de fête publique. »
UN MAUSOLÉE VANITEUX : « Il me semble qu'il n'y a pas de quoi se plaindre... Cela change un peu, de voir du monde ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE : « Vous confondez, mon noble voisin... Ce qui vous charme, ce n'est pas de voir, mais d'être vu... Vous qui avez — jusque dans la mort — voulu posséder pignon sur rue. »
LE MAUSOLÉE VANITEUX : « C'est la jalousie qui vous fait parler... Parce que vous n'avez qu'un simple entourage de bois blanc. »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE : « Jaloux ! Moi !... Et de quoi, mon pauvre ami ?... Je n'eus jamais le goût de la propriété. Je suis locataire d'un humble coin après comme pendant la vie... Affaire d'habitude. Seulement, après comme pendant, j'aime ma tranquillité. Autrefois je n'allais jamais dans le monde... Aujourd'hui je regrette que le monde vienne à moi ! »
LE MAUSOLÉE VANITEUX : « Et pourquoi, s'il vous plaît ? »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE : « Pourquoi ?... Parce qu'à distance on peut encore se faire illusion sur les vivants, tandis que de près... Que voulez-vous ? Je ne comprends pas les douleurs de commande et les désespoirs à heure fixe... À regarder tous ces promeneurs gantés, pommadés, endimanchés, il m'a semblé que ces gens-là venaient faire ici un petit tour pour s'ouvrir l'appétit, et que notre dernière demeure était pour eux un bois de Boulogne comme un autre !... »
LE TOMBEAU D’UN LITTÉRAIRE.— « Vous avez raison ! Mille fois raison ! Les hommes ne sont que des ingrats et des oublieux. »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Je n'ai pas tout à fait voulu dire cela... Il y a des exceptions à la règle. »
LE TOMBEAU D’UN LITTÉRAIRE. — « Non ! Il n'y en a pas ! Quand je pense, moi qui vous parle, que, de mon vivant, je fus une célébrité académique ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Et qu'on a l'imprudence de ne plus s'occuper de vous ! »
LE TOMBEAU D’UN LITTÉRAIRE. — « Comment ? Ne plus s'occuper ! C'est bien pis encore ! Ils ne se rappellent même plus mon nom ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Et vous croyiez pourtant bien vous en être fait un ! »
LE TOMBEAU D’UN LITTÉRAIRE.— « Mais, il y a vingt ans, on ne parlait que de moi ! Mes ouvrages faisaient prime... Mon antichambre était assiégée d'admirateurs... Lorsqu'on m'a conduit ici, l'Institut entier faisait cortège ! On a prononcé sur ma dépouille six discours, six, où l'on déclarait que la littérature ne me remplacerait jamais ! Eh bien ! aujourd'hui, trois mille personnes au moins sont passées devant ma tombe ; et, en lisant l'inscription qui la décore, chacun de s'écrier : « Trois Étoiles ! Connais pas ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Ce qui prouve que la littérature a tenu parole. Elle ne vous a pas remplacé, elle se passe de vous. »
LE TOMBEAU D’UNE MÈRE. — « Mon pauvre cher enfant ! comme il est grandi ! Ah ! si j'avais pu m'échapper un instant de ma froide prison, quand il était là, à genoux sur le gazon ! comme je l'aurais embrassé ! Ils me l'ont laissé si peu de temps, ces étrangers qui ont, par charité, recueilli le malheureux orphelin... mon Dieu ! mon Dieu ! ils ne le rendent peut-être pas heureux ! Son mignon visage m'a semblé tout pâle ! Ils me le tueront de travail... »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Bienfaisance à 25% de rendement, il y en a beaucoup comme cela. »
LE TOMBEAU D’UNE MÈRE.— « Ah ! maintenant je regrette presque de l'avoir vu ! mieux aurait valu ignorer ce qui se passait après moi ! »
LE TOMBEAU D’UNE JEUNE FILLE. — « Elles étaient belles, ces deux riches demoiselles qui se sont arrêtées un instant devant ma pierre tumulaire... Belles ! je l'étais aussi ! je méritais d'être aimée, autant qu'elles le méritent... Mais est-ce qu'on est aimée sans dot ? celui que mon coeur avait choisi a préféré l'ambition à l'amour... il a eu raison, et moi j'ai bien fait de mourir, puisqu'il ne s'est pas même souvenu aujourd'hui ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Ainsi va le monde ! si j'avais rencontré cette âme-là là-haut, il y aurait peut-être ici deux habitants de moins ! »
LE TOMBEAU D’UN VIEIL ONCLE. — « Le sacripant ! le vaurien ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « De la colère posthume ? Qui va là ? »
LE TOMBEAU D’UN VIEIL ONCLE. — « Dire que j'ai été assez sot pour me laisser trépasser en instituant ce coquin mon légataire universel ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Alors c'est un neveu qui a omis de se rendre à ses devoirs ? »
LE TOMBEAU D’UN VIEIL ONCLE. — « Au contraire ! Il s'y est rendu, et je l'aurais volontiers tenu quitte de sa visite. Venir me narguer par son luxe, c'est-à-dire qu'il avait un costume qui lui avait au moins coûté cinq cents livres ! ce que je dépensais en toute une année ! Malédiction ! »
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — « Tout beau ! Calmez-vous. »
LE TOMBEAU D’UN VIEIL ONCLE. — Me calmer ? Quand je pense que j'ai vécu cinquante ans de privations, que j'ai entassé sou sur sou pour que ce mécréant gaspille en prodigalités mes chères économies ! Je parie qu'il avait une voiture qui l'attendait à la porte ! Moi qui n'en ai jamais pris, de voiture, que le jour où l'on m'a amené ici ; encore parce que je ne pouvais pas m'y opposer... J'en mourrais de rage, si ce n'était déjà fait.
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — Les extrêmes se succèdent et se punissent. Il serait à souhaiter que votre exemple apprît à vivre... aux autres.
PLUSIEURS TOMBES. — Délaissées ! Délaissées ! Délaissées !
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — Oui, c'est vrai... L'abandon paraît plus dur le jour des Morts que les autres, à cause de la comparaison... mais mieux vaut souvent l'oubli complet qu'un souvenir hypocrite. Tout à l'heure encore, n'entendiez-vous pas d'ici les échos d'un bal voisin ? C'étaient les regrets éternels de Paris qui faisaient un avant-deux, et, dans les quadrilles comme au théâtre, on aurait pu reconnaître plus d'un visage que nous avions vu le matin !
LE TOMBEAU D’UN VIEIL ONCLE. — Scélérat de neveu !
LE TOMBEAU D’UNE MÈRE.— Mon cher petit !
LE TOMBEAU D’UN LITTÉRAIRE. — Ne pas connaître un ancien académicien !
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — Allons, camarades, voici le jour qui se lève... silence et résignation !
LE TOMBEAU D’UNE JEUNE FEMME. — Le jour ! Il va venir, lui ! Car il n'a pas voulu se mêler à la multitude des indifférents ! Car il sait me pleurer, mon bien aimé ! Car il comprend que les larmes ont leur pudeur !
LE TOMBEAU PHILOSOPHE. — Vous l'entendez, mes amis... Il y a encore de nobles cœurs sur terre... voilà qui doit nous consoler. Quant aux autres... (La cloche du cimetière annonce un premier convoi.) Quant aux autres... voici qui nous venge ! »
Ah ! La jolie annonce qui me tombe sous les yeux !
Je m’empresse de la copier :
« On peut, TOUT EN S’AMUSANT, nettoyer son piano, une armoire à glace, une commode avec son marbre. »
Qui donc prétendait que la vie était monotone et que les distractions se faisaient rares ! Il ne s’agit que de savoir se récréer.
Vous êtes seul. Vous avez le spleen. Vous vous dites :
« Mon Dieu ! Qu’est-ce que je ferais donc bien ?… »
Réfléchir est triste, le plus souvent.
Ciel ! Quelle inspiration !… Et vous attrapez un morceau de la cire merveilleuse. A tour de bras, vous vous mettez à frotter votre commode. Vous êtes heureux !
Le tout, en ce monde, est de savoir s’arranger.
Sans compter qu’il serait par trop cruel de priver les autres d’un plaisir si doux.
Fi, l’égoïsme !
Il est donc à supposer que prochainement on se réunira pour goûter en commun le nouvel amusement.
Attendez-vous à recevoir l’hiver prochain des invitations ainsi conçues :
« Monsieur et Madame X… ont l’honneur de vous prier de vouloir bien passer chez eux la soirée du jeudi courant. On reverdira le mobilier, »
Ce sera exquis ! Ce sera neuf !
(Article Journal Amusant - 31 juillet 1875)
Je m’empresse de la copier :
« On peut, TOUT EN S’AMUSANT, nettoyer son piano, une armoire à glace, une commode avec son marbre. »
Qui donc prétendait que la vie était monotone et que les distractions se faisaient rares ! Il ne s’agit que de savoir se récréer.
Vous êtes seul. Vous avez le spleen. Vous vous dites :
« Mon Dieu ! Qu’est-ce que je ferais donc bien ?… »
Réfléchir est triste, le plus souvent.
Ciel ! Quelle inspiration !… Et vous attrapez un morceau de la cire merveilleuse. A tour de bras, vous vous mettez à frotter votre commode. Vous êtes heureux !
Le tout, en ce monde, est de savoir s’arranger.
Sans compter qu’il serait par trop cruel de priver les autres d’un plaisir si doux.
Fi, l’égoïsme !
Il est donc à supposer que prochainement on se réunira pour goûter en commun le nouvel amusement.
Attendez-vous à recevoir l’hiver prochain des invitations ainsi conçues :
« Monsieur et Madame X… ont l’honneur de vous prier de vouloir bien passer chez eux la soirée du jeudi courant. On reverdira le mobilier, »
Ce sera exquis ! Ce sera neuf !
(Article Journal Amusant - 31 juillet 1875)
Ce qui suit n'est pas du neuf, mais tout au plus du demi-neuf. Il y a, en effet, une bonne dizaine d’années que la question des femmes-avocats fut mise à l’ordre du jour par des chercheurs d’innovation.
Elle reçut un commencement d’exécution avec Mlle Chauvin, qui subit les examens de rigueur, mais qui n’a pas encore été admise à l’exercice de la profession qu’elle ambitionne.
C’est sur cette solution définitive que le débat est engagé aujourd’hui.
Nous ne voyons pas, pour notre part, un seul motif valable pour qu’on interdise au sexe féminin l’usage, et même l’abus de la parole. Il ne s'en servira jamais plus inconsidérément et plus désastreusement que le sexe masculin.
J'ajouterai que, pour certains procès dans lesquels la casuistique sentimentale joue un rôle prépondérant, une avocate me semblera beaucoup plus autorisée qu'un simple avocat.
Elle pourra pénétrer dans l'intimité des motifs qui arment parfois la jalousie des dames ; elle pourra attendrir le jury plus facilement que les discoureurs à toque.
Sans parler du charme que pourra exercer la personne même de l'oratrice et qui jouera un rôle considérable dans les décisions des juges et du jury ; car, ainsi que l’a affirmé dès longtemps une formule connue, on n’est pas de bois. Et cette formule là est aussi bien applicable au Palais qu’ailleurs.
Ne pas oublier, enfin, que les anciens avaient placé la justice sous le haut patronage de Mme Thémis, qui ne portait pas culotte, à ce que je suppose.
Viennent donc les avocates le plus tôt possible : elles seront les bien reçues.
(Le Monde Illustré, 3 décembre 1898, p.2)
Elle reçut un commencement d’exécution avec Mlle Chauvin, qui subit les examens de rigueur, mais qui n’a pas encore été admise à l’exercice de la profession qu’elle ambitionne.
C’est sur cette solution définitive que le débat est engagé aujourd’hui.
Nous ne voyons pas, pour notre part, un seul motif valable pour qu’on interdise au sexe féminin l’usage, et même l’abus de la parole. Il ne s'en servira jamais plus inconsidérément et plus désastreusement que le sexe masculin.
J'ajouterai que, pour certains procès dans lesquels la casuistique sentimentale joue un rôle prépondérant, une avocate me semblera beaucoup plus autorisée qu'un simple avocat.
Elle pourra pénétrer dans l'intimité des motifs qui arment parfois la jalousie des dames ; elle pourra attendrir le jury plus facilement que les discoureurs à toque.
Sans parler du charme que pourra exercer la personne même de l'oratrice et qui jouera un rôle considérable dans les décisions des juges et du jury ; car, ainsi que l’a affirmé dès longtemps une formule connue, on n’est pas de bois. Et cette formule là est aussi bien applicable au Palais qu’ailleurs.
Ne pas oublier, enfin, que les anciens avaient placé la justice sous le haut patronage de Mme Thémis, qui ne portait pas culotte, à ce que je suppose.
Viennent donc les avocates le plus tôt possible : elles seront les bien reçues.
(Le Monde Illustré, 3 décembre 1898, p.2)
On a cité souvent des inscriptions baroques prises sur des boutiques parisiennes.
J'en ai, l'autre jour, au lendemain de la fête, recueilli une qui me paraît les dépasser en imprévu.
Elle était écrite à la main sur une simple feuille de papier collée aux vitres.
Elle disait : "FERMÉ POUR CAUSE D'ENVIE DE DORMIR"
Il serait difficile de traiter sa clientèle avec un plus aimable sans-gêne, vous l'avouerez.
J'en ai, l'autre jour, au lendemain de la fête, recueilli une qui me paraît les dépasser en imprévu.
Elle était écrite à la main sur une simple feuille de papier collée aux vitres.
Elle disait : "FERMÉ POUR CAUSE D'ENVIE DE DORMIR"
Il serait difficile de traiter sa clientèle avec un plus aimable sans-gêne, vous l'avouerez.
La statistique est une aimable farceuse.
Elle trouve toujours moyen de vous remettre en gaieté par ses chiffres fantaisistes.
C’est ainsi que, l’autre jour, un fort calculateur dévastant l’Éternel s’est avisé de rechercher combien il reste de cannibales sur la surface du Globe.
Et il est arrivé au total respectable de deux millions.
Donc deux millions de créatures, dont l’estomac est conformé de la même façon que le nôtre, trouvent un charme suprême à fourrer dedans des biftecks masculins ou féminins.
Au premier abord, cette affirmation m’a horrifié.
Puis je me suis pris à réfléchir, et, si vous le permettez, je vais vous faire part du résultat de mes réflexions.
Après le sentiment de révolte qui avait été tout spontané, est arrivée cette contrepartie :
— Voyons, voyons… Il ne s’agit pas de faire des manières.
Manger son prochain n’est pas, à coup sûr, une opération sentimentale ; mais n’y a-t-il pas plusieurs façons de le manger ?
La première, la plus simple, est celle qui consiste à faire cuire ses chers frères et les accommoder à des sauces quelconques. C’est l’enfance de l’art.
La civilisation a raffiné tout cela. À présent, il y a cent manières différentes de dévorer autrui. Non, en vérité, jamais on ne s’est entremangé avec appétit plus féroce.
Allez-vous en à une séance au Palais-Bourbon ; c’est là que vous verrez le cannibalisme moderne dans toute sa beauté.
La politique, de toutes ses formes, est de l’anthropophagie ornée sous divers noms plus fallacieux les uns que les autres.
Écoutez parler un homme de lettres d’un de ses chers confrères.
En voilà encore un anthropophage !
Il est vrai que lorsque c’est le leur confère qui a la parole, l’anthropophagie fonctionne en sens contraire.
De même dans le monde des arts.
Et dans le monde de la finance donc, s’entremange-t-on avec assez de fureur !
Sans compter que l’anthropophagie est pratiquée peut-être avec plus d’avidité encore par les femmes que par les hommes.
Il y a sur le pavé de Paris des demoiselles qui ont à elles seules consommé plusieurs douzaines d’adorateurs dont elles n’ont laissé que les os.
Décidément, nous, les prétendus civilisés, nous n’avons pas le droit de chercher querelle au cannibalisme. Nous sommes de la paroisse.
Tiens ! au fait, ce mot me rappelle que j’allais oublier d’autres anthropophages farouches : ceux qui, au nom du fanatisme, se mettent en lambeaux, en hachis.
Cannibales primitifs, qui n’êtes plus que deux millions, je crois décidément qu’on n’a pas gagné au change et que votre vieux jeu était moins odieux, moins abominable que les perfectionnements apportés par le modernisme à vos procédés d’ingurgitation mutuelle.
(Journal Amusant, 4 mars 1899, p.2)
Elle trouve toujours moyen de vous remettre en gaieté par ses chiffres fantaisistes.
C’est ainsi que, l’autre jour, un fort calculateur dévastant l’Éternel s’est avisé de rechercher combien il reste de cannibales sur la surface du Globe.
Et il est arrivé au total respectable de deux millions.
Donc deux millions de créatures, dont l’estomac est conformé de la même façon que le nôtre, trouvent un charme suprême à fourrer dedans des biftecks masculins ou féminins.
Au premier abord, cette affirmation m’a horrifié.
Puis je me suis pris à réfléchir, et, si vous le permettez, je vais vous faire part du résultat de mes réflexions.
Après le sentiment de révolte qui avait été tout spontané, est arrivée cette contrepartie :
— Voyons, voyons… Il ne s’agit pas de faire des manières.
Manger son prochain n’est pas, à coup sûr, une opération sentimentale ; mais n’y a-t-il pas plusieurs façons de le manger ?
La première, la plus simple, est celle qui consiste à faire cuire ses chers frères et les accommoder à des sauces quelconques. C’est l’enfance de l’art.
La civilisation a raffiné tout cela. À présent, il y a cent manières différentes de dévorer autrui. Non, en vérité, jamais on ne s’est entremangé avec appétit plus féroce.
Allez-vous en à une séance au Palais-Bourbon ; c’est là que vous verrez le cannibalisme moderne dans toute sa beauté.
La politique, de toutes ses formes, est de l’anthropophagie ornée sous divers noms plus fallacieux les uns que les autres.
Écoutez parler un homme de lettres d’un de ses chers confrères.
En voilà encore un anthropophage !
Il est vrai que lorsque c’est le leur confère qui a la parole, l’anthropophagie fonctionne en sens contraire.
De même dans le monde des arts.
Et dans le monde de la finance donc, s’entremange-t-on avec assez de fureur !
Sans compter que l’anthropophagie est pratiquée peut-être avec plus d’avidité encore par les femmes que par les hommes.
Il y a sur le pavé de Paris des demoiselles qui ont à elles seules consommé plusieurs douzaines d’adorateurs dont elles n’ont laissé que les os.
Décidément, nous, les prétendus civilisés, nous n’avons pas le droit de chercher querelle au cannibalisme. Nous sommes de la paroisse.
Tiens ! au fait, ce mot me rappelle que j’allais oublier d’autres anthropophages farouches : ceux qui, au nom du fanatisme, se mettent en lambeaux, en hachis.
Cannibales primitifs, qui n’êtes plus que deux millions, je crois décidément qu’on n’a pas gagné au change et que votre vieux jeu était moins odieux, moins abominable que les perfectionnements apportés par le modernisme à vos procédés d’ingurgitation mutuelle.
(Journal Amusant, 4 mars 1899, p.2)
DORÉ (Gustave). — Un vin généreux coulant d’un fût inépuisable. Certains regrettent seulement qu’on n’en mette pas davantage en bouteille.
DUMAS (Fils). — Un merveilleux écrivain qui a le défaut de se guinder parfois. Quand on est grand, on n’a pas besoin de talons.
GAMBETTA. — Un grand homme !…
— Un scélérat !…
C’est entre ces deux extrêmes qu’oscille perpétuellement l’opinion de ce bon peuple français, à propos de tout personnage politique en évidence.
Inutile de dire que Gambetta n’a mérité ni les excès de l’adulation, ni les indignités de la calomnie.
Il y a là une éloquence qui, quand elle n’est pas possédée, possède les autres.
Ils lui reprochent de n’avoir pas terminé la guerre et ils ne se reprochent pas de l’avoir commencée.
Ils l’appellent dictateur borgne.
Mais, si ce borgne a régné, c’est ta faute, Empire des aveugles.
GARIBALDI. — Don Quichotte poussé au sublime.
HAUSSMANN. — Le haut de baron de l’Empire — et par droit de taille et par droit de l’influence.
Les officieux d’antan ont voulu nous faire admirer les embellissements de ce boulevardomane qui nous disait : C’est moi qui régale et c’est vous qui payez !
Pas malin de bien habiller sa femme en lui mangeant sa dot.
HUGO (Victor). — Le Poète-Soleil ! Il réchauffe, il féconde, il éclaire !
DUMAS (Fils). — Un merveilleux écrivain qui a le défaut de se guinder parfois. Quand on est grand, on n’a pas besoin de talons.
GAMBETTA. — Un grand homme !…
— Un scélérat !…
C’est entre ces deux extrêmes qu’oscille perpétuellement l’opinion de ce bon peuple français, à propos de tout personnage politique en évidence.
Inutile de dire que Gambetta n’a mérité ni les excès de l’adulation, ni les indignités de la calomnie.
Il y a là une éloquence qui, quand elle n’est pas possédée, possède les autres.
Ils lui reprochent de n’avoir pas terminé la guerre et ils ne se reprochent pas de l’avoir commencée.
Ils l’appellent dictateur borgne.
Mais, si ce borgne a régné, c’est ta faute, Empire des aveugles.
GARIBALDI. — Don Quichotte poussé au sublime.
HAUSSMANN. — Le haut de baron de l’Empire — et par droit de taille et par droit de l’influence.
Les officieux d’antan ont voulu nous faire admirer les embellissements de ce boulevardomane qui nous disait : C’est moi qui régale et c’est vous qui payez !
Pas malin de bien habiller sa femme en lui mangeant sa dot.
HUGO (Victor). — Le Poète-Soleil ! Il réchauffe, il féconde, il éclaire !
(députés)
Monsieur du couloir.
Autre notabilité.
Celui-là ne fait pas de bruit, mais on assure qu’il fait beaucoup de besogne.
M. Du Couloir est sage comme une image.
Immobile, impassible, ne s’émouvant de rien , ne s’étonnant pas davantage, il n’est pas de ceux qui se donnent en spectacle dans les tumultes.
Pas si sot que de gesticuler, que de s’exclamer, que d’attirer l’attention sur sa personne. Modeste comme la timide violette. Celle-ci se révèle par son parfum, M. Du Couloir se révèle par ses actes.
Mais pas de danger qu’il compromettre les apparences !
Pour lui, la véritable représentation, ce sont les entr’actes.
Tant que dure la séance, il ne bronche pas.
Ecoute-il ? Je n’en sais rien.
Prend-il des notes ? Il se peut.
Sommeille-t-il ? Ce n’est pas improbable.
Cependant quelquefois il tourne imperceptiblement la tête, et on dirait qu’il échange comme un signal avec ses voisin d’à côté ou de derrière.
Avez-vous jamais vu fonctionner le chef de claque de l’Opéra ? C’est un spectacle curieux ! Placé au milieu de ses romains, il n’opère jamais lui-même.
Lorsqu’il s’agit de faire partir les bravos, il frappe seulement un petit coup du bout de canne par terre.
Quand il juge que la salve est suffisante et qu’il faut l’arrêter, il se contente d’appuyer le bout de son doigt au milieu du dos de son sous-chef.
Immédiatement celui-ci fait halte, tous les autres l’imitent.
Quant au chef, pour quiconque ne le regarde pas de tout près, il n’a pas bronché.
Il n’a risqué ni un geste ni un signe.
Tel M. Du Couloir dans sa sérénité imperturbable.
Comme je le disais, pendant toute la durée des séances, il semble complètement désintéressé de ce qui se passe autour de lui.
Bien étendu, jamais vous ne le verrez monter à la tribune.
On s’y découvre peu ou prou, et l’on est forcé d’y laisser percer au moins le petit bout de ses opinions.
Ce n’est pas son affaire.
Jamais non plus il n’interrompt. L’interruption a des éclats périlleux. Elle démasque son homme.
Elle peut l’entraîner au-delà de ce qu’il voudrait.
M. Du Couloir n’est pas un député, c’est une statue.
La statue du Silence.
Et pourtant, ne vous y trompez pas, M. Du Couloir est un des personnages les plus influents de l’Assemblée.
Ce roi ne règne pas, mais il gouverne.
Il laisse à d’autres les vaines satisfactions d’amour-propre.
Il laisse à d’autres le prestige de la mise en scène. Lui travaille dans la coulisse.
Ah ! C’est un curieux spectacle que de le voir à la besogne !
Il arrive un des premiers, car c’est surtout le matin, à l’heure où les commissions fonctionnent, qu’il entre lui-même en plein exercice.
On n’est pas alors gêné par la foule importune et par les regards indiscrets.
Seuls, les députés errent dans les corridors déserts. A la recousse !
M. Du Couloir, quelque peu semblable à l’araignée qui a tendu sa toile, happe successivement ses collègues au passage. Avec quel art il module !
Quelle variété d’attitudes et d’entrées en matière !…
Avec celui-ci il sait que c’est la familiarité qui doit réussir.
Il le prend nonchalamment par le bras, voire même par le cou, avec un sourire bon enfant.
Puis, l’emmenant dans une embrasure, il lui chuchote toutes sortes de choses à l’oreille :
— Bah ! Fait l’autre.
— Oui.
— Vous croyez ?
— Je vous l’affirme.
— C’est différent.
— Convenu alors ?
— Convenu.
C’est tout ce qu’on entend du dialogue, car M. Du Couloir a soin de sombrer tous les passages qui pourraient fournir des indications à un auditeur trop curieux.
Avec cet autre, changement de front. Il sait qu’il a affaire à un trembleur, à un timoré. Du plus loin qu’il l’aperçoit, il prend un air sombre, morne, préoccupé.
Il lui tend avec morbidesse une main défaillante, en ayant l’air d’éviter son regard.
— Ah ! Mon dieu, pense l’autre, il y a donc quelque chose de bine grave ce matin ?
M. Du Couloir, qui devance la question et qui n’a pas lâché la main qu’il tenait, hoche la tête avec recueillement.
On fait quelques pas ainsi. La conversation entame. Quand elle s’achève, le nouveau venu, comme le précédent, la termine par le mot :
— Convenu.
Il changera ainsi de bras et de causeurs trente, quarante, cinquante fois.
De temps en temps, il opère par groupes.
Lui est toujours le centre, le pivot.
De loin vous le verrez faisant sa petite conférence en se tournant circulairement vers chacun des groupés.
Ça, c’est la levée en masse. On la réserve généralement pour les grandes occasions.
Quoi qu’il en soit , ne vous méprenez pas. Ce M. Du Couloir est la vraie puissance de là-bas.
Auteur qui a le courage de garder l’anonyme pour mieux assurer le succès de ses comédies, il est le grand fabricant de scénarios de la majorité.
C’est lui qui mène toutes les intrigues, lui qui prépare tous les dénouements.
Les autres font les gestes, il tient les ficelles.
Le public sait à peine le nom de M. Du Couloir.
Ses électeurs s’étonnent qu’il ne se produise pas plus au grand jour.
Lui prend en pitié leur étonnement. Il a raison.
Pendant que les autres s’agitent, lui mène.
Un maître homme que M. Du Couloir ! Le premier, il a eu assez de sagacité pour comprendre qu’au théâtre parlementaire, souffler est plus que jouer.
Et il souffle… En attendant qu’une ère de liberté vraie et de loyauté politique vienne à son tour souffler sur lui.
Monsieur du couloir.
Autre notabilité.
Celui-là ne fait pas de bruit, mais on assure qu’il fait beaucoup de besogne.
M. Du Couloir est sage comme une image.
Immobile, impassible, ne s’émouvant de rien , ne s’étonnant pas davantage, il n’est pas de ceux qui se donnent en spectacle dans les tumultes.
Pas si sot que de gesticuler, que de s’exclamer, que d’attirer l’attention sur sa personne. Modeste comme la timide violette. Celle-ci se révèle par son parfum, M. Du Couloir se révèle par ses actes.
Mais pas de danger qu’il compromettre les apparences !
Pour lui, la véritable représentation, ce sont les entr’actes.
Tant que dure la séance, il ne bronche pas.
Ecoute-il ? Je n’en sais rien.
Prend-il des notes ? Il se peut.
Sommeille-t-il ? Ce n’est pas improbable.
Cependant quelquefois il tourne imperceptiblement la tête, et on dirait qu’il échange comme un signal avec ses voisin d’à côté ou de derrière.
Avez-vous jamais vu fonctionner le chef de claque de l’Opéra ? C’est un spectacle curieux ! Placé au milieu de ses romains, il n’opère jamais lui-même.
Lorsqu’il s’agit de faire partir les bravos, il frappe seulement un petit coup du bout de canne par terre.
Quand il juge que la salve est suffisante et qu’il faut l’arrêter, il se contente d’appuyer le bout de son doigt au milieu du dos de son sous-chef.
Immédiatement celui-ci fait halte, tous les autres l’imitent.
Quant au chef, pour quiconque ne le regarde pas de tout près, il n’a pas bronché.
Il n’a risqué ni un geste ni un signe.
Tel M. Du Couloir dans sa sérénité imperturbable.
Comme je le disais, pendant toute la durée des séances, il semble complètement désintéressé de ce qui se passe autour de lui.
Bien étendu, jamais vous ne le verrez monter à la tribune.
On s’y découvre peu ou prou, et l’on est forcé d’y laisser percer au moins le petit bout de ses opinions.
Ce n’est pas son affaire.
Jamais non plus il n’interrompt. L’interruption a des éclats périlleux. Elle démasque son homme.
Elle peut l’entraîner au-delà de ce qu’il voudrait.
M. Du Couloir n’est pas un député, c’est une statue.
La statue du Silence.
Et pourtant, ne vous y trompez pas, M. Du Couloir est un des personnages les plus influents de l’Assemblée.
Ce roi ne règne pas, mais il gouverne.
Il laisse à d’autres les vaines satisfactions d’amour-propre.
Il laisse à d’autres le prestige de la mise en scène. Lui travaille dans la coulisse.
Ah ! C’est un curieux spectacle que de le voir à la besogne !
Il arrive un des premiers, car c’est surtout le matin, à l’heure où les commissions fonctionnent, qu’il entre lui-même en plein exercice.
On n’est pas alors gêné par la foule importune et par les regards indiscrets.
Seuls, les députés errent dans les corridors déserts. A la recousse !
M. Du Couloir, quelque peu semblable à l’araignée qui a tendu sa toile, happe successivement ses collègues au passage. Avec quel art il module !
Quelle variété d’attitudes et d’entrées en matière !…
Avec celui-ci il sait que c’est la familiarité qui doit réussir.
Il le prend nonchalamment par le bras, voire même par le cou, avec un sourire bon enfant.
Puis, l’emmenant dans une embrasure, il lui chuchote toutes sortes de choses à l’oreille :
— Bah ! Fait l’autre.
— Oui.
— Vous croyez ?
— Je vous l’affirme.
— C’est différent.
— Convenu alors ?
— Convenu.
C’est tout ce qu’on entend du dialogue, car M. Du Couloir a soin de sombrer tous les passages qui pourraient fournir des indications à un auditeur trop curieux.
Avec cet autre, changement de front. Il sait qu’il a affaire à un trembleur, à un timoré. Du plus loin qu’il l’aperçoit, il prend un air sombre, morne, préoccupé.
Il lui tend avec morbidesse une main défaillante, en ayant l’air d’éviter son regard.
— Ah ! Mon dieu, pense l’autre, il y a donc quelque chose de bine grave ce matin ?
M. Du Couloir, qui devance la question et qui n’a pas lâché la main qu’il tenait, hoche la tête avec recueillement.
On fait quelques pas ainsi. La conversation entame. Quand elle s’achève, le nouveau venu, comme le précédent, la termine par le mot :
— Convenu.
Il changera ainsi de bras et de causeurs trente, quarante, cinquante fois.
De temps en temps, il opère par groupes.
Lui est toujours le centre, le pivot.
De loin vous le verrez faisant sa petite conférence en se tournant circulairement vers chacun des groupés.
Ça, c’est la levée en masse. On la réserve généralement pour les grandes occasions.
Quoi qu’il en soit , ne vous méprenez pas. Ce M. Du Couloir est la vraie puissance de là-bas.
Auteur qui a le courage de garder l’anonyme pour mieux assurer le succès de ses comédies, il est le grand fabricant de scénarios de la majorité.
C’est lui qui mène toutes les intrigues, lui qui prépare tous les dénouements.
Les autres font les gestes, il tient les ficelles.
Le public sait à peine le nom de M. Du Couloir.
Ses électeurs s’étonnent qu’il ne se produise pas plus au grand jour.
Lui prend en pitié leur étonnement. Il a raison.
Pendant que les autres s’agitent, lui mène.
Un maître homme que M. Du Couloir ! Le premier, il a eu assez de sagacité pour comprendre qu’au théâtre parlementaire, souffler est plus que jouer.
Et il souffle… En attendant qu’une ère de liberté vraie et de loyauté politique vienne à son tour souffler sur lui.
Une publicité se pavanant depuis quelques jours, annonce un livre intitulé : « l’art de ne rien oublier. »
L’auteur du système s’imagine sans doute qu’il a fait une belle et féconde découverte.
Quoiqu’il m’en coûte de le détromper, je suis forcé de lui dire que si sa réclame était sincère, il aurait fait là une invention funeste à tous, et digne de malédictions de chacun.
L’art de ne rien oublier ! Mais ce serait là une vie rendue impraticable. Ce serait un martyre de chaque instant.
Qui n’a pas besoin d’oubli dans ce monde ?
Comment survivrait-on, si peu à peu l’oubli ne venait faire sa calmante besogne et endormir tous nos deuils ? Et les amoureux ? Que deviendraient-ils, s’ils ne leur était permis, au contraire, de pratiquer l’art de tout oublier ?
— Tu m’aimes ?
— Oh ! Oui.
— Tu m’aimerais toujours ?
— Toujours !
Si l’oubli réparateur et séparateur n’intervenait pas, comme ils seraient attrapés, ces galériens rivés à leur boulet éternel !
Et nos hommes politiques, grand Dieu ! Que voudriez-vous qu’ils devinssent avec votre art de ne rien oublier, inventeur inexorable ? Il n’est pas un d’entre eux qui n’ait donné des entorses à ses opinions de la veille, à ses serments d’antan.
Mais l’oubli bienfaisant, l’oubli providentiel, fait sa bonne besogne. L’orateur ne se souvient pas. Les auditeurs ne se souviennent pas non plus. Et l’on applaudit quand même.
Est-ce qu’il y aurait une politique possible dans un pays aussi secoué, aussi ballotté, aussi convulsé que le nôtre, si l’art de ne rien oublier était une désolante réalité ?
Où il fait encore sa tâche consciencieusement utile, le cher oubli, c’est en littérature et en art.
De quoi voudriez-vous que vécût le public autrement ? Grâce à l’oubli, merveilleux auxiliaire, le lecteur relit 150 fois, sous 150 titres divers, le même roman feuilleton. Et c’est toujours avec un nouveau plaisir.
Grâce à l’oubli, le monsieur assis dans son fauteuil d’orchestre entend indéfiniment le même drame et la même comédie, réédités par des auteurs naïfs, qui ont apporté avec conviction.
Ainsi du dilettante qui dodeline la tête et se pâme à ce grand air, à cette cavatine, à ce duo.
C’est à l’oubli qu’il doit cette douce pâmoison. Car il ne se rappelle pas que son oreille à déjà rencontré au coin de toutes les partitions ces motifs banalement agréables, qui le bercent si tendrement.
L’art de ne rien oublier ! Quand il n’y a rien de nouveau sous le soleil ! Mais ce serait le plus monstrueux des contresens, la plus illogique des tortures.
Oublions, au contraire ; oublions bien vite. C’est d’oubli qu’est faite notre résignation, c’est d’oubli que sont faits nos plaisirs, c’est d’oubli qu’est fait le pardon. C’est d’oubli qu’est faite l’amitié, qui a toujours à excuser, chez l’ami, quelque trahison volontaire ou involontaire.
Vive l’oubli ! Gardez votre brochure célébrée par les réclames, innovateur mal inspiré. Vive l’oubli !
L’auteur du système s’imagine sans doute qu’il a fait une belle et féconde découverte.
Quoiqu’il m’en coûte de le détromper, je suis forcé de lui dire que si sa réclame était sincère, il aurait fait là une invention funeste à tous, et digne de malédictions de chacun.
L’art de ne rien oublier ! Mais ce serait là une vie rendue impraticable. Ce serait un martyre de chaque instant.
Qui n’a pas besoin d’oubli dans ce monde ?
Comment survivrait-on, si peu à peu l’oubli ne venait faire sa calmante besogne et endormir tous nos deuils ? Et les amoureux ? Que deviendraient-ils, s’ils ne leur était permis, au contraire, de pratiquer l’art de tout oublier ?
— Tu m’aimes ?
— Oh ! Oui.
— Tu m’aimerais toujours ?
— Toujours !
Si l’oubli réparateur et séparateur n’intervenait pas, comme ils seraient attrapés, ces galériens rivés à leur boulet éternel !
Et nos hommes politiques, grand Dieu ! Que voudriez-vous qu’ils devinssent avec votre art de ne rien oublier, inventeur inexorable ? Il n’est pas un d’entre eux qui n’ait donné des entorses à ses opinions de la veille, à ses serments d’antan.
Mais l’oubli bienfaisant, l’oubli providentiel, fait sa bonne besogne. L’orateur ne se souvient pas. Les auditeurs ne se souviennent pas non plus. Et l’on applaudit quand même.
Est-ce qu’il y aurait une politique possible dans un pays aussi secoué, aussi ballotté, aussi convulsé que le nôtre, si l’art de ne rien oublier était une désolante réalité ?
Où il fait encore sa tâche consciencieusement utile, le cher oubli, c’est en littérature et en art.
De quoi voudriez-vous que vécût le public autrement ? Grâce à l’oubli, merveilleux auxiliaire, le lecteur relit 150 fois, sous 150 titres divers, le même roman feuilleton. Et c’est toujours avec un nouveau plaisir.
Grâce à l’oubli, le monsieur assis dans son fauteuil d’orchestre entend indéfiniment le même drame et la même comédie, réédités par des auteurs naïfs, qui ont apporté avec conviction.
Ainsi du dilettante qui dodeline la tête et se pâme à ce grand air, à cette cavatine, à ce duo.
C’est à l’oubli qu’il doit cette douce pâmoison. Car il ne se rappelle pas que son oreille à déjà rencontré au coin de toutes les partitions ces motifs banalement agréables, qui le bercent si tendrement.
L’art de ne rien oublier ! Quand il n’y a rien de nouveau sous le soleil ! Mais ce serait le plus monstrueux des contresens, la plus illogique des tortures.
Oublions, au contraire ; oublions bien vite. C’est d’oubli qu’est faite notre résignation, c’est d’oubli que sont faits nos plaisirs, c’est d’oubli qu’est fait le pardon. C’est d’oubli qu’est faite l’amitié, qui a toujours à excuser, chez l’ami, quelque trahison volontaire ou involontaire.
Vive l’oubli ! Gardez votre brochure célébrée par les réclames, innovateur mal inspiré. Vive l’oubli !
Nous y voila.
On a recommandé à parler comme de plus belle de candidatures académiques.
C’est là une des distractions favorites du français, né malin.
Lorsque mes concitoyens commencent à s’ennuyer, et qu’ils ne savent sur quel sujet de conversation exécuter des variations fantaisistes, ils dissertent sur la valeur des candidats à l’Académie.
J’ai appris par la renommée, dont la trompette sert là à un bien drôle d’usage, que plusieurs messieurs, dont la notoriété n’a guère franchi les murailles de la classe où ils professent, ont écrit à l’Académie pour solliciter le vote des immortels qui survivent pour le quart d’heure.
C’est plus fort que moi, jamais, au grand jamais, je ne pourrai me faire à ces procédés-là.
Que peuvent-elles bien contenir, ces lettres prodigieuses dans lesquelles on vient ainsi briguer le suffrage des gens ?
Je ne vois que deux formules.
La première, celle de la modestie hypocrite, s’exprimant ainsi :
« Messieurs les académiciens,
Je n’ai aucun titre à l’honneur que je viens solliciter de vous.
Mes oeuvres sont d’une platitude révoltante.
Mon style est hérissé de fautes de français. J’ai pris un peu partout les sujets que j’ai traités.
Bref, mon indignité est absolue.
Mais je sais que vous possédez des trésors d’indulgence, c’est ce qui m’enhardit à venir solliciter de vous le fauteuil laissé vacant.
J’ose espérer, Messieurs, que, fidèles à vos habitudes, vous ne me refuserez pas une faveur que je ne mérite en rien.
Et d’avance, je vous prie d’agréer les sincères remerciements de votre très-obligé. »
Vous conviendrez que cette façon de protéger l’immortalité à la tire est souverainement grotesque, et que les académiciens qui reçoivent de pareilles missives doivent se sentir profondément humiliés.
Mais ce qui me semble encore plus drolatique, c’est la formule n°2, qui doit être ainsi conçue :
« Messieurs les Académiciens,
Je ne ferai pas de fausse modestie avec vous.
Je sais que je je suis un grand homme.
J’écris avec une pureté idéale. Ma pensée dépasse en élévation celle des plus grands génies connus.
Je brillerai au milieu de vous comme un phare, et l’honneur qui rejaillira de ma nomination sur le docte corps auquel vous appartenez sera incomparable.
En conséquence, Messieurs, je n’insiste pas ; ce serait vous faire injure.
Vous ne pouvez songer à repousser un homme tel que moi.
Si vous le faisiez, vous vous prépareriez des remords éternels.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, mes salutations empressées. »
Vous touchez du doigt, par ces spécimens, tout ce qu’il y a d’inepte dans l’usage qui oblige les candidats à se mettre d’eux-mêmes en avant.
C’est là une routine sotte contre laquelle protestent le bon sens et le bon goût.
On l’a dit et redit.
Cependant la vieille habitude persiste.
Pour ceux qui n’ont aucune valeur, cette mendicité à domicile qu’on appelle les visites académiques, peut encore s’admettre.
Mais qu’un homme de mérite aille de porte en porte le chapeau à la main, murmurant du ton du petit Savoyard qui demande un sou :
« un petit fauteuil, s’il vous plaît… »
Sans compter que le public ne se doute pas des rebuffades que souvent essuient les quémandeurs de palmes vertes.
Certains académiciens tels que Sainte-Beuve, Villemain, et d’autres, étaient célèbres par leur rebuffades quand ils avaient affaire à quelqu’un dont ils ne partageaient pas les tendances.
Le plus bel exemple dans ce genre remonte à la querelle des classiques et des romantiques.
L’intraitable Etienne de Jouy, défenseur acharné des vieilles doctrines, aperçoit par sa fenêtre un écrivain de la nouvelle-école qui entrait dans sa maison.
Persuadé que celui-ci vient solliciter sa voix pour l’Académie, il se précipite sur le palier, et d’en haut lui crie :
« Vous savez, ce n’est pas la peine de monter. »
Le plus drôle de l’aventure, c’est que l’autre venait tout simplement voir un de ses amis qui demeurait à l’étage au-dessous...
(Article Journal Amusant - 23 août 1873)
On a recommandé à parler comme de plus belle de candidatures académiques.
C’est là une des distractions favorites du français, né malin.
Lorsque mes concitoyens commencent à s’ennuyer, et qu’ils ne savent sur quel sujet de conversation exécuter des variations fantaisistes, ils dissertent sur la valeur des candidats à l’Académie.
J’ai appris par la renommée, dont la trompette sert là à un bien drôle d’usage, que plusieurs messieurs, dont la notoriété n’a guère franchi les murailles de la classe où ils professent, ont écrit à l’Académie pour solliciter le vote des immortels qui survivent pour le quart d’heure.
C’est plus fort que moi, jamais, au grand jamais, je ne pourrai me faire à ces procédés-là.
Que peuvent-elles bien contenir, ces lettres prodigieuses dans lesquelles on vient ainsi briguer le suffrage des gens ?
Je ne vois que deux formules.
La première, celle de la modestie hypocrite, s’exprimant ainsi :
« Messieurs les académiciens,
Je n’ai aucun titre à l’honneur que je viens solliciter de vous.
Mes oeuvres sont d’une platitude révoltante.
Mon style est hérissé de fautes de français. J’ai pris un peu partout les sujets que j’ai traités.
Bref, mon indignité est absolue.
Mais je sais que vous possédez des trésors d’indulgence, c’est ce qui m’enhardit à venir solliciter de vous le fauteuil laissé vacant.
J’ose espérer, Messieurs, que, fidèles à vos habitudes, vous ne me refuserez pas une faveur que je ne mérite en rien.
Et d’avance, je vous prie d’agréer les sincères remerciements de votre très-obligé. »
Vous conviendrez que cette façon de protéger l’immortalité à la tire est souverainement grotesque, et que les académiciens qui reçoivent de pareilles missives doivent se sentir profondément humiliés.
Mais ce qui me semble encore plus drolatique, c’est la formule n°2, qui doit être ainsi conçue :
« Messieurs les Académiciens,
Je ne ferai pas de fausse modestie avec vous.
Je sais que je je suis un grand homme.
J’écris avec une pureté idéale. Ma pensée dépasse en élévation celle des plus grands génies connus.
Je brillerai au milieu de vous comme un phare, et l’honneur qui rejaillira de ma nomination sur le docte corps auquel vous appartenez sera incomparable.
En conséquence, Messieurs, je n’insiste pas ; ce serait vous faire injure.
Vous ne pouvez songer à repousser un homme tel que moi.
Si vous le faisiez, vous vous prépareriez des remords éternels.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, mes salutations empressées. »
Vous touchez du doigt, par ces spécimens, tout ce qu’il y a d’inepte dans l’usage qui oblige les candidats à se mettre d’eux-mêmes en avant.
C’est là une routine sotte contre laquelle protestent le bon sens et le bon goût.
On l’a dit et redit.
Cependant la vieille habitude persiste.
Pour ceux qui n’ont aucune valeur, cette mendicité à domicile qu’on appelle les visites académiques, peut encore s’admettre.
Mais qu’un homme de mérite aille de porte en porte le chapeau à la main, murmurant du ton du petit Savoyard qui demande un sou :
« un petit fauteuil, s’il vous plaît… »
Sans compter que le public ne se doute pas des rebuffades que souvent essuient les quémandeurs de palmes vertes.
Certains académiciens tels que Sainte-Beuve, Villemain, et d’autres, étaient célèbres par leur rebuffades quand ils avaient affaire à quelqu’un dont ils ne partageaient pas les tendances.
Le plus bel exemple dans ce genre remonte à la querelle des classiques et des romantiques.
L’intraitable Etienne de Jouy, défenseur acharné des vieilles doctrines, aperçoit par sa fenêtre un écrivain de la nouvelle-école qui entrait dans sa maison.
Persuadé que celui-ci vient solliciter sa voix pour l’Académie, il se précipite sur le palier, et d’en haut lui crie :
« Vous savez, ce n’est pas la peine de monter. »
Le plus drôle de l’aventure, c’est que l’autre venait tout simplement voir un de ses amis qui demeurait à l’étage au-dessous...
(Article Journal Amusant - 23 août 1873)
Petites fleurs qui sans culture
Aviez grandi dans la forêt,
Et que la main de la nature
venait féconder en secret ;
Vous qui de la saison nouvelle
Nous annonciez le cher retour,
Que la brise du bout de l'aile
Venait frôler avec amour ;
Quand, dans mes champêtres maraudes,
Je vous trouvai près du chemin
Où sur un tapis d'émeraudes
Brillaient vos robes de carmin,
Tout orgueilleux de ma conquête,
Je me mis à faire un bouquet,
Voyant d'avance ma chambrette,
Grâce à vous, prendre un air coquet,
Mais voici qu'à peine arrachées
A votre cher gazon natal,
Sur votre tige desséchées
Vous languissez dans le cristal ;
Déjà vos têtes délicates
Se penchent, vous semblez souffrir ;
Je vous aimais pourtant, ingrates ;
Pourquoi si tôt vouloir mourir ?
Chez moi vous n'auriez, je vous jure,
Jamais eu rien à désirer,
Et dans une belle eau bien pure
Vous auriez pu vous admirer ;
Vous eussiez été souveraines
Et maitresses de mon logis ;
Poète et fleurs avaient, vilaines,
Été jusqu'Ici bons amis !
Mais non I... Pour que vous puissiez vivre
Il vous faut un lit de gazon
Dont le frais parfum vous enivre,
il vous faut un coin d'horizon ;
Il vous faut la bonne visite
Du soleil venant se bercer
Dans le calice qui l'invite
Et qui se laisse caresser ;
Il faut à vos belles corolles
Le doux baiser des papillons,
Et leurs jeux tendres et frivoles,
Et le cri joyeux des grillons ;
Il vous faut la foule mutine
De mille insectes amoureux,
il vous faut sous chaque étamine
Loger un hôte bienheureux ;
Il vous faut le plaintif murmure
De l'eau coulant à petit bruit
Et promenant à l'aventure
Son mince filet qui s'enfuit ;
Il vous faut la chanson aimée
De vos oiseaux mélodieux
Venant redire à la ramée
Des refrains appris dans les cieux ;
Il vous faut, quand avec ses voiles
La nuit prend son manteau flottant,
Le regard tremblant des étoiles
Auxquelles vous ressemblez tant ;
Il vous faut la lumière blanche
De la lime aux rayons d'argent,
Sur votre tête qui se penche
Promenant son disque changeant ;
Il vous faut, quand toute rosée
Sourit l'aurore au bout du ciel,
Les pleurs féconds de la rosée
Qui deviendront gouttes de miel ;
Il vous faut enfin la nature,
La terre, l'eau, l'air et le feu ;
Il faut à toute créature
Sa part dans les présents de Dieu !
Si vous êtes, ô mes fleurettes,
Mortes si tôt dans ma maison,
C'est qu'à la fois pour vous, pauvrettes,
C'était l'exil et la prison ;
C'est qu'ici-bas tout a sa vie,
Mais aussi tout a ses douleurs ;
Que mortelle est là nostalgie
Pour les hommes et pour les fleurs !
Aviez grandi dans la forêt,
Et que la main de la nature
venait féconder en secret ;
Vous qui de la saison nouvelle
Nous annonciez le cher retour,
Que la brise du bout de l'aile
Venait frôler avec amour ;
Quand, dans mes champêtres maraudes,
Je vous trouvai près du chemin
Où sur un tapis d'émeraudes
Brillaient vos robes de carmin,
Tout orgueilleux de ma conquête,
Je me mis à faire un bouquet,
Voyant d'avance ma chambrette,
Grâce à vous, prendre un air coquet,
Mais voici qu'à peine arrachées
A votre cher gazon natal,
Sur votre tige desséchées
Vous languissez dans le cristal ;
Déjà vos têtes délicates
Se penchent, vous semblez souffrir ;
Je vous aimais pourtant, ingrates ;
Pourquoi si tôt vouloir mourir ?
Chez moi vous n'auriez, je vous jure,
Jamais eu rien à désirer,
Et dans une belle eau bien pure
Vous auriez pu vous admirer ;
Vous eussiez été souveraines
Et maitresses de mon logis ;
Poète et fleurs avaient, vilaines,
Été jusqu'Ici bons amis !
Mais non I... Pour que vous puissiez vivre
Il vous faut un lit de gazon
Dont le frais parfum vous enivre,
il vous faut un coin d'horizon ;
Il vous faut la bonne visite
Du soleil venant se bercer
Dans le calice qui l'invite
Et qui se laisse caresser ;
Il faut à vos belles corolles
Le doux baiser des papillons,
Et leurs jeux tendres et frivoles,
Et le cri joyeux des grillons ;
Il vous faut la foule mutine
De mille insectes amoureux,
il vous faut sous chaque étamine
Loger un hôte bienheureux ;
Il vous faut le plaintif murmure
De l'eau coulant à petit bruit
Et promenant à l'aventure
Son mince filet qui s'enfuit ;
Il vous faut la chanson aimée
De vos oiseaux mélodieux
Venant redire à la ramée
Des refrains appris dans les cieux ;
Il vous faut, quand avec ses voiles
La nuit prend son manteau flottant,
Le regard tremblant des étoiles
Auxquelles vous ressemblez tant ;
Il vous faut la lumière blanche
De la lime aux rayons d'argent,
Sur votre tête qui se penche
Promenant son disque changeant ;
Il vous faut, quand toute rosée
Sourit l'aurore au bout du ciel,
Les pleurs féconds de la rosée
Qui deviendront gouttes de miel ;
Il vous faut enfin la nature,
La terre, l'eau, l'air et le feu ;
Il faut à toute créature
Sa part dans les présents de Dieu !
Si vous êtes, ô mes fleurettes,
Mortes si tôt dans ma maison,
C'est qu'à la fois pour vous, pauvrettes,
C'était l'exil et la prison ;
C'est qu'ici-bas tout a sa vie,
Mais aussi tout a ses douleurs ;
Que mortelle est là nostalgie
Pour les hommes et pour les fleurs !
Ce jour-là, paraissait à l’Officiel la déclaration de guerre à la Prusse.
On ne sait que trop, hélas ! Par quelles péripéties lamentables devait passer cette odieuse campagne, entreprise avec une si criminelle témérité.
Durantin avait suivi toutes les phases de la lutte avec une anxiété fiévreuse.
Secondment parce qu’il était patriote, mais premièrement parce qu’il était devenu propriétaire.
Au milieu de septembre, il n’y eut plus d’illusions à se faire, l’ennemi approchait, l’ennemi était arrivé.
On signalait sa présence à dix lieues, à huit lieus, à six lieurs.
Quand on fut tout à fait la vieille de l’investissement, Durantin frappa le sol au pied :
— Eh bien ! Non, je m’en irai pas. Eh bien ! Non, je n’aurai pas peur d’eux… Je resterai, quoi qu’il arrive, et si Clamart ne recèle qu’un Français dans son sein, ce sera moi… Quitter ma maison… Ma maison !… Ma maison !…
Ce disant, sa voix suivait un crescendo qu’aucune musique ne pouvait noter. C’était de la tendresse et du désespoir, de la douleur et de l’amour… un drame lyrique dans un cri…
Il en avait douze à loger.
Douze Bavarois du septième régiment :
— Vin… Vin… !
Ce fut le premier mot de la conversation.
Les trois pièces de Bordeaux que Durantin avait fait venir n’étaient plus qu’un souvenir à la fin de la semaine.
Vous connaissez par coeur cette sinistre histoire là. Un matin, Durantin rentra chez lui, trouva ses Bavarois, qui, avec la pointe de leurs sabres, enlevaient les parquets. Ses parquets !
— Sacrebleu ! Lieutenant. Le lieutenant se retourna d’un air qui coupa la parole au malheureux.
Le lendemain, à son réveil, ses Bavarois abattaient les cloisons.
— Mais je vous en supplie… Mon dieu, mon Dieu !
Le troisième jour ils fendaient les persiennes pour allumer le feu ; le quatrième jour on commença le déménagement par les pendules.
Pauvre Durantin ! Il avait été si heureux de trouver une occasion pareille : une maison toute meublée !
A la fin, il perdit patience, et s’en fut trouver un général.
— Général, il se passe des choses…
— En effet, monsieur, interrompit le général brusquement, il se passe, comme vous dites, des choses que je suis décidé à ne pas tolérer plus longtemps.
— a la bonne heure, général, je savais bien…
— Vous devriez, en effet, vous douter que, tôt ou tard, nous nous apercevrions du joli métier que vous faites.
— Moi ?
— N’essayez pas de feindre, vous êtes un espion français.
— Un espion ?…
— Es-ce que, sans cela, vous seriez resté ici quand toute la population est partie ?
Durantin répondit je ne sais quoi, le général fit un signe ; on l’empoigna et on le fouilla.
Dans sa poche, il avait écrit en abréviation toutes les notes relatives aux embellissements qu’il projetait.
— Voilà une preuve, s’écria le général triomphant, qu’on l’emmène au bout de son jardin, et…
Il compéta sa pensée par un geste significatif.
Cinq minutes après, il était à genoux, deux canons de pistolet sur les tempes.
Le général qui finit par comprendre les hiéroglyphes du pauvre homme, eut, par hasard, un accès d’humanité.
Son aide de camp intervint au moment même où l’on allait lâcher la détente.
A dater de ce jour, il fut interdit à Durantin de mettre le pied dehors.
D’ailleurs, le bombardement venait de commencer de part et d’autre.
Il vécut sept semaines dans sa cave, rampant pour aller chercher sa nourriture.
Et quelle nourriture !
Quelques pommes de terre, plus ou moins crues, du pain, plus ou moins noir.
Quelle drôle de villégiature !
Tout à une fin. Celle-là fut lugubre, mais c’était toujours une fin.
L’armistice fut signé, les Prussiens évacuèrent, Durantin respira.
D’abord, ses Bavarois n’avaient pas découvert un certain petit caveau où il avait muré tout ce qu’il avait de plus précieux ; ensuite il avait trouvé deux ou trois de ses meubles dans les plaines des environs. Il faut être philosophe.
Avec des réparations et de la patience, il n’y paraîtrait plus. Il se remit aussitôt à la tâche, repeignant, volant des papiers, nettoyant, ratissant.
Dame ! Ne s’agissait-il pas de ressusciter sa maison, sa chère maison !
Le 17 mars, le printemps aidant, cela vous avait déjà un petit air. On sait ce qui survint le 18 (en 1871)
Durantin jura une seconde fois de ne pas lâcher pied ; une seconde fois il tint parole.
La villa de Durantin se trouvait placée dans cette situation bizarre, qu’elle était à moitié chemin du fort de Vanves et des batteries versaillaises.
Les obus avaient l’air d’y siffler :
Les rendez-vous de noble compagnie.
Se donnent tous en ce charmant séjour.
Il fallut redescendre à la cave.
Une nuit, on heurta à la porte à grands coups de crosse.
Ah ! Mon Dieu ! Qu’y avait-il encore ?
— La cambuse n’est donc pas habitée ? Tonnait une voix enrouée et avinée, enfonçons la porte !
Une porte que Durantin avait fait replacer quinze jours avant. Tout en chêne, monsieur, avec des ornements de cuivre !
Il s’élança, hors de sa cachette et ouvrit.
— Ah ! Ah ! Le hibou se montre, empoignons-le.
— Mais…
— C’est un gendarme déguisé.
— Un roussin.
— A mort !
— Messieurs…
— Il nous appelle : Messieurs ! Tu vas te taire, vieux gredin ; ton affaire est bonne.
— Citoyens, c’est ma propriété !
— Il parle de propriété !
— A mort… A mort !…
On emmena Durantin, non sans avoir au préalable pillé sous ses yeux tout ce qui restait.
— le commandement du fort décidera de lui, avait dit le chef de la reconnaissance communarde.
Heureusement, d’une part, le vin coucha en route la moitié de ses gardiens ; d’autre part, la seconde moitié fut mise en fuite par un obus qui éclata dans le tas.
A la faveur du désordre, Durantin regagne à quatre pattes sa maison infortunée où il tomba à moitié mort.
Le surlendemain, dès l’aube, de nouveaux coups de crosse ébranlent la porte.
Les communaux qui reviennent !
Cette fois Durantin n’y tient plus.
Il gagne le fond du jardin, escalade un mur mitoyen.
— En voilà un qui s’évade, crie une voix, tirons dessus !
C’était la voix d’un soldat de Versailles, car l’armée allait prendre le fort de Vanves.
Une décharge cassa la jambe à l’ami des champs qui dégringola de son mur.
Il en eut pour trois mois d’hôpital ou plutôt d’ambulance ; car on l’avait emmené à Satory où il était gardé à vue.
Il guérit enfin, et, son innocence proclamée, il fut rendu à la liberté.
Dimanche dernier, le coeur ému, soupirant comme après un effroyable cauchemar, il descendait à ce qui fut la gare de Clamart avant d’être devenue un monceau de ruines.
De loin, sur la route, il découvrit sa maison.
C’était bien elle ! Deux ou trois bombes lui avaient ouvert des jour inattendus ; mais, bast ! Tout se répare.
N’avait-on pas recollé la jambe à Durantin ? Une ère d’ordre et de tranquillité s’ouvrait, il lui restait quelques écus.
Enfin, il allait pouvoir vivre en campagnard.
Quand il entra, il faillit s’évanouir de joie d’abord, d’étonnement ensuite.
Trois inconnus étaient là prenant des mesures.
— Messieurs, cette maison est à moi.
— En ce cas, Monsieur, nous sommes désolés de ce que nous allons vous apprendre… nous sommes officiers du génie ; cet immeuble a jadis été construit dans la zone militaire du fort, on a eu le tort d’en négliger la démolition avant le siège… des ordres vont être donnés pour qu’on y procède immédiatement… Vous savez que c’est le droit de l’État et qu’il ne doit aucune indemnité.
Durantin perdit connaissance.
On peut voir en ce moment à Charenton un pensionnaire qui, du matin au soir, reste assis dans une allée, accumulant des petits tas de sable en répétant avec un rire sinistre :
— encore un étage de plus à ma maison, comme elle sera belle !… Celle-là du moins, on ne la démolira pas !...
(Nouvelle que Pierre Véron a publiée dans le journal « Le monde illustré » du 22 juillet 1871 en précisant « histoire vraie » et recopié dans cet ouvrage, mais je n’ai pas vu d’autres sources à ce sujet dans d'autres journaux)
On ne sait que trop, hélas ! Par quelles péripéties lamentables devait passer cette odieuse campagne, entreprise avec une si criminelle témérité.
Durantin avait suivi toutes les phases de la lutte avec une anxiété fiévreuse.
Secondment parce qu’il était patriote, mais premièrement parce qu’il était devenu propriétaire.
Au milieu de septembre, il n’y eut plus d’illusions à se faire, l’ennemi approchait, l’ennemi était arrivé.
On signalait sa présence à dix lieues, à huit lieus, à six lieurs.
Quand on fut tout à fait la vieille de l’investissement, Durantin frappa le sol au pied :
— Eh bien ! Non, je m’en irai pas. Eh bien ! Non, je n’aurai pas peur d’eux… Je resterai, quoi qu’il arrive, et si Clamart ne recèle qu’un Français dans son sein, ce sera moi… Quitter ma maison… Ma maison !… Ma maison !…
Ce disant, sa voix suivait un crescendo qu’aucune musique ne pouvait noter. C’était de la tendresse et du désespoir, de la douleur et de l’amour… un drame lyrique dans un cri…
Il en avait douze à loger.
Douze Bavarois du septième régiment :
— Vin… Vin… !
Ce fut le premier mot de la conversation.
Les trois pièces de Bordeaux que Durantin avait fait venir n’étaient plus qu’un souvenir à la fin de la semaine.
Vous connaissez par coeur cette sinistre histoire là. Un matin, Durantin rentra chez lui, trouva ses Bavarois, qui, avec la pointe de leurs sabres, enlevaient les parquets. Ses parquets !
— Sacrebleu ! Lieutenant. Le lieutenant se retourna d’un air qui coupa la parole au malheureux.
Le lendemain, à son réveil, ses Bavarois abattaient les cloisons.
— Mais je vous en supplie… Mon dieu, mon Dieu !
Le troisième jour ils fendaient les persiennes pour allumer le feu ; le quatrième jour on commença le déménagement par les pendules.
Pauvre Durantin ! Il avait été si heureux de trouver une occasion pareille : une maison toute meublée !
A la fin, il perdit patience, et s’en fut trouver un général.
— Général, il se passe des choses…
— En effet, monsieur, interrompit le général brusquement, il se passe, comme vous dites, des choses que je suis décidé à ne pas tolérer plus longtemps.
— a la bonne heure, général, je savais bien…
— Vous devriez, en effet, vous douter que, tôt ou tard, nous nous apercevrions du joli métier que vous faites.
— Moi ?
— N’essayez pas de feindre, vous êtes un espion français.
— Un espion ?…
— Es-ce que, sans cela, vous seriez resté ici quand toute la population est partie ?
Durantin répondit je ne sais quoi, le général fit un signe ; on l’empoigna et on le fouilla.
Dans sa poche, il avait écrit en abréviation toutes les notes relatives aux embellissements qu’il projetait.
— Voilà une preuve, s’écria le général triomphant, qu’on l’emmène au bout de son jardin, et…
Il compéta sa pensée par un geste significatif.
Cinq minutes après, il était à genoux, deux canons de pistolet sur les tempes.
Le général qui finit par comprendre les hiéroglyphes du pauvre homme, eut, par hasard, un accès d’humanité.
Son aide de camp intervint au moment même où l’on allait lâcher la détente.
A dater de ce jour, il fut interdit à Durantin de mettre le pied dehors.
D’ailleurs, le bombardement venait de commencer de part et d’autre.
Il vécut sept semaines dans sa cave, rampant pour aller chercher sa nourriture.
Et quelle nourriture !
Quelques pommes de terre, plus ou moins crues, du pain, plus ou moins noir.
Quelle drôle de villégiature !
Tout à une fin. Celle-là fut lugubre, mais c’était toujours une fin.
L’armistice fut signé, les Prussiens évacuèrent, Durantin respira.
D’abord, ses Bavarois n’avaient pas découvert un certain petit caveau où il avait muré tout ce qu’il avait de plus précieux ; ensuite il avait trouvé deux ou trois de ses meubles dans les plaines des environs. Il faut être philosophe.
Avec des réparations et de la patience, il n’y paraîtrait plus. Il se remit aussitôt à la tâche, repeignant, volant des papiers, nettoyant, ratissant.
Dame ! Ne s’agissait-il pas de ressusciter sa maison, sa chère maison !
Le 17 mars, le printemps aidant, cela vous avait déjà un petit air. On sait ce qui survint le 18 (en 1871)
Durantin jura une seconde fois de ne pas lâcher pied ; une seconde fois il tint parole.
La villa de Durantin se trouvait placée dans cette situation bizarre, qu’elle était à moitié chemin du fort de Vanves et des batteries versaillaises.
Les obus avaient l’air d’y siffler :
Les rendez-vous de noble compagnie.
Se donnent tous en ce charmant séjour.
Il fallut redescendre à la cave.
Une nuit, on heurta à la porte à grands coups de crosse.
Ah ! Mon Dieu ! Qu’y avait-il encore ?
— La cambuse n’est donc pas habitée ? Tonnait une voix enrouée et avinée, enfonçons la porte !
Une porte que Durantin avait fait replacer quinze jours avant. Tout en chêne, monsieur, avec des ornements de cuivre !
Il s’élança, hors de sa cachette et ouvrit.
— Ah ! Ah ! Le hibou se montre, empoignons-le.
— Mais…
— C’est un gendarme déguisé.
— Un roussin.
— A mort !
— Messieurs…
— Il nous appelle : Messieurs ! Tu vas te taire, vieux gredin ; ton affaire est bonne.
— Citoyens, c’est ma propriété !
— Il parle de propriété !
— A mort… A mort !…
On emmena Durantin, non sans avoir au préalable pillé sous ses yeux tout ce qui restait.
— le commandement du fort décidera de lui, avait dit le chef de la reconnaissance communarde.
Heureusement, d’une part, le vin coucha en route la moitié de ses gardiens ; d’autre part, la seconde moitié fut mise en fuite par un obus qui éclata dans le tas.
A la faveur du désordre, Durantin regagne à quatre pattes sa maison infortunée où il tomba à moitié mort.
Le surlendemain, dès l’aube, de nouveaux coups de crosse ébranlent la porte.
Les communaux qui reviennent !
Cette fois Durantin n’y tient plus.
Il gagne le fond du jardin, escalade un mur mitoyen.
— En voilà un qui s’évade, crie une voix, tirons dessus !
C’était la voix d’un soldat de Versailles, car l’armée allait prendre le fort de Vanves.
Une décharge cassa la jambe à l’ami des champs qui dégringola de son mur.
Il en eut pour trois mois d’hôpital ou plutôt d’ambulance ; car on l’avait emmené à Satory où il était gardé à vue.
Il guérit enfin, et, son innocence proclamée, il fut rendu à la liberté.
Dimanche dernier, le coeur ému, soupirant comme après un effroyable cauchemar, il descendait à ce qui fut la gare de Clamart avant d’être devenue un monceau de ruines.
De loin, sur la route, il découvrit sa maison.
C’était bien elle ! Deux ou trois bombes lui avaient ouvert des jour inattendus ; mais, bast ! Tout se répare.
N’avait-on pas recollé la jambe à Durantin ? Une ère d’ordre et de tranquillité s’ouvrait, il lui restait quelques écus.
Enfin, il allait pouvoir vivre en campagnard.
Quand il entra, il faillit s’évanouir de joie d’abord, d’étonnement ensuite.
Trois inconnus étaient là prenant des mesures.
— Messieurs, cette maison est à moi.
— En ce cas, Monsieur, nous sommes désolés de ce que nous allons vous apprendre… nous sommes officiers du génie ; cet immeuble a jadis été construit dans la zone militaire du fort, on a eu le tort d’en négliger la démolition avant le siège… des ordres vont être donnés pour qu’on y procède immédiatement… Vous savez que c’est le droit de l’État et qu’il ne doit aucune indemnité.
Durantin perdit connaissance.
On peut voir en ce moment à Charenton un pensionnaire qui, du matin au soir, reste assis dans une allée, accumulant des petits tas de sable en répétant avec un rire sinistre :
— encore un étage de plus à ma maison, comme elle sera belle !… Celle-là du moins, on ne la démolira pas !...
(Nouvelle que Pierre Véron a publiée dans le journal « Le monde illustré » du 22 juillet 1871 en précisant « histoire vraie » et recopié dans cet ouvrage, mais je n’ai pas vu d’autres sources à ce sujet dans d'autres journaux)
La voilà revenue, cette période qui, sous des noms divers, n’est en réalité que Sainte-Gastrite.
Le boudin de Noël commence, les marrons glacés continuent, la galette des rois s’achève.
La tradition réveillonnante me paraît absurde, d’abord parce qu’elle est une tradition. Pas plus que je n’admets qu’on pleure à date fixe les morts qu’on a perdus, et que la Toussaint soit le rendez-vous des regrets, je ne saurais comprendre qu’il y ait pour l’indigestion en choeur une nuit consacrée où l’on se grise par ordre.
Ce qui peut faire le charme d’un souper, c’est l’imprévu, c’est l’improvisation.
On se rencontre à quelques-uns dans une soirée, au théâtre, n’importe où. On se dit :
- Tiens, je souperais bien aujourd’hui.
- Moi aussi.
Là dessus on part ensemble, on décoiffe quelques vieilles bouteilles, on laisse la gaieté aller à la dérive, et le plaisir vient sans qu’on ait pensé.
Mais s’entraîner d’avance pour l’amusement comme un cheval s’entraîne pour la course, non, jamais !
Je ne me représente pas le monsieur qui, invité à réveillonner sur le coup de minuit, reste chez lui toute la soirée, en habit noir, assis devant sa pendule, en pensant :
Encore deux heures et demie avant que je déchaîne ma folle gaieté ! Plus que trois quarts d’heure pour être étourdissant de drôlerie… Ah ! Moins vingt, essayons notre premier sourire.
Mais que voulez-vous ! C’est surtout pour le Parisien que l’habitude est une seconde nature. Chacun, au sortir d’un réveillon, se dit :
- Mon Dieu, que c’est bête ! Ai-je assez mal au coeur, me suis-je assez éreinté pour rien !
Et la fois suivante on recommence comme de plus belle.
Nous l’avons bien vu pendant le siège (1870-71), hélas !
La population décimée par les privations et les épidémies, écrasée par le désespoir, brisée par les émotions de toute sorte, sachant que l’on courait à une épouvantable catastrophe couronnant d’épouvantables deuils, la population n’en voulut pas moins réveillonner à tâtons avec des côtelettes de chien, des confitures d’os pilés et des andouillettes de rat.
Espérez donc ensuite convertir ces routiniers de l’estomac !
(Article du Journal Amusant, 22 décembre 1877)
Le boudin de Noël commence, les marrons glacés continuent, la galette des rois s’achève.
La tradition réveillonnante me paraît absurde, d’abord parce qu’elle est une tradition. Pas plus que je n’admets qu’on pleure à date fixe les morts qu’on a perdus, et que la Toussaint soit le rendez-vous des regrets, je ne saurais comprendre qu’il y ait pour l’indigestion en choeur une nuit consacrée où l’on se grise par ordre.
Ce qui peut faire le charme d’un souper, c’est l’imprévu, c’est l’improvisation.
On se rencontre à quelques-uns dans une soirée, au théâtre, n’importe où. On se dit :
- Tiens, je souperais bien aujourd’hui.
- Moi aussi.
Là dessus on part ensemble, on décoiffe quelques vieilles bouteilles, on laisse la gaieté aller à la dérive, et le plaisir vient sans qu’on ait pensé.
Mais s’entraîner d’avance pour l’amusement comme un cheval s’entraîne pour la course, non, jamais !
Je ne me représente pas le monsieur qui, invité à réveillonner sur le coup de minuit, reste chez lui toute la soirée, en habit noir, assis devant sa pendule, en pensant :
Encore deux heures et demie avant que je déchaîne ma folle gaieté ! Plus que trois quarts d’heure pour être étourdissant de drôlerie… Ah ! Moins vingt, essayons notre premier sourire.
Mais que voulez-vous ! C’est surtout pour le Parisien que l’habitude est une seconde nature. Chacun, au sortir d’un réveillon, se dit :
- Mon Dieu, que c’est bête ! Ai-je assez mal au coeur, me suis-je assez éreinté pour rien !
Et la fois suivante on recommence comme de plus belle.
Nous l’avons bien vu pendant le siège (1870-71), hélas !
La population décimée par les privations et les épidémies, écrasée par le désespoir, brisée par les émotions de toute sorte, sachant que l’on courait à une épouvantable catastrophe couronnant d’épouvantables deuils, la population n’en voulut pas moins réveillonner à tâtons avec des côtelettes de chien, des confitures d’os pilés et des andouillettes de rat.
Espérez donc ensuite convertir ces routiniers de l’estomac !
(Article du Journal Amusant, 22 décembre 1877)
Franchement, la vie positive nous déborde, et sur tous les terrains elle fait la plus redoutable concurrence à la fantaisie.
Ici, ce sont des soucis de politique qui entrent en lice ; là, c’est le prosaïsme des temps qui déclare la guerre au roman ; ailleurs, ce sont les réalismes de cour d’assises qui monopolisent le terrible.
Allez donc, après cela, vous creuser la cervelle pour imaginer un moyen d’amuser ou d’émouvoir vos contemporains.
Les dits contemporains sont blasés par avance.
Tous les imbroglios que vous pourrez fabriquer leur paraîtront fades à côté des intrigues de la récente question politique chinoise ou de la question danubienne.
De même que les plus terribles complications à la Frédéric Soulié laisseront froids les lecteurs habitués à la lecture de la Gazette des Tribunaux.
Cela est si vrai que vous voyez le feuilleton, aussi bien que le théâtre, obligé de devenir lui-même une succursale des journaux judiciaires.
On n’a plus d’yeux, on n’a plus d’oreilles que pour ces récréations lugubres ; la cause célèbre règne et gouverne. Vainement vous racontez les horreurs les plus corsées ; si vous n’ajoutez pas que ces horreurs sont l’histoire d'un monsieur X... ou d’une madame Z... qui ont été jugés ou condamnés en l’année 18..., le public reste inattentif et indifférent.
Ce besoin de positivisme, cette matérialisation générale, se traduisent sous toutes les formes. S’agit-il de mise en scène ? Le goût du jour exige des réalités pour de bon, des animaux vivants luttant contre un belluaire, des vaisseaux de grandeur naturelle s’engloutissant au commandement.
Jadis on savait se contenter d’une autre façon. De jolis vers ou une saynète exquise débitée entre deux paravents suffisaient à la satisfaction des gourmets ; maintenant, s’agît-il d’un chef-d’œuvre, le directeur sera obligé d’éclairer le quatrième acte avec une lune à la lumière électrique.
Bonsoir l’idéal, il faut en prendre son parti. La vie vécue a triomphé à jamais de la vie rêvée.
La preuve de ce que je viens d’avancer, je la trouverais encore, si besoin était, dans l’épidémie de mémoires qui sévit depuis trois ou quatre ans sans discontinuer.
Voici qu'après Rigolboche, Thérésa (célèbre danseuse et chanteuse de l'époque) et bien d’autres, on annonce que Mlle Schneider a pris la plume pour raconter par le menu les faits et gestes de son existence illustre. Soyons assurés à l’avance que ces mémoires-là obtiendront un succès foudroyant.
Savoir combien de fois la Grande-duchesse a dîné dans tel restaurant, si elle aime ou n’aime pas les truffes, combien de robes elle use par mois, chez quel parfumeur elle prend son rouge et son blanc, l’adresse de son cordonnier et la mesure de ses bottines, voilà autant de questions palpitantes qui ne peuvent manquer de mettre le monde en émoi.
Autres temps, autres mœurs !
Lorsque jadis un écrivain éprouvait le besoin de rédiger ses mémoires, c’est qu’il avait été mêlé aux grands événements intelligents de son époque, c’est qu’il avait approché des sommités qui tenaient entre leurs mains le présent ou l’avenir du monde ; c’est qu’il pouvait dire aux lecteurs :
« J’ai étudié tel problème humain avec ce grand philosophe, les destinées européennes avec tel grand homme d’État. »
Aujourd’hui, on se met en face d’un encrier pour conter ses soupers au café Anglais ou ses folles dépenses chez la couturière.
C’est d’ailleurs une règle générale ; le cancan nous tue. Dans les journaux, il prend la place des articles, aussi bien des articles sérieux que des articles spirituels.
Là où l’on trouvait jadis une fantaisie ingénieuse ou un examen élevé, on ne rencontre plus que des petits faits hachés informant le peuple de l’heure à laquelle le ministre s’est levé, de la couleur du cheval que la marquise de B... étrennait à son coupé, du nombre de bougies brûlées au dernier raout du financier ***.
Et toujours le positivisme, toujours le prosaïsme, toujours le matérialisme !
Nous avons ri bien fort de nos aïeux qui nageaient dans l’Ether et qui poétisaient jusqu’au fumier de leurs bergeries. Si nos aïeux nous contemplent du haut du ciel, c’est à leur tour de rire à nos dépens.
Où ils nageaient, nous barbotons ; l’Ether a fait place au macadam.
Ici, ce sont des soucis de politique qui entrent en lice ; là, c’est le prosaïsme des temps qui déclare la guerre au roman ; ailleurs, ce sont les réalismes de cour d’assises qui monopolisent le terrible.
Allez donc, après cela, vous creuser la cervelle pour imaginer un moyen d’amuser ou d’émouvoir vos contemporains.
Les dits contemporains sont blasés par avance.
Tous les imbroglios que vous pourrez fabriquer leur paraîtront fades à côté des intrigues de la récente question politique chinoise ou de la question danubienne.
De même que les plus terribles complications à la Frédéric Soulié laisseront froids les lecteurs habitués à la lecture de la Gazette des Tribunaux.
Cela est si vrai que vous voyez le feuilleton, aussi bien que le théâtre, obligé de devenir lui-même une succursale des journaux judiciaires.
On n’a plus d’yeux, on n’a plus d’oreilles que pour ces récréations lugubres ; la cause célèbre règne et gouverne. Vainement vous racontez les horreurs les plus corsées ; si vous n’ajoutez pas que ces horreurs sont l’histoire d'un monsieur X... ou d’une madame Z... qui ont été jugés ou condamnés en l’année 18..., le public reste inattentif et indifférent.
Ce besoin de positivisme, cette matérialisation générale, se traduisent sous toutes les formes. S’agit-il de mise en scène ? Le goût du jour exige des réalités pour de bon, des animaux vivants luttant contre un belluaire, des vaisseaux de grandeur naturelle s’engloutissant au commandement.
Jadis on savait se contenter d’une autre façon. De jolis vers ou une saynète exquise débitée entre deux paravents suffisaient à la satisfaction des gourmets ; maintenant, s’agît-il d’un chef-d’œuvre, le directeur sera obligé d’éclairer le quatrième acte avec une lune à la lumière électrique.
Bonsoir l’idéal, il faut en prendre son parti. La vie vécue a triomphé à jamais de la vie rêvée.
La preuve de ce que je viens d’avancer, je la trouverais encore, si besoin était, dans l’épidémie de mémoires qui sévit depuis trois ou quatre ans sans discontinuer.
Voici qu'après Rigolboche, Thérésa (célèbre danseuse et chanteuse de l'époque) et bien d’autres, on annonce que Mlle Schneider a pris la plume pour raconter par le menu les faits et gestes de son existence illustre. Soyons assurés à l’avance que ces mémoires-là obtiendront un succès foudroyant.
Savoir combien de fois la Grande-duchesse a dîné dans tel restaurant, si elle aime ou n’aime pas les truffes, combien de robes elle use par mois, chez quel parfumeur elle prend son rouge et son blanc, l’adresse de son cordonnier et la mesure de ses bottines, voilà autant de questions palpitantes qui ne peuvent manquer de mettre le monde en émoi.
Autres temps, autres mœurs !
Lorsque jadis un écrivain éprouvait le besoin de rédiger ses mémoires, c’est qu’il avait été mêlé aux grands événements intelligents de son époque, c’est qu’il avait approché des sommités qui tenaient entre leurs mains le présent ou l’avenir du monde ; c’est qu’il pouvait dire aux lecteurs :
« J’ai étudié tel problème humain avec ce grand philosophe, les destinées européennes avec tel grand homme d’État. »
Aujourd’hui, on se met en face d’un encrier pour conter ses soupers au café Anglais ou ses folles dépenses chez la couturière.
C’est d’ailleurs une règle générale ; le cancan nous tue. Dans les journaux, il prend la place des articles, aussi bien des articles sérieux que des articles spirituels.
Là où l’on trouvait jadis une fantaisie ingénieuse ou un examen élevé, on ne rencontre plus que des petits faits hachés informant le peuple de l’heure à laquelle le ministre s’est levé, de la couleur du cheval que la marquise de B... étrennait à son coupé, du nombre de bougies brûlées au dernier raout du financier ***.
Et toujours le positivisme, toujours le prosaïsme, toujours le matérialisme !
Nous avons ri bien fort de nos aïeux qui nageaient dans l’Ether et qui poétisaient jusqu’au fumier de leurs bergeries. Si nos aïeux nous contemplent du haut du ciel, c’est à leur tour de rire à nos dépens.
Où ils nageaient, nous barbotons ; l’Ether a fait place au macadam.
Un vers connu a prétendu que :
C’est par les dîners qu’on gouverne les hommes.
C’est aussi par les joujoux.
Dis-moi quels hochets ont charmé les premières années, et je te tirerai l’horoscope de ta vocation. Si la France est un soldat comme l’assure une phrase consacrée, cela ne tient-il pas, un peu, beaucoup, à ce que l’on nous met entre les mains, dès que nous avons cessé d’être ficelés dans le maillot, des sabres de bois et des trompettes à dix centimes ?
Au collège, j’avais pour camarade un garçon qui passait son temps à fourrer des mouches dans des boîtes en papier. C’était un symptôme : il est devenu garde du commerce ! (bras-droit de l’huissier à l’époque)
C’est par les dîners qu’on gouverne les hommes.
C’est aussi par les joujoux.
Dis-moi quels hochets ont charmé les premières années, et je te tirerai l’horoscope de ta vocation. Si la France est un soldat comme l’assure une phrase consacrée, cela ne tient-il pas, un peu, beaucoup, à ce que l’on nous met entre les mains, dès que nous avons cessé d’être ficelés dans le maillot, des sabres de bois et des trompettes à dix centimes ?
Au collège, j’avais pour camarade un garçon qui passait son temps à fourrer des mouches dans des boîtes en papier. C’était un symptôme : il est devenu garde du commerce ! (bras-droit de l’huissier à l’époque)
Une de ces dames, flanquée d’une amie,
La cocotte (devant son miroir, est en train de se faire le visage) :
Ce qu’il y a d’agréable dans notre profession, c’est que les outils ne coûtent pas cher.
Oui, mais ils s’usent vite, riposte l’amie en regardant perfidement les rides que l’autre est en train de boucher.
La cocotte (devant son miroir, est en train de se faire le visage) :
Ce qu’il y a d’agréable dans notre profession, c’est que les outils ne coûtent pas cher.
Oui, mais ils s’usent vite, riposte l’amie en regardant perfidement les rides que l’autre est en train de boucher.
C’était pendant le siège de Paris.
On était arrivé à la période aigüe, quand, dans les premiers jours de janvier 1871, la pauvre grande ville assiégée n’était plus q’une sorte de cadavre vivant.
Un soir, — c’était, ma foi ! Les Rois, — nous étions réunis huit ou dix chez un ami.
Il faisait froid et noir au dehors. Plus de gaz dans les rues ; plus d’espoir dans les coeurs.
Le canon prussien tonnait sans interruption, vomissant la mitraille à travers les ténèbres…
Cependant le Parisien, fidèle à ses anniversaires, célébrait quand même la fête de la galette traditionnelle. Seulement ladite galette avait été remplacé par le pain noir que vous savez.
Quand on eut cherché la fève dans un morceau de ce pain mémorable, on se regarda, ne sachant que faire et ne pouvant parvenir à oublier, malgré les efforts que l’on faisait pour grimacer une minute de gaieté !
La conversation elle-même s’était arrêtée, les femmes inclinaient la tête, les enfants respectaient cette rêverie sans la bien comprendre.
Tout à coup, au dehors, une voix se fit entendre, voix à l’accent plaintif et comme épuisée. La voix disait : Lan…terne… magique ! Mais l’orgue n’était pas là pour lui donner la réplique.
Lanterne magique !… Parbleu ! C’était la diversion souhaitée par tous.
Cinq minutes après, le montreur était là, dépliant son appareil.
C’était un vieillard à la tête toute blanchie.
D’une main tremblotante, il installa sa lanterne. On fit la nuit. Il commença.
Je remarquai que la voix était si faible, si faible, qu’on avait peine à entendre les explications du vieux. Sans doute l’effet de l’âge.
Mais soudain, à un tableau comique qui représentait un paysan changeant de tête avec son oie, et pendant que les bébés de l’assistance éclataient de rire, la voix se tut tout à fait, en même temps qu’un bruit étrange sa produisit.
On aurait dit la chute d’un corps.
Il y eut un instant d’hésitation. On attendait ; mais comme la voix ne recommençait pas sa démonstration, on alla chercher de la lumière.
Le vieillard était gisant à terre…
On s’empressa. Quand on le rappela à la vie, ll confessa qu’il mourait absolument de faim, n’ayant pas mangé depuis quarante-huit heures et n’ayant pas un sou pour aller chercher la maigre ration que l’on allouait à chaque assiégé…
Pendant ce temps-là, la neige tombait à gros flocons ; la bise soufflait plus âpre que jamais, et le canon prussien semblait redoubler de rage…
Telle est la scène que la lanterne magique fait revivre dans mon souvenir.
Oh ! Cet hiver de 1871 !…
(La « lanterne magique » était l’ancêtre du projecteur de diapositives)
On était arrivé à la période aigüe, quand, dans les premiers jours de janvier 1871, la pauvre grande ville assiégée n’était plus q’une sorte de cadavre vivant.
Un soir, — c’était, ma foi ! Les Rois, — nous étions réunis huit ou dix chez un ami.
Il faisait froid et noir au dehors. Plus de gaz dans les rues ; plus d’espoir dans les coeurs.
Le canon prussien tonnait sans interruption, vomissant la mitraille à travers les ténèbres…
Cependant le Parisien, fidèle à ses anniversaires, célébrait quand même la fête de la galette traditionnelle. Seulement ladite galette avait été remplacé par le pain noir que vous savez.
Quand on eut cherché la fève dans un morceau de ce pain mémorable, on se regarda, ne sachant que faire et ne pouvant parvenir à oublier, malgré les efforts que l’on faisait pour grimacer une minute de gaieté !
La conversation elle-même s’était arrêtée, les femmes inclinaient la tête, les enfants respectaient cette rêverie sans la bien comprendre.
Tout à coup, au dehors, une voix se fit entendre, voix à l’accent plaintif et comme épuisée. La voix disait : Lan…terne… magique ! Mais l’orgue n’était pas là pour lui donner la réplique.
Lanterne magique !… Parbleu ! C’était la diversion souhaitée par tous.
Cinq minutes après, le montreur était là, dépliant son appareil.
C’était un vieillard à la tête toute blanchie.
D’une main tremblotante, il installa sa lanterne. On fit la nuit. Il commença.
Je remarquai que la voix était si faible, si faible, qu’on avait peine à entendre les explications du vieux. Sans doute l’effet de l’âge.
Mais soudain, à un tableau comique qui représentait un paysan changeant de tête avec son oie, et pendant que les bébés de l’assistance éclataient de rire, la voix se tut tout à fait, en même temps qu’un bruit étrange sa produisit.
On aurait dit la chute d’un corps.
Il y eut un instant d’hésitation. On attendait ; mais comme la voix ne recommençait pas sa démonstration, on alla chercher de la lumière.
Le vieillard était gisant à terre…
On s’empressa. Quand on le rappela à la vie, ll confessa qu’il mourait absolument de faim, n’ayant pas mangé depuis quarante-huit heures et n’ayant pas un sou pour aller chercher la maigre ration que l’on allouait à chaque assiégé…
Pendant ce temps-là, la neige tombait à gros flocons ; la bise soufflait plus âpre que jamais, et le canon prussien semblait redoubler de rage…
Telle est la scène que la lanterne magique fait revivre dans mon souvenir.
Oh ! Cet hiver de 1871 !…
(La « lanterne magique » était l’ancêtre du projecteur de diapositives)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Lecteurs de Pierre Véron (416)Voir plus
Quiz
Voir plus
la mythologie grecque
Qu i sont les premiers enfants d'Ouranous et de Gaia ?
les titans
les cyclopes
les titans et les titanides
les titanides
50 questions
896 lecteurs ont répondu
Thèmes :
mythologie grecqueCréer un quiz sur cet auteur896 lecteurs ont répondu