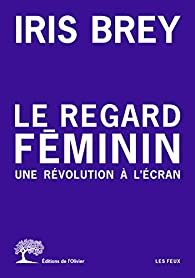>
Critique de Gentileschi
Iris Brey reprend dans cet essai le concept de « male gaze » développé par la théoricienne du cinéma Laura Mulvey dans les années 1970. Une majorité de films seraient mis en scène de manière à présenter au spectateur un point de vue masculin sur les femmes, qui s'en trouveraient réduites au statut d'objets du regard. le spectateur est invité à prendre du plaisir en observant les corps des femmes (le « gaze » c'est le regard qui fixe), à travers des plans qui les sexualisent. La thèse d'Iris Brey, c'est qu'il a existé, et ce dès les débuts du cinéma, un autre cinéma, qui invite les spectateurices à ressentir l'expérience des personnages féminins, jusqu'à entrer dans un partage d'expérience actif avec elles. C'est ce principe filmique qu'elle appelle le « female gaze ». Brey se sort bien de la critique de la binarité de genre sous-jacente à sa démarche théorique (pourquoi revendiquer un female gaze face au male gaze à une époque queer et fluide?), en disant simplement que l'expérience spécifique des femmes (de toutes les femmes, trans et cis, avec ou sans enfants etc.) n'est pas encore sortie de sa place marginale, pas plus qu'elle n'a fini de déranger. le livre revient alors sur l'histoire du cinéma en traversant un corpus de films qui mettent en oeuvre un female gaze. Ce parcours passe par des noms attendus, comme ceux d'Agnès Varda, Chantal Ackermann, Jane Campion ou Céline Sciamma (ce qui ne veut pas dire que leurs films aient été beaucoup vus), mais il explore surtout les marges du cinéma, en présentant les films (entre autres) de Maya Deren, Dorothy Arzner, Barbara Hammer, Barbara Loden ou encore de Marie-Claude Treilhou. le female gaze peut être mis en oeuvre par des hommes, et le livre contient une analyse passionnante du film Elle de Paul Verhoeven allant dans ce sens. le livre explore aussi un corpus sériel.
Cette mise en valeur de films souvent peu connus est à mes yeux l'un des aspects les plus stimulants de ce livre, qui sait nous inviter à aller vers ces oeuvres et à nous plonger dans des expériences de cinéma inédites, à partager un moment de la vie d'héroïnes qu'on aurait aimé rencontrer plus tôt. En tant que cinéphile et en tant que femme, je partage le point de vue défendu par le livre. Je pense en effet qu'une grande partie des films tournés aux XXe et au XXIe siècles représente très pauvrement la vie et le point de vue des femmes, donne une fausse impression de leurs désirs et de leurs expériences, voire les réduit au statut de potiches. J'ai toutefois une réserve concernant la forme du livre, dont j'assume qu'elle soit liée à ma formation académique. Je suppose qu'Iris Brey a voulu écrire un essai accessible à toustes, court et écrit dans un style compréhensible. Cette démarche est évidemment louable, mais je trouve que le propos gagnerait beaucoup de force en entrant dans une discussion plus approfondie avec le matériel théorique sur lequel il repose (l'approche phénoménologique des films, l'écriture féminine etc.), et en affinant les analyses de films. Dans la conclusion, Iris Brey montre que l'équipe rédactionnelle des Cahiers du cinéma à l'époque de Stéphane Delorme ne comprend pas les enjeux qui entourent le genre du point de vue au cinéma, et reste bloquée dans une perspective critique sexiste. Or, à mes yeux, les Cahiers de Delorme (du moins ce que j'en ai lu), représentent un idéal de ce qu'on peut faire en terme de profondeur critique. J'en conclu que j'aimerais lire (et écrire) des textes qui marient une écriture sensible, subtile, qui va explorer les complexités des oeuvres et du monde, à un point de vue qui ne soit pas mutilé par son incapacité à comprendre la richesse du féminisme.
Cette mise en valeur de films souvent peu connus est à mes yeux l'un des aspects les plus stimulants de ce livre, qui sait nous inviter à aller vers ces oeuvres et à nous plonger dans des expériences de cinéma inédites, à partager un moment de la vie d'héroïnes qu'on aurait aimé rencontrer plus tôt. En tant que cinéphile et en tant que femme, je partage le point de vue défendu par le livre. Je pense en effet qu'une grande partie des films tournés aux XXe et au XXIe siècles représente très pauvrement la vie et le point de vue des femmes, donne une fausse impression de leurs désirs et de leurs expériences, voire les réduit au statut de potiches. J'ai toutefois une réserve concernant la forme du livre, dont j'assume qu'elle soit liée à ma formation académique. Je suppose qu'Iris Brey a voulu écrire un essai accessible à toustes, court et écrit dans un style compréhensible. Cette démarche est évidemment louable, mais je trouve que le propos gagnerait beaucoup de force en entrant dans une discussion plus approfondie avec le matériel théorique sur lequel il repose (l'approche phénoménologique des films, l'écriture féminine etc.), et en affinant les analyses de films. Dans la conclusion, Iris Brey montre que l'équipe rédactionnelle des Cahiers du cinéma à l'époque de Stéphane Delorme ne comprend pas les enjeux qui entourent le genre du point de vue au cinéma, et reste bloquée dans une perspective critique sexiste. Or, à mes yeux, les Cahiers de Delorme (du moins ce que j'en ai lu), représentent un idéal de ce qu'on peut faire en terme de profondeur critique. J'en conclu que j'aimerais lire (et écrire) des textes qui marient une écriture sensible, subtile, qui va explorer les complexités des oeuvres et du monde, à un point de vue qui ne soit pas mutilé par son incapacité à comprendre la richesse du féminisme.