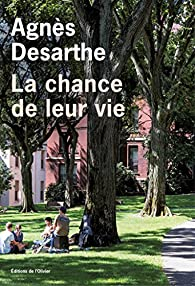>
Critique de Floyd2408
J'avais rencontré Agnès Desarthe dans un de ses romans, Coeur changeant édité en 2015, d'une masse critique par Babelio, cette histoire m'avait transporté dans une aventure féminine passionnante, avec une prose légère et entrainante. Pour mon anniversaire, j'ai laissé choisir pour mon cadeau ma mère, un roman dans ma librairie préférée, Les passeurs de textes à Troyes, de la rentrée littéraire de cette année 2018, lui proposant certains auteurs que je connaissais, son choix se porta sur La chance de leur vie, la quatrième de couverture ressemblant à ses lectures.
Un roman raconte toujours une histoire, pas celle narrer par l'auteur mais celle ressentit par le lecteur, comme un écho à ses propres expériences, ces parcourir au fond de soi un cheminement étrange se lie entre la prose de l'auteur et la liberté de les percevoir, les absorber, les digérer, les faire voltiger dans les méandres de mon âme errantes. Les premiers mots furent une sorte de nourriture indigeste, comme une viande avariée se diffusant avec beaucoup de difficultés dans une lecture agréable, mais il faut toujours dans un premier temps laisser le temps aux mots à s'évaporer dans la trouble de mon esprit critique et quelque fois hermétique. Alors je décide de changer ma façon de lire, pour disséquer avec beaucoup de méthode et de tranquillité ce roman, je deviens étranger de ma personne pour devenir un dévoreur de mots, un funambule de la prose.
le roman commence comme un conte, le style de l'imparfait, annonce une époque lointaine, les premiers mots sont une présentation éphémère des personnages, le secret du lieu laisse avenir une sorte d'intrigue échappant au temps, une façon de laisser le lecteur dans une expectative absolue, la fable commence, c'est faire revivre ce passé, une transmission à chacun.
« Un village dont on taisait le nom par amour du secret »
Un homme Hector originaire de Cornouailles, lieu mystique de ses légendes, sa femme Sylvie, leur fils Lester. de ses 14 ans, il s'exerçait déjà à la sagesse, désirant vouloir choisir son propre prénom, Absalom Absalom faisant écho pour ma part au titre du roman de William Faulkner publié en 1936, ce livre est depuis un bon moment dans ma bibliothèque, perdu dans les dédales poussiéreux de ses livres qui attendent d'être dévorés avec beaucoup d'envie et de curiosité. Ce petit trio en route vers une nouvelle destinée, celle des Etats-Unis, l'université d'Earl University en Caroline du Nord, c'est La chance de leur vie, comme le titre l'annonce, mais est-ce, un trompe l'oeil !, cette traversée de l'Atlantique pour une destinée inconnue et excitante, une liberté.
De ce trio Agnès Desarthe, va s'offrir avec beaucoup de précision, l'introspection de cette femme, mère de famille et épouse à la maison, ou s'ajoute comme un ingrédient, cette recette de vie, son fils, un adolescent et son mari, professeur de philosophie.
Sylvie, une femme, sexagénaire, épouse docile et oisive dans son intérieur, sa maison qu'elle n’œuvre jamais d'une main de fer, elle est libre de cette ménagère, prisonnière de ses tâches, c'est ce que son mari aime, cette oisiveté, celle qui échappe au quotidien qu'il a vécu avec ses parents, Sylvie est cette femme qui lui donne cette liberté de survivre à son passé, elle est si sauvage et inefficace, une vie de liberté, sans contrainte, comme une vie de Bohème. Cette femme semble invisible, transparente, Sylvie se considère comme une princesse, elle n'a jamais travaillé, juste lu toute la bibliothèque de son mari, Hector, et mère de deux enfants, élevé un, l'autre mort peu de temps après sa naissance. La vie de cette femme expatriée loin de sa terre natale, à l'anglais trop scolaire pour se sentir à l'aise, navigue dans ce nouveau quartier comme une naufragée.
« Nous sommes des naufragés. Seuls sur une île peut-être pas déserte, mais hostile. »
Sa première rencontre fortuite, après s'être perdue dans les dédales figés d'un quartier clone des maisons et des jardins des autres, rencontre Mister Black, un paysagiste, un homme noir, la guide pour rentrer chez elle et lui cette phrase qui trouble Sylvie d'une allusion probable.
« Vous êtes nouvelle ici. Vous aurez sûrement besoin de moi. Je viendrais planter des azalées dans votre pelouse »
Sylvie est un mystère charmant, se troublant de choses anodines, comment répondre à une invitation chez des inconnus, se préparant à l'avance, comme si elle préparait un rôle, se mémorisant des répliques pour s'y attacher, pour ne pas être déstabiliser, mais comme nous le savons jamais les choses évolues comme nous l'avions décidées et de là Sylvie tombe dans l'abime de sa torpeur, et nous le lecteur, se dessine un sourire ironique de la situation, Sylvie en devient comique, malgré elle, elle nous touche de cette timidité naturelle, elle n'aime pas déranger son quotidien inerte aux autres, elle vit de son trio. J'aime cette scène où Sylvie n'a pas envie de rencontrer cette femme, la directrice du département Farah Asmanantou, au contraire de celle-ci, timide car indécise sur ce qu'elle prendrait , thé, café, se persuade qu'elle répondra du café le jour venu, moment drôle de ce passage sur cette indécision puérile, ce manque de confiance en soi, sur un détail insignifiant, une banalité courante, dont Sylvie veut faire bonne figure, c'est fort amusant, voir cocasse. Lors de cette rencontre avec Farah, Sylvie se trouve désappointée par la conversation sur les pseudonymes et la question posée par la maitresse de maison, voulant plutôt répondre à cette question dont sa réponse avait été apprise par coeur, du café, une ironie de la scène, elle est juste la femme d'Hector, se trouvant dans une aliénation où se déploie sa liberté, beaucoup de situation dans le roman m'ont fait sourire comme cette scène de la machine à laver tombant en panne, Sylvie comme souvent s'imagine des histoires, pour elle les appareils électro-ménagers œuvrent comme autant de Cassandre inanimés et modernes, des signes se rappellent à elle, comme le désordre inhabituel dans le lave-vaisselle, si ordonné avec Hector, et en parle à son mari qui ne comprends ce genre de discussion.
J'ai aimé cette femme au cœur de ce livre, Sylvie est l'apanage vivant de la femme naturellement gentille, une femme que l'on a envie de serrer dans ses bras pour ne plus la quitter et sentir couler en soi sa force tranquille vous embraser les sens. Cette femme solitaire de la mort de sa petite fille, à la naissance, se perdant dans la bibliothèque de son mari pour se nourrir encore et encore de tous ses livres qu'elle un à un digère à la suite sans s'interrompre, Hector sait que sa femme, se remplit de lecture pour chasser tout l'espace que le chagrin aurait colonisé, elle se soigne de cette perte, de cette fille morte peu de temps après sa naissance. Son Mari, il l'aime, il aime sa femme, Il se souvient de sa femme agile, rapide l'appelant la petite chèvre référence à son passé de bergère, de la perte de l'enfant mort-né, cet enfant qu'il a pleuré, il la revoit encore trente ans plus tard, et imagine que c'est Sylvie sauvage et campagnarde, puis à force de la reprendre sur tout il la rendu inerte de ses actes comme une femme inutile adepte du dogme taoïste du non agir, esclave de lui , soumise, elle est devenu un fantôme, celui qu'il a créé comme une vengeance tacite de la mort de leur fille, puis l'anecdote troublante de Sylvie et du père de Hector son beau-père, il était discret , parlé peu , juste des petites phrases courtes, il l'avait fait demandé pour lui parler lui dire qu'elle était comme à statuette inca, son corps était antique, un trouble de sa voix pour lui dire ces choses que l'on ne dit pas à sa belle-fille, un secret intime trop puissant pour être véhiculé, lui demande la faveur de se montrer nue devant lui, il est âgé, son corps est comme celui des femmes des cavernes, elle se montre à lui comme une forme de respect, cet acte fort et intime les lie à jamais dans leur chair, Sylvie se met à nue, ce secret sera à jamais sourd, après sa mort , enceinte, la main sur son ventre elle prononça cette phrase comme un hommage à cet vieil homme « Femme des cavernes », cette femme me plait dans façon d'agir, c'est une femme, certes soumise par complaisance, car comme peut le dire Hector, aimant dominer sa femme, être plus que tout avec sa femme, il a honte et pense à la formule de Napoléon sur la Chine
« Quant Sylvie s'éveillera, le monde entier tremblera. »
J'aime l'idée de ce réveil, de cette force cachée, prisonnière de sa timidité et de sa soumission pour son Mari, par amour et simplicité, Sylvie, au matin souvent, se retrouve anxieuse, au bord du précipice, dans une voie qu'elle ne doit pas suivre comme elle l'a déjà fait plus jeune, son mari Hector la guide, pour avoir des repères, elle aime être la grand-mère de son fils et le bébé de son mari, belle ambiguïté, s'amuse dans la rue avec des inconnus à concevoir qu'elle est sa mamie, un jeu de dupe, de son âge avancé pour être mère, mais s'en accommode de cette pirouette amusante et savoureuse de sa piété légère et naturelle.
Sylvie prends des cours de poterie, avec pour professeur Lauren ayant déjà exposée dans plusieurs grandes villes américaine, discutant avec parcimonie, restant dans sa bulle, comme toujours, discrète, solitaire de sa vision de son manque de pertinence, Sylvie s'entretient avec Lauren, lui avouant sans honte qu'elle en a marre de faire ce stage de poterie avec ses ignorants, aimant l'attitude se Sylvie, elle lui fait penser à une espionne du temps de guerre froide, son visage est impassible face à la terre, encore cette ironie de Sylvie qui ne fait rien car elle attend juste l'inspiration, celle qui est vierge d'idée, cette inertie statique qui définit au plus profond de sa chair cette femme sans idée.
Sylvie trouve dans cette terre nouvelle, une forme de passerelle entre son passé et sa destinée, des bribes de sa vie s'évaporent de son esprit pour en prendre possessions à tout moment, sa fille décédée, une blessure encore brulante dans sa chair, une vie sans mère, sans compagne d'amitié, à la lisière de l'isolement, c'était un handicap, exclut d'un secret de femmes, de ces conversations féminines, abandonnée dans l'ilot solitaire des soucis des femmes, la puberté, la ménopause, traversant ses étapes dans l'ignorance d'une conversation entre femmes, sans soutien., puis petit à petit Sylvie navigue au fond d'elle-même, comme une évidence, sa ménopause lui reviens en mémoire cette transition comme celle de son adolescence, sans amertume , juste une curiosité, une suite logique de sa vie, et s'ensuit une description des symptômes, des montés de chaleur, des lieus, des regards, des médecins et de leur indifférences face au désordre subit, elle veut juste parler de ces changements, avoir une oreille attentive à ces phénomènes fluctuants. Elle s'interroge sur le complexe féminin, ses émois, toutes ses choses qu'elle ne lit pas dans des romans, seul la rive masculine étalait ses dérives comme les lectures de Philip Roth, Romain Gary osant parler de leur adolescence masturbatoire, toute cette impudeur mise dans leur prose, leur panne sexuelle, et de là Sylvie disparait dans les silences féminins de leur désirs, pour disparaitre dans une réflexion simple sur de ne pas avoir lu les bons livres surement, l'homme se raconte, la femme est plus silencieuse dans ce sens, cette parenthèse où le corps mute vers une métamorphose volcanique ou les coulées de lave transpire le corps, ils sont élus le couple le plus sexy, eux les vieux, son mari se retrouve le nouveau Foucault, belle ironie, elle se rappelle son passé de bergère, elle s'amuse des femmes déguisées qui papillonnent autour de son mari, de son oeil candide et confiant, puis s'évade en regardant ces femmes fatigués cernés plus jeunes engluées dans leur vies, leur sacs qu'elles n'a plus , se souviens des pochettes qu'elle fabriquait, une forme de liberté, d'émancipation….
Sylvie n'oublie pas, sa jupe en daim, ce premier achat de jeunesse, lui a permis de s'émanciper de son père et des hommes. Un refrain de son fils lui rappelle la chorale, et de son père ne voulant pas qu'elle prenne la mobylette, lui préférant de faire du stop pour dire cette phrase horrible
« J'la préfère violée que morte »
Chanter du Bach la rapproché de Dieu qui l'entendait, elle en était certaine, elle n'avait aucune sensation en mirant dans la glace, car dans son enfance il y avait peu d'endroit pour le faire, poitrine fine, elle n'avait jamais porté de soutien-gorge. Elle se trouve au États-Unis, pour que son enfance s'invite en elle, le futur donne naissance à son passé.
Du succès de son mari, elle n'est pas jalouse, pour elle la jalousie est avilissant, un panorama solitaire ouvrant sa vue vers un café en pleine nature de devanture moderne, elle regarde son mari avec une autre femme, d'une bougie pour éclairer ce tableau de Georges de la Tour, elle aime cette scène, sans jalousie, savoure l'instant du baiser de son mari avec sa maitresse Caridad Lopez y Lopes, professeur de littérature, divorcée, deux enfants, cinq et trois ans. Sylvie connait parfaitement son mari, il aime l'oisiveté chez une femme, cet amour courtois.
Sylvie, toujours aussi imperturbable, rentre de cette scène qu'elle n'a pas vue, il ne sait rien passé, et ce geste particulier de son marin remettant en désordre le petit triangle de son col de chemise, toujours relevé, comme un signe de son amour pour sa femme.
Ce geste anodin du petit col relevé est pour Sylvie un acte d'amour, ce détail cristallise cet amour pour son mari.
La famille parle de l'attentat du Bataclan, si Lester connaissait des victimes, Sylvie et son fils ont une vraie conversation, un échange utérin se créé, un lien maternel universel, avoir de la douleur pour des inconnus morts, cette empathie bien vaillante, et prie en le cachant à sa maman, évoque qu'il l'aime en anglais, une forme de honte de sa foie nouvelle. Ces attentats marquent Lester dans son âme, trouve la foi pour Dieu, lisant Les confessions de Saint Augustin, Lester connait la cruauté humaine, cette vilaine qu'il détaille avec beaucoup de froideur, ce qui effraie sa mère, elle se détache de cette conversation, son fils est trop alerte, trop intelligent, il diserte la nature humaine avec beaucoup de pragmatique, comme une dissection, il a cette froideur d'un psychopathe, cette cruauté, qu'il reconnait. Il pense être un monstre.
« Elle voudrait lui vanter les mérites de la lâcheté, l'initier au génie de l'autruche »
Sylvie au fond d'elle rejette son fils, le sentant un Monstre. Lester pense que les êtres humains ne pensent qu'au plaisir du sexe. Lester méprise la nouvelle technologie, les téléphones portables, internet, le passage sur la Bataclan avec ce jeune garçon ayant perdu 4 doigts perturbe Lester, relaté par une fille sur internet, cette réflexion du rôle de la toile et sa rapidité à vomir ces informations, Lester est plus choqué par la manière de cette information est venue à lui, il la compare à la boue après une inondation,
« C'est une boue semblable à celle qui suit les inondations et cause autant de dégâts que l'eau elle-même »
Certes le roman oppose deux Amériques avec deux de ces personnages, Farah Asmanantou, une immigrée du Yémen, la directrice du département, maitresse d'Hector, son parcours laborieux, étudiant et récurant les toilettes des étudiants de Mathématiques en même temps, idéalisant le prochain vote des américains pour une femme Président des États-Unis, à son apposé, la femme de Jhersy Gonçalves, professeur de littérature espagnole, d'origine polonaise, Astrid, d'origine du Sud, issue de la septième génération dans le coton, côté raciste de cette belle Amérique, votant Donald Trump sans remords, ces deux femmes représentent bien cette dualité américaine, ouverte et fermée à la fois.
Pour finir avec ce roman, j'aurai aimé Agnès Desarthe écrire un vraie roman de femme, une vie de femme sans pudeur, allant dans le coeur et la chair de ces femmes, leur quotidien, leur désir, leur envie, leur faiblesse, leur fantasme, leur peur, leur vie…
Un roman raconte toujours une histoire, pas celle narrer par l'auteur mais celle ressentit par le lecteur, comme un écho à ses propres expériences, ces parcourir au fond de soi un cheminement étrange se lie entre la prose de l'auteur et la liberté de les percevoir, les absorber, les digérer, les faire voltiger dans les méandres de mon âme errantes. Les premiers mots furent une sorte de nourriture indigeste, comme une viande avariée se diffusant avec beaucoup de difficultés dans une lecture agréable, mais il faut toujours dans un premier temps laisser le temps aux mots à s'évaporer dans la trouble de mon esprit critique et quelque fois hermétique. Alors je décide de changer ma façon de lire, pour disséquer avec beaucoup de méthode et de tranquillité ce roman, je deviens étranger de ma personne pour devenir un dévoreur de mots, un funambule de la prose.
le roman commence comme un conte, le style de l'imparfait, annonce une époque lointaine, les premiers mots sont une présentation éphémère des personnages, le secret du lieu laisse avenir une sorte d'intrigue échappant au temps, une façon de laisser le lecteur dans une expectative absolue, la fable commence, c'est faire revivre ce passé, une transmission à chacun.
« Un village dont on taisait le nom par amour du secret »
Un homme Hector originaire de Cornouailles, lieu mystique de ses légendes, sa femme Sylvie, leur fils Lester. de ses 14 ans, il s'exerçait déjà à la sagesse, désirant vouloir choisir son propre prénom, Absalom Absalom faisant écho pour ma part au titre du roman de William Faulkner publié en 1936, ce livre est depuis un bon moment dans ma bibliothèque, perdu dans les dédales poussiéreux de ses livres qui attendent d'être dévorés avec beaucoup d'envie et de curiosité. Ce petit trio en route vers une nouvelle destinée, celle des Etats-Unis, l'université d'Earl University en Caroline du Nord, c'est La chance de leur vie, comme le titre l'annonce, mais est-ce, un trompe l'oeil !, cette traversée de l'Atlantique pour une destinée inconnue et excitante, une liberté.
De ce trio Agnès Desarthe, va s'offrir avec beaucoup de précision, l'introspection de cette femme, mère de famille et épouse à la maison, ou s'ajoute comme un ingrédient, cette recette de vie, son fils, un adolescent et son mari, professeur de philosophie.
Sylvie, une femme, sexagénaire, épouse docile et oisive dans son intérieur, sa maison qu'elle n’œuvre jamais d'une main de fer, elle est libre de cette ménagère, prisonnière de ses tâches, c'est ce que son mari aime, cette oisiveté, celle qui échappe au quotidien qu'il a vécu avec ses parents, Sylvie est cette femme qui lui donne cette liberté de survivre à son passé, elle est si sauvage et inefficace, une vie de liberté, sans contrainte, comme une vie de Bohème. Cette femme semble invisible, transparente, Sylvie se considère comme une princesse, elle n'a jamais travaillé, juste lu toute la bibliothèque de son mari, Hector, et mère de deux enfants, élevé un, l'autre mort peu de temps après sa naissance. La vie de cette femme expatriée loin de sa terre natale, à l'anglais trop scolaire pour se sentir à l'aise, navigue dans ce nouveau quartier comme une naufragée.
« Nous sommes des naufragés. Seuls sur une île peut-être pas déserte, mais hostile. »
Sa première rencontre fortuite, après s'être perdue dans les dédales figés d'un quartier clone des maisons et des jardins des autres, rencontre Mister Black, un paysagiste, un homme noir, la guide pour rentrer chez elle et lui cette phrase qui trouble Sylvie d'une allusion probable.
« Vous êtes nouvelle ici. Vous aurez sûrement besoin de moi. Je viendrais planter des azalées dans votre pelouse »
Sylvie est un mystère charmant, se troublant de choses anodines, comment répondre à une invitation chez des inconnus, se préparant à l'avance, comme si elle préparait un rôle, se mémorisant des répliques pour s'y attacher, pour ne pas être déstabiliser, mais comme nous le savons jamais les choses évolues comme nous l'avions décidées et de là Sylvie tombe dans l'abime de sa torpeur, et nous le lecteur, se dessine un sourire ironique de la situation, Sylvie en devient comique, malgré elle, elle nous touche de cette timidité naturelle, elle n'aime pas déranger son quotidien inerte aux autres, elle vit de son trio. J'aime cette scène où Sylvie n'a pas envie de rencontrer cette femme, la directrice du département Farah Asmanantou, au contraire de celle-ci, timide car indécise sur ce qu'elle prendrait , thé, café, se persuade qu'elle répondra du café le jour venu, moment drôle de ce passage sur cette indécision puérile, ce manque de confiance en soi, sur un détail insignifiant, une banalité courante, dont Sylvie veut faire bonne figure, c'est fort amusant, voir cocasse. Lors de cette rencontre avec Farah, Sylvie se trouve désappointée par la conversation sur les pseudonymes et la question posée par la maitresse de maison, voulant plutôt répondre à cette question dont sa réponse avait été apprise par coeur, du café, une ironie de la scène, elle est juste la femme d'Hector, se trouvant dans une aliénation où se déploie sa liberté, beaucoup de situation dans le roman m'ont fait sourire comme cette scène de la machine à laver tombant en panne, Sylvie comme souvent s'imagine des histoires, pour elle les appareils électro-ménagers œuvrent comme autant de Cassandre inanimés et modernes, des signes se rappellent à elle, comme le désordre inhabituel dans le lave-vaisselle, si ordonné avec Hector, et en parle à son mari qui ne comprends ce genre de discussion.
J'ai aimé cette femme au cœur de ce livre, Sylvie est l'apanage vivant de la femme naturellement gentille, une femme que l'on a envie de serrer dans ses bras pour ne plus la quitter et sentir couler en soi sa force tranquille vous embraser les sens. Cette femme solitaire de la mort de sa petite fille, à la naissance, se perdant dans la bibliothèque de son mari pour se nourrir encore et encore de tous ses livres qu'elle un à un digère à la suite sans s'interrompre, Hector sait que sa femme, se remplit de lecture pour chasser tout l'espace que le chagrin aurait colonisé, elle se soigne de cette perte, de cette fille morte peu de temps après sa naissance. Son Mari, il l'aime, il aime sa femme, Il se souvient de sa femme agile, rapide l'appelant la petite chèvre référence à son passé de bergère, de la perte de l'enfant mort-né, cet enfant qu'il a pleuré, il la revoit encore trente ans plus tard, et imagine que c'est Sylvie sauvage et campagnarde, puis à force de la reprendre sur tout il la rendu inerte de ses actes comme une femme inutile adepte du dogme taoïste du non agir, esclave de lui , soumise, elle est devenu un fantôme, celui qu'il a créé comme une vengeance tacite de la mort de leur fille, puis l'anecdote troublante de Sylvie et du père de Hector son beau-père, il était discret , parlé peu , juste des petites phrases courtes, il l'avait fait demandé pour lui parler lui dire qu'elle était comme à statuette inca, son corps était antique, un trouble de sa voix pour lui dire ces choses que l'on ne dit pas à sa belle-fille, un secret intime trop puissant pour être véhiculé, lui demande la faveur de se montrer nue devant lui, il est âgé, son corps est comme celui des femmes des cavernes, elle se montre à lui comme une forme de respect, cet acte fort et intime les lie à jamais dans leur chair, Sylvie se met à nue, ce secret sera à jamais sourd, après sa mort , enceinte, la main sur son ventre elle prononça cette phrase comme un hommage à cet vieil homme « Femme des cavernes », cette femme me plait dans façon d'agir, c'est une femme, certes soumise par complaisance, car comme peut le dire Hector, aimant dominer sa femme, être plus que tout avec sa femme, il a honte et pense à la formule de Napoléon sur la Chine
« Quant Sylvie s'éveillera, le monde entier tremblera. »
J'aime l'idée de ce réveil, de cette force cachée, prisonnière de sa timidité et de sa soumission pour son Mari, par amour et simplicité, Sylvie, au matin souvent, se retrouve anxieuse, au bord du précipice, dans une voie qu'elle ne doit pas suivre comme elle l'a déjà fait plus jeune, son mari Hector la guide, pour avoir des repères, elle aime être la grand-mère de son fils et le bébé de son mari, belle ambiguïté, s'amuse dans la rue avec des inconnus à concevoir qu'elle est sa mamie, un jeu de dupe, de son âge avancé pour être mère, mais s'en accommode de cette pirouette amusante et savoureuse de sa piété légère et naturelle.
Sylvie prends des cours de poterie, avec pour professeur Lauren ayant déjà exposée dans plusieurs grandes villes américaine, discutant avec parcimonie, restant dans sa bulle, comme toujours, discrète, solitaire de sa vision de son manque de pertinence, Sylvie s'entretient avec Lauren, lui avouant sans honte qu'elle en a marre de faire ce stage de poterie avec ses ignorants, aimant l'attitude se Sylvie, elle lui fait penser à une espionne du temps de guerre froide, son visage est impassible face à la terre, encore cette ironie de Sylvie qui ne fait rien car elle attend juste l'inspiration, celle qui est vierge d'idée, cette inertie statique qui définit au plus profond de sa chair cette femme sans idée.
Sylvie trouve dans cette terre nouvelle, une forme de passerelle entre son passé et sa destinée, des bribes de sa vie s'évaporent de son esprit pour en prendre possessions à tout moment, sa fille décédée, une blessure encore brulante dans sa chair, une vie sans mère, sans compagne d'amitié, à la lisière de l'isolement, c'était un handicap, exclut d'un secret de femmes, de ces conversations féminines, abandonnée dans l'ilot solitaire des soucis des femmes, la puberté, la ménopause, traversant ses étapes dans l'ignorance d'une conversation entre femmes, sans soutien., puis petit à petit Sylvie navigue au fond d'elle-même, comme une évidence, sa ménopause lui reviens en mémoire cette transition comme celle de son adolescence, sans amertume , juste une curiosité, une suite logique de sa vie, et s'ensuit une description des symptômes, des montés de chaleur, des lieus, des regards, des médecins et de leur indifférences face au désordre subit, elle veut juste parler de ces changements, avoir une oreille attentive à ces phénomènes fluctuants. Elle s'interroge sur le complexe féminin, ses émois, toutes ses choses qu'elle ne lit pas dans des romans, seul la rive masculine étalait ses dérives comme les lectures de Philip Roth, Romain Gary osant parler de leur adolescence masturbatoire, toute cette impudeur mise dans leur prose, leur panne sexuelle, et de là Sylvie disparait dans les silences féminins de leur désirs, pour disparaitre dans une réflexion simple sur de ne pas avoir lu les bons livres surement, l'homme se raconte, la femme est plus silencieuse dans ce sens, cette parenthèse où le corps mute vers une métamorphose volcanique ou les coulées de lave transpire le corps, ils sont élus le couple le plus sexy, eux les vieux, son mari se retrouve le nouveau Foucault, belle ironie, elle se rappelle son passé de bergère, elle s'amuse des femmes déguisées qui papillonnent autour de son mari, de son oeil candide et confiant, puis s'évade en regardant ces femmes fatigués cernés plus jeunes engluées dans leur vies, leur sacs qu'elles n'a plus , se souviens des pochettes qu'elle fabriquait, une forme de liberté, d'émancipation….
Sylvie n'oublie pas, sa jupe en daim, ce premier achat de jeunesse, lui a permis de s'émanciper de son père et des hommes. Un refrain de son fils lui rappelle la chorale, et de son père ne voulant pas qu'elle prenne la mobylette, lui préférant de faire du stop pour dire cette phrase horrible
« J'la préfère violée que morte »
Chanter du Bach la rapproché de Dieu qui l'entendait, elle en était certaine, elle n'avait aucune sensation en mirant dans la glace, car dans son enfance il y avait peu d'endroit pour le faire, poitrine fine, elle n'avait jamais porté de soutien-gorge. Elle se trouve au États-Unis, pour que son enfance s'invite en elle, le futur donne naissance à son passé.
Du succès de son mari, elle n'est pas jalouse, pour elle la jalousie est avilissant, un panorama solitaire ouvrant sa vue vers un café en pleine nature de devanture moderne, elle regarde son mari avec une autre femme, d'une bougie pour éclairer ce tableau de Georges de la Tour, elle aime cette scène, sans jalousie, savoure l'instant du baiser de son mari avec sa maitresse Caridad Lopez y Lopes, professeur de littérature, divorcée, deux enfants, cinq et trois ans. Sylvie connait parfaitement son mari, il aime l'oisiveté chez une femme, cet amour courtois.
Sylvie, toujours aussi imperturbable, rentre de cette scène qu'elle n'a pas vue, il ne sait rien passé, et ce geste particulier de son marin remettant en désordre le petit triangle de son col de chemise, toujours relevé, comme un signe de son amour pour sa femme.
Ce geste anodin du petit col relevé est pour Sylvie un acte d'amour, ce détail cristallise cet amour pour son mari.
La famille parle de l'attentat du Bataclan, si Lester connaissait des victimes, Sylvie et son fils ont une vraie conversation, un échange utérin se créé, un lien maternel universel, avoir de la douleur pour des inconnus morts, cette empathie bien vaillante, et prie en le cachant à sa maman, évoque qu'il l'aime en anglais, une forme de honte de sa foie nouvelle. Ces attentats marquent Lester dans son âme, trouve la foi pour Dieu, lisant Les confessions de Saint Augustin, Lester connait la cruauté humaine, cette vilaine qu'il détaille avec beaucoup de froideur, ce qui effraie sa mère, elle se détache de cette conversation, son fils est trop alerte, trop intelligent, il diserte la nature humaine avec beaucoup de pragmatique, comme une dissection, il a cette froideur d'un psychopathe, cette cruauté, qu'il reconnait. Il pense être un monstre.
« Elle voudrait lui vanter les mérites de la lâcheté, l'initier au génie de l'autruche »
Sylvie au fond d'elle rejette son fils, le sentant un Monstre. Lester pense que les êtres humains ne pensent qu'au plaisir du sexe. Lester méprise la nouvelle technologie, les téléphones portables, internet, le passage sur la Bataclan avec ce jeune garçon ayant perdu 4 doigts perturbe Lester, relaté par une fille sur internet, cette réflexion du rôle de la toile et sa rapidité à vomir ces informations, Lester est plus choqué par la manière de cette information est venue à lui, il la compare à la boue après une inondation,
« C'est une boue semblable à celle qui suit les inondations et cause autant de dégâts que l'eau elle-même »
Certes le roman oppose deux Amériques avec deux de ces personnages, Farah Asmanantou, une immigrée du Yémen, la directrice du département, maitresse d'Hector, son parcours laborieux, étudiant et récurant les toilettes des étudiants de Mathématiques en même temps, idéalisant le prochain vote des américains pour une femme Président des États-Unis, à son apposé, la femme de Jhersy Gonçalves, professeur de littérature espagnole, d'origine polonaise, Astrid, d'origine du Sud, issue de la septième génération dans le coton, côté raciste de cette belle Amérique, votant Donald Trump sans remords, ces deux femmes représentent bien cette dualité américaine, ouverte et fermée à la fois.
Pour finir avec ce roman, j'aurai aimé Agnès Desarthe écrire un vraie roman de femme, une vie de femme sans pudeur, allant dans le coeur et la chair de ces femmes, leur quotidien, leur désir, leur envie, leur faiblesse, leur fantasme, leur peur, leur vie…