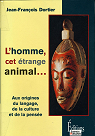Citations sur De Socrate à Foucault. Les philosophes au banc d'essai (15)
Chapitre I. Socrate
Retour sur une trop belle légende
« Socrate, un saint et un martyr. » Tout comme le Messie auquel il est parfois comparé, Socrate est un fondateur et un martyr : il a enseigné une pensée nouvelle, mais sulfureuse, ce pour quoi il fut condamné à mort et devint le saint martyr de la philosophie.
Voilà pour la légende.
Mais quand on se penche avec un peu d’esprit critique sur cette histoire, une tout autre facette apparaît.
À son nom sont associés les principes élémentaires de la philosophie : toujours questionner les dogmes et les idées reçues. Aussi est-il mis en scène dans de nombreux dialogues en train d’interpeller les Athéniens, de les pousser dans leurs retranchements et de les mettre devant leurs propres contradictions. Pour le philosophe, admettre ses erreurs est en effet le premier pas pour atteindre à la vérité.Socrate lui-même ne professe aucune doctrine, aucun système. Il se présente comme un esprit libre, détaché de tout dogme. Il avoue même, avec humilité, ne rien savoir : « Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien ». Ce constat d’ignorance serait la marque de la sagesse suprême.
Voilà donc Socrate tel qu’il nous est dépeint : Socrate le sage, Socrate le libre-penseur, Socrate le père de la philosophie… envoyé au trépas par une foule ignorante. Cette image fait partie des mythes que la philosophie a elle-même créés.
Retour sur une trop belle légende
« Socrate, un saint et un martyr. » Tout comme le Messie auquel il est parfois comparé, Socrate est un fondateur et un martyr : il a enseigné une pensée nouvelle, mais sulfureuse, ce pour quoi il fut condamné à mort et devint le saint martyr de la philosophie.
Voilà pour la légende.
Mais quand on se penche avec un peu d’esprit critique sur cette histoire, une tout autre facette apparaît.
À son nom sont associés les principes élémentaires de la philosophie : toujours questionner les dogmes et les idées reçues. Aussi est-il mis en scène dans de nombreux dialogues en train d’interpeller les Athéniens, de les pousser dans leurs retranchements et de les mettre devant leurs propres contradictions. Pour le philosophe, admettre ses erreurs est en effet le premier pas pour atteindre à la vérité.Socrate lui-même ne professe aucune doctrine, aucun système. Il se présente comme un esprit libre, détaché de tout dogme. Il avoue même, avec humilité, ne rien savoir : « Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien ». Ce constat d’ignorance serait la marque de la sagesse suprême.
Voilà donc Socrate tel qu’il nous est dépeint : Socrate le sage, Socrate le libre-penseur, Socrate le père de la philosophie… envoyé au trépas par une foule ignorante. Cette image fait partie des mythes que la philosophie a elle-même créés.
Chapitre IV. Michel de Montaigne
Le savoir sceptique
Michel de Montaigne a 38 ans lorsqu’il décide d’abandonner ses charges publiques et de se retirer dans son château. Il va pouvoir enfin se consacrer à ses Essais. Nous sommes en 1571.
Assis à son bureau, au sommet du pigeonnier qu’il a fait aménager en bibliothèque, il songe à sa jeunesse. Il se revoit enfant courant dans la cour du château familial. Son père avait voulu – selon des principes d’éducation très modernes – que l’enfant apprenne le latin sans effort, comme une langue vivante : précepteur et gens du château, tous sont contraints à ne parler qu’en latin devant l’enfant. Il se souvient de la surprise des autres élèves à son arrivée au collège de Bordeaux face à un garçon qui ne parlait que la langue de Cicéron !
Puis il y eut ses études de droit, ses débuts de magistrat au parlement de Bordeaux, sa rencontre avec son ami Étienne de la Boétie mort à l’âge de 33 ans, son mariage avec Françoise de La Chassaigne, ses six filles, toutes mortes en bas âge sauf sa petite Éléonore. Il songe à son père disparu l’année précédente.
Tous ces fantômes sont là lorsqu’il commence l’écriture des Essais.Toute l’entreprise des Essais repose sur ce principe inaugural : Montaigne sera l’objet de son livre. Oser parler de soi est une révolution mentale. Cette posture marque la naissance de l’humanisme (mettre l’homme et non Dieu au centre de l’univers).
Le savoir sceptique
Michel de Montaigne a 38 ans lorsqu’il décide d’abandonner ses charges publiques et de se retirer dans son château. Il va pouvoir enfin se consacrer à ses Essais. Nous sommes en 1571.
Assis à son bureau, au sommet du pigeonnier qu’il a fait aménager en bibliothèque, il songe à sa jeunesse. Il se revoit enfant courant dans la cour du château familial. Son père avait voulu – selon des principes d’éducation très modernes – que l’enfant apprenne le latin sans effort, comme une langue vivante : précepteur et gens du château, tous sont contraints à ne parler qu’en latin devant l’enfant. Il se souvient de la surprise des autres élèves à son arrivée au collège de Bordeaux face à un garçon qui ne parlait que la langue de Cicéron !
Puis il y eut ses études de droit, ses débuts de magistrat au parlement de Bordeaux, sa rencontre avec son ami Étienne de la Boétie mort à l’âge de 33 ans, son mariage avec Françoise de La Chassaigne, ses six filles, toutes mortes en bas âge sauf sa petite Éléonore. Il songe à son père disparu l’année précédente.
Tous ces fantômes sont là lorsqu’il commence l’écriture des Essais.Toute l’entreprise des Essais repose sur ce principe inaugural : Montaigne sera l’objet de son livre. Oser parler de soi est une révolution mentale. Cette posture marque la naissance de l’humanisme (mettre l’homme et non Dieu au centre de l’univers).
Chapitre VIII. Georg Hegel
En quête de l’esprit absolu
Georg Wilhelm Friedrich Hegel est à la philosophie ce que l’Everest est à l’alpinisme. Il est l’auteur qui assigne à la pensée le but le plus élevé : atteindre « l’esprit absolu », point culminant censé surplomber tous les savoirs qui l’ont précédé.
Ses livres sont d’une aridité déroutante, sa prose abstraite et souvent lourde. Hegel en avait d’ailleurs parfaitement conscience. Une légende raconte qu’au soir de sa mort (il a été emporté par le choléra en 1831), il aurait fait venir un de ses fidèles pour lui exprimer ses dernières volontés : « – Je veux que vous fassiez traduire mes œuvres. – Très bien, Maître, mais en quelle langue ? – En allemand. – Mais vos livres sont déjà en allemand ! »
On lui attribue aussi cette citation : « Il n’y a qu’une personne qui m’a vraiment compris, et encore ! Elle m’a mal compris. »
L’obscurité légendaire d’Hegel n’a d’égal que son ambition. L’esprit absolu qu’il se propose d’atteindre englobe la pensée de la nature, de l’histoire du monde et des idées. Car, pour Hegel, l’histoire des hommes et celle des idées sont une seule et même chose, même si elles se sont séparées. À terme, elles apparaîtront comme les deux faces d’une même réalité dont les contradictions doivent être dépassées. Loin d’être une marche paisible vers le progrès, l’histoire de l’esprit est une odyssée dramatique faite de conflits entre forces contraires qui doivent s’affronter et se déchirer, avant de finir par se réconcilier dans une synthèse qui marquera la fin de l’histoire
En quête de l’esprit absolu
Georg Wilhelm Friedrich Hegel est à la philosophie ce que l’Everest est à l’alpinisme. Il est l’auteur qui assigne à la pensée le but le plus élevé : atteindre « l’esprit absolu », point culminant censé surplomber tous les savoirs qui l’ont précédé.
Ses livres sont d’une aridité déroutante, sa prose abstraite et souvent lourde. Hegel en avait d’ailleurs parfaitement conscience. Une légende raconte qu’au soir de sa mort (il a été emporté par le choléra en 1831), il aurait fait venir un de ses fidèles pour lui exprimer ses dernières volontés : « – Je veux que vous fassiez traduire mes œuvres. – Très bien, Maître, mais en quelle langue ? – En allemand. – Mais vos livres sont déjà en allemand ! »
On lui attribue aussi cette citation : « Il n’y a qu’une personne qui m’a vraiment compris, et encore ! Elle m’a mal compris. »
L’obscurité légendaire d’Hegel n’a d’égal que son ambition. L’esprit absolu qu’il se propose d’atteindre englobe la pensée de la nature, de l’histoire du monde et des idées. Car, pour Hegel, l’histoire des hommes et celle des idées sont une seule et même chose, même si elles se sont séparées. À terme, elles apparaîtront comme les deux faces d’une même réalité dont les contradictions doivent être dépassées. Loin d’être une marche paisible vers le progrès, l’histoire de l’esprit est une odyssée dramatique faite de conflits entre forces contraires qui doivent s’affronter et se déchirer, avant de finir par se réconcilier dans une synthèse qui marquera la fin de l’histoire
Chapitre V. René Descartes
Les secrets cachés de la méthode
Durant la nuit du 10 au 11 novembre 1619, René Descartes, alors âgé de vingt-trois ans, fait trois rêves qui vont changer le cours de sa vie. Le jeune homme a fait halte dans un petit village d’Allemagne, sur les bords du Danube. Il est alors en garnison avec les troupes du duc de Bavière, auprès de qui il s’est engagé un peu plus tôt. Tandis que ses compagnons d’armes passent leurs soirées à boire et bavarder, lui préfère s’enfermer dans une petite chambre d’auberge. Là, il lit, étudie, prend des notes. Il a découvert depuis peu les charmes des mathématiques dans lesquelles il excelle. Elles lui offrent une nouvelle façon de penser le monde, dont il couve l’espoir de dévoiler les lois cachées…
Penser le monde à l’aide de la seule raison : voilà à quoi il va s’employer. Une révolution mentale est en cours. « La nature est écrite en langage mathématique », a dit Galilée quelques années plutôt. Les mathématiques ont donc ce pouvoir extraordinaire de décrypter les lois de la nature. Pour Descartes, c’est une révélation. Voilà un projet à la mesure de son ambition : il va mettre au jour les lois de la Création, conçues par un Dieu physicien qui a construit le monde selon un plan rationnel.
Les secrets cachés de la méthode
Durant la nuit du 10 au 11 novembre 1619, René Descartes, alors âgé de vingt-trois ans, fait trois rêves qui vont changer le cours de sa vie. Le jeune homme a fait halte dans un petit village d’Allemagne, sur les bords du Danube. Il est alors en garnison avec les troupes du duc de Bavière, auprès de qui il s’est engagé un peu plus tôt. Tandis que ses compagnons d’armes passent leurs soirées à boire et bavarder, lui préfère s’enfermer dans une petite chambre d’auberge. Là, il lit, étudie, prend des notes. Il a découvert depuis peu les charmes des mathématiques dans lesquelles il excelle. Elles lui offrent une nouvelle façon de penser le monde, dont il couve l’espoir de dévoiler les lois cachées…
Penser le monde à l’aide de la seule raison : voilà à quoi il va s’employer. Une révolution mentale est en cours. « La nature est écrite en langage mathématique », a dit Galilée quelques années plutôt. Les mathématiques ont donc ce pouvoir extraordinaire de décrypter les lois de la nature. Pour Descartes, c’est une révélation. Voilà un projet à la mesure de son ambition : il va mettre au jour les lois de la Création, conçues par un Dieu physicien qui a construit le monde selon un plan rationnel.
Chapitre XV. Michel Foucault
Quand « savoir » rime avec « pouvoir »
Le 2 décembre 1970, Michel Foucault, 44 ans, prononce son discours inaugural au Collège de France où il vient d’être élu. Le titre de sa conférence, « L’Ordre du discours », résume assez bien l’idée directrice de son œuvre. Par ce titre, il interroge les conditions de production du discours et sa façon d’organiser le savoir, mais aussi sa dimension disciplinaire, sa façon de « mettre en ordre le monde », son pouvoir. « L’Ordre du discours » associe donc deux notions habituellement disjointes : le savoir et le pouvoir. Toute l’entreprise de Foucault est là : débusquer la marque du pouvoir dans le savoir ; dévoiler ce qui se présente sous le visage de la vérité, mais dissimule en fait une entreprise de domination.
Si la volonté de savoir cache toujours une volonté de pouvoir, alors la philosophie, la théologie, la médecine et les sciences humaines ne sont pas épargnées. Elles sont toutes des « disciplines » qui, comme le mot l’indique, désignent à la fois un domaine d’étude et une instance de domination.
En 1961, Foucault fit une entrée très remarquée dans le monde intellectuel avec la publication de Histoire de la folie à l’âge classique. Le livre est organisé autour du récit du « grand renfermement ». Cet enfermement débute avec la création de l’Hôpital général de Paris en 1656. Cette date marque la fin d’une époque et le début d’une nouvelle façon de concevoir la folie.
Quand « savoir » rime avec « pouvoir »
Le 2 décembre 1970, Michel Foucault, 44 ans, prononce son discours inaugural au Collège de France où il vient d’être élu. Le titre de sa conférence, « L’Ordre du discours », résume assez bien l’idée directrice de son œuvre. Par ce titre, il interroge les conditions de production du discours et sa façon d’organiser le savoir, mais aussi sa dimension disciplinaire, sa façon de « mettre en ordre le monde », son pouvoir. « L’Ordre du discours » associe donc deux notions habituellement disjointes : le savoir et le pouvoir. Toute l’entreprise de Foucault est là : débusquer la marque du pouvoir dans le savoir ; dévoiler ce qui se présente sous le visage de la vérité, mais dissimule en fait une entreprise de domination.
Si la volonté de savoir cache toujours une volonté de pouvoir, alors la philosophie, la théologie, la médecine et les sciences humaines ne sont pas épargnées. Elles sont toutes des « disciplines » qui, comme le mot l’indique, désignent à la fois un domaine d’étude et une instance de domination.
En 1961, Foucault fit une entrée très remarquée dans le monde intellectuel avec la publication de Histoire de la folie à l’âge classique. Le livre est organisé autour du récit du « grand renfermement ». Cet enfermement débute avec la création de l’Hôpital général de Paris en 1656. Cette date marque la fin d’une époque et le début d’une nouvelle façon de concevoir la folie.
Chapitre XII. Karl Popper
Contre les systèmes clos
Karl Popper naît à Vienne, en 1902, à un moment où la capitale autrichienne est le centre culturel de l’Europe. Durant sa jeunesse, l’adolescent suit avec passion les débats intellectuels qui se nouent autour du marxisme, de la psychanalyse naissante, de la philosophie analytique du cercle de Vienne, de la théorie de la relativité du jeune Albert Einstein…
Très tôt, il est amené à s’interroger sur la scientificité de certaines de ces théories, notamment du marxisme auquel il adhérera un temps. Enseignant les mathématiques et la physique dans les collèges, il poursuit ses réflexions épistémologiques sur la nature de la science et publie en 1934 Logique de la découverte scientifique.
Né dans une famille juive protestante, l’arrivée du nazisme l’oblige à fuir en Nouvelle-Zélande. Après la guerre, il vient s’installer à Londres (grâce à l’intervention de son ami Friedrich von Hayek). Il y fera toute sa carrière comme enseignant de philosophie et de méthodologie scientifique à la célèbre London school of Economics, c’est là également qu’il publiera toute son œuvre.« À quelle(s) condition(s) une théorie est-elle scientifique ? » Telle est la question qui fonde toute l’œuvre de Popper. Son projet est de distinguer la véritable démarche scientifique des spéculations idéologiques ou métaphysiques.
Habituellement, on juge qu’une théorie est scientifique parce qu’elle est vérifiable. Or, pour Popper, ce qui définit la scientificité d’une proposition, ce n’est pas la vérification mais sa capacité à affronter des tests qui pourraient l’infirmer, la rendre fausse ou falsifiable.
Contre les systèmes clos
Karl Popper naît à Vienne, en 1902, à un moment où la capitale autrichienne est le centre culturel de l’Europe. Durant sa jeunesse, l’adolescent suit avec passion les débats intellectuels qui se nouent autour du marxisme, de la psychanalyse naissante, de la philosophie analytique du cercle de Vienne, de la théorie de la relativité du jeune Albert Einstein…
Très tôt, il est amené à s’interroger sur la scientificité de certaines de ces théories, notamment du marxisme auquel il adhérera un temps. Enseignant les mathématiques et la physique dans les collèges, il poursuit ses réflexions épistémologiques sur la nature de la science et publie en 1934 Logique de la découverte scientifique.
Né dans une famille juive protestante, l’arrivée du nazisme l’oblige à fuir en Nouvelle-Zélande. Après la guerre, il vient s’installer à Londres (grâce à l’intervention de son ami Friedrich von Hayek). Il y fera toute sa carrière comme enseignant de philosophie et de méthodologie scientifique à la célèbre London school of Economics, c’est là également qu’il publiera toute son œuvre.« À quelle(s) condition(s) une théorie est-elle scientifique ? » Telle est la question qui fonde toute l’œuvre de Popper. Son projet est de distinguer la véritable démarche scientifique des spéculations idéologiques ou métaphysiques.
Habituellement, on juge qu’une théorie est scientifique parce qu’elle est vérifiable. Or, pour Popper, ce qui définit la scientificité d’une proposition, ce n’est pas la vérification mais sa capacité à affronter des tests qui pourraient l’infirmer, la rendre fausse ou falsifiable.
Chapitre XI. Science et Philosophie
Une histoire d’amour en cinq actes
Cela commence par une histoire d’amour très fusionnelle entre philosophie et science. Mais le couple va bientôt se brouiller jusqu’au divorce. Depuis peu, les anciens amants se sont retrouvés et amorcent un timide dialogue.
La science et la philosophie sont nées dans le même berceau. Thalès, le fondateur de l’école de Milet, fut tout à la fois philosophe, astronome et mathématicien (découvreur du fameux théorème qui porte son nom). On peut en dire de même pour Pythagore (lui aussi a son théorème), Démocrite ou Aristote. Tous appartiennent à l’histoire des sciences autant qu’à celle de la philosophie pour une raison simple : dans l’Antiquité grecque, philosophie et science sont presque indissociables.
Dans la plupart des écoles philosophiques grecques (à l’Académie de Platon, au Lycée d’Aristote, mais aussi chez les stoïciens, épicuriens, pythagoriciens, éléates), on enseignait tout à la fois les mathématiques et l’astronomie autant que la rhétorique ou l’éthique (sans parler de la gymnastique et de la musique). Le philosophe est alors une sorte de décathlonien de la pensée. Cela ne veut pas dire qu’il ne fait pas distinction entre les sphères du savoir. Aristote par exemple s’attache à différencier les savoirs sur la nature (qui incluent la connaissance des astres, des éléments, des animaux) et les sciences de l’action (éthique, politique). Ces savoirs spécialisés sont considérés selon lui comme « seconds » par rapport à la « philosophie première », que l’un de ses élèves rebaptisera « métaphysique ».
Une histoire d’amour en cinq actes
Cela commence par une histoire d’amour très fusionnelle entre philosophie et science. Mais le couple va bientôt se brouiller jusqu’au divorce. Depuis peu, les anciens amants se sont retrouvés et amorcent un timide dialogue.
La science et la philosophie sont nées dans le même berceau. Thalès, le fondateur de l’école de Milet, fut tout à la fois philosophe, astronome et mathématicien (découvreur du fameux théorème qui porte son nom). On peut en dire de même pour Pythagore (lui aussi a son théorème), Démocrite ou Aristote. Tous appartiennent à l’histoire des sciences autant qu’à celle de la philosophie pour une raison simple : dans l’Antiquité grecque, philosophie et science sont presque indissociables.
Dans la plupart des écoles philosophiques grecques (à l’Académie de Platon, au Lycée d’Aristote, mais aussi chez les stoïciens, épicuriens, pythagoriciens, éléates), on enseignait tout à la fois les mathématiques et l’astronomie autant que la rhétorique ou l’éthique (sans parler de la gymnastique et de la musique). Le philosophe est alors une sorte de décathlonien de la pensée. Cela ne veut pas dire qu’il ne fait pas distinction entre les sphères du savoir. Aristote par exemple s’attache à différencier les savoirs sur la nature (qui incluent la connaissance des astres, des éléments, des animaux) et les sciences de l’action (éthique, politique). Ces savoirs spécialisés sont considérés selon lui comme « seconds » par rapport à la « philosophie première », que l’un de ses élèves rebaptisera « métaphysique ».
Chapitre X. Ludwig Wittgenstein
Le philosophe radical
Le personnage de Ludwig Wittgenstein relève d’un genre particulier : celui du penseur solitaire, en rupture avec le monde, et dont l’histoire fascine.
Sa vie débute à Vienne, en 1889, à l’époque où la capitale autrichienne rassemble toute l’élite intellectuelle européenne, de Robert Musil à Joseph Schumpeter, de Gustav Mahler à Sigmund Freud, de György Lukács à Karl Kraus.
La famille Wittgenstein semble frappée par deux lourds fardeaux, le génie et le suicide. Le génie d’abord. Karl, le père de Ludwig est un personnage hors du commun. À 20 ans, il avait déjà composé un opuscule philosophique et s’était enfui seul aux États-Unis avec pour tout bagage un violon. De retour en Autriche, il a rapidement fait fortune comme maître de forges. Magnat de l’industrie, sa richesse était monumentale, équivalente à celle des Krupp en Allemagne. Personnage éclatant, mondain, autoritaire, anticonformiste (il refuse l’anoblissement proposé par l’empereur), il brille en tout : musicien, c’est aussi un intellectuel (il écrit des articles d’économie et de philosophie), un amateur d’art et un mécène. Le tout Vienne défile chez lui : Brahms, Mahler sont venus jouer à la maison, le palais familial est orné de tableaux de Gustav Klimt et de sculptures d’Auguste Rodin.
Le philosophe radical
Le personnage de Ludwig Wittgenstein relève d’un genre particulier : celui du penseur solitaire, en rupture avec le monde, et dont l’histoire fascine.
Sa vie débute à Vienne, en 1889, à l’époque où la capitale autrichienne rassemble toute l’élite intellectuelle européenne, de Robert Musil à Joseph Schumpeter, de Gustav Mahler à Sigmund Freud, de György Lukács à Karl Kraus.
La famille Wittgenstein semble frappée par deux lourds fardeaux, le génie et le suicide. Le génie d’abord. Karl, le père de Ludwig est un personnage hors du commun. À 20 ans, il avait déjà composé un opuscule philosophique et s’était enfui seul aux États-Unis avec pour tout bagage un violon. De retour en Autriche, il a rapidement fait fortune comme maître de forges. Magnat de l’industrie, sa richesse était monumentale, équivalente à celle des Krupp en Allemagne. Personnage éclatant, mondain, autoritaire, anticonformiste (il refuse l’anoblissement proposé par l’empereur), il brille en tout : musicien, c’est aussi un intellectuel (il écrit des articles d’économie et de philosophie), un amateur d’art et un mécène. Le tout Vienne défile chez lui : Brahms, Mahler sont venus jouer à la maison, le palais familial est orné de tableaux de Gustav Klimt et de sculptures d’Auguste Rodin.
Chapitre IX. Edmund Husserl
Les arbres en fleurs et la phénoménologie
Edmund Husserl est assis à sa table de travail dans sa maison de Göttingen. Nous sommes en 1910. Il rédige ses Idées directrices pour une phénoménologie, manuscrit sur lequel il travaille depuis des années et qu’il a maintes fois repris et remanié. C’est le printemps et le philosophe austro-allemand voit par la fenêtre un arbre en fleurs. Cet arbre, pense-t-il, est peut-être un bon moyen pour expliquer quelques-unes des idées clés de la nouvelle philosophie qu’il veut promouvoir : la phénoménologie.
« Prenons cet arbre en fleurs, écrit Husserl, c’est la chose, l’objet de la nature que je perçois ; là-bas, dans le jardin ». Ceci est un arbre réel, mais fermons les yeux et oublions cet arbre-là pour penser à la notion d’arbre.
Alors que la nature nous présente des objets réels sous différents états – platane, sapin ou cerisier en fleurs – la pensée peut en extraire un schéma abstrait, une idée pure, une « essence » qui transcende toutes les figures contingentes. L’idée d’arbre est bien formée d’un tronc et de branches. C’est la forme générale, le « noyau commun » qui s’impose lorsqu’on y pense.
Ces idées pures, ou « essence », qui organisent notre pensée, et qui donnent du sens à l’objet : voilà l’objet de la phénoménologie que Husserl entend promouvoir. Elle doit, selon lui, proposer une nouvelle voie pour la philosophie et la sortir de la crise qu’elle connaît alors.
Les arbres en fleurs et la phénoménologie
Edmund Husserl est assis à sa table de travail dans sa maison de Göttingen. Nous sommes en 1910. Il rédige ses Idées directrices pour une phénoménologie, manuscrit sur lequel il travaille depuis des années et qu’il a maintes fois repris et remanié. C’est le printemps et le philosophe austro-allemand voit par la fenêtre un arbre en fleurs. Cet arbre, pense-t-il, est peut-être un bon moyen pour expliquer quelques-unes des idées clés de la nouvelle philosophie qu’il veut promouvoir : la phénoménologie.
« Prenons cet arbre en fleurs, écrit Husserl, c’est la chose, l’objet de la nature que je perçois ; là-bas, dans le jardin ». Ceci est un arbre réel, mais fermons les yeux et oublions cet arbre-là pour penser à la notion d’arbre.
Alors que la nature nous présente des objets réels sous différents états – platane, sapin ou cerisier en fleurs – la pensée peut en extraire un schéma abstrait, une idée pure, une « essence » qui transcende toutes les figures contingentes. L’idée d’arbre est bien formée d’un tronc et de branches. C’est la forme générale, le « noyau commun » qui s’impose lorsqu’on y pense.
Ces idées pures, ou « essence », qui organisent notre pensée, et qui donnent du sens à l’objet : voilà l’objet de la phénoménologie que Husserl entend promouvoir. Elle doit, selon lui, proposer une nouvelle voie pour la philosophie et la sortir de la crise qu’elle connaît alors.
Chapitre II. Platon
Le philosophe qui voulait être roi
Platon est souvent présenté comme le père de la philosophie. Il est en tout cas l’une des trois figures principales de la pensée grecque avec Socrate, qui fut son maître, et Aristote, qui fut son élève. Il a fondé l’une des plus importantes écoles philosophiques de l’Antiquité grecque, qui perdurera pendant trois siècles et évoluera sous l’impulsion de ses successeurs et de leur doctrine : l’Académie, créée à Athènes en 387 av. J.-C.
Platon est l’auteur d’une œuvre volumineuse, composée essentiellement de dialogues dont chacun est associé à un thème particulier, et dans lesquels interviennent des membres de son entourage, ce qui explique pourquoi leur titre fait référence à des noms propres (Phédon, Critias, Gorgias). Seuls Le Banquet, Les Lois et La République, qui est son œuvre majeure, font exception. Dans La République, Platon défend une idée cardinale : il existe un monde d’idées vraies et immuables qui ne sont accessibles qu’à une petite élite de sages qui, sachant ce qui est juste et bien, sont seuls capables de gouverner la cité. Mais on ne saurait entrer dans cette œuvre sans connaître son auteur : car il y a un lien étroit entre la vie de Platon, sa position sociale, sa vision du monde, de la société et de la connaissance.
Qui était donc Platon ? Platon est un héritier. Héritier de l’une des plus grandes familles aristocratiques d’Athènes, hériter spirituel de son maître Socrate. Socrate éduquait en effet de « jeunes gens » se destinant à diriger la cité. On ne peut comprendre l’idéalisme de Platon sans l’associer à cette vision élitiste de la société.
Le philosophe qui voulait être roi
Platon est souvent présenté comme le père de la philosophie. Il est en tout cas l’une des trois figures principales de la pensée grecque avec Socrate, qui fut son maître, et Aristote, qui fut son élève. Il a fondé l’une des plus importantes écoles philosophiques de l’Antiquité grecque, qui perdurera pendant trois siècles et évoluera sous l’impulsion de ses successeurs et de leur doctrine : l’Académie, créée à Athènes en 387 av. J.-C.
Platon est l’auteur d’une œuvre volumineuse, composée essentiellement de dialogues dont chacun est associé à un thème particulier, et dans lesquels interviennent des membres de son entourage, ce qui explique pourquoi leur titre fait référence à des noms propres (Phédon, Critias, Gorgias). Seuls Le Banquet, Les Lois et La République, qui est son œuvre majeure, font exception. Dans La République, Platon défend une idée cardinale : il existe un monde d’idées vraies et immuables qui ne sont accessibles qu’à une petite élite de sages qui, sachant ce qui est juste et bien, sont seuls capables de gouverner la cité. Mais on ne saurait entrer dans cette œuvre sans connaître son auteur : car il y a un lien étroit entre la vie de Platon, sa position sociale, sa vision du monde, de la société et de la connaissance.
Qui était donc Platon ? Platon est un héritier. Héritier de l’une des plus grandes familles aristocratiques d’Athènes, hériter spirituel de son maître Socrate. Socrate éduquait en effet de « jeunes gens » se destinant à diriger la cité. On ne peut comprendre l’idéalisme de Platon sans l’associer à cette vision élitiste de la société.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean-François Dortier (24)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
441 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre441 lecteurs ont répondu