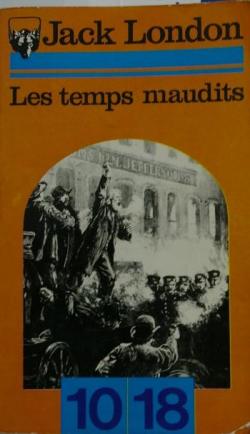>
Critique de Laureneb
Le titre place ces nouvelles à la fois sous un angle religieux et politique révolutionnaire.
D'abord, l''adjectif « maudit » renvoie à la malédiction divine, les hommes devenus obligés de travailler à la sueur de leur front pour se nourrir après la Chute. Il est donc beaucoup question de pain, de nourriture, mais à travers le prisme du manque : les personnages ont faim, constamment. C'est le boxeur qui pense au bifteck qu'il n'a pas mangé et qui l'empêche de se battre avec suffisamment d'énergie. C'est la mère qui se prive pour nourrir ses enfants, tandis que l'aîné de la fratrie se restreint pour nourrir ses petits frères. Ce sont les hommes préhistoriques qui inventent des techniques de pêche et d'agriculture. Il faut donc souffrir au travail pour manger, ce qui pèse sur les corps, tous maigres, rachitiques, pâles, toussant à force d'inhaler les poussières de l'usine.
Ensuite, « maudits » renvoie aussi aux « damnés ». Et là, on pense aux « damnés de la terre » de l'Internationale – qui évoque d'ailleurs dès le 2ème vers « les forçats de la faim ». J'ai eu l'impression que London voulait illustrer à différentes époques la mainmise du capitalisme sur le prolétariat, pour appeler à la révolution. A ce titre, la 1ère nouvelle est un apologue, un récit narratif à portée morale : un homme préhistorique évoque la fondation d'une société, lorsque des hommes indépendants s'unissent pour, au départ, être plus forts ensemble en formant une tribu. Mais très vite, trois maux qui agissent ensemble apparaissent pour les opprimer : le pouvoir, la religion et l'argent. le pouvoir, c'est celui qui a la force, celui qui peut frapper les autres avec arbitraire. La religion, c'est celui qui manipule les autres par de fausses promesses. Et l'argent, c'est celui qui vit, s'enrichit et s'engraisse par le travail des autres, qui, eux, dépendent de lui pour se nourrir. C'est une sorte de mythe des origines, le capitalisme vient de la naissance même de la société humaine, même s'il est très perturbant de lire des hommes préhistoriques parler au passé simple... le style d'écriture et les temps des verbes n'ont pas été adaptés au contexte, du moins dans la version traduite.
Après cet apologue, les autres nouvelles reprennent le même thème, et la même thèse, de façon très appuyée, en martelant même le message. La deuxième nouvelle pourrait d'abord être du Dickens, un enfant obligé de travailler pour nourrir sa famille dans une fabrique sombre, poussiéreuse, pour quelques centimes. C'est sombre, larmoyant, misérabiliste presque. Et elle finit en conte philosophique lumineux, baigné littéralement de soleil, lorsque le jeune adulte décide de tout quitter pour profiter de la vie. Deux nouvelles présentent des boxeurs, qui combattent non par amour de la violence, mais pour leur idéal : servir la révolution ou nourrir sa famille. Il y a une certaine beauté mélancolique dans la description du vieux boxeur face à la jeunesse, qui ne recherche plus la gloire mais juste un peu d'argent pour son loyer et ses enfants. le corps est donc, dans sa matérialité, sa corporéité, un élément du combat pour la « lutte finale ».
Mais face à la domination, la révolte ne pourra être que collective. Les prolétaires doivent s'unir. C'est ce que comprend Bill Tots qui organise des syndicats. Bill Tots est un personnage intéressant car il pourrait être l'inverse de Martin Eden : c'est la fausse identité d'un universitaire venant étudier en sociologue, les prolétaires dans leur milieu, se déguisant en travailleur pour se fondre parmi eux. Mais, progressivement, il apprécie la liberté des prolétaires : ils parlent, jouent, chantent, désirent et aiment... sans contrainte. La fausse identité devient la réelle, le sociologue bourgeois disparaît pour endosser définitivement les habits du porte-fait. Cette union des travailleurs devra mener à la grève générale, comme dans « Le rêve de Debs » qui est, de manière significative, la dernière nouvelle, ou comme dans le roman de London le Talon de fer qui approfondit la thématique. Mais ce dernier récit est plutôt drôle – en partie du moins, car il se place du point de vue des riches bourgeois : pour eux, grève générale veut dire un chauffeur qui ne les conduit plus, plus de livraison de lait frais, et plus d'olives dans les cocktails servis au club, dont les serviteurs sont eux aussi en grève d'ailleurs.
Différents récits engagés donc, dommage que certains soient un peu rapides, ce qui empêche de s'intéresser vraiment aux personnages, qui sont des types, des stéréotypes même, plus que de véritables individualités.
D'abord, l''adjectif « maudit » renvoie à la malédiction divine, les hommes devenus obligés de travailler à la sueur de leur front pour se nourrir après la Chute. Il est donc beaucoup question de pain, de nourriture, mais à travers le prisme du manque : les personnages ont faim, constamment. C'est le boxeur qui pense au bifteck qu'il n'a pas mangé et qui l'empêche de se battre avec suffisamment d'énergie. C'est la mère qui se prive pour nourrir ses enfants, tandis que l'aîné de la fratrie se restreint pour nourrir ses petits frères. Ce sont les hommes préhistoriques qui inventent des techniques de pêche et d'agriculture. Il faut donc souffrir au travail pour manger, ce qui pèse sur les corps, tous maigres, rachitiques, pâles, toussant à force d'inhaler les poussières de l'usine.
Ensuite, « maudits » renvoie aussi aux « damnés ». Et là, on pense aux « damnés de la terre » de l'Internationale – qui évoque d'ailleurs dès le 2ème vers « les forçats de la faim ». J'ai eu l'impression que London voulait illustrer à différentes époques la mainmise du capitalisme sur le prolétariat, pour appeler à la révolution. A ce titre, la 1ère nouvelle est un apologue, un récit narratif à portée morale : un homme préhistorique évoque la fondation d'une société, lorsque des hommes indépendants s'unissent pour, au départ, être plus forts ensemble en formant une tribu. Mais très vite, trois maux qui agissent ensemble apparaissent pour les opprimer : le pouvoir, la religion et l'argent. le pouvoir, c'est celui qui a la force, celui qui peut frapper les autres avec arbitraire. La religion, c'est celui qui manipule les autres par de fausses promesses. Et l'argent, c'est celui qui vit, s'enrichit et s'engraisse par le travail des autres, qui, eux, dépendent de lui pour se nourrir. C'est une sorte de mythe des origines, le capitalisme vient de la naissance même de la société humaine, même s'il est très perturbant de lire des hommes préhistoriques parler au passé simple... le style d'écriture et les temps des verbes n'ont pas été adaptés au contexte, du moins dans la version traduite.
Après cet apologue, les autres nouvelles reprennent le même thème, et la même thèse, de façon très appuyée, en martelant même le message. La deuxième nouvelle pourrait d'abord être du Dickens, un enfant obligé de travailler pour nourrir sa famille dans une fabrique sombre, poussiéreuse, pour quelques centimes. C'est sombre, larmoyant, misérabiliste presque. Et elle finit en conte philosophique lumineux, baigné littéralement de soleil, lorsque le jeune adulte décide de tout quitter pour profiter de la vie. Deux nouvelles présentent des boxeurs, qui combattent non par amour de la violence, mais pour leur idéal : servir la révolution ou nourrir sa famille. Il y a une certaine beauté mélancolique dans la description du vieux boxeur face à la jeunesse, qui ne recherche plus la gloire mais juste un peu d'argent pour son loyer et ses enfants. le corps est donc, dans sa matérialité, sa corporéité, un élément du combat pour la « lutte finale ».
Mais face à la domination, la révolte ne pourra être que collective. Les prolétaires doivent s'unir. C'est ce que comprend Bill Tots qui organise des syndicats. Bill Tots est un personnage intéressant car il pourrait être l'inverse de Martin Eden : c'est la fausse identité d'un universitaire venant étudier en sociologue, les prolétaires dans leur milieu, se déguisant en travailleur pour se fondre parmi eux. Mais, progressivement, il apprécie la liberté des prolétaires : ils parlent, jouent, chantent, désirent et aiment... sans contrainte. La fausse identité devient la réelle, le sociologue bourgeois disparaît pour endosser définitivement les habits du porte-fait. Cette union des travailleurs devra mener à la grève générale, comme dans « Le rêve de Debs » qui est, de manière significative, la dernière nouvelle, ou comme dans le roman de London le Talon de fer qui approfondit la thématique. Mais ce dernier récit est plutôt drôle – en partie du moins, car il se place du point de vue des riches bourgeois : pour eux, grève générale veut dire un chauffeur qui ne les conduit plus, plus de livraison de lait frais, et plus d'olives dans les cocktails servis au club, dont les serviteurs sont eux aussi en grève d'ailleurs.
Différents récits engagés donc, dommage que certains soient un peu rapides, ce qui empêche de s'intéresser vraiment aux personnages, qui sont des types, des stéréotypes même, plus que de véritables individualités.