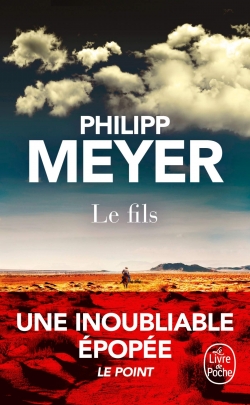>
Critique de Arakasi
A 80 ans passés, « le Colonel » Eli McCullough est une légende au Texas. Plusieurs années de vie parmi les Comanches, suivies d'une brève mais mémorable carrière militaire durant la guerre de Sécession et d'une ascension fulgurante dans le monde de l'élevage ont drapé sa personne d'une auréole d'héroïsme et d'invincibilité. Mais tout le monde ne partage pas cette admiration béate. Surhomme pour les paysans et les vaqueros mexicains qu'il tyrannise pourtant sans état d'âme, il n'est qu'une brute amorale aux yeux de son fils Pete, un révolver vivant braqué sur le reste du monde. En revanche, aux yeux de son arrière-petite-fille Jeannie, « le Colonel » est un aïeul prestigieux et omniscient, un exemple à suivre mais surtout le seul homme de sa famille qui lui ait témoigné attention et respect malgré sa condition de fillette née dans un univers de mâles. Mais connait-on réellement un homme tant que l'on n'a pas marché dans ses bottes, respiré par ses poumons, vu le monde par ses yeux ?
Ce n'est pas un seul point de vue, mais trois que nous propose Philipp Meyer. le premier est celui d'Eli McCullough, le patriarche de la famille et le personnage central du roman, celui autour duquel et par rapport auquel se définiront tous les autres, que ce soit pour l'imiter ou pour fuir son influence écrasante. Enlevé à treize ans par les Comanches après avoir vu sa famille se faire massacrer, il a été élevé comme un jeune indien et s'est profondément attaché à la vie sauvage et libre des plaines avant de revenir vers la civilisation nanti d'une conviction féroce – rien n'a jamais été acquis autrement que par la force – et d'une volonté forcenée de faire fortune. Un point de vue radical que ne pourra jamais partager son fils Pete, homme sensible et doux qui tentera, bien des années plus tard, de se libérer des chaînes paternelles et de trouver sa place dans un monde où sensibilité et douceur sont considérées comme des marques de faiblesse. Troisième et dernier point de vue, Jeannie, petite-fille de Pete et arrière-petite-fille d'Eli, luttera jusqu'au bout de ses forces pour reprendre le flambeau familial et se faire respecter à l'égal de ses parents masculins dans la sphère sans merci de l'industrie pétrolière.
A travers ces trois points de vue alternés et échelonnés sur différentes époques – de 1850 à 1880 pour Eli, 1918 pour Pete et de 1930 à nos jours pour Jeannie – Philipp Meyer nous offre une fabuleuse saga familiale et un des portraits les plus frappants du l'Ouest américain que j'ai pu lire. Amatrice de western, j'étais tout à fait disposée à me laisser emporter par l'épopée aventureuse d'Eli, mais j'ai eu l'agréable surprise de découvrir dans Pete et Jeannie des personnages tout aussi dignes d'intérêt. Leurs trois visions du monde se complètent et s'affrontent pour former un roman puissant, addictif et d'une immense richesse humaine. Je les ai tous aimés, quoique pour différentes raisons – Oui, oui, même ce rustre d'Eli, malgré sa dureté et sa philosophie de vie taillée à la hachette !
Le Texas est le quatrième personnage principal du roman et peut-être le plus important. Terre de feu et de fureur, aussi assoiffé de sang que les veines d'un ivrogne d'alcool, il a vu se dérouler sur son sol crevassé plus de meurtres, de rapts et de crimes que dans presque tout le reste des Etats-Unis. Pas la moindre trace d'angélisme ou de manichéisme dans « le Fils » : Blancs, Mexicains et Indiens partagent tous cet héritage de violence – la principale différence qui les sépare étant que les deux premiers groupes doublent leur barbarie d'hypocrisie, alors que les Indiens l'assument sans ambiguïté. En avançant dans ma lecture, j'ai souvent songé à la célèbre phrase du général Sheridan qui, décidemment, n'aimait guère les Etats du Sud : « Si j'étais propriétaire du Texas et de l'Enfer, je mettrai le Texas en location et je vivrais en Enfer. » A qui le dis-tu, mon gars…
Une aura tragique nimbe également ce portrait de l'Ouest américain que nous serons condamnés à voir se déliter, génération après génération. Nous verrons mourir et brûler les forêts et les plaines opulentes de l'enfance d'Eli, progressivement remplacées par les champs des cultivateurs et les derricks des chercheurs de pétrole qui assécheront et saccageront le sol texan. Tragédies personnelles et tragédie de la terre assassinée se conjuguent alors pour donner un magnifique roman, plein de brutalité, de cruauté et de rudesse, mais aussi débordant de beauté et de cette mélancolie touchante et profonde propre aux choses perdues et qui jamais, jamais ne reviendront. de la très belle littérature !
Ce n'est pas un seul point de vue, mais trois que nous propose Philipp Meyer. le premier est celui d'Eli McCullough, le patriarche de la famille et le personnage central du roman, celui autour duquel et par rapport auquel se définiront tous les autres, que ce soit pour l'imiter ou pour fuir son influence écrasante. Enlevé à treize ans par les Comanches après avoir vu sa famille se faire massacrer, il a été élevé comme un jeune indien et s'est profondément attaché à la vie sauvage et libre des plaines avant de revenir vers la civilisation nanti d'une conviction féroce – rien n'a jamais été acquis autrement que par la force – et d'une volonté forcenée de faire fortune. Un point de vue radical que ne pourra jamais partager son fils Pete, homme sensible et doux qui tentera, bien des années plus tard, de se libérer des chaînes paternelles et de trouver sa place dans un monde où sensibilité et douceur sont considérées comme des marques de faiblesse. Troisième et dernier point de vue, Jeannie, petite-fille de Pete et arrière-petite-fille d'Eli, luttera jusqu'au bout de ses forces pour reprendre le flambeau familial et se faire respecter à l'égal de ses parents masculins dans la sphère sans merci de l'industrie pétrolière.
A travers ces trois points de vue alternés et échelonnés sur différentes époques – de 1850 à 1880 pour Eli, 1918 pour Pete et de 1930 à nos jours pour Jeannie – Philipp Meyer nous offre une fabuleuse saga familiale et un des portraits les plus frappants du l'Ouest américain que j'ai pu lire. Amatrice de western, j'étais tout à fait disposée à me laisser emporter par l'épopée aventureuse d'Eli, mais j'ai eu l'agréable surprise de découvrir dans Pete et Jeannie des personnages tout aussi dignes d'intérêt. Leurs trois visions du monde se complètent et s'affrontent pour former un roman puissant, addictif et d'une immense richesse humaine. Je les ai tous aimés, quoique pour différentes raisons – Oui, oui, même ce rustre d'Eli, malgré sa dureté et sa philosophie de vie taillée à la hachette !
Le Texas est le quatrième personnage principal du roman et peut-être le plus important. Terre de feu et de fureur, aussi assoiffé de sang que les veines d'un ivrogne d'alcool, il a vu se dérouler sur son sol crevassé plus de meurtres, de rapts et de crimes que dans presque tout le reste des Etats-Unis. Pas la moindre trace d'angélisme ou de manichéisme dans « le Fils » : Blancs, Mexicains et Indiens partagent tous cet héritage de violence – la principale différence qui les sépare étant que les deux premiers groupes doublent leur barbarie d'hypocrisie, alors que les Indiens l'assument sans ambiguïté. En avançant dans ma lecture, j'ai souvent songé à la célèbre phrase du général Sheridan qui, décidemment, n'aimait guère les Etats du Sud : « Si j'étais propriétaire du Texas et de l'Enfer, je mettrai le Texas en location et je vivrais en Enfer. » A qui le dis-tu, mon gars…
Une aura tragique nimbe également ce portrait de l'Ouest américain que nous serons condamnés à voir se déliter, génération après génération. Nous verrons mourir et brûler les forêts et les plaines opulentes de l'enfance d'Eli, progressivement remplacées par les champs des cultivateurs et les derricks des chercheurs de pétrole qui assécheront et saccageront le sol texan. Tragédies personnelles et tragédie de la terre assassinée se conjuguent alors pour donner un magnifique roman, plein de brutalité, de cruauté et de rudesse, mais aussi débordant de beauté et de cette mélancolie touchante et profonde propre aux choses perdues et qui jamais, jamais ne reviendront. de la très belle littérature !