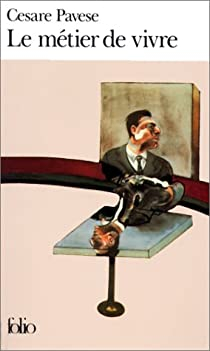>
Il faut travailler, sinon par goût, du moins par désespoir»
(Baudelaire)
Tenu une quinzaine d'années, à partir de 1935, jusqu'en 1950, une semaine jour pour jour avant que son auteur ait décidé de se taire une fois pour toutes («Pas de paroles. Un geste. Je n'écrirai plus», note-t-il le 18 août 1950), la lecture du journal de Cesare Pavese ne ressemblerait pour moi à aucune autre dans le genre.
Sans aucun doute l'une des pièces maîtresses de l'oeuvre de l'Italien météorique. constamment relu et révisé par son auteur, doté par ses soins, année après année, de nombreux renvois entre les entrées qui le constituent, titré (magnifiquement !) comme s'il s'agissait d'un essai ou un d'un roman, Pavese semble avoir accordé à son journal intime la même importance et la même attention industrieuse qu'il avait vouées à son oeuvre de poète, d'essayiste et romancier, et avoir visiblement souhaité aussi qu'il soit lu par d'autres.
Un ouvrage inclassable, disais-je, en tant que journal. Pratiquement exempte, entre autres, de tous ces détails liés à la vie quotidienne, registres qui alourdissent souvent d'une dimension prosaïque et d'agenda les journaux personnels, par des tas d'«éphémérités» sans grand intérêt, à part pour l'auteur lui-même ou pour ses éventuels biographes.
En compensation, le lecteur pourra avoir le sentiment de voir peu à peu s'y installer un fil souterrain, une trame en quelque sorte, entre des instantanés égrenés au fil des jours qui passent - et qui se ressemblent, rajouterait certainement l'auteur («Ce qui arrive une fois arrive toujours»).
Quoique fragmentaires par définition, parfois trop elliptiques ou évanescents, voire trop abstraits et/ou difficiles à saisir dans leur complétion plus ou moins télégraphique ou, aux choix, dans leur incomplétude relative, ces «instantanés subjectifs» paraîtront cependant reposer sur un lit commun, et dégager une cohérence interne en lien plutôt avec la construction de la pensée, les impressions et les réactions à vif de l'auteur qu'avec, donc, des faits ou évènements concrets les ayant provoquées, et dont par ailleurs on n'apprendra pas grand-chose, ou bien le strict minimum.
Remarquablement agencés d'autre part par l'obsession de Pavese vis-à-vis de cette «unité formelle» qu'il cherchait à donner à ses écrits en général, à sa poésie autant qu'à sa prose, le tout finit par ressembler, non pas un journal à proprement parler, mais davantage à un long monologue intérieur, certes accidenté et discontinu, mais pourvu d'une dimension et d'une intensité narratives indéniables, ainsi que d'un vrai dénouement dramatique, découlant en toute logique – malheureusement ici, puisqu'il ne s'agit pas d'un personnage de fiction –de ce qui avait précédé.
Métier de vivre : naissance et mort d'une fiction personnelle qu'on compose par-devers soi mais dont le contrôle nous échappera forcément!
«Ces notes de journal ne comptent pas à cause de leur découverte explicite, mais à cause des aperçus qu'elles ouvrent sur la manière que j'ai inconsciemment d'être. Ce que je dis n'est pas vrai mais trahit -par le seul fait que je le dis- mon être.»
Constitué d'une part de considérations et de réflexions originales autour de la littérature, notamment autour du sens et de l'objectif qu'il veut accorder à son oeuvre de poète et de romancier, mais aussi sur l'art en général et les tentatives de représenter le réel par la pensée, par le langage et les symboles, ainsi que d'un florilège exceptionnel d'aphorismes et de méditations, morales et existentielles, la plupart du temps d'une profondeur et d'une justesse époustouflantes, issues en grande partie de l'auto-observation très affûtée auquel son auteur s'abandonnera volontiers, et… d'autre part, très paradoxalement, d'extraits, certains en vrac, absolument sans filtre, issus, dirait-on, des carnets intimes de quelqu'un de très immature sur le plan émotionnel et affectif (selon Natalia Ginzburg, amie proche de l'écrivain et coéditrice de la première édition de son journal, Pavese serait resté toute sa vie «un éternel adolescent»), s'exprimant souvent de manière choquante ou vulgaire, asocial, en mal de conquêtes féminines, s'épanchant sans retenue sur ses frustrations et sur son incapacité à satisfaire pleinement une femme (jusqu'à assumer un mépris teinté de misogynie vis-à-vis de celles qui, selon lui, se jouent à chaque fois de sa candeur en matière amoureuse) - dressant en filigrane, parallèlement à une dimension apollinienne à laquelle la pensée insisterait à s'accrocher, un inventaire sans concession de ses faiblesses et de ses contradictions, du découragement et du mal-être qui semblent coller à la peau d'un homme ne pouvant s'empêcher de se mesurer sans cesse à des idéaux que, soit il considèrera comme étant hors de sa portée, soit avec lesquels il peinera à vouloir négocier - le Métier de Vivre est une lecture fondamentalement contrastée, qui ne s'avèrera pas toujours commode, qui bousculera et instiguera la curiosité de ceux que s'y risqueront.
Balloté constamment entre des extrêmes, frôlant les grands sommets de la pensée et les bas fond de la psyché, le lecteur doit s'habituer aux exercices de grand-écart entre le sublime et l'indigne auquel Pavese se livre sans inhibitions, sans artifices, écarts à certains moments, il faut le dire, totalement incompréhensibles, en tout cas vus de l'extérieur (Mais, à y réfléchir, ne pourrait-on pas avancer que ce serait, peu ou prou, le cas de tout un chacun, chaque subjectivité comportant des contrastes entre ses zones d'ombre et de lumière, qu'on essaiera dans la mesure du possible, avec plus ou moins de succès selon les situations, de gommer face à autrui ?). Faudrait-il pour autant jeter le « pavese » dans la mare ? Rappeler aussi sa sympathie dans un premier temps pour le parti fasciste (mais il faudrait alors évoquer également sa peine de «confino», suite à une suspicion de trahison, ou encore son adhésion postérieure au parti communiste italien...)
Pour l'avoir lu, je ne pense pas. Trop simpliste, à mon avis.
« Il faut se détacher de tout pour se rapprocher de tout. Jouir de chaque chose de manière profane mais avec un détachement sacré. Avec un coeur pur.»
Le métier de vivre pour Cesare Pavese devrait cependant s'exercer dans une tension trop élevée, trop continue, et trop dangereuse entre des contraires.
Indépendamment de l'attrait manifeste pour l'autodestruction qu'on peut y déceler, et contre lequel Pavese semble malgré tout s'être courageusement battu durant une grande partie de sa courte existence - ainsi que l'attesterait également ce «journal»-, le Métier de Vivre reste l'un des témoignages les plus poignants qu'il m'ait jamais été donné de lire à propos de ces paradoxes inextricables, en même temps universels et consubstantiels à ce qu'on appelle notre solitude ontologique, à savoir, de cette volupté, et en même temps lassitude que l'on éprouve à certains moments à être soi et à n'être que soi, à rechercher invariablement soi-même dans le regard des autres et dans les nouvelles expériences de la vie, tout en désirant à la fois être comme ces autres à qui l'on attribue alors ce qui nous manque, ou enfin à s'appliquer à faire coïncider une irréductible liberté à être soi, avec la force ferme de sens d'un destin particulier qui nous aurait été attribué (ou comme dirait Pavese à ce propos, l'illusion, même lorsqu'il s'agira d'un malheur, que ce dernier «ne t'est pas arrivé par hasard mais parce que, in alio loco, on t'en veut, ce qui pourrait vouloir dire que, in alio loco, tu comptes»).
«L'art de ne pas se laisser décourager par les réactions d'autrui (…) L'art de nous mentir à nous-mêmes en sachant que nous mentons. L'art de regarder les gens en face, nous-mêmes compris, comme si c'étaient les personnages d'une de nos nouvelles. L'art de se rappeler toujours que, nous-mêmes ne comptant pour rien et aucun des autres ne comptant pour rien, nous comptons plus que chacun, simplement parce que nous sommes nous-mêmes (…) L'art de toucher de façon foudroyante le fond de la douleur, pour remonter d'un coup de talon. L'art de nous substituer à chacun et de savoir en conséquence que chacun s'intéresse seulement à soi. L'art d'attribuer n'importe lequel de nos gestes à un autre, pour nous faire voir à l'instant s'il est sensé.
L'art de se passer de l'art.
L'art d'être seul.»
Une ambition aux substrats à la base féconds, prometteurs, terroir de semailles multiples et fructueuses, mais qui inaugurera aussi de longues périodes de sécheresse vitale pour l'auteur. Et si les ténèbres ne réussiront jamais à infiltrer complètement le paysage, les éclairs lumineux de la pensée seront en revanche guidés par une flamme impossible à contempler longtemps, au risque d'en être aveuglé.
«Avoir un goût libidineux pour l'abattement, pour l'abandon, pour l'énervante douceur, et une volonté impitoyable de réagir, mâchoire serrée, exclusive et tyrannique, est une promesse d'éternelle et féconde vie intérieure.»
Pavese voudrait incarner une sorte d'Hamlet moderne, déchiré comme son modèle entre un désir d'être et de ne pas être, d'être aimé, reconnu en tant qu'homme par une femme, en tant qu'intellectuel et écrivain de génie par ses pairs, et celui de cesser de jouer la comédie vis-à-vis des autres et de soi-même afin d'y arriver, ambitionnant par-dessus tout de faire cavalier solitaire et d'approcher, peut-être comme aucun autre de ses contemporains, le «coeur sauvage des choses» (sic).
L'on assistera toutefois au long de ces pages à une course éperdue (et perdue d'avance en quelque sorte) : celle d'un homme dans un état perpétuel et fiévreux de quête de sens, sens à donner à son apprentissage de la vie et à la souffrance morale qui en découle pour lui (un mot qui revient très souvent dans ces notes), autant qu'à son métier de poète et d'écrivain.
Pavese donne l'impression de courir après des projections fragiles et inconstantes, insuffisantes en tout cas à juguler ou à apaiser durablement ses pulsions d'autodestruction : projections de se laisser vivre simplement, de sagesse stoïcienne ou de spiritualité religieuse, de tendresse féminine ou de réussite littéraire, qui paraissent s'éloigner au fur et à mesure, parfois au moment même où il avait pourtant l'air de s'en rapprocher enfin quelque peu.
C'est ainsi que, en 1950, après avoir vu son oeuvre enfin couronnée de succès, et quelques semaines après que celle-ci a été reconnue officiellement aussi, par un «Strega», l'un des plus prestigieux prix littéraires italiens, cédant enfin à l'appel dont les échos sont perceptibles dès le début de ce journal, l'écrivain met fin à ses jours dans une chambre anonyme d'hôtel.
Selon une vieille superstition orientale, il ne faut jamais terminer complètement sa maison : la construction une fois achevée, dit le proverbe, bientôt sonne l'heure de mourir...
Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage alors, et tous vos péchés vous seront (peut-être) pardonnés..?
«Le péché n'est pas un acte ou un autre», répondrait Pavese, «mais toute une vie mal agencée».
Ministre et martyre de sa soif d'absolu, l'homme finit par se piéger lui-même. Prométhée livré en pâture à sa conscience hyper-vigilante et à son mal-être, s'alimentant de ses propres entrailles, mis à part quelques rares moments de transport amoureux se terminant invariablement en eau de boudin, il ne trouvera d'autre salut que dans le sacrifice progressif de sa vie privée sur l'autel d'une oeuvre, pour laquelle il travaillera avec acharnement. Une oeuvre aux canons esthétiques de plus en plus exigeants, parfois difficiles d'accès, en tout cas pour le commun des mortels, à l'image par exemple de ces notes qu'il développera à profusion autour de concepts tels les «lien-symboles », l'«image-récit», ou les «blocs-réalité», certaines à l'air tout de même assez alambiquées, d'autres où l'on pourra reconnaître des idées reprises par le mouvement encore balbutiant en 1950, du «nouveau-roman».
Le mariage entre ces deux dimensions disparates, une dimension prospective en vue de créer un corpus cohérent de notions liées à cette «forme unitaire» qu'il chérissait particulièrement et qu'il aimerait pouvoir donner à ses poèmes et à ses romans autant qu'à son métier même de vivre, à laquelle vient se rajouter une base chaotique de données intimes livrées sans aucune retenue, donne un résultat insoupçonné, littéralement renversant par la sincérité avec laquelle son auteur se glisse à tour de rôle dans la peau d'un père du désert, retiré du monde dans un paysage intérieur accidenté, parfois inhospitalier, mais cependant d'une lucidité stupéfiante, et dans celle d'un adolescent impulsif, exhibant ses fêlures derrière une semblant d'arrogance, défiant l'existence, marchant insouciant au bord d'un gouffre qui finirait par l'engloutir.
Lire le Métier de Vivre, c'est accompagner Pavese (et s'accompagner soi-même) dans un périple intérieur à haut risque au cours duquel, à ces contrées reculées où l'on s'acharne à régner en monarques absolus, «à qui tout serait dû », se succéderait la possibilité terrible d'un gouffre menaçant s'ouvrant sous ses pieds, enfer personnel déserté par les autres, vallée de souffrances et lieu d'immolation de sa propre subjectivité.
Est-ce qu'on pourrait en toute conscience recommander une telle lecture ? Est-ce qu'il faut tomber dessus par hasard, comme dans mon cas ? Était-ce d'ailleurs un hasard si je suis tombé dessus, moi qui, en tant que lecteur, fais plutôt partie de ceux qui idéalisent la littérature comme un mode d'accéder directement à une autre forme de connaissance du monde et de ces «mathématiques d'être» (sic) compliquées et irreproductibles de chacun de ses occupants provisoires, plutôt que comme un divertissement?
Prudence, donc! Je vous conseillerais au préalable, avant de décider si c'est une lecture ou pas pour vous, d'aller faire un tour parmi la quantité colossale de citations du Métier de Vivre postées sur le site ( plus de 350 !!). Cela reflète bien d'ailleurs, à mon avis, l'intérêt majeur de cet ouvrage : il y en a une quasiment à toutes les pages qui vaut la peine qu'on s'y arrête !
C'est pour l'instant le seul livre de cet auteur (mis à part quelques lectures ponctuelles de ses poèmes qui, soit dit au passage, ne m'avaient laissé aucun souvenir en particulier) que j'ai eu l'occasion de lire.
Et pourtant j'ai comme la conviction intime que, le cas échéant, aucun autre de ses ouvrages ne me correspondra autant, ne m'intriguera autant, ne me questionnera ni me touchera autant…
«1er janvier 1950
(…)
Promenade matinale. Beau soleil. Mais où sont les impressions de 45-46 ? Retrouvé à grand-peine les points de départ, mais rien de neuf.
Rome se tait. Ni les pierres ni les arbres ne disent plus grand-chose. Cet hiver extraordinaire sous le ciel serein piquant (…) même la douleur, le suicide étaient alors vie, étonnement, tension. Au fond, dans les grandes périodes, tu as toujours éprouvé la tentation du suicide. Tu étais abandonné. Tu avais dépouillé ton armure. Tu étais un gamin.
L'idée du suicide était une protestation de la vie. C'est la mort de ne plus vouloir mourir.»
….
Critique de Creisifiction
Il faut travailler, sinon par goût, du moins par désespoir»
(Baudelaire)
Tenu une quinzaine d'années, à partir de 1935, jusqu'en 1950, une semaine jour pour jour avant que son auteur ait décidé de se taire une fois pour toutes («Pas de paroles. Un geste. Je n'écrirai plus», note-t-il le 18 août 1950), la lecture du journal de Cesare Pavese ne ressemblerait pour moi à aucune autre dans le genre.
Sans aucun doute l'une des pièces maîtresses de l'oeuvre de l'Italien météorique. constamment relu et révisé par son auteur, doté par ses soins, année après année, de nombreux renvois entre les entrées qui le constituent, titré (magnifiquement !) comme s'il s'agissait d'un essai ou un d'un roman, Pavese semble avoir accordé à son journal intime la même importance et la même attention industrieuse qu'il avait vouées à son oeuvre de poète, d'essayiste et romancier, et avoir visiblement souhaité aussi qu'il soit lu par d'autres.
Un ouvrage inclassable, disais-je, en tant que journal. Pratiquement exempte, entre autres, de tous ces détails liés à la vie quotidienne, registres qui alourdissent souvent d'une dimension prosaïque et d'agenda les journaux personnels, par des tas d'«éphémérités» sans grand intérêt, à part pour l'auteur lui-même ou pour ses éventuels biographes.
En compensation, le lecteur pourra avoir le sentiment de voir peu à peu s'y installer un fil souterrain, une trame en quelque sorte, entre des instantanés égrenés au fil des jours qui passent - et qui se ressemblent, rajouterait certainement l'auteur («Ce qui arrive une fois arrive toujours»).
Quoique fragmentaires par définition, parfois trop elliptiques ou évanescents, voire trop abstraits et/ou difficiles à saisir dans leur complétion plus ou moins télégraphique ou, aux choix, dans leur incomplétude relative, ces «instantanés subjectifs» paraîtront cependant reposer sur un lit commun, et dégager une cohérence interne en lien plutôt avec la construction de la pensée, les impressions et les réactions à vif de l'auteur qu'avec, donc, des faits ou évènements concrets les ayant provoquées, et dont par ailleurs on n'apprendra pas grand-chose, ou bien le strict minimum.
Remarquablement agencés d'autre part par l'obsession de Pavese vis-à-vis de cette «unité formelle» qu'il cherchait à donner à ses écrits en général, à sa poésie autant qu'à sa prose, le tout finit par ressembler, non pas un journal à proprement parler, mais davantage à un long monologue intérieur, certes accidenté et discontinu, mais pourvu d'une dimension et d'une intensité narratives indéniables, ainsi que d'un vrai dénouement dramatique, découlant en toute logique – malheureusement ici, puisqu'il ne s'agit pas d'un personnage de fiction –de ce qui avait précédé.
Métier de vivre : naissance et mort d'une fiction personnelle qu'on compose par-devers soi mais dont le contrôle nous échappera forcément!
«Ces notes de journal ne comptent pas à cause de leur découverte explicite, mais à cause des aperçus qu'elles ouvrent sur la manière que j'ai inconsciemment d'être. Ce que je dis n'est pas vrai mais trahit -par le seul fait que je le dis- mon être.»
Constitué d'une part de considérations et de réflexions originales autour de la littérature, notamment autour du sens et de l'objectif qu'il veut accorder à son oeuvre de poète et de romancier, mais aussi sur l'art en général et les tentatives de représenter le réel par la pensée, par le langage et les symboles, ainsi que d'un florilège exceptionnel d'aphorismes et de méditations, morales et existentielles, la plupart du temps d'une profondeur et d'une justesse époustouflantes, issues en grande partie de l'auto-observation très affûtée auquel son auteur s'abandonnera volontiers, et… d'autre part, très paradoxalement, d'extraits, certains en vrac, absolument sans filtre, issus, dirait-on, des carnets intimes de quelqu'un de très immature sur le plan émotionnel et affectif (selon Natalia Ginzburg, amie proche de l'écrivain et coéditrice de la première édition de son journal, Pavese serait resté toute sa vie «un éternel adolescent»), s'exprimant souvent de manière choquante ou vulgaire, asocial, en mal de conquêtes féminines, s'épanchant sans retenue sur ses frustrations et sur son incapacité à satisfaire pleinement une femme (jusqu'à assumer un mépris teinté de misogynie vis-à-vis de celles qui, selon lui, se jouent à chaque fois de sa candeur en matière amoureuse) - dressant en filigrane, parallèlement à une dimension apollinienne à laquelle la pensée insisterait à s'accrocher, un inventaire sans concession de ses faiblesses et de ses contradictions, du découragement et du mal-être qui semblent coller à la peau d'un homme ne pouvant s'empêcher de se mesurer sans cesse à des idéaux que, soit il considèrera comme étant hors de sa portée, soit avec lesquels il peinera à vouloir négocier - le Métier de Vivre est une lecture fondamentalement contrastée, qui ne s'avèrera pas toujours commode, qui bousculera et instiguera la curiosité de ceux que s'y risqueront.
Balloté constamment entre des extrêmes, frôlant les grands sommets de la pensée et les bas fond de la psyché, le lecteur doit s'habituer aux exercices de grand-écart entre le sublime et l'indigne auquel Pavese se livre sans inhibitions, sans artifices, écarts à certains moments, il faut le dire, totalement incompréhensibles, en tout cas vus de l'extérieur (Mais, à y réfléchir, ne pourrait-on pas avancer que ce serait, peu ou prou, le cas de tout un chacun, chaque subjectivité comportant des contrastes entre ses zones d'ombre et de lumière, qu'on essaiera dans la mesure du possible, avec plus ou moins de succès selon les situations, de gommer face à autrui ?). Faudrait-il pour autant jeter le « pavese » dans la mare ? Rappeler aussi sa sympathie dans un premier temps pour le parti fasciste (mais il faudrait alors évoquer également sa peine de «confino», suite à une suspicion de trahison, ou encore son adhésion postérieure au parti communiste italien...)
Pour l'avoir lu, je ne pense pas. Trop simpliste, à mon avis.
« Il faut se détacher de tout pour se rapprocher de tout. Jouir de chaque chose de manière profane mais avec un détachement sacré. Avec un coeur pur.»
Le métier de vivre pour Cesare Pavese devrait cependant s'exercer dans une tension trop élevée, trop continue, et trop dangereuse entre des contraires.
Indépendamment de l'attrait manifeste pour l'autodestruction qu'on peut y déceler, et contre lequel Pavese semble malgré tout s'être courageusement battu durant une grande partie de sa courte existence - ainsi que l'attesterait également ce «journal»-, le Métier de Vivre reste l'un des témoignages les plus poignants qu'il m'ait jamais été donné de lire à propos de ces paradoxes inextricables, en même temps universels et consubstantiels à ce qu'on appelle notre solitude ontologique, à savoir, de cette volupté, et en même temps lassitude que l'on éprouve à certains moments à être soi et à n'être que soi, à rechercher invariablement soi-même dans le regard des autres et dans les nouvelles expériences de la vie, tout en désirant à la fois être comme ces autres à qui l'on attribue alors ce qui nous manque, ou enfin à s'appliquer à faire coïncider une irréductible liberté à être soi, avec la force ferme de sens d'un destin particulier qui nous aurait été attribué (ou comme dirait Pavese à ce propos, l'illusion, même lorsqu'il s'agira d'un malheur, que ce dernier «ne t'est pas arrivé par hasard mais parce que, in alio loco, on t'en veut, ce qui pourrait vouloir dire que, in alio loco, tu comptes»).
«L'art de ne pas se laisser décourager par les réactions d'autrui (…) L'art de nous mentir à nous-mêmes en sachant que nous mentons. L'art de regarder les gens en face, nous-mêmes compris, comme si c'étaient les personnages d'une de nos nouvelles. L'art de se rappeler toujours que, nous-mêmes ne comptant pour rien et aucun des autres ne comptant pour rien, nous comptons plus que chacun, simplement parce que nous sommes nous-mêmes (…) L'art de toucher de façon foudroyante le fond de la douleur, pour remonter d'un coup de talon. L'art de nous substituer à chacun et de savoir en conséquence que chacun s'intéresse seulement à soi. L'art d'attribuer n'importe lequel de nos gestes à un autre, pour nous faire voir à l'instant s'il est sensé.
L'art de se passer de l'art.
L'art d'être seul.»
Une ambition aux substrats à la base féconds, prometteurs, terroir de semailles multiples et fructueuses, mais qui inaugurera aussi de longues périodes de sécheresse vitale pour l'auteur. Et si les ténèbres ne réussiront jamais à infiltrer complètement le paysage, les éclairs lumineux de la pensée seront en revanche guidés par une flamme impossible à contempler longtemps, au risque d'en être aveuglé.
«Avoir un goût libidineux pour l'abattement, pour l'abandon, pour l'énervante douceur, et une volonté impitoyable de réagir, mâchoire serrée, exclusive et tyrannique, est une promesse d'éternelle et féconde vie intérieure.»
Pavese voudrait incarner une sorte d'Hamlet moderne, déchiré comme son modèle entre un désir d'être et de ne pas être, d'être aimé, reconnu en tant qu'homme par une femme, en tant qu'intellectuel et écrivain de génie par ses pairs, et celui de cesser de jouer la comédie vis-à-vis des autres et de soi-même afin d'y arriver, ambitionnant par-dessus tout de faire cavalier solitaire et d'approcher, peut-être comme aucun autre de ses contemporains, le «coeur sauvage des choses» (sic).
L'on assistera toutefois au long de ces pages à une course éperdue (et perdue d'avance en quelque sorte) : celle d'un homme dans un état perpétuel et fiévreux de quête de sens, sens à donner à son apprentissage de la vie et à la souffrance morale qui en découle pour lui (un mot qui revient très souvent dans ces notes), autant qu'à son métier de poète et d'écrivain.
Pavese donne l'impression de courir après des projections fragiles et inconstantes, insuffisantes en tout cas à juguler ou à apaiser durablement ses pulsions d'autodestruction : projections de se laisser vivre simplement, de sagesse stoïcienne ou de spiritualité religieuse, de tendresse féminine ou de réussite littéraire, qui paraissent s'éloigner au fur et à mesure, parfois au moment même où il avait pourtant l'air de s'en rapprocher enfin quelque peu.
C'est ainsi que, en 1950, après avoir vu son oeuvre enfin couronnée de succès, et quelques semaines après que celle-ci a été reconnue officiellement aussi, par un «Strega», l'un des plus prestigieux prix littéraires italiens, cédant enfin à l'appel dont les échos sont perceptibles dès le début de ce journal, l'écrivain met fin à ses jours dans une chambre anonyme d'hôtel.
Selon une vieille superstition orientale, il ne faut jamais terminer complètement sa maison : la construction une fois achevée, dit le proverbe, bientôt sonne l'heure de mourir...
Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage alors, et tous vos péchés vous seront (peut-être) pardonnés..?
«Le péché n'est pas un acte ou un autre», répondrait Pavese, «mais toute une vie mal agencée».
Ministre et martyre de sa soif d'absolu, l'homme finit par se piéger lui-même. Prométhée livré en pâture à sa conscience hyper-vigilante et à son mal-être, s'alimentant de ses propres entrailles, mis à part quelques rares moments de transport amoureux se terminant invariablement en eau de boudin, il ne trouvera d'autre salut que dans le sacrifice progressif de sa vie privée sur l'autel d'une oeuvre, pour laquelle il travaillera avec acharnement. Une oeuvre aux canons esthétiques de plus en plus exigeants, parfois difficiles d'accès, en tout cas pour le commun des mortels, à l'image par exemple de ces notes qu'il développera à profusion autour de concepts tels les «lien-symboles », l'«image-récit», ou les «blocs-réalité», certaines à l'air tout de même assez alambiquées, d'autres où l'on pourra reconnaître des idées reprises par le mouvement encore balbutiant en 1950, du «nouveau-roman».
Le mariage entre ces deux dimensions disparates, une dimension prospective en vue de créer un corpus cohérent de notions liées à cette «forme unitaire» qu'il chérissait particulièrement et qu'il aimerait pouvoir donner à ses poèmes et à ses romans autant qu'à son métier même de vivre, à laquelle vient se rajouter une base chaotique de données intimes livrées sans aucune retenue, donne un résultat insoupçonné, littéralement renversant par la sincérité avec laquelle son auteur se glisse à tour de rôle dans la peau d'un père du désert, retiré du monde dans un paysage intérieur accidenté, parfois inhospitalier, mais cependant d'une lucidité stupéfiante, et dans celle d'un adolescent impulsif, exhibant ses fêlures derrière une semblant d'arrogance, défiant l'existence, marchant insouciant au bord d'un gouffre qui finirait par l'engloutir.
Lire le Métier de Vivre, c'est accompagner Pavese (et s'accompagner soi-même) dans un périple intérieur à haut risque au cours duquel, à ces contrées reculées où l'on s'acharne à régner en monarques absolus, «à qui tout serait dû », se succéderait la possibilité terrible d'un gouffre menaçant s'ouvrant sous ses pieds, enfer personnel déserté par les autres, vallée de souffrances et lieu d'immolation de sa propre subjectivité.
Est-ce qu'on pourrait en toute conscience recommander une telle lecture ? Est-ce qu'il faut tomber dessus par hasard, comme dans mon cas ? Était-ce d'ailleurs un hasard si je suis tombé dessus, moi qui, en tant que lecteur, fais plutôt partie de ceux qui idéalisent la littérature comme un mode d'accéder directement à une autre forme de connaissance du monde et de ces «mathématiques d'être» (sic) compliquées et irreproductibles de chacun de ses occupants provisoires, plutôt que comme un divertissement?
Prudence, donc! Je vous conseillerais au préalable, avant de décider si c'est une lecture ou pas pour vous, d'aller faire un tour parmi la quantité colossale de citations du Métier de Vivre postées sur le site ( plus de 350 !!). Cela reflète bien d'ailleurs, à mon avis, l'intérêt majeur de cet ouvrage : il y en a une quasiment à toutes les pages qui vaut la peine qu'on s'y arrête !
C'est pour l'instant le seul livre de cet auteur (mis à part quelques lectures ponctuelles de ses poèmes qui, soit dit au passage, ne m'avaient laissé aucun souvenir en particulier) que j'ai eu l'occasion de lire.
Et pourtant j'ai comme la conviction intime que, le cas échéant, aucun autre de ses ouvrages ne me correspondra autant, ne m'intriguera autant, ne me questionnera ni me touchera autant…
«1er janvier 1950
(…)
Promenade matinale. Beau soleil. Mais où sont les impressions de 45-46 ? Retrouvé à grand-peine les points de départ, mais rien de neuf.
Rome se tait. Ni les pierres ni les arbres ne disent plus grand-chose. Cet hiver extraordinaire sous le ciel serein piquant (…) même la douleur, le suicide étaient alors vie, étonnement, tension. Au fond, dans les grandes périodes, tu as toujours éprouvé la tentation du suicide. Tu étais abandonné. Tu avais dépouillé ton armure. Tu étais un gamin.
L'idée du suicide était une protestation de la vie. C'est la mort de ne plus vouloir mourir.»
….