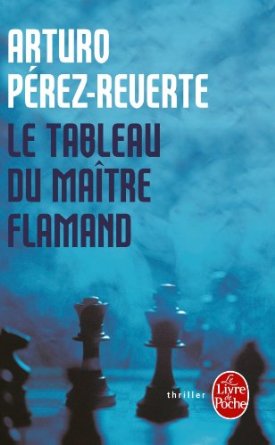>
Critique de Michael_Millasseau
J'ai lu, il y a quelque temps, « Le Tableau du Maître Flamand » d'Arturo Pérez-Reverte. Ce livre m'a particulièrement marqué pour plusieurs raisons. L'auteur a su associer avec brio les énigmes mystérieuses du moyen-âge, le monde des échecs et l'art à une intrigue policière moderne. Tous les éléments étaient réunis pour happer mon esprit jusqu'à ce que mes yeux touchent le point final. Appréhendant très mal l'espagnol, je n'ai lu que la traduction française. le style est simple, sans fioriture et respecte parfaitement les codes du genre. Inutile d'en dire plus sur ce point, il ne s'agit pas du travail de l'auteur.
Selon le niveau critique du lecteur, on peut aussi trouver quelques imperfections (c'est un avis strictement personnel), quelques passages lors desquels je me suis dit « j'aurai plutôt raconté ça comme si… » ou « ça aurait été sympa si… ». Mais à quoi bon vous les énumérer ? Je ne les ai pas trouvés si nombreux et de toute façon, je les ai vite oubliés pour ne retenir que l'essentiel : ce qui m'a fait vibrer en lisant ce livre. Et entre nous, je risquerai de gâcher votre plaisir si je commençais à décortiquer le scénario.
Julia est restauratrice de tableaux et travaille sur une oeuvre moyenâgeuse représentant un duc et un chevalier jouant aux échecs en présence de la duchesse assise en retrait. Julia découvre une inscription latine qui se traduit par « Qui a tué le chevalier ? ». Les chroniques de l'époque révèlent effectivement que le chevalier avait été assassiné, mais l'Histoire avec un grand H avait gardé le secret du meurtrier.
Or cette inscription latine peut aussi se traduire par « Qui a pris le cavalier ? ». La réponse à cette question se cache peut-être dans la partie qui se joue entre les deux hommes peints sur le tableau. Julia se persuade qu'en retrouvant la pièce qui a pris le cavalier, elle saura qui a tué le chevalier. Mais alors que cette énigme vieille de plus de 500 ans refait surface, un meurtre violent est commis dans l'entourage de la jeune femme. Dès lors, Arturo Pérez-Reverte plonge le lecteur au coeur de deux intrigues distinctes, mais liées dont les protagonistes sont assimilés aux pièces d'un échiquier. Une main menaçante manipule ces pièces tant dans le passé que dans le présent, avec une étrange symétrie, comme vue au travers d'un miroir.
Les personnages principaux sont au nombre de trois, comme dans le tableau. Julia est une jeune femme indépendante qui se montre forte et qui, pourtant, dévoile beaucoup de tendresse, surtout pour son ami Cesar. Elle est passionnée par l'art et depuis toute petite, par les chasses au trésor. Cesar l'a pratiquement élevée. Celui-ci la considère comme sa propre fille et a tendance à la surprotéger, toujours à l'affût des relations douteuses qui pullulent comme des mouches autour de Julia. Cesar s'affiche avec des airs d'aristocrate vieillissant dans le monde de l'art. Propriétaire d'une galerie, très cultivé et méticuleux, il a un regard assez sombre sur la vie en général, mais surtout sur l'entourage de sa protégée. Ce qui m'a attiré chez lui était son flegme pimenté d'un délicieux cynisme. On s'y attache facilement surtout quand on le voit au travers du regard de Julia.
Enfin, nous avons Muñoz ; le joueur d'échecs par excellence. Je n'ai jamais croisé qu'un seul grand amateur d'échec et il ne ressemblait en rien à Muñoz. Mais déjà, ce personnage un peu geek m'avait semblé un brin caricatural. Pour autant, j'ai beaucoup aimé cet antihéros qui vit dans son propre monde et se vêtit de chemises aux manches élimées. À travers lui, c'est tout un univers que l'on découvre ; les petites manies des joueurs, leur comportement devant un échiquier et un adversaire. Aussi, à la différence de ce que j'ai lu dans un autre livre ou vu dans des films, ce personnage est dénué de toute arrogance. Il est simple, mais terriblement efficace.
« La Partie d'Échecs ». Tel est le nom du tableau sur lequel travaille Julia. Cette partie est au coeur de l'intrigue. Dans le tableau, elle est figée quelques coups après que le cavalier ait été pris. Dans le roman, elle sera jouée à rebours. Même si cette pratique semble évidente pour les connaisseurs (je l'ai appris plus tard), je l'ai découverte grâce au livre. Quelle ingéniosité ! L'histoire ne dit pas si l'auteur est lui-même un joueur invétéré, mais pour moi, intégrer une telle pratique dans une intrigue policière tient du génie. J'étais tellement subjugué par cette technique que je me suis surpris à essayer moi-même, à l'instar de Muñoz, de retrouver le coup précédent (j'avoue n'y être parvenu qu'une seule fois). Alors oui, si on a quelques notions et qu'on se prend au jeu, on coupe la lecture. Et comme pour les romans d'Agatha Christie, j'ai posé mon livre à plusieurs reprises pour prendre le temps d'émettre des hypothèses et jouer moi-même cette partie fictive.
Mais Pérez-Reverte va plus loin encore. Au-delà de jouer cette partie à rebours l'auteur se paye aussi le luxe de la jouer à l'endroit dans le livre. Et rebelote, je reposais mon livre ! Les pièces n'ont pas été posées là au petit bonheur la chance. Cette partie d'échecs supporte les deux intrigues tel le squelette du scénario établi par l'auteur. Qu'il ait lui-même déterminé chaque coup ou qu'un joueur aussi malin que Muñoz le lui ait soufflé à l'oreille, je ne peux que m'incliner devant un tel travail d'adaptation. Chaque pièce symbolise un personnage bien défini du roman. Chaque mouvement correspond à une action précise. Je sais, je me répète, mais franchement… quel génie !
Surtout, que les lecteurs se rassurent. « Le Tableau de Maître Flamand » est écrit pour tout le monde. Même si vous n'y connaissez rien aux échecs, je suis certain que vous vous prendrez au jeu sans aucune difficulté.
Ce tableau est l'oeuvre d'un artiste complètement fictif au même titre que le sont le duc Fernand Altenhoffen, la duchesse Béatrice de Bourgogne et le Chevalier d'Arras. Pérez-Reverte donne à l'artiste le nom de van Huys. Et ce maître Flamand travaille donc au service de son mécène, Fernand, duc d'Ostenbourg.
Il se trouve qu'après avoir lu « Le Tableau du Maître Flamand », je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir en tirer un scénario. de l'aveu de l'auteur, un film avait « malheureusement » (sic) déjà été réalisé. Mais à l'époque, je n'en avais aucune idée. Mon idée était d'ancrer cette histoire dans la véritable Histoire. Telle ne fut pas ma surprise de découvrir que le peintre, le duc et la duchesse avaient leur alter ego dans la vraie vie. Pérez-Reverte s'est complètement inspiré du maître van Eyck qui était au service du duc Philipe le Bon, lui-même grand mécène, et la duchesse Isabelle de Portugal. Je n'en ai aucune certitude, bien sûr, mais la ressemblance dans le parcours de ces personnages-là et ces personnes-ci est assez frappante. À noter que Philippe le Bon fut l'un des principaux acteurs dans la réconciliation entre la Bourgogne et la France lors du traité d'Arras en 1435… Arras, comme le chevalier dans le livre. En revanche, nulle trace de ce chevalier assassiné dans l'entourage de Philippe le Bon ; celui-là serait donc une pure invention. Ici encore, les amateurs d'Histoire ne pourront que se satisfaire du travail de recherche et d'adaptation de Pérez-Reverte. Pour ma part, j'avais le sentiment d'avoir remonté le temps.
Tant sur les échecs que dans l'implantation historique, l'auteur a énormément travaillé sur la crédibilité pour envoûter ses lecteurs. C'est précis, intelligent et fascinant. On y croit. J'étais plongé au coeur de cette enquête policière complètement innovante, j'étais pris de passion pour cette partie diabolique et j'étais témoin de la vie ces personnages du XVe siècle. Un bon moment de lecture.
Selon le niveau critique du lecteur, on peut aussi trouver quelques imperfections (c'est un avis strictement personnel), quelques passages lors desquels je me suis dit « j'aurai plutôt raconté ça comme si… » ou « ça aurait été sympa si… ». Mais à quoi bon vous les énumérer ? Je ne les ai pas trouvés si nombreux et de toute façon, je les ai vite oubliés pour ne retenir que l'essentiel : ce qui m'a fait vibrer en lisant ce livre. Et entre nous, je risquerai de gâcher votre plaisir si je commençais à décortiquer le scénario.
Julia est restauratrice de tableaux et travaille sur une oeuvre moyenâgeuse représentant un duc et un chevalier jouant aux échecs en présence de la duchesse assise en retrait. Julia découvre une inscription latine qui se traduit par « Qui a tué le chevalier ? ». Les chroniques de l'époque révèlent effectivement que le chevalier avait été assassiné, mais l'Histoire avec un grand H avait gardé le secret du meurtrier.
Or cette inscription latine peut aussi se traduire par « Qui a pris le cavalier ? ». La réponse à cette question se cache peut-être dans la partie qui se joue entre les deux hommes peints sur le tableau. Julia se persuade qu'en retrouvant la pièce qui a pris le cavalier, elle saura qui a tué le chevalier. Mais alors que cette énigme vieille de plus de 500 ans refait surface, un meurtre violent est commis dans l'entourage de la jeune femme. Dès lors, Arturo Pérez-Reverte plonge le lecteur au coeur de deux intrigues distinctes, mais liées dont les protagonistes sont assimilés aux pièces d'un échiquier. Une main menaçante manipule ces pièces tant dans le passé que dans le présent, avec une étrange symétrie, comme vue au travers d'un miroir.
Les personnages principaux sont au nombre de trois, comme dans le tableau. Julia est une jeune femme indépendante qui se montre forte et qui, pourtant, dévoile beaucoup de tendresse, surtout pour son ami Cesar. Elle est passionnée par l'art et depuis toute petite, par les chasses au trésor. Cesar l'a pratiquement élevée. Celui-ci la considère comme sa propre fille et a tendance à la surprotéger, toujours à l'affût des relations douteuses qui pullulent comme des mouches autour de Julia. Cesar s'affiche avec des airs d'aristocrate vieillissant dans le monde de l'art. Propriétaire d'une galerie, très cultivé et méticuleux, il a un regard assez sombre sur la vie en général, mais surtout sur l'entourage de sa protégée. Ce qui m'a attiré chez lui était son flegme pimenté d'un délicieux cynisme. On s'y attache facilement surtout quand on le voit au travers du regard de Julia.
Enfin, nous avons Muñoz ; le joueur d'échecs par excellence. Je n'ai jamais croisé qu'un seul grand amateur d'échec et il ne ressemblait en rien à Muñoz. Mais déjà, ce personnage un peu geek m'avait semblé un brin caricatural. Pour autant, j'ai beaucoup aimé cet antihéros qui vit dans son propre monde et se vêtit de chemises aux manches élimées. À travers lui, c'est tout un univers que l'on découvre ; les petites manies des joueurs, leur comportement devant un échiquier et un adversaire. Aussi, à la différence de ce que j'ai lu dans un autre livre ou vu dans des films, ce personnage est dénué de toute arrogance. Il est simple, mais terriblement efficace.
« La Partie d'Échecs ». Tel est le nom du tableau sur lequel travaille Julia. Cette partie est au coeur de l'intrigue. Dans le tableau, elle est figée quelques coups après que le cavalier ait été pris. Dans le roman, elle sera jouée à rebours. Même si cette pratique semble évidente pour les connaisseurs (je l'ai appris plus tard), je l'ai découverte grâce au livre. Quelle ingéniosité ! L'histoire ne dit pas si l'auteur est lui-même un joueur invétéré, mais pour moi, intégrer une telle pratique dans une intrigue policière tient du génie. J'étais tellement subjugué par cette technique que je me suis surpris à essayer moi-même, à l'instar de Muñoz, de retrouver le coup précédent (j'avoue n'y être parvenu qu'une seule fois). Alors oui, si on a quelques notions et qu'on se prend au jeu, on coupe la lecture. Et comme pour les romans d'Agatha Christie, j'ai posé mon livre à plusieurs reprises pour prendre le temps d'émettre des hypothèses et jouer moi-même cette partie fictive.
Mais Pérez-Reverte va plus loin encore. Au-delà de jouer cette partie à rebours l'auteur se paye aussi le luxe de la jouer à l'endroit dans le livre. Et rebelote, je reposais mon livre ! Les pièces n'ont pas été posées là au petit bonheur la chance. Cette partie d'échecs supporte les deux intrigues tel le squelette du scénario établi par l'auteur. Qu'il ait lui-même déterminé chaque coup ou qu'un joueur aussi malin que Muñoz le lui ait soufflé à l'oreille, je ne peux que m'incliner devant un tel travail d'adaptation. Chaque pièce symbolise un personnage bien défini du roman. Chaque mouvement correspond à une action précise. Je sais, je me répète, mais franchement… quel génie !
Surtout, que les lecteurs se rassurent. « Le Tableau de Maître Flamand » est écrit pour tout le monde. Même si vous n'y connaissez rien aux échecs, je suis certain que vous vous prendrez au jeu sans aucune difficulté.
Ce tableau est l'oeuvre d'un artiste complètement fictif au même titre que le sont le duc Fernand Altenhoffen, la duchesse Béatrice de Bourgogne et le Chevalier d'Arras. Pérez-Reverte donne à l'artiste le nom de van Huys. Et ce maître Flamand travaille donc au service de son mécène, Fernand, duc d'Ostenbourg.
Il se trouve qu'après avoir lu « Le Tableau du Maître Flamand », je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir en tirer un scénario. de l'aveu de l'auteur, un film avait « malheureusement » (sic) déjà été réalisé. Mais à l'époque, je n'en avais aucune idée. Mon idée était d'ancrer cette histoire dans la véritable Histoire. Telle ne fut pas ma surprise de découvrir que le peintre, le duc et la duchesse avaient leur alter ego dans la vraie vie. Pérez-Reverte s'est complètement inspiré du maître van Eyck qui était au service du duc Philipe le Bon, lui-même grand mécène, et la duchesse Isabelle de Portugal. Je n'en ai aucune certitude, bien sûr, mais la ressemblance dans le parcours de ces personnages-là et ces personnes-ci est assez frappante. À noter que Philippe le Bon fut l'un des principaux acteurs dans la réconciliation entre la Bourgogne et la France lors du traité d'Arras en 1435… Arras, comme le chevalier dans le livre. En revanche, nulle trace de ce chevalier assassiné dans l'entourage de Philippe le Bon ; celui-là serait donc une pure invention. Ici encore, les amateurs d'Histoire ne pourront que se satisfaire du travail de recherche et d'adaptation de Pérez-Reverte. Pour ma part, j'avais le sentiment d'avoir remonté le temps.
Tant sur les échecs que dans l'implantation historique, l'auteur a énormément travaillé sur la crédibilité pour envoûter ses lecteurs. C'est précis, intelligent et fascinant. On y croit. J'étais plongé au coeur de cette enquête policière complètement innovante, j'étais pris de passion pour cette partie diabolique et j'étais témoin de la vie ces personnages du XVe siècle. Un bon moment de lecture.